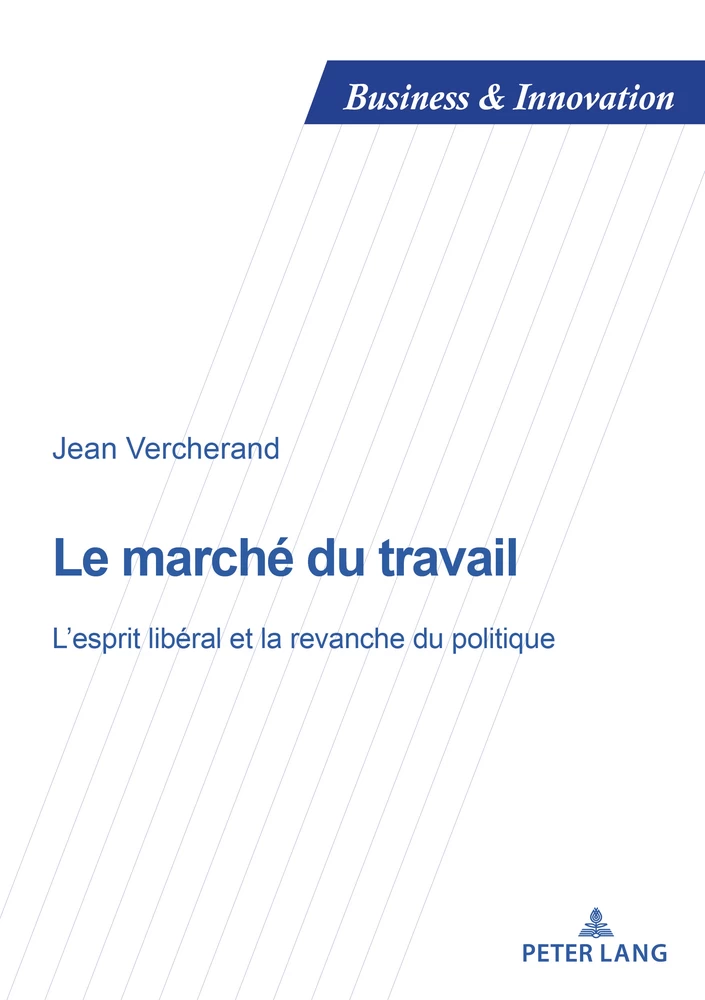Le marché du travail
L’esprit libéral et la revanche du politique
Résumé
L’ambition de cet ouvrage est de fournir une explication à cette inversion de tendance et à l’incapacité des décideurs politiques d’enrayer cette dégradation de la situation. Sur la base d’un examen attentif et comparatif de l’histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles, l’auteur montre que cette incapacité vient du fait que le corpus théorique dominant, sur lequel s’appuient la grande majorité des économistes, des commentateurs de l’économie et des décideurs politiques, souffre de deux lacunes majeures. L’une les empêche de comprendre comment fonctionne réellement le marché du travail ; l’autre ne leur permet pas de saisir pleinement ce qui détermine la croissance économique à long terme et quelles conséquences il en résulte pour l’emploi.
Cet ouvrage s’adresse, non seulement à tous les étudiants, chercheurs et enseignants en économie (universités, écoles d’ingénieurs et de commerce, IEP, etc.), mais aussi à toute personne soucieuse de comprendre les problèmes économiques et sociaux d’aujourd’hui (chômage de masse, inégalités, précarité, déclassements, crises, etc.).
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Avant-propos
- Introduction générale
- Deux hypothèses centrales
- 1. L’offre de travail des salariés n’est pas autonome vis-à-vis de la demande mais subordonnée peu ou prou à celle-ci
- 2. Le progrès technique exerce sur la dynamique économique deux impacts fondamentalement différents
- Plan de l’ouvrage
- Chapitre I. La « question sociale » depuis le XIXe siècle
- Introduction
- 1. Une asymétrie manifeste de rapport de force
- 1.1. Une asymétrie déjà reconnue par Adam Smith
- 1.2. Une manifestation contemporaine d’asymétrie : stress et harcèlement au travail
- 1.3. Une asymétrie que législateurs et juristes ont dû reconnaître
- 2. La récurrence des crises économiques sous l’ère industrielle
- 2.1. Les crises de courte durée (ou de courte période)
- 2.2. Les fluctuations de longue durée (de longue période)
- 3. La durée du travail et les salaires en longue période
- 3.1. L’allongement de la durée du travail au début de la révolution industrielle
- 3.2. Le partage irrégulier des gains de productivité entre revenu et loisir
- 4. Les revendications ouvrières
- 4.1. Un thème dominant : augmenter les salaires
- 4.2. La « place particulière » de la réduction du temps de travail
- 4.3. Les objectifs visés par la réduction de la durée du travail
- 4.4. L’opposition du patronat
- 4.5. Les critiques des économistes à l’égard du raisonnement du Mouvement ouvrier
- 4.6. Une volonté de transformation de la société
- 5. L’intervention publique sur le marché du travail82
- 5.1. Les prémices d’un droit spécifique du travail (avant 1914)
- 5.2. De l’État « simple arbitre » à l’État « chef d’orchestre »91 (après 1914)
- 5.3. La réglementation de la durée du travail aujourd’hui en France
- Conclusion : des raisonnements erronés et sophistiques ?
- Chapitre II. La représentation néoclassique du marché du travail
- Introduction
- 1. La théorie de l’offre de travail
- 1.1. L’hypothèse d’optimisation des choix
- 1.2. La courbe d’offre individuelle de travail
- 1.3. L’interprétation de l’évolution historique de la durée du travail
- 1.4. L’offre globale de travail sur le marché
- 2. La théorie de la demande de travail
- 2.1. La demande de travail par une entreprise concurrentielle
- 2.2. La demande globale de travail sur le marché
- 3. L’équilibre du marché du travail, ses modifications et les distorsions
- 4. Le relâchement des hypothèses du modèle néoclassique de base
- 4.1. Les différentes hypothèses relâchées
- 4.2. Les modèles de négociations salariales
- Conclusion : des représentations du marché du travail peu convaincantes
- Chapitre III. l’asymétrie de rapport de force employeur/employé
- Introduction
- 1. Conséquences de cette asymétrie de rapport de force sur l’offre de travail
- 1.1. L’offre de force de travail en situation de dépendance
- 1.2. L’offre individuelle de travail quand l’employeur décide de faire varier sa durée
- 1.3. L’offre globale de travail salarié en situation de dépendance
- 1.4. Comparaison avec d’autres marchés caractérisés par des asymétries de rapport de force
- 2. Approfondissement de la demande de travail
- 2.1. La demande de travail à long terme par une entreprise
- 2.2. La demande de force de travail par une entreprise
- 2.3. La demande de travail à long terme sur le marché
- 3. Équilibre et déséquilibre du marché du travail en situation d’asymétrie de rapport de force
- 3.1. La maximisation du profit par allongement de la durée du travail
- 3.2. La maximisation du profit par non-répercussion des gains de productivité sur le taux de salaire
- 3.3. Les crises de surproduction/sous-consommation (ou de surinvestissement)
- 4. La « rigidité » du taux de salaire réel
- Conclusion : une histoire sociale devenant intelligible sur courte période
- Chapitre IV. Le double impact du progrès technique
- Introduction
- 1. La contradiction apparente entre les fonctions de consommation de court et de long termes
- 1.1. L’hypothèse keynésienne de concavité de la fonction de consommation de court terme
- 1.2. La linéarité de la fonction de consommation de long terme
- 1.3. Les fausses réponses à cette contradiction
- 2. Le rôle spécifique des innovations dans les biens de consommation
- 2.1. L’effet de ces innovations sur la fonction d’utilité de la consommation
- 2.2. L’effet de ces innovations sur l’arbitrage consommation/épargne
- 2.3. Autres déterminants des comportements de consommation
- 3. Les effets relatifs du progrès technique sur la croissance et sur l’emploi des facteurs
- 3.1. Interaction entre les comportements de production et ceux de consommation
- 3.2. Les implications sur la théorie de la croissance
- 3.3. Les implications particulières pour le travail
- 4. L’irrégularité de la croissance
- 4.1. Les cycles de Juglar
- 4.2. Les fluctuations de Kondratieff
- 5. Confrontation avec les faits
- 5.1. Les débuts de la révolution industrielle
- 5.2. Les « Trente glorieuses » et leur retournement
- 5.3. La leçon des faits
- Conclusion : une histoire sociale devenant intelligible sur longue période
- Chapitre V. Implications normatives sur les politiques du travail
- Introduction
- 1. La lutte contre le chômage
- 1.1. Le chômage de courte période
- 1.2. Le chômage de longue période
- 1.3. Quid de la valeur « travail » ?
- 2. Les effets des politiques « libérales » face au chômage de longue période
- 2.1. Le travail est un facteur homogène : le retour des crises cycliques de courte (ou moyenne) période
- 2.2. Le travail est un facteur hétérogène : l’aggravation des inégalités sociales
- 3. Les pseudo-explications du chômage de masse
- 3.1. Un coût du travail trop élevé ? Notamment du SMIC ?
- 3.2. Un droit du travail trop contraignant ?
- 3.3. Des prélèvements obligatoires trop élevés ?
- 3.4. La mondialisation ?
- 3.5. L’incertitude ?
- 3.6. Trop d’immigrés ?
- Conclusion : partager équitablement la valeur ajoutée et la demande de travail
- Chapitre VI. Une synthèse théorique est-elle possible ?
- 1. Le courant néoclassique : la faille principale
- 2. Le courant keynésien : une critique inachevée
- 3. Le courant marxien : un isolement dommageable
- 4. Le courant schumpétérien : une reconnaissance tardive
- Conclusion générale
- Du même auteur
- Bibliographie
- Index
- Tires de la collection
Jean Vercherand
Le marché du travail
L’esprit libéral et
la revanche du politique
Business & Innovation
Vol. 18
Cette publication a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. Peter Lang s.a.
éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2018
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com; brussels@peterlang.com
ISSN 2034-5402
ISBN 978-2-8076-0654-8
ePDF 978-2-8076-0655-5
ePUB 978-2-8076-0656-2
MOBI 978-2-8076-0657-9
DOI 10.3726/b13101
D/2018/5678/13
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Bibliothek »
« Die Deutsche Bibliothek » répertorie cette publication dans la « Deutsche National-bibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site <http://dnb.ddb.de>.
À propos de l’auteur
Jean VERCHERAND est ingénieur agronome, économiste et historien à l’INRA, CESAER, AgroSup, Université Bourgogne Franche-Comté, Dijon.
À propos du livre
Voici plus de 40 ans qu’économistes et politiques s’échinent à faire reculer le chômage de masse, la précarité et les inégalités sociales. En vain. Dans tous les pays développés, la situation, examinée sous l’angle du chômage ou des inégalités, s’est dégradée par rapport à celle qui a prévalu durant les « Trente glorieuses ». Parallèlement, le taux de croissance économique n’a cessé de s’affaiblir en dépit d’un endettement public de plus en plus élevé.
L’ambition de cet ouvrage est de fournir une explication à cette inversion de tendance et à l’incapacité des décideurs politiques d’enrayer cette dégradation de la situation. Sur la base d’un examen attentif et comparatif de l’histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles, l’auteur montre que cette incapacité vient du fait que le corpus théorique dominant, sur lequel s’appuient la grande majorité des économistes, des commentateurs de l’économie et des décideurs politiques, souffre de deux lacunes majeures. L’une les empêche de comprendre comment fonctionne réellement le marché du travail ; l’autre ne leur permet pas de saisir pleinement ce qui détermine la croissance économique à long terme et quelles conséquences il en résulte pour l’emploi.
Cet ouvrage s’adresse, non seulement à tous les étudiants, chercheurs et enseignants en économie (universités, écoles d’ingénieurs et de commerce, IEP, etc.) mais aussi à toute personne soucieuse de comprendre les problèmes économiques et sociaux d’aujourd’hui (chômage de masse, inégalités, précarité, déclassements, crises, etc.).
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Table des matières
1. L’offre de travail des salariés n’est pas autonome vis-à-vis de la demande mais subordonnée peu ou prou à celle-ci
2. Le progrès technique exerce sur la dynamique économique deux impacts fondamentalement différents
Chapitre I. La « question sociale » depuis le XIXe siècle
1. Une asymétrie manifeste de rapport de force
1.1. Une asymétrie déjà reconnue par Adam Smith
1.2. Une manifestation contemporaine d’asymétrie : stress et harcèlement au travail
1.3. Une asymétrie que législateurs et juristes ont dû reconnaître
2. La récurrence des crises économiques sous l’ère industrielle
2.1. Les crises de courte durée (ou de courte période)
2.2. Les fluctuations de longue durée (de longue période)
3. La durée du travail et les salaires en longue période
3.1. L’allongement de la durée du travail au début de la révolution industrielle
3.2. Le partage irrégulier des gains de productivité entre revenu et loisir
4. Les revendications ouvrières
4.1. Un thème dominant : augmenter les salaires
4.2. La « place particulière » de la réduction du temps de travail
4.3. Les objectifs visés par la réduction de la durée du travail
4.4. L’opposition du patronat←9 | 10→
4.5. Les critiques des économistes à l’égard du raisonnement du Mouvement ouvrier
4.6. Une volonté de transformation de la société
5. L’intervention publique sur le marché du travail
5.1. Les prémices d’un droit spécifique du travail (avant 1914)
5.2. De l’État « simple arbitre » à l’État « chef d’orchestre » (après 1914)
5.3. La réglementation de la durée du travail aujourd’hui en France
Conclusion : des raisonnements erronés et sophistiques ?
Chapitre II. La représentation néoclassique du marché du travail
1. La théorie de l’offre de travail
1.1.1. L’hypothèse d’optimisation des choix
1.2. La courbe d’offre individuelle de travail
1.3. L’interprétation de l’évolution historique de la durée du travail
1.4. L’offre globale de travail sur le marché
2. La théorie de la demande de travail
2.1. La demande de travail par une entreprise concurrentielle
2.2. La demande globale de travail sur le marché
3. L’équilibre du marché du travail, ses modifications et les distorsions
4. Le relâchement des hypothèses du modèle néoclassique de base
4.1. Les différentes hypothèses relâchées
4.2. Les modèles de négociations salariales
Conclusion : des représentations du marché du travail peu convaincantes
Chapitre III. l’asymétrie de rapport de force employeur/employé
1. Conséquences de cette asymétrie de rapport de force sur l’offre de travail
1.1. L’offre de force de travail en situation de dépendance←10 | 11→
1.2. L’offre individuelle de travail quand l’employeur décide de faire varier sa durée
1.3. L’offre globale de travail salarié en situation de dépendance
1.4. Comparaison avec d’autres marchés caractérisés par des asymétries de rapport de force
2. Approfondissement de la demande de travail
2.1. La demande de travail à long terme par une entreprise
Résumé des informations
- Pages
- 282
- Année
- 2018
- ISBN (PDF)
- 9782807606555
- ISBN (ePUB)
- 9782807606562
- ISBN (MOBI)
- 9782807606579
- ISBN (Broché)
- 9782807606548
- DOI
- 10.3726/b13101
- Langue
- français
- Date de parution
- 2017 (Décembre)
- Mots clés
- travail emploi marché progrès innovation croissance chômage
- Published
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2018. 282 p., 28 fig. n/b, 2 fig. en couleurs, 2 tabl.