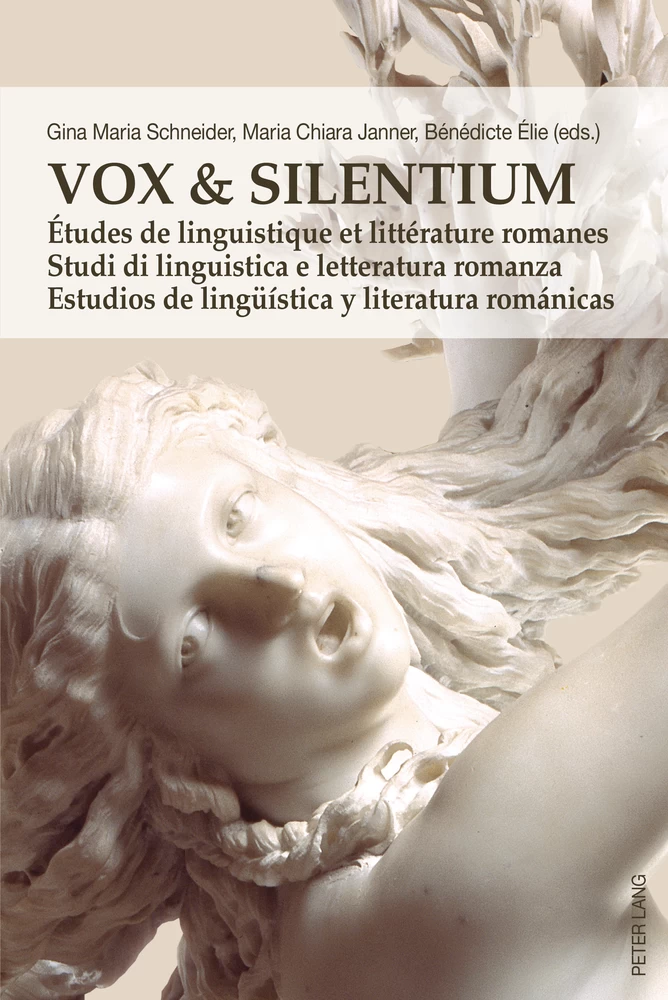Vox & Silentium
Études de linguistique et littérature romanes – Studi di linguistica e letteratura romanza – Estudios de lingüística y literatura románicas
Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- I Introduction
- II Contributions
- What does voice and silence tell us about speaker identity? An introduction to temporal speaker individualities and their use for forensic speaker comparison.
- Silenzio, «voce di bocca» e «voce di cuore» nella predicazione in volgare di Giordano da Pisa e Bernardino da Siena
- La Voix et le Silence : l’envers et l’endroit du Verbe fin-de-siècle
- Il rovesciamento del lessico religioso in Liana Millu
- La historia acallada y los «ruidos» en: Autobiografía del general Franco de Manuel Vázquez Montalbán
- «Lo que el silencio nombra»: mística y poesía en la obra de Hugo Mujica
- Pascal Quignard. Entre le refus du langage et l’impossibilité de se taire, le silence musical
- Entre ne rien dire et ne dire que des riens : les poétiques de Flaubert, Manzoni et Clarín
- Voz y silencio en la obra de Manuel Rivas: Todo es silencio (2010)
- Alternance codique dans les SMS écrits en Suisse italophone et romanchophone
- Vedre il silenzio. Forme grafico-interpuntive di rappresentazione della voce e delle sue pause
- Punteggiatura del silenzio in Fortezza di Giovanni Giudici
- Partituras silenciosas: pautas de lectura para textos pentagramados
- Le rôle des éléments nuls à l’intérieur de quelques syntagmes nominaux et leur effect sur léaccord sujet-verbe en français et en roumain
- Sintassi di gesto e parola: note sull’eloquio afasico
- Interazioni tra oralità e unità segniche: uno studio sulle labializzazioni nella Lingua dei Segni Italiana (LIS)
- III Résumés
- IV Collaborateurs
← 6 | 7 →I
Introduction← 7 | 8 →
← 8 | 9 →Le mythe ovidien d’Apollon et Daphné symbolise l’un des problèmes majeurs de la modernité, à savoir le dialogue entre voix (vox) et silence (silentium), annoncé dans le titre de ce volume. Approchée et effleurée par Apollon, la nymphe pousse un cri et se transforme en arbuste de laurier, privé de parole. La sculpture de Gian Lorenzo Bernini (1622-1625) interprète cette rencontre oxymorique entre la voix et le silence. Une femme sculptée dans le marbre ne devrait pas pouvoir crier ; or sa représentation, bouche ouverte, regard bouleversé, exprime un véritable cri pour qui la regarde. La matérialité inanimée de la sculpture empêche de percevoir le son et, dans le même temps, en exprime toute la force, tout en se transformant en écoute du silence.
La double valeur inhérente au laurier souligne ce paradoxe. D’un côté, il représente ici le silence de la nymphe Daphné après sa métamorphose. De l’autre, ce sont précisément les feuilles de cet arbre qui couronnent le dieu de la poésie. Pourrait-on conclure que la nymphe silencieuse poursuit sa vie dans la voix des poètes ?
***
Les notions de voix et de silence gagnent en complexité notamment lorsqu’on les met en relation, puisque le silence se révèle comme une entité qui ne peut pas se définir simplement comme l’absence de voix. En comparaison avec la voix, il prend une dimension particulière qu’on peut spécifier tant en linguistique qu’en littérature.
En linguistique, la signification du silence et de la voix est pertinente à tous les niveaux du système de la langue. La phonétique et la phonologie rendent compte de la description des sons langagiers et s’occupent d’identifier le locuteur à l’aide de sa voix. Au niveau morphosyntaxique, le silence peut être porteur de significations, par exemple par le concept de morphème nul ou d’ellipse. Il existe, en dernier lieu, des formes de communication non verbale ou de paralangage, complétant la langue parlée ou bien s’y suppléant totalement, comme c’est le cas aussi des différentes langues des signes.
Dans le domaine de la littérature, on peut étudier la pluralité des voix dans une œuvre littéraire (plurivocité et polyphonie), la dimension indicible du discours poétique ou bien la signification des pauses et des éléments graphiques dans la versification. La voix et le silence sont cependant aussi des éléments fondamentaux pour l’analyse littéraire, pouvant ← 9 | 10 →rendre compte de divers aspects du texte, que ce soit le silence ou la voix des protagonistes ou du narrateur. Non seulement lorsqu’ils sont envisagés dans une perspective thématique, la voix et le silence peuvent acquérir, par conséquent, diverses significations.
Les contributions de ce volume, présentées lors du VIIe Dies Romanicus Turicensis à l’Université de Zurich le 21 et 22 juin 2013, s’intéressent à ces différentes formes de voix ou silence tant en linguistique qu’en littérature. Né en 2003, ce congrès biennal se veut un échange fructueux entre les jeunes chercheurs dans le champ des langues et littératures romanes, et a pour but d’approfondir le débat transdisciplinaire sur un thème spécifique. Dans son édition de 2013, une vingtaine de jeunes chercheurs venant des différentes régions de Suisse, d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Espagne, du Canada et du Mexique y ont participé, ce qui prouve le caractère de plus en plus international du Dies Romanicus Turicensis.
***
Le volume commence par l’article de notre conférencier invité, Volker Dellwo, professeur assistant au Laboratoire de phonétique de l’Université de Zurich. Sa contribution, ayant pour titre « What does voice and silence tell us about speaker identity? », envisage les notions de voix et silence du point de vue de la phonétique judiciaire et confirme l’individualité des interlocuteurs à travers les caractéristiques temporelles du langage humain (tels les patrons prosodiques, les aspects rythmiques ou la durée de l’élocution).
Suivent une série de contributions qui ne s’intéressent pas tant à l’individu qu’aux différentes valeurs attribuées à la voix et au silence d’un point de vue littéraire ou culturel, et ce tout au long de l’histoire de la littérature du XIVe au XXe siècle. Francesca Galli (Università della Svizzera italiana) ouvre cette première section avec des considérations autour des discours de Giordano da Pisa et de Bernardino da Siena, deux des prédicateurs toscans les plus importants aux XIVe et XVe siècles. Partant de l’usage éthique de la parole, elle observe dans leurs sermons une valorisation particulière du silence, présente dès les débuts du christianisme, qui alterne avec un emploi raisonnable de la voix. Vient ensuite l’étude de Julien Marsot (Université de Montréal), centrée sur la poésie française de la fin du XIXe siècle, qui relie la dévaluation axiologique de la voix par la tradition judéo-chrétienne avec la volonté contraire de l’esthétique décadente de faire du poème une voix singulière entendue sur la scène du cabaret. À travers l’œuvre de Maurice ← 10 | 11 →Rollinat, Marsot analyse comment voix et silence constituent l’envers et l’endroit d’une même modernité fin-de-siècle. Les contributions de Destefani et de Riosalido, de leur côté, étudient la manière dont la littérature redonne une voix à l’histoire inexprimable du XXe siècle. En partant du livre Il fumo di Birkenau de Liana Millu, survivante du camp de concentration de Auschwitz-Birkenau, Sibilla Destefani (Universität Zürich) fait voir comment l’écrivaine arrive à surmonter, à travers le renversement du lexique biblique, le silence occasionné autour de la Shoah. Une thématique comparable est proposée par Patricia Riosalido Villar (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED) dans son étude centrée sur le livre Autobiografía del general Franco (1992) de Manuel Vázquez Montalbán. Elle nous montre dans quelle mesure, à travers un dialogue fictif entre le personnage de Franco et l’antifasciste Marcial Pombo, ce roman donne voix aux perdants de la guerre civile, exprimant ce qui autrefois n’a pas pu être exprimé. Enfin, la problématique de l’indicible au XXe siècle est reprise dans le travail de Mariana Moraes Medina (Universidad de Navarra), qui termine cette première partie avec une réflexion sur la valeur du silence dans le mysticisme du prêtre-écrivain argentin Hugo Mujica (1942). Le silence étant à l’origine de sa vocation de poète, le désir d’exprimer l’inexprimable – un désir relié à celui de la transcendance – se traduit dans son œuvre littéraire dans une conception de la parole poétique comme entité entourée du vide, du silence.
Dans une deuxième série de contributions, le lecteur observe la présence de la voix et du silence sur un niveau thématique ou narratif, en relation avec les formes d’expression (parfois silencieuses) des différents types de locuteurs. L’essai de Marion Coste (Université Paris III Sorbonne Nouvelle) montre le refus paradoxal du langage observé chez les personnages mutiques ou quasi-mutiques de Pascal Quignard, qui devient un taire sans taire, un « silence expressif ». Particulièrement importante à ce propos, l’expression musicale se transforme en un lieu pour habiter le silence. Si l’essai de Coste se centre sur le silence des personnages qui refusent le langage, Tanja Schwan (Universität Leipzig) se propose de montrer deux autres formes de silence, notamment le fait de ne rien dire (« das Nichtsagen » en tant qu’indicible), produit par le narrateur même, et celui de ne dire que des riens (« das Nichtssagende » en tant qu’échange d’idées reçues dans le brouhaha des personnages et des narrateurs), propre à quelques personnages. Selon une approche comparatiste, elle analyse trois romans européens : Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín et I promessi sposi d’Alessandro Manzoni. La contribution de Sandra Carrasco (Universität St. Gallen) ← 11 | 12 →porte sur le roman Todo es silencio (2010) de l’écrivain contemporain Manuel Rivas et analyse la relation entre la voix et le silence qui s’y présente non seulement comme un motif mais aussi comme un procédé littéraire. Partant du concrétisme – concept qu’elle définit à l’aide des théories psychanalytiques et sociologiques –, elle esquisse la mise en scène d’une voix narrative incapable de différencier le niveau figuré du langage de celui non figuré. Dans le domaine de la linguistique, enfin, Claudia Cathomas, Nicola Ferretti et Anne-Danièle Gazin (Universität Bern) consacrent leur étude à la présence simultanée de différentes langues dans les SMS écrits en Suisse italophone et romanchophone. Comme le démontrent les auteurs à partir du corpus analysé, bien que les phénomènes de polyphonie puissent se manifester sous diverses formes, elles ont en commun la nécessité d’une compétence bilingue assez limitée et se cantonnent le plus souvent en début et fin de message dans des formules de salutations.
Plusieurs contributions montrent ensuite que la thématique de la voix et du silence ne se manifeste pas seulement au niveau du contenu ou de la narration, mais a aussi des résonances au niveau de l’expression. D’une manière générale, l’étude d’Elisa Tonani (Università degli Studi di Genova), intitulée « Vedere il silenzio » (‘Voir le silence’), met l’accent sur la ponctuation dans les textes littéraires, en tant que représentation graphique de la voix et de ses silences. Elle nous fait voir ainsi comment la ponctuation établit un pont entre l’oral et l’écrit, en particulier lorsqu’elle fournit, par le biais d’indications graphico-visuelles, des indications pour la reproduction acoustique. L’aspect de la ponctuation est approfondi par Lisa Cadamuro (Università di Pavia), qui analyse dans la poésie de Giovanni Giudici l’emploi original des deux-points et du trait d’union à la fin du vers. Comme le souligne la chercheuse, dans la mesure où ces deux signes élargissent l’espace vide qui suit, ils conduisent à une véritable « ponctuation du silence » qui relie le niveau de la forme aux thèmes du texte et en renforce la signification. Avec l’étude de Susana González Aktories (Universidad Autónoma de México) le lecteur observe que dans la poésie expérimentale la représentation graphique finit par remplacer le texte dans son intégrité. En partant d’exemples tirés de l’œuvre de Francesco Cangiullo, de Dick Higgins et d’Augusto de Campos, sa contribution montre que la soi-disant ‘poésie pentagrammée’, en tant que « partiture silencieuse », est capable de reproduire dans la tête du lecteur-contemplateur une sphère à la fois poétique et musicale, dotée de voix.
← 12 | 13 →Les trois dernières études confirment, finalement, que le silence en linguistique peut acquérir une signification précise qui, dans certains cas, amène à la construction d’une nouvelle voix. Dans l’étude de Gabriela Soare (Université de Genève), ce silence s’articule au niveau de la syntaxe. À partir de différents exemples de la langue française et du roumain, elle examine le rôle des éléments dits « nuls ou silencieux » à l’intérieur de quelques syntagmes nominaux et l’effet qu’ils peuvent avoir pour l’accord sujet-verbe. Il y a, en tout cas, des formes de communication où il est question de véhiculer le message linguistique entier sous forme de langue « silencieuse ». En étudiant la manière dans laquelle les gestes dits co-verbaux se combinent avec la parole dans l’expression de locuteurs ayant un trouble linguistique acquis, Valentina Bianchi (Università per Stranieri di Siena) défend que la complémentarité de la parole et du geste, qui permet de « dire autrement », forme un nouveau système là où l’aphasie a porté à une désagrégation des structures linguistiques. L’article de Sabina Fontana et d’Erika Raniolo (Università di Catania, a Ragusa) se concentre, en dernier lieu, sur un autre aspect de l’interaction entre langage verbal et éléments non-verbaux, en analysant le phénomène des labialisations dans la langue des signes italienne. Les tests réalisés par les deux chercheuses montrent que ces fragments de langue parlée articulés en combinaison avec les signes ne sont pas redondants par rapport aux gestes, mais représentent plutôt un phénomène structurel, cohérent avec la nature multimodale des langues. Entre voix et silence il existe dans ce cas-là, par conséquent, une sorte de complémentarité.
***
Le comité organisateur du VIIe Dies Romanicus Turicensis (Cristina Albizu, Julie Dekens, Mario A. Della Costanza, Cyril Dubois, Bénédicte Élie, Valeria Frei, Maria Chiara Janner, Charlotte Meisner, Gina Maria Schneider et Michael Schwarzenbach) exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du congrès et à la publication des actes : le Romanisches Seminar de l’Université de Zurich et son programme doctoral « Méthodes et perspectives », ainsi que le Zürcher Universitätsverein et le Prof. Dr. em. Georg Bossong. Nous remercions, en particulier, tous les auteurs sans lesquels cette publication n’aurait jamais vu le jour.
Résumé des informations
- Pages
- 280
- Année
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783035108231
- ISBN (ePUB)
- 9783035194388
- ISBN (MOBI)
- 9783035194371
- ISBN (Broché)
- 9783034316118
- DOI
- 10.3726/978-3-0351-0823-1
- Langue
- français
- Date de parution
- 2015 (Avril)
- Mots clés
- Phonologie Syntax Speaker Macrolincuistics
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2015. 280 p., 6 ill. en couleurs