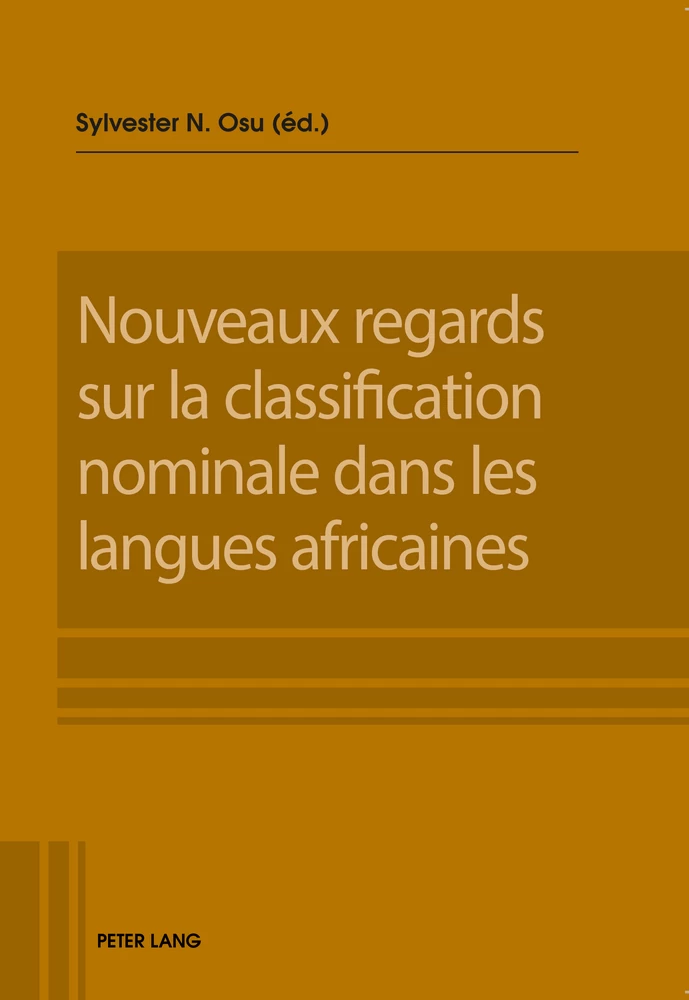Nouveaux regards sur la classification nominale dans les langues africaines
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur/l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Remerciements
- Pour une étude de la classification nominale à travers le fonctionnement spécifique du classificateur : un essai introductif
- Classes nominales
- Classes nominales par préfixation
- Noun formation in Mashami
- Classificatory and expressive functions of nominal prefixes in Hehe
- Cumul de classificateurs et polyfonctionnalité en cilubà
- Accords et désaccords de classe en swahili standard : un jeu de reprises intégrales et de reprises distinctives
- Classes nominales par suffixation
- Entre classificateur et subordonnant : le marqueur NDE en peul
- Amorphous, seamless vs. Polymorphous, seamed entities : -m and -do in Mὺυré noun class system
- Genres
- Genre grammatical en berbère et morphologie du nom en touareg
- Le genre féminin en amharique : une tentative d’interprétation sémantique
- Absence de classification nominale
- Répartition des noms et préfixation récurrente des noms et des verbes en ìkwéré, une langue sans système de classification nominale
Au nom de tous les auteurs, je remercie l’ensemble des collègues dont les noms suivent pour avoir participé à la relecture d’un ou plusieurs des articles :
Alexandra Aikhenvald (The Cairns Institute, James Cook University, Australia), Caesar Akuetey (Knox College, Galesburg, Illinois), Felix Ameka (Leiden University Centre for Linguistics, Nederlands), Assibi Amidu (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway), Oliver Bond (University of Surrey, UK), Catherine Collin (Université de Nantes, France), Bruce Connell (York University, Glendon College, Linguistics and Language Studies), Abdourahmane Diallo (Institut für Afrikanistik (Goethe-Universität Francfort), Klaudia Dombrowski-Hahn (Universität Bayreuth), Lionel Galand (professeur honoraire à l’INALCO et directeur d’études honoraire à l’École pratique des Hautes Études, IVe section), Timothée Mukash Kalel (Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo), Olga Kapeliuk (professeur émérite Hebrew University, Jerusalem Israel), Michel Lafon (LLACAN, Villejuif, France), Jérôme Lentin (professeur émérite, INALCO, Paris) Marteen Mous (Leiden University Centre for Linguistics, Nederlands), Gérard Philippson (professeur émérite INALCO, Paris), Sophie Vassilaki (INALCO, Paris). Il va sans dire que les auteurs sont seuls responsables des erreurs et omissions qu’on pourrait relever.
Je tiens également à remercier le Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL), UMR 7270 (CNRS, Université d’Orléans, Université François Rabelais de Tours, BNF) sans le soutien duquel cet ouvrage n’aurait pas vu le jour.
1. Bref rappel historique de l’étude de la classification nominale dans les langues africaines
Depuis que Bleek, initié à Berlin aux langues africaines par Carl Lepsius, s’est intéressé aux classes nominales, dans sa thèse de doctorat datée de 1851, avant de réaliser ses principales publications sur les langues bantu en 1862 et 1869,1 de très nombreux travaux ont été consacrés à ce phénomène complexe (classes nominales) dans les diverses langues appartenant à cette famille linguistique. En fait, la classification nominale s’est révélée un trait indispensable des langues bantu, si bien que pour différencier les langues bantoïdes non bantu (tiv, mambila, wute) des langues bantu, Greenberg et Crabb se sont basés exclusivement sur l’innovation des indices de classes à nasale /m/ en proto-bantu. Ce critère a permis ensuite de confirmer le caractère bantu des langues bamileke (par opposition à une classification antérieure les considérant comme semi-bantu).2 Au fond, la classification nominale a occupé très tôt une place centrale dans l’étude des langues bantu, qu’il s’agisse de la description des classes nominales à proprement parler (Bleek, op. cit.) ou de travaux de classification ← 11 | 12 → des langues bantu (Meinhof 1932),3 ou encore de reconstruction du Bantu Commun (cf. Guthrie 1967), ou enfin des reconstructions grammaticales (Meeussen 1965) et locatives (cf. Grégoire, 1980 : 521) de ces langues.
Toutefois, le colloque du CNRS organisé par G. Manessy et dont les Actes ont été publiés en 1967 a permis de montrer que ce phénomène complexe ne concerne pas que les seules langues bantu puisqu’on le retrouve aussi bien dans les langues « Plateau » du Nigeria central que dans les langues gur et atlantique. Welmers (1973 : 159) écrit :
Dans toutes les branches de la famille Niger-Kordofanienne, à l’exception du groupe mande, on s’attend à ce que le nom dans sa forme la plus simple puisse être décomposé en une base et un affixe. Dans certaines langues notamment le yoruba, l’igbo et l’efik, l’affixe peut au mieux assumer une fonction grammaticale minimale telle que la dérivation d’un nombre limité de noms à partir de verbes, et on a seulement des traces infimes de corrélation sémantique, que d’ailleurs on aurait beaucoup de difficulté à identifier sauf en recourant à des études comparées. A l’opposé, il existe plusieurs langues et groupes de langues dans lesquels les affixes, en combinaison avec les bases nominales, sont un critère majeur pour répartir les noms dans des classes nominales différentes les unes des autres dans un certain nombre de constructions grammaticales.4
En fait, Welmers soutient nettement plus loin (p. 184) que les classes nominales sont assez répandues dans la famille Niger-Congo. ← 12 | 13 →
2. Reconnaître une classe nominale
On sait aujourd’hui que les critères d’identification d’une classe nominale diffèrent selon la branche de langues considérée. Ainsi, pour ce qui concerne les langues bantu, une classe se reconnaît, en général, par une combinaison de trois critères au moins : a) un accord de classe qui consiste à rappeler l’indice d’une classe donnée sur tous les éléments qui se rapportent au nom (sujet ou objet) de l’énoncé dans lequel apparaît le nom ainsi classifié. Par conséquent, une différence d’accord dans la chaîne signale une différence de classe ; b) tous les noms appartenant à la même classe doivent comporter la même forme préfixale, exception faite des variantes. Par conséquent, une différence de préfixes nominaux signale une différence de classe ; c) il faut le même type d’appariement, c’est-à-dire, pour l’essentiel, d’opposition singulier/pluriel. Là encore, une différence d’appariements signale que l’on a deux classes distinctes (cf. Mba-Nkoghe 1999 : 267).
Mais si une classe nominale bantu va tendanciellement fonctionner par l’opposition du singulier au pluriel, certains noms ne vérifient pas cette caractéristique. On parle alors de mono-classe pour signifier que ces noms sont soit au singulier sans un correspondant pluriel, et c’est le cas par exemple, de la classe 14 dont le nom (p.ex. òbwɔ̀xɔ̀ « peur ») comporte le préfixe /o-/ en létὲƔὲ ; soit au pluriel sans un correspondant singulier, et c’est le cas par exemple des éléments de la classe 6 marqués formellement par le préfixe /ma-/ (comme dans mà : lì « vins ») dans cette même langue (cf. Tsoue 2011 : 38). Voici un exemple d’accord dans la langue létὲƔὲ (Tsoue, communication personnelle) :
| kàbùlù | kàmɔ̀ | kàmâɔ̀bƔɔ̀ |
| kà-bùlu | kà-mɔ̀ | kà-mâ-bɔ̀Ɣ-ɔ̀ |
| CL7-Tabouret | PND-un | PV-formatif-casser-VF |
| Il y a un tabouret cassé. | ||
| bàánà | bàkjὲƔὲ | bàkínà |
| bà-ánà | bà-kjὲƔɛ | bà-kín-à |
| CL2-enfants | PND-petits | PV-RAD-VF |
| Les petits enfants dansent. |
CL : classe ; PND : préfixe nominal de dépendance ; RAD : radical ; VF : voyelle finale
En définitive, on a des classes distinctes si, par exemple, l’on a le même accord mais des préfixes nominaux et des appariements différents. ← 13 | 14 →
Pour le peul, langue atlantique, il est généralement admis qu’une classe nominale réunit des lexèmes qui obéissent à deux critères : a) la présence d’une série de suffixes donnés qui marquent nécessairement ces lexèmes, et b) les accords qu’imposent ces suffixes au niveau des dépendants, c’est-à-dire les pronoms, démonstratifs, adjectifs et participes. Ainsi, si l’on considère les trois termes debb-o « femme », wur-o « village » et haak-o « feuillage », on s’aperçoit que malgré la présence du même suffixe -o, ces termes appartiennent à trois classes différentes. C’est parce que le suffixe -o impose trois schèmes d’accord différents au niveau du démonstratif, de la façon suivante : oo debb-o « cette femme », mais ngoo wur-o « ce village » et koo haak-o « ce feuillage ». Quant au rôle de l’appariement dans la reconnaissance d’une classe nominale en peul, Lacroix (1981 : 27) écrit :
L’emploi d’un nombre plus important d’exemples établit l’existence de seize séries primaires au singulier et de trois au pluriel, chaque substantif ne pouvant appartenir qu’à une classe déterminée de singulier et, si la pluralisation est possible, qu’à une « classe » de pluriel, chaque « classe » de singulier formant un « genre » avec la « classe » correspondante du pluriel.
Il en ressort, selon Lacroix, que le genre ou appariement n’intervient pas dans la définition des classes nominales en peul.5
Enfin, en m£…ré, langue gur, les nominaux se répartissent en classes caractérisées par des affixes particuliers exprimant l’unicité ou la pluralité, la collectivité-masse et les déverbatifs (cf. Canu 1967 : 180). Mais Kabore (1985 : 140–177) associe trois fonctions à la classification nominale dans cette langue. La première fonction est purement morphologique. Pour lui, il existe en mʊ̀ʊré divers morphèmes qui jouent le rôle de suffixes classificatoires et leur nombre s’élève à 13 (mais voir Canu 1967 : 203 qui finalement en a retenu 12). La deuxième fonction est celle de quantification. Le suffixe de classe permet certes une opposition unique-multiple, mais il permet également d’indiquer l’opposition d’une certaine quantité à une toute petite quantité ou au contraire à une très grande quantité. Et la troisième fonction concerne la dérivation, c’est-à-dire qu’à partir de la même base, on peut former, grâce aux suffixes de classes, des termes différents qui entretiennent des relations sémantiques les uns avec les autres.
A partir de ses travaux sur le dadjriwale (langue kru, parlée en Côte d’Ivoire), N’dré (2012 : 3–4) relie la notion de classe nominale à un système ← 14 | 15 → de catégorisation des noms autour d’un même affixe. Selon cet auteur, l’accord de l’adjectif, du déterminant démonstratif et du pronom anaphorique-objet dans cette langue, est lié à la nature de la voyelle finale du radical nominal. C’est pourquoi, selon lui, définir une classe nominale revient en fin de compte à considérer la propriété commune qu’ont les éléments d’un paradigme lexical donné comme le point de départ d’une contrainte morphophonologique.6
Il en ressort qu’une classe nominale se définit grâce à un faisceau complexe de critères. Le nombre de classes varie en fonction des langues, l’indice de classe peut être une consonne, une voyelle, une syllabe ou la marque zéro, et il peut apparaître en position de préfixe ou de suffixe dans la structure nominale. Rappelons que pour Kadima (1969 : introduction) :
Une étude complète du système des classes du bantou doit comporter l’examen de la forme des affixes de classes (préfixes et infixes), le fonctionnement de l’accord, la distribution des classes, les appariements des classes et les thèmes qui y entrent, la valeur sémantique des préfixes et l’origine des classes, la forme, le sens et l’origine de l’augment.7
3. Désaccord sur le lien entre classe nominale et genre
Pour revenir à Bleek, on peut penser que son intérêt pour les classes nominales n’est pas sans lien avec les phénomènes semblables dans les systèmes à genre grammatical tel qu’en allemand, une langue qu’il connaissait bien, et dans d’autres langues indo-européennes. D’ailleurs, le lien entre ces deux types de phénomènes a été plus récemment souligné par Aikhenvald (2000 : 1) lorsqu’elle soutient que les classificateurs se présentent sous diverses formes et qu’il existe dans certaines langues du monde des classes d’accord grammatical qu’on appelle classes nominales ou genres, établies ← 15 | 16 → à partir des traits sémantiques de base tels que animé, sexe ou humain. Leur nombre peut varier de deux, comme en portugais, à dix, comme dans les langues bantu, ou même à des dizaines, comme dans certaines langues d’Amérique du sud.8 Elle affirme p. 19 :9
Les termes CLASSE NOMINALE, GENRE ou encore CLASSE DE GENRE sont souvent employés comme synonymes suivant la tradition linguistique […] Ici, j’emploie ‘classe nominale’ pour couvrir aussi bien classe nominale que genre. Toutefois, pour respecter la tradition linguistique, j’emploie le terme genre pour désigner des systèmes qui font deux ou trois distinctions (comprenant toujours le masculin et le féminin) comme dans les langues indo-européennes, afro-asiatiques et dravidiennes.
Aikhenvald semble donc dire que les classes nominales et les genres grammaticaux sont deux variantes d’un même phénomène.10 L’absence de critères consensuels pour distinguer entre ce qui est une classe nominale et ce qui ne l’est pas dans les diverses langues plaide en faveur de la synonymie des deux termes. Enfin, les propos suivants de Hockett (1985) ne sont pas faits pour clarifier davantage la situation. Il écrit p. 232 :
Dans les langues avec un système à genres, on peut avoir seulement deux classes11 comme on peut en avoir vingt voire même trente ; et p. 233 : dans les langues bantu qui peuvent avoir jusqu’à vingt-cinq ou trente genres, les classes peuvent s’apparier en couples de singulier et pluriel.
Beaucoup de participants à une discussion sur l’ambiguïté des termes « classe » et « genre » lors du colloque international sur la classification nominale dans les langues africaines, organisé à Aix-en-Provence, 3–7 juillet ← 16 | 17 → 1967, trouveraient sans aucun doute la position d’Aikhenvald un peu radicale. Et les propos de Manessy (1967 : 395), repris ci-dessous, me semblent résumer l’essentiel du débat et des différents points de vue exprimés à cette occasion :
Il me semble utile, pour la clarté et l’efficacité, d’étendre aux langues non bantu la définition du Professeur GUTHRIE et de ne parler de « classes » que lorsque la répartition des noms en groupes formellement marqués est sanctionnée par quelque mécanisme d’accord (avec l’adjectif, l’anaphorique, le démonstratif, etc.). Si cette condition n’est pas jugée nécessaire, il sera aisé de démontrer à l’aide d’un dictionnaire de rimes l’existence de classes en français contemporain. Il ne me semble légitime d’employer le mot pour désigner l’association de deux ou plusieurs classes (ou groupes de noms) que dans la mesure où cette association exprime une catégorie grammaticalisée, obligatoire, dans la langue en question. Tel serait le cas dans un parler où tout singulier impliquerait virtuellement un pluriel, ou bien dans lequel tout substantif comporterait en principe trois degrés : normal, diminutif, augmentatif. La notion de « genre » n’est pas liée à celle de « classe ». On trouve des langues où les noms (substantifs et adjectifs) sont répartis en groupes caractérisés seulement par l’opposition régulière d’un certain affixe de singulier à un certain affixe de pluriel. Ces langues ne comportent pas de classes, mais plusieurs genres ; elles pourraient être dites langues à genres multiples.
La différence entre « classe » et « genre » est également longuement soulignée par Welmers (1973 : 159) :
On a parfois comparé les systèmes de classes nominales des langues bantu et autres langues Niger-kordofaniennes avec les systèmes de genres dans les langues indo-européennes ou d’autres familles encore. On peut en effet, observer à travers les langues une forme de ressemblance dans la mesure où différents groupes de noms sont différenciés grâce à des affixes, et il existe un accord grammatical entre les noms et leurs modificateurs d’un côté, et d’autres morphèmes qui renvoient à eux, de l’autre. Dans les langues à genres, en revanche, il y a en général, deux ou trois classes de noms, puis il y a une corrélation partielle entre ces noms et la distinction sur le critère de sexe. Dans les langues à classes de la famille Niger-kordofanienne, il y a souvent beaucoup plus que trois classes, la distinction sur la base du sexe n’est pas pertinente et on observe d’autres types de corrélations sémantiques. Une autre différence intéressante : dans les systèmes à genres dans les langues indo-européennes, genre et nombre peuvent, du moins dans une certaine mesure, être identifiés séparément (c’est le cas des paires singulier-pluriel en grec, masculin -os, -oi, féminin -a, ai) ; mais dans les classes nominales des langues Niger-kordofaniennes, chaque affixe du singulier tout comme les affixes du pluriel est à la fois autonome et est constitué d’un seul morphème.12 ← 17 | 18 →
Ajoutons qu’en linguistique contemporaine, « genre » est une catégorie grammaticale au même titre que temps, aspect, modalité, personne, nombre et cas, ce qui n’est pas le cas des « classes nominales ». A moins que les classes ne soient automatiquement assimilées à la catégorie de genre.
Il est important de noter que dans la tradition de la linguistique africaine, l’expression « classification nominale » tend à désigner presque exclusivement le phénomène des classes nominales. Ainsi, les Actes du colloque sur la classification nominale organisé en 1967 à Aix-en-Provence (ouvrage déjà cité ci-dessus), ne contiennent aucune contribution sur un système à genres tel qu’on le trouve dans les langues afro-asiatiques (langues tchadiques, éthiopiennes et berbères) ou encore sur un système à classificateurs comme, par exemple, les classificateurs numéraux en ejagham et kana (Aikhenvald 2000 : 99, voir aussi Ikoro 1996 : 89–102 pour le kana).
4. Une pirouette par l’arbitraire vs. la motivation sémantique
Ces phénomènes sont très bien répertoriés dans les diverses langues du monde et dans certains cas bien décrits dans les divers domaines d’investigation.13 Corbett (1991 : 7) reprend une question fondamentale, à savoir « qu’est-ce qui permet au locuteur natif d’une langue à genres (ou ← 18 | 19 → à classes) de savoir le genre d’un nom » ? Après avoir écarté la réponse qui veut que le locuteur se rappelle tout simplement le genre de chaque nom, ce qui demanderait à ce locuteur une mémoire d’éléphant, l’auteur se démarque de Bloomfield (1970 : 263) pour qui « il ne semble pas y avoir de critère pratique qui permettrait de déterminer le genre d’un nom en allemand, en français ou en latin ». Les raisons qui amènent à se poser la question sont très claires pour Corbett : tout d’abord, les locuteurs natifs de telles langues ne commettent pratiquement pas d’erreur de genre ; or, si le locuteur devait se rappeler le genre de chaque nom, on relèverait davantage d’erreurs. Deuxièmement, les mots d’emprunts sont aussitôt intégrés dans le système de genres, montrant ainsi qu’il y a bel et bien un mécanisme d’affectation des genres qui ne se ramène pas au fait de se les rappeler. Et troisièmement, les locuteurs peuvent affecter des mots inventés à tel ou tel genre avec un degré très élevé de régularité, preuve s’il en est qu’ils sont aptes à établir le genre d’un nom.
Il reste cependant à comprendre ce qui fait qu’un affixe se combine avec telle ou telle base et fait son accord de telle ou telle façon. En somme, comment rendre compte de la régularité (je pars du postulat que les cas souvent considérés comme exceptions sont en fait partie intégrante de cette régularité) qui caractérise une classe nominale donnée ? Cela ne semble pas s’expliquer par l’arbitraire, si l’on entend par là l’absence de tout rapport de nécessité entre un nom et la classe nominale (ou le genre) à laquelle il est affecté, car il est très difficile de cerner la limite de l’arbitraire. D’ailleurs, rien jusqu’ici ne peut étayer l’hypothèse selon laquelle la répartition des substantifs en classes (ou genres) n’était pas motivée dans les proto-langues.
Pourrait-il s’agir alors d’une motivation sémantique, comme le suggère Craig (1986) lorsqu’elle soutient (p. 5) qu’au delà des différences morphosyntaxiques qui les caractérisent, tous les systèmes de classifications dont il est question dans le volume qu’elle présente partagent en commun un ensemble de principes sémantiques de catégorisation.14 En effet, outre qu’elles regroupent les termes sur la base de la forme du marqueur de classe ou de genre, les études sur ces phénomènes ont souvent insisté sur le lien sémantique entre termes affectés à une classe ou à un genre donné. Corbett (1991 : 7–8, 1994 : 1349) relève d’ailleurs que le locuteur d’une ← 19 | 20 → langue à genres (ou à classes nominales) doit avoir à sa disposition deux types d’information concernant un nom pour pouvoir l’affecter à un genre ou une classe : son sens et sa forme. Dans cette perspective, l’information relative au sens -critères sémantiques donc-, peut suffire dans certaines langues y compris le dizi, langue omotique parlée en Ethiopie, à déterminer le genre alors que dans d’autres, notamment les langues bantu, les critères formels doivent s’ajouter aux critères sémantiques.
Mais alors, on est frappé de constater que toute tentative d’expliquer la combinaison d’un affixe avec des bases par le fait que les bases en question renvoient à un champ sémantique homogène souligne aussitôt l’existence des exceptions. C’est peut-être une façon de soutenir que l’appartenance d’un terme à une classe nominale est arbitraire.
Shimamungu (1998 : 23sqq), par exemple, montre qu’en kinyarwanda (une langue bantu), les substantifs comportant l’affixe /-mu-/ au singulier et /-ba-/ au pluriel appartiennent à la classe 1, et désignent des humains ; toutefois, certains humains appartiennent à d’autres classes (p.ex. urugabo/ibigabo ‘gros bonhomme/gros bonhommes’ appartient à la classe 8 ; akagabo ‘petit homme’ à la classe 10) ; ceux qui comportent /-ku-/ au singulier et /-ma-/ au pluriel sont classés en 5, classe réservée à certaines parties du corps (ukuguru/amaguru ‘jambe/jambes’, ukubóko/amabóko ‘bras/bras’, et d’autres parties du corps se retrouvent dans d’autres classes. Ainsi, urura/amara ‘un seul intestin/intestins’ sont en classe 8. Quant à la classe 6, elle regroupe des êtres divers, mais surtout des animaux et des phénomènes naturels, p.ex. ihené/ihené ‘chèvre/chèvres’, inkurú/inkurú ‘nouvelle/nouvelles’, imvúra/imvúra ‘pluie/pluies’ et insína/insína ‘bananier/bananiers’. Le passage suivant, tiré de Denny & Creider (1986 : 217), résume bien la situation :
L’hypothèse que les classes nominales marquées par des préfixes ont un contenu sémantique caractérisé a souvent été envisagée par bon nombre de bantouistes. La plupart sont arrivés à la conclusion que si tous les membres d’une classe naturelle ou si une grande partie d’entre eux peuvent être affectés à une même classe (comme par exemple le fait de placer les arbres en classe 3/4 et les fruits en classe 5/6), il n’existe pas pour une classe donnée un contenu sémantique qui lui est intrinsèque (exception faite de la classe 1/2 souvent relevée).
Il faut, pour être tout à fait complet, ajouter qu’à l’inverse des bantouistes auxquels ils font référence dans ce passage, Denny et Creider entendent montrer que les préfixes de classes du Proto-Bantou constituaient un système sémantique dans lequel chaque préfixe était associé à un sens ← 20 | 21 → spécifique. Autrement dit, pour ces auteurs, la répartition des noms en classes sur la base des propriétés sémantiques est tout à fait opératoire.
5. Genre et sexe
Dans une tentative de dissocier les sexes et les genres, Brunot (1936 : 85–86) écrit :
Un certain nombre d’êtres nous apparaissent comme des mâles ou des femelles. Ils ont un sexe : l’homme, la femme ; le cheval, la jument ; le chat, la chatte. Les mots homme et femme correspondent à une différence naturelle […] Il est impossible au contraire de ne pas donner aux noms leur genre, et les formes correspondantes aux mots qui accompagnent le nom. Quoique table et tableau n’aient pas de sexe, il est impossible de dire un table, une tableau. La notion linguistique de genre est donc fort souvent à part de la notion de sexe, elle a une tout autre valeur et une tout autre importance.
Details
- Pages
- 340
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Softcover)
- 9783034321099
- ISBN (PDF)
- 9783034324274
- ISBN (ePUB)
- 9783034324281
- ISBN (MOBI)
- 9783034324298
- DOI
- 10.3726/978-3-0343-2427-4
- Language
- German
- Publication date
- 2017 (April)
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2016. 340 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG