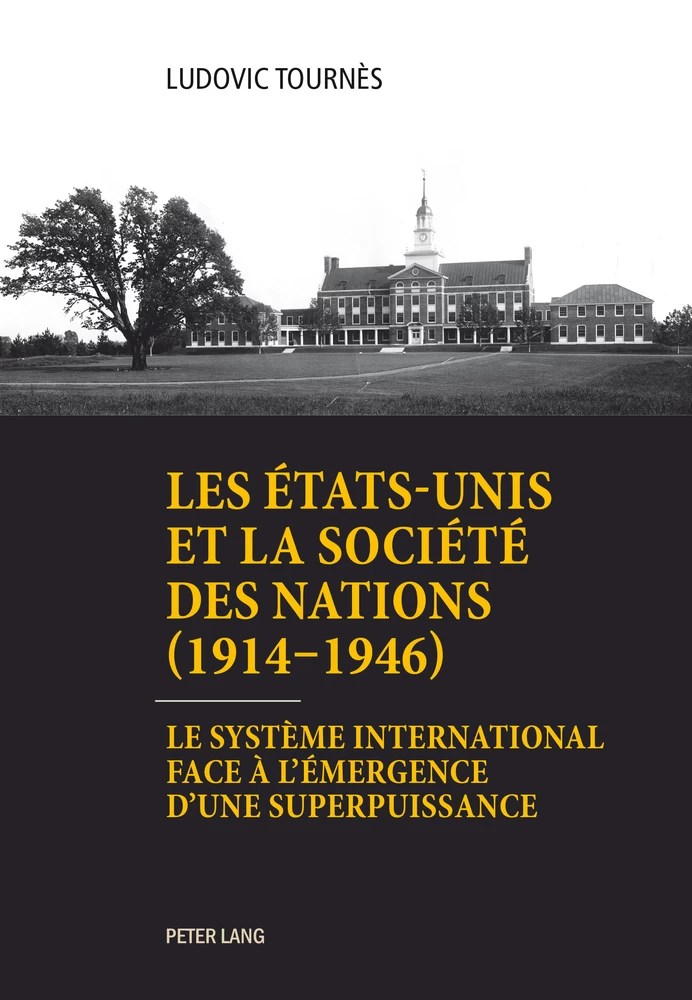Les États-Unis et la Société des Nations (1914–1946)
Le système international face à l’émergence d’une superpuissance
Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Table des abréviations
- Introduction : une autre histoire de la Société des Nations
- I. La SdN en débat aux États-Unis
- A. L’arbitrage international et le système de La Haye
- B. L’internationalisme américain
- Le courant légaliste
- Le courant wilsonien
- C. Les États-Unis et la paix de Versailles
- Les projets en présence
- La délégation américaine à la Conférence de la paix
- Le pacte de la Société des Nations
- D. Le rejet du traité
- Les enjeux du débat américain
- Des amendements aux réserves
- Les deux votes du Sénat
- La SdN se met en marche
- E. La Cour permanente de justice internationale ou l’autre SdN
- II. La politique de sécurité collective de la philanthropie Carnegie
- A. La science au service de l’arbitrage
- Les enquêtes de terrain
- Les frontières de l’Albanie
- La reconstruction économique et financière de l’Autriche
- B. Promouvoir le droit international
- C. La guerre hors la loi
- Le protocole de Genève et le Plan Shotwell
- Le Pacte de Paris
- La crise mandchoue et la fin de la sécurité collective
- III. L’internationale de l’expertise : les sections techniques
- A. Impliquer les États-Unis coûte que coûte
- B. Le partenariat Secrétariat / fondations
- Raymond Fosdick : de la SdN à la fondation Rockefeller
- Le financement philanthropique
- C. Le gouvernement américain et les activités techniques
- Les agents doubles du Secrétariat
- Commissions, comités et conférences
- Acteurs publics et privés : une synergie complexe
- IV. Une politique mondiale de la santé
- A. Un nouvel enjeu international
- La création de l’Organisation d’hygiène
- L’engagement de la fondation Rockefeller
- B. La coopération euro-américaine et ses limites
- Le Service de renseignement épidémiologique
- L’échange de personnel sanitaire
- Les commissions d’experts : un lieu d’affrontement
- V. Coopération intellectuelle ou affrontement géoscientifique ?
- A. Le nouveau paysage scientifique international
- Conseil international des recherches et Union académique internationale
- La SdN et la coopération intellectuelle
- B. Les États-Unis et la coopération intellectuelle
- La structuration de la vie scientifique américaine
- Les Américains à la CICI
- L’engagement des fondations philanthropiques
- C. L’échec de la CICI
- Coopération ou rivalité ?
- L’institut interaméricain de coopération intellectuelle
- VI. Les États-Unis dans le système sociétaire : l’Organisation internationale du travail
- A. Les débuts de l’organisation
- La Conférence de Washington
- L’établissement de liens avec les États-Unis
- B. Industriels et philantropes au chevet du BIT
- Albert Thomas à la recherche de son autonomie
- John D. Rockefeller, Jr. et l’Industrial relations counselors
- Edward Filene et le Twentieth century fund
- C. L’adhésion
- Le rapprochement américain
- La stratégie de l’OIT
- Légitimation du New deal ou hausse des standards internationaux du travail ?
- « Rockefeller money is tainted money »
- VII. Réorganiser l’économie mondiale
- A. La SdN et l’économie
- Les débuts de l’Organisation économique et financière
- La participation du gouvernement américain
- B. L’implication de la philanthropie rockefellerienne
- Une politique mondiale d’expertise économique
- La coordination des travaux
- Le Service de renseignement économique
- VIII. L’américanisation de la coopération intellectuelle
- A. La Conférence permanente des hautes études internationales
- Philanthropie américaine et étude des relations internationales
- De la crise de l’IICI au financement américain
- La prise de contrôle administrative et intellectuelle
- Le Geneva research centre
- B. La division internationale du travail d’expertise
- Coordonner la recherche européenne
- Comités nationaux et fellows
- C. De la sécurité collective au commerce international
- L’État et la vie économique
- La sécurité collective
- Le commerce international
- IX. De Genève à Princeton : mort et renaissance de la SdN
- A. La réforme Bruce
- B. Le déménagement aux États-Unis
- Le Département économique, financier et du transit
- Les autres services de la SdN
- C. Un laboratoire du projet onusien
- L’intégration dans les réseaux d’experts
- Aide d’urgence et reconstruction
- L’économie mondiale, entre libéralisation et régulation
- Le bien être des populations
- Conclusion
- Sources
- Bibliographie
- Index
Introduction : Une autre histoire de la Société des Nations
Octobre 1940. Alors que la quasi-totalité de l’Europe est tombée sous la domination nazie, le Directeur de l’Institute of advanced study de l’université de Princeton, Frank Aydelotte, évoque devant son conseil d’administration le déménagement d’une partie des services de la Société des Nations aux États-Unis qui a eu lieu au cours du mois de juillet précédent :
Nous avions sauvé l’une des plus importantes sections techniques de la Société [des Nations] de la destruction par les nazis ; nous avions roulé le gouvernement fantoche de Vichy. À l’heure la plus sombre de l’histoire de la Société, les États-Unis, qui n’en sont pas membres, offraient non seulement un refuge à d’importantes activités de la SdN, mais également la possibilité de continuer leurs travaux. Le groupe d’économistes rassemblé et formé progressivement depuis vingt ans était déjà ici ou bien en voie d’arriver, avec la grande majorité de leurs documents microfilmés. Le département d’économie de notre Institut, spécialisé dans les questions financières internationales, se voyait renforcé de façon significative. Sur le moment, nous étions trop fatigués pour faire quoi que ce soit, si ce n’est nous émerveiller de notre succès. M. [Arthur] Sweetser et moi pensâmes qu’il n’y avait plus qu’une chose à faire pour ne pas laisser retomber l’euphorie. Nous partîmes à Springdale faire une partie de golf. Sweetser est un bon golfeur. Nous avions déjà joué ensemble de nombreuses parties endiablées, mais jamais aussi délicieuses que celle de ce matin d’août1.
L’euphorie d’Aydelotte paraît curieuse à première vue, compte tenu de ce que l’on connaît généralement de l’histoire de la Société des Nations et des relations que les États-Unis ont entretenu avec elle. Les manuels scolaires et universitaires ont en effet appris à des générations de lycéens et d’étudiants que les États-Unis, après avoir été à l’origine de la Société des Nations par l’intermédiaire de leur président Woodrow Wilson, s’en sont ← 1 | 2 → détournés après le rejet du Traité de Versailles par le Congrès américain, et n’ont jamais entretenu de relations avec elle. Comment se fait-il, dans ces conditions, qu’une partie de la Société ait été accueillie sur le sol américain ? Et surtout, pourquoi Aydelotte s’en réjouit-il comme d’une bonne affaire, étant donné le discrédit qui est alors celui de la SdN du fait de son échec à maintenir la paix en Europe et dans le monde ? Au-delà de son caractère anecdotique, l’épisode du déménagement d’une partie de la Société des Nations aux États-Unis à l’été 1940 pose des questions qui invitent à reconsidérer non seulement l’histoire de cette organisation, mais aussi celle de la politique étrangère américaine, et, enfin, celle du système contemporain des organisations internationales. C’est au croisement de ces trois problématiques que se situe cet ouvrage.
L’histoire de la SdN tout d’abord. Le récit classique, largement construit après 1945, a longtemps consisté à la considérer comme un échec. L’organisation fondée en 1919 aurait non seulement été handicapée dès ses débuts par le retrait américain, mais aussi par le fait qu’elle n’était, au fond, qu’un club de vainqueurs dont l’Allemagne, la Russie bolchévique ou encore la Turquie ont été exclues dans un premier temps. Malgré une action non négligeable au cours des années vingt qui aurait porté sur les fonts baptismaux la notion de sécurité collective, la Société des Nations, animée par un idéalisme naïf, aurait périclité dès le début des années trente, incapable de réagir face aux coups de boutoir des régimes totalitaires (Allemagne, Italie, Japon) remettant en cause le fragile ordre versaillais. Dans cette perspective, les crises successives qui débouchent sur la Seconde guerre mondiale (invasion de la Mandchourie en 1931, réarmement allemand et invasion de l’Éthiopie par l’Italie en 1935, démembrement de la Tchécoslovaquie en 1938-1939) dessineraient en creux l’incapacité de la Société à assurer sa mission originelle de maintenir la paix mondiale. Les leçons de cet échec auraient été tirées en 1945 à travers la mise en place d’un nouveau système international véritablement universel mais fondé sur le primat des grandes puissances qui auraient pu désormais jouer un rôle de stabilisation plus important dans les crises internationales.
Si ce récit contient sa part de vérité, il n’est pas exempt de simplifications. D’abord parce qu’il semblerait indiquer que l’organisation qui a succédé à la SdN, l’ONU, serait, elle, un « succès ». Or, il est permis d’en ← 2 | 3 → douter : dès 1947, celle-ci a en effet été paralysée par la logique de guerre froide et a dû revoir ses ambitions initiales à la baisse ; et si la fin de la guerre froide en 1989 a paru lui ouvrir de nouvelles perspectives, celles-ci sont restées limitées, comme en ont témoigné son incapacité à régler des crises majeures comme la guerre en ex-Yougoslavie entre 1992 et 1999, le génocide rwandais de 1994 ou, plus récemment, la guerre civile syrienne qui fait rage depuis 2011, sans parler de la crise ukrainienne qui a fait ressurgir au printemps 2014 la logique de guerre froide.
D’autre part, la thèse de l’échec repose largement sur l’idée qu’il existe une rupture entre la SdN et l’ONU. Or, les continuités entre les deux organisations, mises en évidence par l’historiographie récente, sont nombreuses, ne serait-ce que parce que de nombreux fonctionnaires de la SdN ont continué leur carrière dans l’appareil de l’ONU, y apportant leurs expériences et leurs pratiques. Plus généralement, le projet qui fonde l’ONU s’inscrit dans la continuité de la SdN, et l’examen de l’activité intense de celle-ci pendant la Deuxième guerre mondiale, comme on le verra plus loin, montre qu’elle joue un rôle majeur dans l’élaboration du nouvel ordre mondial, lequel ne surgit pas ex nihilo en 1945 mais est le résultat d’un important travail de préparation dans lequel les experts de la SdN, et pas seulement les économistes auxquels Aydelotte fait allusion, prennent toute leur part. Il est donc nécessaire d’interroger l’histoire de cette organisation autrement qu’en termes d’échec, non pas pour opérer une quelconque réhabilitation, mais simplement pour mieux comprendre son histoire, et donc notre actualité. C’est ce qu’ont fait les historiens depuis la fin des années 1990 : alors que l’histoire de la SdN avait longtemps été délaissée2, la fin de la guerre froide, le processus de mondialisation et la ← 3 | 4 → résurgence, notamment en Europe, de problèmes internationaux souvent issus des réorganisations territoriales de l’après 1918, ont conduit les historiens à s’intéresser à nouveau à l’organisation3.
Cette historiographie en pleine expansion est également la conséquence de l’affirmation depuis les années 1980 des historiographies du transnational. Qu’on les appelle world history, global history, transnational history, connected history ou histoire croisée, toutes s’intéressent, selon des modalités diverses, à une histoire entendue à l’échelle mondiale4, pour laquelle les organisations internationales sont un observatoire idéal5. La Société des Nations ayant été la première tentative dans l’histoire de l’humanité pour réguler les relations internationales et coordonner la coopération dans de multiples domaines, elle constitue un terrain de choix pour cette histoire mondiale – ou transnationale, ou globale, comme on voudra. Si la nouvelle historiographie de la SdN n’a pas négligé les questions politiques traditionnelles6, elle s’est surtout tournée vers d’autres directions, s’intéressant notamment au travail des sections dites « techniques » ou des organisations liées à la SdN, lesquelles ont mis en œuvre tout au long de l’entre-deux-guerres un travail important de normalisation et d’harmonisation internationale dans de nombreux do ← 4 | 5 → maines, qu’il s’agisse de l’économie7, de la santé8, de la coopération intellectuelle9, des réfugiés10, des transports11 ou encore du travail12 ; d’autres questions connexes ont été aussi explorées, comme les mouvements de soutien à la SdN13, témoignant de l’épaisseur sociale du phénomène et de l’engouement qu’a pu représenter la SdN, trop souvent décrite comme une organisation désincarnée et loin des préoccupations des populations. Même si certains problèmes restent encore peu couverts, comme la justice internationale ou le trafic des stupéfiants, l’image qui se dégage de cette historiographie en plein essor est claire : la SdN, loin d’être l’échec souvent décrit, a fait preuve d’une profusion d’initiatives extrêmement variées, un fait d’autant plus remarquable que ses activités techniques, entrées presque par effraction dans le Pacte, se sont multipliées en peu ← 5 | 6 → de temps avec des moyens réduits, et ont connu une montée en puissance inversement proportionnelle au discrédit politique de l’organisation, de sorte qu’elles sont devenues au cours des années trente le cœur de l’activité de la société des Nations, avant d’être, pour la plupart, reconduites sous une autre appellation dans le cadre du système de l’ONU : le Conseil économique et social, l’Organisation mondiale de la santé, le Haut-commissariat aux réfugiés, ou encore l’UNESCO, sont autant d’héritiers directs de la SdN dont ils ont poursuivi le travail.
Cette historiographie dessine une autre histoire de la SdN, non pas tant celle d’une parenthèse tragique que celle d’un moment fondateur dans l’histoire du système international contemporain, où se mettent en place non seulement un dispositif institutionnel nouveau (une assemblée d’États et un réseau d’organisations spécialisées), mais aussi des pratiques nouvelles (la systématisation des conférences internationales et des comités d’experts, ou encore les premières expériences d’administration internationale), et enfin une approche nouvelle des questions internationales qui fait une large place à l’analyse scientifique des problèmes en vue d’élaborer des solutions. Les relations internationales y sont envisagées pour la première fois de manière globale : en effet, l’organisation ne limite pas son activité aux négociations concernant le tracé des frontières, mais y intègre la limitation des armements, les réfugiés, les problèmes sanitaires et alimentaires, la réorganisation du système financier international, les échanges intellectuels, et bien d’autres problèmes qui constituent aujourd’hui l’ordinaire de l’activité des organisations internationales de la galaxie onusienne. Une telle perspective conduit évidemment à réviser la chronologie admise traditionnellement par les historiens de l’entre-deux-guerres, indexée sur l’histoire politique de la période : celle-ci considère peu ou prou les années vingt comme une période de relatif succès de la SdN, tandis que les années trente sont considérées comme celles de sa descente aux enfers du fait de la crise, de la montée des totalitarismes et de l’inexorable marche à la guerre.
Or, cette chronologie ne marche pas si l’on intègre à la réflexion le travail des sections techniques. Dans le cas de l’Organisation économique et financière, pour ne prendre qu’un seul exemple, les années vingt sont celles de la gestation et la décennie suivante celle de la montée en puissance, précisément à cause de la crise, qui légitime aux yeux des respon ← 6 | 7 → sables l’existence d’un organe d’expertise et de coordination des politiques économiques mondiales ; alors même que les années trente sont habituellement considérées comme celles du retour du nationalisme et du déclin de l’internationalisme, on observe au contraire au sein de la SdN une montée en puissance de la certitude du bien fondé de la coopération internationale dans des domaines tels que l’économie ; cette croissance du credo internationaliste n’est nullement anecdotique, si l’on considère que les actions de l’Organisation économique et financière, et plus généralement des sections techniques, posent les bases de ce qui deviendra après 1945 la méthode de travail habituelle des grandes institutions internationales, mais aussi des constructions supranationales hybrides telles que la Communauté économique européenne, autant d’organisations qui reposent en grande partie sur le principe des réunions d’experts et de technocrates14. Ce modèle est d’ailleurs peut être arrivé à épuisement en ce début de XXIe siècle, si l’on en juge par les critiques croissantes qu’encourent ces grands symposiums d’experts non élus, en raison de leur déficit de représentation démocratique ; raison de plus pour se pencher sur son histoire et mieux comprendre comment le faire évoluer.
Quoi qu’il en soit, la chronologie qui se dégage ici n’est pas tant celle d’une SdN paralysée dès le début des années trente, mais plutôt celle d’une organisation dont les activités techniques, et pas seulement dans le domaine économique, s’intensifient à partir de ce moment et vont déboucher pendant la Deuxième guerre mondiale sur un vaste processus de réorganisation du système international qui arrive à maturité en 1945, système dont la forme restera pour l’essentiel inchangée jusqu’à nos jours. Les continuités entre l’avant 1939 et l’après 1945 sont donc au moins aussi importantes que les ruptures suggérées par les bornes rigides de la chronologie politico-militaire. Plus généralement, ces faits invitent l’historien à réviser ses idées reçues sur la période de l’entre-deux-guerres et à la replacer dans le long terme de l’histoire du XXe siècle. ← 7 | 8 →
La deuxième histoire que l’étude des relations entre les États-Unis et la SdN nous invite à reconsidérer est celle de la politique étrangère américaine, et en particulier le supposé isolationnisme de l’entre-deux-guerres qui ne tient guère si l’on replace cette politique dans la longue durée. Maintes fois corrigée, la légende de l’isolationnisme a toujours la vie dure, surtout en Europe. Dès 1954, l’historien américain William Appleman Williams a pourtant fait justice de cette idée reçue15. Dans les années suivantes, les travaux de Carl Parrini16, Melvyn Leffler17, Frank Costigliola18, Denise Artaud19, Robert Dallek20 ou Wayne Cole21, pour n’en citer que quelques-uns, ont également contribué à la corriger. Si l’échec personnel et politique de Wilson en 1919, concrétisé par le refus du Congrès de ratifier le Traité de Versailles, a marqué les esprits, il n’est pas représentatif de la politique étrangère américaine dans l’entre-deux-guerres, qui se caractérise par une implication croissante dans les affaires mondiales22, excepté pendant la période 1935-1939 où s’appliquent les lois dites de neutralité. Le Traité de Versailles a certes été rejeté, mais à une courte majorité, et il existe tout au long de l’entre-deux-guerres un courant internationaliste dans le monde politique et intellectuel américain qui milite activement ← 8 | 9 → pour la participation des États-Unis aux affaires mondiales23, alors qu’ils en étaient largement absents jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cette participation est une réalité dès le début des années vingt, en particulier sur les questions économiques et financières, devenues au lendemain de la Grande guerre des questions politiques à part entière. Dès ce moment, bien des dirigeants et entrepreneurs américains ont compris que la prospérité de leur pays dépendait de celle de l’Europe, laquelle est alors à la fois le centre du commerce international, le principal client des États-Unis (elle absorbe 50 % des exportations américaines) et également son principal débiteur. Les États-Unis ont donc intérêt à favoriser la pacification du continent européen, à soutenir sa reconstruction et à favoriser sa réintégration dans le commerce international. Après 1918, ils interviennent dans le jeu européen via les questions économiques et financières. Le triptyque prêts américains-réparations-dettes interalliées est de ce point de vue un aspect fondamental des relations internationales de l’entre-deux-guerres et significatif de la montée en puissance américaine24 : grâce à leur puissance financière, les États-Unis sont en mesure de peser sur la réorganisation de l’économie européenne, se substituant progressivement à la puissance financière anglaise déclinante, imposant un traitement clément vis-à-vis de l’Allemagne avec le plan Dawes en 1924, évitant une domination française sans partage sur le continent européen en contribuant à stopper l’opération de la Ruhr, et récupérant par le circuit des dettes interalliées une partie de l’argent des réparations, augmenté par les taux d’intérêt des prêts consentis à la France et à la Grande Bretagne.
Au cours des années vingt, les États-Unis sont donc déjà au cœur du jeu européen et aucun accord ne peut se faire sans leur aval, comme le montre leur présence dans toutes les grandes conférences organisées par la SdN, que l’on analysera dans les pages qui suivent. Plutôt que d’isolationnisme, il faut parler d’interventionnisme limité, et de volonté de ne ← 9 | 10 → prendre aucun engagement contraignant, dans la longue tradition du non entanglement américain. Mais cet interventionnisme est réel, même si les tensions intérieures au monde politique américain l’empêchent d’être plus approfondi. D’une certaine façon, les États-Unis adoptent en Europe après 1918 le rôle d’arbitre des affaires du continent qu’avait joué la Grande Bretagne depuis 1815. Quant aux autres parties du monde, ils y sont tout sauf isolationnistes : c’est vrai en Amérique latine, où la tradition des interventions inaugurée par la guerre avec l’Espagne de 1898 continue après 1918 (Haïti, République dominicaine), et prolonge la diplomatie du dollar25 ; c’est vrai aussi en Asie, où la montée des ambitions américaines et la confrontation avec le Japon26 apparaissent au grand jour à la conférence de Washington de 1921-1922.
Les États-Unis de l’entre-deux-guerres ne sont donc pas isolationnistes, mais effectuent leurs premiers pas de superpuissance, ce qui ne va pas sans hésitations. Déjà incontournables dans le jeu international dès 1918, ils n’ont pas encore les moyens ni la volonté politique d’en être les arbitres ; leur volonté de défendre leurs intérêts nationaux s’articule avec difficulté avec leur ambition de reconfigurer l’ensemble des relations internationales, ambition qui ne s’est pas arrêtée avec l’échec de Wilson. C’est à l’aune de cette articulation difficile entre deux tendances contradictoires qu’il faut lire leurs relations avec la Société des Nations. Cette politique est d’autant plus complexe à interpréter qu’elle est mise en œuvre par une administration fédérale en pleine croissance, dont les organes intervenant sur le plan international sont de plus en plus nombreux (Département d’État, du commerce, du travail, du trésor etc.) ; leurs positions ne sont pas identiques et les rivalités entre eux existent, y compris au sein d’un même Département. Quant au Congrès, il a fait savoir, en refusant la ratification du Traité de Versailles, qu’il n’entendait pas abandonner à la Maison blanche le leadership en matière de politique étrangère. En bref, ← 10 | 11 → la pluralité d’acteurs rend difficile l’identification d’une position univoque des États-Unis vis-à-vis de la SdN. À tout prendre, la lecture de la politique étrangère américaine d’aujourd’hui n’est guère plus aisée.
Mais pour bien prendre la mesure de la relation des États-Unis avec la SdN, il importe surtout de ne pas se limiter aux acteurs gouvernementaux et d’inclure dans l’analyse les acteurs privés. Le rôle de ces derniers dans les relations internationales a depuis plusieurs décennies maintenant été pris en compte par la science politique27 et la sociologie28, même si les travaux de ces disciplines manquent souvent de profondeur chronologique et ne remontent guère en amont des années 1970. Or, le rôle des acteurs non gouvernementaux est bien plus ancien, et les historiens sont entrés plus récemment dans le débat pour le souligner, notamment à travers le développement de l’histoire transnationale29. Cette prise en compte s’est progressivement imposée comme une nécessité pour construire une histoire renouvelée des relations internationales, et pour se débarrasser définitivement du « réalisme de base30 » qui a jusqu’à une date parfois très récente selon les pays (notamment la France), irrigué une grande partie de la production historiographique. Pour autant, le rôle des acteurs non gouvernementaux ne doit pas être lu en simples termes d’« influence » sur les décideurs, ce qui conduit à une perspective finalement aussi simpliste, ← 11 | 12 → en sens inverse, que la perspective réaliste classique. Il est bien plus intéressant de considérer la politique étrangère comme une coproduction résultant de l’articulation entre de multiples acteurs, publics et privés, dont il est souvent impossible de déterminer qui a eu l’influence la plus déterminante.
Parmi ces acteurs privés, il faut faire une place importante aux grandes fondations philanthropiques, notamment la fondation Rockefeller, mais aussi la Carnegie endowment for international peace, le Bureau of social hygiene, le Twentieth century fund ou encore le Milbank memorial fund. Leur présence forte dans la politique étrangère américaine est connue depuis longtemps31. Mais le cadre d’interprétation de celle-ci reste sujet à des interprétations contradictoires qui n’ont pas clarifié pleinement leur rôle et leur statut. Leur action est révélatrice du dynamisme expansionniste des élites américaines qui, tout en menant leur propre politique, agissent de concert avec le gouvernement américain dans une synergie sans précédent dans l’histoire des relations internationales. Les fondations construisent en effet dès les années 1910 une diplomatie philanthropique32 agissant à(ux) côté(s) de l’État, aux confins de la frontière entre public et privé qui est, aux États-Unis plus qu’ailleurs, une vaste zone d’indifférenciation plus qu’une ligne de démarcation clairement identifiable. C’est dans cette zone que se déploie la coopération de fait entre l’administration fédérale et les acteurs privés. Cette zone n’a pas été définie clairement par les tendances qui s’opposent lorsqu’il s’agit d’interpréter l’action internationale des grandes fondations : alors qu’un courant gramscien a mis en avant la dépendance structurelle des fondations vis-à-vis de l’État américain, un courant libéral a au contraire insisté sur son autono ← 12 | 13 → mie33. L’un et l’autre ont déployé des arguments convaincants en faveur de leur thèse, mais les deux fonctionnent sur l’idée d’une frontière nette entre public et privé qui ne correspond pas à la réalité. Les fondations américaines ne sont ni structurellement dépendantes, ni autonomes par rapport aux pouvoirs publics : elles entretiennent avec eux une relation d’étroite interdépendance qui, à l’international, se traduit par une coproduction de la politique étrangère américaine. Les relations entre les États-Unis et la Société des Nations en sont une illustration évidente : alors que le gouvernement américain prend ses distances vis-à-vis de la Société après 1919, les milieux internationalistes, dont les fondations sont l’émanation, militent activement en faveur d’un rapprochement. De fait, si le wilsonisme échoue au Congrès, il survit politiquement via le mouvement internationaliste, notamment via les organisations de soutien à la SdN et surtout les fondations philanthropiques telles que la fondation Rockefeller. L’analyse de leur investissement financier et intellectuel dans la SdN amène à reconsidérer l’idée reçue de la non-participation des États-Unis à l’organisation puisque la conséquence de cet activisme de la diplomatie philanthropique aboutit, à la fin des années trente, à intégrer de facto les États-Unis dans le système sociétaire. Il serait pour autant erroné de réduire le rôle des fondations à une simple « influence » sur les cercles gouvernementaux qui aurait amené le gouvernement américain à se rapprocher de la Société. Si une telle influence est incontestable, elle ne résume pas leur action. Bien des membres de l’administration fédérale ont en effet vite compris, sans l’aide des fondations, qu’il était de l’intérêt des États-Unis de participer à la SdN ; dès lors, la question qu’ils se posaient dès les années vingt n’était pas de savoir s’il fallait participer ou non, mais plutôt comment participer sans risquer l’obstruction des isolationnistes, notamment au Congrès. C’est ici que les acteurs privés, et notamment les fondations, entrent en scène, car leur action va permettre aux États-Unis de participer à l’organisation sans en être membre.
Mettre l’accent sur cette multipolarité de la politique étrangère américaine n’aide pas seulement à décrypter la position des États-Unis vis-à-vis ← 13 | 14 → de la SdN. Elle contribue, plus largement, à mieux comprendre le processus d’émergence des États-Unis en tant que « superpuissance », catégorie nouvelle d’une géopolitique mondiale, qui ne connaissait jusqu’en 1919 que les « grandes puissances », les « puissances à intérêts particuliers34 », et les pays dominés ou colonisés. Si la notion de superpuissance fait partie intégrante du paysage géopolitique depuis la guerre froide, les historiens ont relativement peu interrogé la spécificité de cette catégorie par rapport à celle de « grande puissance », si ce n’est pour souligner la démesure de l’arsenal militaire et la nature mondiale de la diplomatie de l’État ainsi défini. Or, si ces deux éléments jouent un rôle majeur dans l’émergence de la puissance américaine à partir de la fin du XIXe siècle, il faut prendre en compte d’autres facteurs, en particulier la projection à l’international d’une multitude d’acteurs privés (entreprises, missionnaires, universités, fondations, ligues de tempérance, organisations para-religieuses, etc.) qui vont promouvoir d’un même mouvement les intérêts commerciaux et les valeurs américaines partout dans le monde35, et dilater du même coup les champs d’action de la diplomatie américaine. L’investissement des grandes fondations dans la SdN s’inscrit clairement dans cette logique.
L’émergence de cette multiplicité d’acteurs privés va contribuer à la construction d’une politique étrangère fonctionnant selon des règles nouvelles. La division du travail, pas toujours concertée, entre acteurs publics et privés, est l’un des aspects essentiels de cette nouvelle diplomatie. Elle est fondée sur une perméabilité, institutionnalisée dans la vie politique américaine, entre les sphères gouvernementale et non gouvernementale. En effet, les passerelles entre les deux sont nombreuses, et l’on verra au cours des pages suivantes de nombreux acteurs impliqués dans les relations entre les États-Unis et la Société des Nations passer de l’une à l’autre (James T. Shotwell, Raymond B. Fosdick, Elihu Root, Nicholas Murray Butler, Arthur Sweetser…), de sorte qu’il est difficile de tracer une frontière nette entre les deux. Dans l’arène internationale dominée jusqu’à la ← 14 | 15 → fin du XIXe siècle par les diplomates professionnels36, cette distribution des rôles est une nouveauté qui déstabilise les Européens, non seulement parce qu’ils doivent traiter avec une multitude d’acteurs qui ont des statuts, des pratiques et des objectifs différents, mais aussi parce que la politique étrangère est, aux États-Unis plus qu’ailleurs, soumise aux enjeux intérieurs37 qui s’expriment en particulier à travers les votes du Congrès, ce dernier ayant dans le domaine extérieur des prérogatives sans équivalent dans les autres parlements des grandes puissances. Cette dilatation des formes et des domaines d’intervention de la diplomatie américaine se voit clairement dans les relations entre les États-Unis et la Société des Nations, puisque celles-ci se déroulent avant tout dans les sections techniques, qu’il s’agisse d’économie, d’hygiène, de coopération ou de lutte contre le trafic de drogue. Si les États-Unis construisent une nouvelle diplomatie dans l’entre-deux-guerres, ce n’est, à tout prendre, peut-être pas tant du fait des positions adoptées par Wilson dans ses Quatorze points (positions qui tombent aux oubliettes après l’échec de la ratification jusqu’à leur résurgence en 1945), que parce que la diplomatie américaine, au-delà de son ambition mondiale, fonctionne structurellement selon d’autres règles que celles de ses interlocuteurs européens, en particulier du fait de la synergie entre acteurs privés et publics qui la coproduisent. La superpuissance américaine naissante apparaît ainsi non pas comme la seule résultante de la puissance militaire, mais aussi de la profusion d’acteurs intéressés à faire acquérir aux États-Unis une position centrale dans l’organisation du monde, et ce, dans tous les domaines.
L’analyse des relations entre les États-Unis et la Société des Nations invite à reconsidérer une troisième histoire, celle du système des organisations internationales. On l’a vu plus haut, la perspective classique consiste à considérer qu’il y a rupture entre le système créé en 1919 et celui qui voit le jour en 1945, notamment du fait de l’absence des États-Unis de la SdN, et, par contrepoint, de leur rôle structurant dans la mise sur pied du système ← 15 | 16 → de l’ONU. Or, comme on le verra dans les pages qui suivent, les États-Unis ne sont pas absents de la SdN. Ils sont impliqués dans le système sociétaire dès 1919, et ce, dans toutes ses strates, y compris les strates politiques, notamment à travers leur présence aux conférences internationales. Plus encore, ils contribuent dès le début des années 1920 à modeler le système sociétaire, notamment en contribuant à l’expansion des sections techniques. Celles-ci tiennent en effet une place secondaire dans le Pacte de la SdN, et leur développement au cours des années suivantes s’explique largement par le financement abondant que certaines d’entre elles reçoivent tout au long de leur histoire de la part des fondations américaines, en particulier celles de la galaxie Rockefeller. Il importe donc de rompre avec le récit classique selon lequel la SdN devrait sa création à Woodrow Wilson avant que les États-Unis ne s’en désintéressent. C’est en fait une image, sinon inverse, du moins très différente, qui se dégage : en effet, si Wilson a joué un rôle majeur, la Société qu’il a contribué à créer a des contours vagues ; en particulier, le président américain s’est peu intéressé aux activités non politiques, qu’il n’a guère mis d’énergie à défendre lors de la rédaction du Pacte, à l’exception de l’Organisation internationale du travail. Mais au cours des années suivantes, et notamment la décennie 1930, ce sont ces activités qui vont connaître la plus grande croissance. La SdN ne s’oriente donc pas précisément dans la direction prévue par Wilson ; mais le développement de ses sections techniques est quand même en partie dû à la présence des États-Unis.
La participation des Américains aux sections techniques consiste non seulement à les financer, mais aussi à participer à leurs travaux, et à favoriser le développement d’une expertise dans un certain nombre de domaines (économie, santé, etc.), ainsi qu’à mettre les experts des différents pays en relation les uns avec les autres en fonction des projets qu’ils souhaitent voir aboutir. Cette politique visant à systématiser la circulation d’hommes et de savoirs, typique des fondations américaines, se manifeste par la création de réseaux transatlantiques dont les sections techniques de la SdN sont des points nodaux. Pour saisir ce processus, il est important de s’intéresser non seulement à la dimension institutionnelle des financements américains, mais aussi et surtout aux acteurs qui composent les institutions financées ou coopèrent avec elles. C’est ici que l’on saisit la spécificité de la participation des acteurs privés à la politique étrangère ← 16 | 17 → américaine. Or, si la sociologie et la science politique ont développé une littérature théorique importante sur les réseaux, les études empiriques sur leur déploiement historique, en particulier à l’échelle internationale, restent très rares. Cet ouvrage entend combler une lacune de ce point de vue.
La Société des Nations est en effet un observatoire de choix pour comprendre le fonctionnement des réseaux internationaux, car elle est un carrefour entre de multiples milieux scientifiques. La perspective adoptée ici consistera donc à la considérer non pas comme un bloc homogène, mais comme une structure ouverte et un lieu de rencontre entre experts venus d’horizons différents qui y élaborent des savoirs et des pratiques qui vont constituer le répertoire d’action des organisations internationales jusqu’à aujourd’hui. Cette perspective permet de prendre en compte l’action des États non-membres sur le terrain : en effet, la distinction entre États membres et non-membres, si elle est claire en théorie, l’est nettement moins dans les faits, car les multiples commissions d’experts créées dans le cadre des activités techniques comprennent de nombreux ressortissants d’États non-membres. C’est notamment – et surtout – le cas des États-Unis, qui sont pleinement impliqués dans la quasi-totalité d’entre elles ; non seulement ils y sont l’un des pays les mieux représentés, mais ils participent de façon active à leurs travaux, même si dans bien des cas leur présence ne se traduit pas par un droit de vote – mais l’on sait qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un droit de vote pour influer sur le travail d’une commission. Les États-Unis étant officiellement absents de la SdN, c’est en analysant leur place et leur rôle dans ces réseaux d’experts agissant dans l’orbite des sections technique que l’on peut saisir leur place réelle à la SdN, d’autant plus que c’est dans ces commissions que s’effectue l’essentiel du travail de la Société. De ce point de vue, la capacité des Américains à s’insérer dans des réseaux internationaux, à en créer d’autres, et à y acquérir une place centrale afin de donner le ton dans la production et l’utilisation du savoir, est l’un des facteurs qui contribuent à construire la superpuissance intellectuelle américaine dès l’entre-deux-guerres. Cette capacité est le résultat de la possession d’une force de frappe logistique, intellectuelle et scientifique sans précédent dans le monde, du fait d’un système universitaire en pleine croissance, d’un ensemble d’instituts d’expertise privés ou semi-publics qui produisent et appliquent un savoir, et de fondations qui jouent ← 17 | 18 → à la fois le rôle de financeurs, de médiateurs entre producteurs de savoirs venus de différents pays, mais aussi de pourvoyeuses d’idées et de directions générales de travail, et enfin de coordinatrices à l’échelle internationale. Cette dimension, invisible si l’on analyse la Société des Nations avec une perspective purement gouvernementale, apparaît pleinement lorsque l’on tourne son regard vers les acteurs privés. L’analyse du rôle des grandes fondations dans cette perspective a montré sa pertinence à l’échelle nationale38. On en testera ici la validité à l’échelle mondiale.
L’action en profondeur des internationalistes américains aura pour résultat de façonner une SdN loin des canons wilsoniens, bien que les acteurs impliqués dans la SdN, en particulier la fondation Rockefeller, se réclament du wilsonisme. La politique américaine vis-à-vis de la SdN est en fait triple : elle consiste d’abord à stimuler la croissance des activités techniques au détriment des activités politiques, pour faire de la SdN un vaste réservoir d’expertise et non un forum de décision en matière de politique internationale ; elle consiste ensuite à favoriser l’autonomisation des sections exerçant ces activités vis-à-vis de l’administration centrale de la SdN, pour faire du système sociétaire un ensemble d’organes décentralisés et de conférences ad hoc ; elle consiste enfin à essayer de limiter les initiatives des organes techniques qui cherchent à exercer un rôle de coordination internationale dans les questions qui sont de leur ressort, ou alors à tenter d’en prendre le contrôle. En résumé, le fil conducteur de la politique américaine vis-à-vis de la SdN consiste à favoriser la multiplication des organes spécialisés au détriment de toute politisation de l’institution, et l’autonomisation au détriment de toute centralisation : on ne saurait faire moins wilsonien. L’aboutissement de ce processus est l’explosion du système sociétaire, dont le déménagement d’une partie de l’organisation aux États-Unis en 1940 constitue le signe le plus visible. Cette explosion va faciliter sa reconfiguration entre 1940 et 1945, et du même coup l’installation du leadership américain dans ce processus qui aboutit à la création de l’ONU. On pourra dès lors toujours gloser à l’infini pour savoir si ce processus de démantèlement obéit à une stratégie mûrie dès 1919 par ← 18 | 19 → l’administration fédérale américaine, ou bien si celle-ci se construit au gré des événements et des occasions. La réponse importe en fait assez peu car la logique de l’interaction entre les États-Unis et la SdN conduit de facto à ce résultat.
L’ouvrage qui suit sera organisé en neuf chapitres qui exploreront les différentes facettes de ce processus. Le premier montrera comment la SdN a été en permanence présente dans le débat intérieur américain depuis les années 1910 jusqu’aux années trente, et comment les discussions relatives à sa création et à ses prérogatives résonnent étroitement avec les discussions relatives au rôle que doivent jouer les États-Unis dans le monde d’après 1918. Le deuxième chapitre fournira une première analyse du rôle des acteurs non gouvernementaux, à travers l’étude de la diplomatie menée par la Carnegie endowment for international peace dans le domaine de la sécurité collective, en particulier à travers son rôle dans l’élaboration du Pacte Briand-Kellog. Le troisième chapitre présentera un panorama général des activités techniques, qui constituent le cœur de la participation américaine à la SdN, non seulement parce que leur existence même s’explique en grande partie par la volonté des instances de la SdN de rapprocher les États-Unis du système sociétaire, mais aussi parce que les fondations américaines les ont abondamment financées. Les chapitres suivants illustreront cette idée à travers l’étude de plusieurs organisations techniques où les États-Unis sont impliqués : l’Organisation d’hygiène (chapitre IV), la Commission internationale de coopération intellectuelle et l’Institut international de coopération intellectuelle (chapitres V et VIII), l’Organisation internationale du Travail (chapitre VI), et l’Organisation économique et financière (chapitres VII et IX). Ces cas présentent des facettes différentes de la participation américaine, de son importance et de son impact. Mais tous illustrent à la fois l’investissement croissant des États-Unis dans le système sociétaire au fur et à mesure que l’on avance dans l’entre-deux-guerres, et montrent la dialectique complexe qui s’opère du fait de cet investissement, entre le développement de ses activités et le démantèlement du système, un processus qui connaît son aboutissement en 1940 avec le déménagement d’une partie de l’Organisation économique et financière aux États-Unis, suivi de sa contribution importante à la réorganisation du monde d’après-guerre. De ce point de vue, l’histoire de la Société des Nations se poursuit naturellement dans celle de l’ONU. ← 19 | 20 → ← 20 | 21 →
1 Extract from the report of the Director to the trustees of the Institute of advanced study, 14 October 1940, RF 1.1/100/18/154. Pour la signification des abréviations utilisées pour désigner les fonds d’archives, se reporter en fin d’ouvrage à la rubrique « Sources ».
2 On signalera quelques exceptions, comme les travaux de Victor-Yves Ghébali : voir par exemple La Réforme Bruce, 1939-1940, Genève, Centre européen de la dotation Carnegie pour la paix internationale, 1970 ; « Aux origines de l’Ecosoc : l’évolution des commissions et organisations techniques de la Société des Nations », Annuaire Français de Droit International, 18, 1972, pp. 469-511 ; ou L’Organisation internationale du travail (L’organisation internationale et l’évolution de la société mondiale, vol. 3, sous la direction de Roberto Ago & Nicolas Vaticos), Genève, Georg, 1987. Parmi les autres travaux anciens, on citera par exemple The League of Nations in Retrospect, Actes du colloque, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1983.
3 On se contentera ici de donner deux références : Pedersen Susan, « Review Essay : Back to the League of Nations », The American Historical Review, 112-4, 2007, pp. 1091-117 ; voir également le site History of the League of Nations <http://www.leagueofnationshistory.org/homepage.shtml>, qui recense les chercheurs travaillant sur la SdN et leurs travaux publiés ou en cours.
Résumé des informations
- Pages
- X, 418
- Année de publication
- 2016
- ISBN (Broché)
- 9783034320528
- ISBN (MOBI)
- 9783035197075
- ISBN (ePUB)
- 9783035197082
- ISBN (PDF)
- 9783035203349
- DOI
- 10.3726/978-3-0352-0334-9
- Langue
- français
- Date de parution
- 2015 (Décembre)
- Mots Clés (Keywords)
- philanthropie entre-deux-guerres Organisation d'hygiène Organisation économique et financière institut international de coopération intellectuelle Etats-Unis Société des nations
- Publié
- Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2016. X, 418 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG