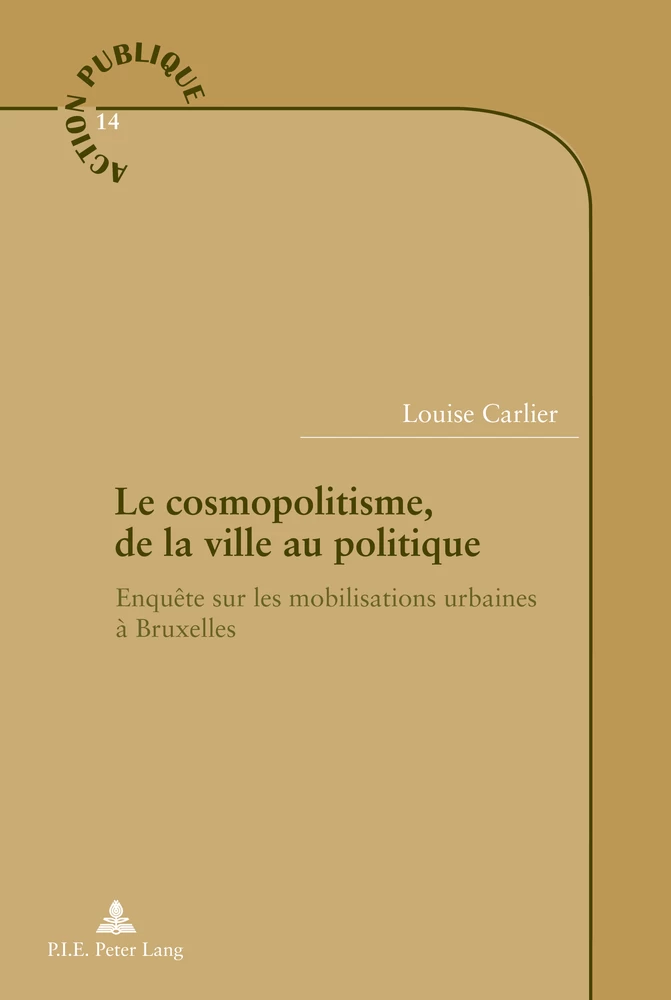Le cosmopolitisme, de la ville au politique
Enquête sur les mobilisations urbaines à Bruxelles
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur/l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction
- Première partie une approche sociologique de la ville cosmopolite
- 1. Le cosmopolitisme dans l’œuvre de R.E. Park
- 1.1. Le contexte de la pensée de l’auteur
- 1.2. L’approche sociologique de R.E. Park
- 1.3. La ville cosmopolite
- 1.4. Le cosmopolitisme comme horizon politique
- 2. Hospitalité et citoyenneté
- 2.1. L’héritage kantien
- 2.2. Hospitalité et citoyenneté d’un point de vue sociologique
- 2.3. Différents modèles de cosmopolitisme
- 2.4. Ouvrir l’enquête
- Deuxième partie enquête sur le cosmopolitisme à bruxelles
- 1. Les bouleversements de Bruxelles comme ordre écologique et comme ordre politique dans les années 1960
- 1.1. L’Exposition universelle de 1958
- 1.2. La ville, un ordre politique ?
- 1.3. Les modifications écologiques de la ville
- 2. Les luttes urbaines ou l’hospitalité au regard de deux figures d’étrangers
- 2.1. La communauté de voisinage au cœur de la mobilisation
- 2.2. Deux figures d’étrangers en face-à-face
- 2.3. Le droit à la ville
- 2.4. La citoyenneté, condition à l’hospitalité urbaine
- 3. Lesaléasduvivreensemble
- 3.1. Vers une lecture culturelle des différences
- 3.2. La nouvelle question urbaine
- 3.3. Une autre figuration de la communauté urbaine
- 3.4. Cosmopolitisme et globalisation
- 4. Le cosmopolitisme comme projet de ville
- 4.1. Les dynamiques d’association au fondement du « projet »
- 4.2. Le cosmopolitisme comme projet urbain et politique
- 4.3. Ancrer le cosmopolitisme dans l’écologie de la ville
- Conclusion
- Bibliographie générale
- Titres de la collection
Bruxelles est une ville souvent qualifiée de cosmopolite. Elle se présente d’une part, comme une « ville globale », son statut de capitale européenne attirant de nombreuses entreprises multinationales et associations internationales ; et d’autre part, comme une ville d’immigration, sa population se composant pour une grande partie d’habitants de nationalités étrangères, nés étrangers ou de parents étrangers. On y croise une diversité de « figures de l’étranger », comme dans toute grande ville certes, mais avec la particularité que, ce mélange y est perceptible, les espaces centraux de la ville contenant cette diversité.
De nombreux acteurs bruxellois convoquent aujourd’hui le cosmopolitisme à la fois pour caractériser la ville et pour définir un projet (politique, économique, culturel) pour celle-ci. Si cette notion apparaît à Bruxelles comme une évidence, elle s’impose aujourd’hui au-delà. Le « cosmopolitisme » est un terme qui revient de manière récurrente, tant dans les conversations ordinaires que dans les discours publics, tant dans les articles de presse que dans les ouvrages de sociologie, d’anthropologie et de philosophie pour approcher des objets aussi divers que les pratiques culturelles, les villes, ou l’horizon politique dans le contexte de la globalisation.
Mais que signifie, au juste, ce terme ? Son évocation suscite, quelques fois, l’agacement propre aux mots qui, chargés d’une pluralité de significations, semblent perdre de leur force et de leur consistance à mesure qu’ils sont énoncés. Il s’agit pourtant d’un concept au cœur de notre modernité démocratique, empreint de promesses et d’exigences qui sont à la hauteur des écueils de sa concrétisation. Le cosmopolitisme ouvre à la question, haute d’exigences éthiques et politiques, d’un ordre commun dans un contexte de différence ou d’hétérogénéité culturelle, question déjà posée par les philosophes de l’Antiquité grecque et aujourd’hui au cœur de l’actualité.
La réflexion contemporaine du cosmopolitisme prend place dans le contexte de la globalisation ; il est approché à la fois par la sociologie, qui en étudie les formes concrètes, et par la pensée philosophique, qui le charge de promesses éthiques et politiques. Cette réflexion tend ainsi aujourd’hui à être dissociée entre deux angles de vue. ← 9 | 10 →
Le cosmopolitisme du point de vue de la sociologie
En sociologie, le concept de cosmopolitisme retrouve une place de choix pour saisir des phénomènes de recomposition spatiale, culturelle, identitaire, liés à la mobilité accrue des capitaux et des hommes. Pour U. Beck, en sciences sociales, c’est « la transformation globale de la modernité et de ses prospectives, qui appelle à repenser le cosmopolitisme » (2007, p. 223). Une sociologie de la globalisation va alors tenter d’imposer un tournant dans les sciences sociales (Abélès, 2008 ; Sassen, 2009 ; Beck, 2007), invitées à saisir cette globalisation comme processus multidimensionnel et à en étudier les contours. C’est dans ce cadre que le terme de « cosmopolitisme » va s’imposer. On constate l’émergence de tout un courant nommé parfois globaliste, parfois mondialiste, référant le cosmopolitisme à des pratiques globales, déterritorialisées, saisissables dans des « flux » (Friedman, 2004b ; Assayag, 1998 ; Abélès, 2008). Les formes culturelles translocales y sont prises comme objet privilégié de l’analyse et appréhendées en termes de métissage, d’hybridité, de créolisation ou de cosmopolitisme. La sociologie doit alors prendre ses distances avec l’ethnographie micro-locale pour privilégier une approche diasporique, centrée sur la dynamique des flux, qui serait plus adéquate en régime de globalisation – comme le propose, par exemple, A. Appaduraï (2005).
Pour d’autres, la globalisation s’inscrit d’abord dans des lieux. Ce débat divise la pensée sociologique autour de la pertinence heuristique de la ville comme objet d’analyse pour saisir ces nouvelles dynamiques. A. Tarrius (2001, 2007a, 2007b) et S. Sassen (2004, 2009) représentent deux points de vue qui s’opposent quant à la pertinence de la ville pour la lecture de ces dynamiques globales. Pour le premier, le cosmopolitisme suppose de considérer la « fluidité » propre à la globalisation – les réseaux qui traversent la ville, la mobilité qui caractérise les nouvelles formes migratoires émergeant durant le milieu et la fin des années 1980 en Europe, et soutenant la constitution d’économies internationales, « souterraines » ou « affairistes ». Il considère que de « nouveaux cosmopolitismes » sont portés par les populations qui traversent ces « territoires circulatoires » (2007a, p. 152), et constituent des réseaux internationaux : « élites professionnelles circulantes » et « petits migrants ». Ce sont eux qui soutiennent des « constructions cosmopolites nouvelles » (ibid., p. 146). La ville devient donc un espace de côtoiement momentané, un support de ces réseaux : « la cité est un point de passage, d’échange, une halte où l’on se reconnaît – un espace traversé plus qu’habité » (ibid.). En tant que telle, elle constitue un « territoire circulatoire », au même titre que les points de passage et les routes qui structurent ces réseaux d’échanges. C’est dans ce type de territoire qu’émergent des « valeurs ethniques ← 10 | 11 → et économiques trans-versales, trans-frontalières, inter-culturelles, inter-ethniques » (ibid., p. 158) au fondement du cosmopolitisme : « il est espace-temps de la transition-mondialisation, il est intermédiaire, nouvelle instance intégratrice aux sociabilités plus cosmopolites » (ibid.). Le cosmopolitisme se loge alors dans ces relations caractérisées par ce préfixe du trans- ou du inter-, émergeant des dynamiques économiques de circulation. Mais il se trouve également dissocié de la ville. Pour S. Sassen, il en est tout autrement : la ville reste un lieu d’analyse privilégié pour comprendre les phénomènes de « globalisation » car la ville est le lieu de leur cristallisation : « Les grandes villes autour du monde sont le terrain sur lequel une multiplicité de processus de globalisation prennent des formes concrètes et localisées » (2009, p. 133). Elle critique l’approche sociologique de la globalisation qui tend à ne considérer que des flux et à oublier les lieux dans lesquels ils se concrétisent et qui les rendent possibles : « Les images maîtresses dans le récit à présent dominant de la globalisation économique insistent sur l’hypermobilité, les communications globales et la neutralisation du lieu et de la distance » (ibid., p. 103). Or, pour S. Sassen, « bon nombre des ressources nécessaires aux activités globales ne sont pas hypermobiles mais au contraire profondément implantées dans des lieux comme les villes globales » (ibid., p. 104) – qu’il s’agisse des infrastructures, des élites globales, ou des travailleurs plus précarisés. Sassen invite à retrouver le rôle de la ville dans la sociologie tel qu’il s’est notamment formé dans la première moitié du 20e siècle, pour l’École de Chicago comme pour G. Simmel ou M. Weber : « Pour eux, étudier la ville n’était pas simplement étudier l’urbain. Il s’agissait d’étudier les processus sociaux majeurs d’une époque » (ibid., p. 106). Si la sociologie a ensuite délaissé la ville comme outil d’analyse sociologique, elle affirme l’importance de reconsidérer sa pertinence heuristique. Ce point de vue rejoint celui de J.-F. Côté, pour lequel la globalisation donne tout son sens à la ville comme espace du cosmopolitisme : « Les villes-métropoles étant les dépositaires privilégiés de ces développements liés au phénomène de la mondialisation, ce sont elles en effet qui paraissent être à l’avant-plan de la représentation du cosmopolitisme contemporain » (2005, p. 239). Parce qu’elles sont le lieu du face-à-face entre le capitalisme mondialisé et ceux qu’il tend à exclure, et plus largement, des contradictions et des tensions qui divisent le monde contemporain.
Le cosmopolitisme du point de vue de la philosophie
En philosophie politique, le cosmopolitisme constitue un horizon politique et moral propre à la modernité démocratique. La conception contemporaine du cosmopolitisme est principalement redevable d’un auteur, E. Kant, qui en a livré sa définition moderne. Pour ce dernier, le ← 11 | 12 → cosmopolitisme a pour horizon normatif la « paix perpétuelle » entre les peuples tout en étant envisagé comme une concrétisation historique et processuelle. Le cosmopolitisme réfère à l’instauration d’une communauté de droit entre tous les êtres humains, à « un projet d’intégration juridique et politique de l’humanité » via un « art communicationnel » fondé sur la faculté de juger (Cheneval, 2005, p. 169). Si les principes politiques modernes (comme ceux de souveraineté, d’égalité, de citoyenneté, de liberté) trouvaient progressivement, à l’époque de E. Kant, un espace de réalisation dans le cadre l’État-nation, il n’en est plus de même aujourd’hui. L’État-nation ne paraît plus comme le lieu de l’émancipation individuelle et collective fondée sur la contractualisation des rapports entre les êtres humains et la définition collective d’un dessein partagé : la mondialisation entraîne une rupture face à ce projet d’émancipation. Comme le note F. Cheneval, il perd « sa capacité de rationaliser, d’organiser et de démocratiser la société » (ibid., p. 258). C’est en réponse à cet « échec » que s’impose alors le cosmopolitisme, en vue de donner une orientation éthique, politique ou juridique à la mondialisation, dans le respect des principes politiques modernes. Pour J.-M. Ferry, « l’idée cosmopolitique se profile comme instrument puissant pour combler le vide laissé par la mondialisation » (2000, p. 36) et nombreuses sont les pratiques et les aspirations morales qui attestent que « l’idée cosmopolitique s’éveille aujourd’hui à l’actualité » (ibid., p. 14). Dans la lignée d’Habermas (1981), la mondialisation est vue comme une « radicalisation de la modernité » (Ferry, 2000, p. 258). Il n’y a donc pas de rupture entre le cosmopolitisme moderne et postmoderne, mais plutôt une continuité (ibid., p. 261).
La philosophie politique moderne ne doit pas se résigner face à la mondialisation. Elle l’a anticipée dans les faits ainsi que dans les normes. Avec l’idée cosmopolitique, elle possède un instrument conceptuel puissant pour combler le vide politique que la mondialisation a créé en limitant l’importance de l’État-Nation.
Le cosmopolitisme des Modernes – principalement représenté par E. Kant – était un projet utopique, basé sur des principes moraux et politiques propres à la Modernité politique, s’imposant dans un contexte d’interdépendance croissante des États-nations, mais qui ne trouvait alors pas de formes concrètes de réalisation. Au contraire, il tend aujourd’hui à désigner de nouvelles pratiques et institutions politiques transnationales dans le cadre de l’érosion des États-nations. J.-F. Côté note ainsi « la distance prise à l’égard du cosmopolitisme moderne, particulièrement en fait parce que le cosmopolitisme, au lieu d’être cantonné à un horizon utopique ou théologique, devient l’enjeu d’un débat véritablement politique » (2005, p. 255). ← 12 | 13 →
Le retour au concept du cosmopolitisme dans les discours sociologiques et philosophiques est donc profondément lié à la volonté de saisir les dynamiques économiques, culturelles et politiques qui s’imposent aujourd’hui. C’est dans le contexte de la globalisation, de l’affaiblissement des États-nations et de la prise en compte de la diversité culturelle des sociétés que le cosmopolitisme s’est trouvé fortement investi tant par la pensée sociologique que philosophique.
Des formes concrètes du cosmopolitisme à son horizon politique
Details
- Pages
- 234
- Publication Year
- 2016
- ISBN (Softcover)
- 9782875743053
- ISBN (PDF)
- 9783035265859
- ISBN (MOBI)
- 9783035297768
- ISBN (ePUB)
- 9783035297775
- DOI
- 10.3726/978-3-0352-6585-9
- Language
- French
- Publication date
- 2016 (January)
- Keywords
- cosmopolitisme mobilisations urbaines hospitalité citoyenneté Ecole de Chicago sociologie urbaine
- Published
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2016. 234 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG