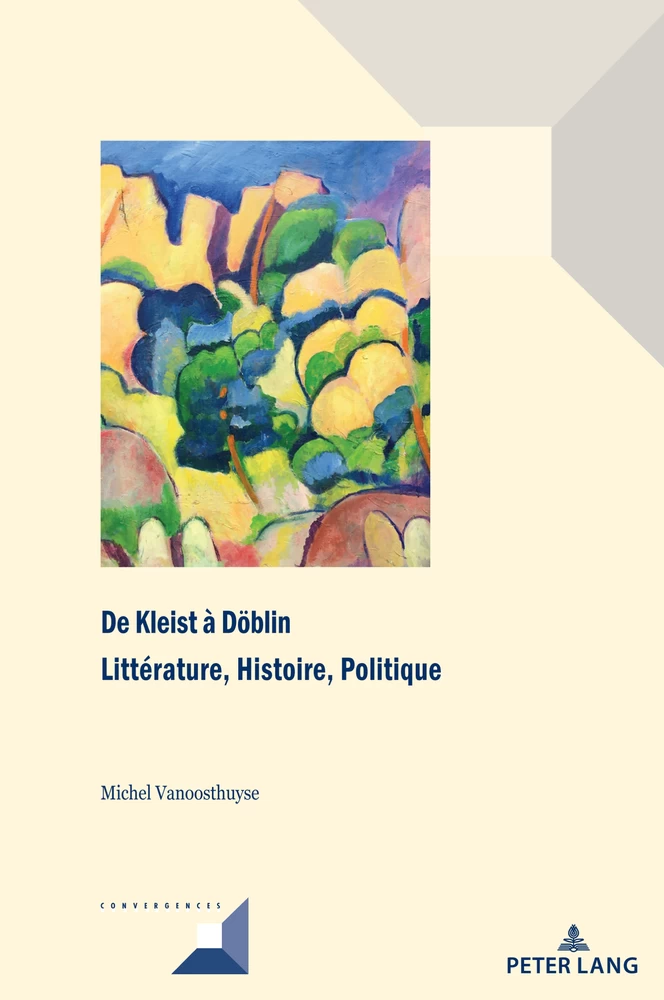De Kleist à Döblin
Littérature, Histoire, Politique
Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Avant-propos
- Du même auteur
- Traductions et préfaces
- I. Identités en question
- Le corps de la marquise
- Ce que dit la bouche d’O…
- Kleist et ses lettres
- Histoires d’eau
- Ce que dit la bouche d’O
- Moritz et son patient
- Je, tu, il
- Illusion d’optique
- Rendre l’autre fou
- Épilogue
- Une écriture de la mémoire : Anton Reiser, de Moritz
- Une expérience très proustienne
- Le journal
- Le roman psychologique
- La mémoire sacrificielle
- D’une logique à l’autre
- Walser Narcisse
- Malte entre l’abject et le sublime
- Des Journaux aux Cahiers
- L’abject
- Écrire
- Décrire : comme Cézanne
- Raconter
- Interpréter
- L’innommable
- Le rire de Kafka
- ÉC-RIRE
- Distanciation
- Le burlesque
- Kafka rêveur
- Espace et identité: Romans pragois au tournant du XXe siècle
- Tucholsky voyageur ou le regard décentré
- Une question de regard
- De la nature
- De la tradition
- Le souci explicatif
- Nostalgie, nostalgie
- Un roman en crise d’identité: L’Homme sans qualités, de Robert Musil
- II. Littérature et Politique 1 : De la liquidation de l’héritage français au bismarckisme
- « Eux et pas nous »: Représentations allemandes de la Terreur
- « Eux et pas nous »
- Le cas Büchner
- Le tournant de 1848
- Le Grand Récit wilhelminien
- Terreur et nationalisme
- Du fantasme révolutionnaire à la « Realpolitik » :: Deux fictions allemandes des années 1850
- Folie française ou démence populaire ?: Visions bismarckiennes de la Révolution française
- « Tuer le mort »
- Folie française
- Guerre d’images
- Exorcisme
- Lutte des classes
- Apocalypse
- Sus à Posa
- Bismarck, Mirabeau allemand
- Un amour de Dahn
- À l’école italienne: Felix Dahn et l’unité allemande
- Une vieille histoire
- La liquidation du rêve autrichien
- Un Bismarck romain
- Le voyage en Italie : une leçon de politique
- Épilogue
- III. Littérature et Politique 2 : La littérature de l’exil (1933–1945)
- Le roman historique dit de l’exil (1933–1945)
- Un vieux couple
- Nouvelles considérations intempestives
- Deux pratiques
- Histoire/Roman: Le débat théorique
- Le roman historique, façon Döblin
- Qu’est-ce que l’histoire ? Avec l’histoire on veut quelque chose
- Vingt ans après
- « Le monde suant les faits par mille pores à la fois »
- « Le roman historique est, premièrement, un roman et, deuxièmement, ce n’est pas de l’histoire »
- La révolution ? Quelle révolution ?
- Que faire ?
- « Tant je suis allemand »
- Le roman historique, façon Brecht
- « Mon maître Döblin »
- Du « théâtre épique » au « roman épique »
- La construction narrative
- Description, sommaire narratif, scène dialoguée
- La référence hispanique dans le roman historique de l’exil
- Le langage de la ruse dans Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale, de Bertolt Brecht
- Savoir et pouvoir dans le Galilée de Brecht
- « Je crois en la raison »
- Sagredo ou le réalisme
- Montage/démontage
- Les résistances du préjugé I
- Les résistances du préjugé 2
- Les résistances du préjugé 3
- Le savoir : une marchandise
- « La science est une vache à lait »
- La leçon du propriétaire
- La leçon de l’Autorité
- Conclusion
- IV. Un mythe français : Ernst Jünger
- Jünger et ses dévots
- La légende
- La fabrique du héros
- Petites manœuvres
- La passion Jünger
- Ernst Jünger ou la fabrique de l’oubli
- Rappels
- De la mémoire à la fiction
- La fabrique de l’oubli
- Jünger en voie de canonisation
- D’Orages d’acier au Travailleur: Naissance d’un fasciste
- Un regard « moderne » ?
- « L’administration du souvenir »
- Du « je » au « nous »
- L’écriture combattante
- Préparer la guerre
- Penser la défaite
- Comment prendre le pouvoir ?
- L’État à venir
- L’hommage de Heidegger
- Le mythe parisien d’Ernst Jünger
- Les trois cercles
- Escamotages
- Petit retour en arrière
- Le virage
- V. Le döblinisme dans tous ses états
- « Linke Poot »: Döblin polémiste
- Döblin autobiographe: Schicksalsreise ou L’Exode et le Royaume
- D’un texte à l’autre
- L’exode et la défaite
- Entre « ciel et terre »
- La mimésis, l’épique et le carnavalesque: Döblin théoricien du roman
- La mimésis indigente du « littérateur »
- Ce que mimésis veut dire
- L’« œuvre épique » et le carnavalesque
- Les mots et la chose: À propos du Rideau noir, roman des mots et des hasards (1903)
- L’amour, les femmes dans Voyage babylonien (1934)
- Épreuves préparatoires
- L’épreuve décisive
- La leçon
- Hamlet ou la longue nuit prend fin: « Une sorte de roman psychanalytique »
- Retour au foyer
- « Une sorte de roman psychanalytique »
- L’enfer du couple
- Edward/Hamlet
- Rédemption
- Berlin Alexanderplatz. Retours
- Index
Avant-propos
Les textes rassemblés ici concernent plusieurs aspects de la littérature essentiellement narrative de langue allemande, celle qui s’est écrite depuis l’époque des Lumières et du Romantisme jusqu’au milieu du siècle dernier.
La diversité du corpus et la multiplicité des auteurs ne devraient cependant pas masquer la relative homogénéité de l’ensemble : qu’il s’agisse des analyses de la relation que cette littérature a entretenue avec la Révolution française, des études consacrées à la littérature antinazie de l’exil, ou encore des travaux centrés sur des écrivains très engagés dans la politique de leur temps comme Döblin ou Jünger, il apparaît que ces pages s’intéressent en priorité aux rapports que la littérature, dans des contextes différents, entretient avec l’histoire et la politique.
En priorité, mais pas uniquement : de nombreuses études, sur Kleist, Moritz, Rilke, Kafka, Musil ou Robert Walser, plusieurs textes concernant Döblin, s’attachent moins à la relation de la fiction à l’histoire, encore que cette dernière ne soit jamais véritablement absente, qu’au travail littéraire envisagé dans sa dimension d’exploration et d’interrogation du sujet sur lui-même.
Mais si la visée des auteurs peut être différente, le principe général qui gouverne l’approche de leurs écrits est un : ce principe est que les œuvres de fiction sont des actes, des processus dynamiques d’exploration et de connaissance. De ce point de vue, il n’y a pas de différence entre une littérature comprise, par exemple, comme un processus d’affranchissement progressif des idées révolutionnaires françaises et les œuvres de Moritz, Kleist, Kafka ou Walser, etc., interprétées comme une quête de soi et une recherche de solutions aux problèmes souvent dramatiques posés par la vie.
Les textes présentés sont partagés en cinq sections : identités en question ; littérature et politique I : de l’héritage français au bismarckisme ; littérature et politique II : l’exil. Deux complexes concernent pour finir des auteurs à tous points de vue antagoniques, qui ont retenu depuis longtemps l’intérêt de l’auteur de ces lignes : Ernst Jünger et Alfred Döblin.
Sauf mention contraire les traductions sont de l’auteur
Du même auteur
Nazisme et antinazisme dans la littérature & l’art allemand (1920–1945), Textes réunis
par André Combes, Michel Vanoosthuyse, Isabelle Vodoz, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1986.
La Révolution française dans l’imaginaire allemand, Études réunies par Michel Vanoosthuyse, Germanica, 1989.
Écritures de la mémoire, Études réunies par Ingrid Haag et Michel Vanoosthuyse, Cahiers d’Études Germaniques, 1995.
Kurt Tucholsky, Études réunies et publiées sous la direction de Michel Vanoosthuyse, Cahiers d’Études Germaniques, 1996.
Le roman historique. Mann, Brecht, Döblin, Paris, Presses Universitaires de France, « Perspectives Germaniques », 1996.
Entre critique et rire. Le Disparu de Franz Kafka, Maurice Godé, Michel Vanoosthuyse (éd.), Montpellier, Bibliothèque d’Études Germaniques et Centre-Européennes, 1997.
Heinrich Heine, Études réunies par Karl-Heinz Götze, Ingrid Haag, Michel Vanoosthuyse, Cahiers d’Études Germaniques, 1998.
Crises allemandes de l’identité, Michel Vanoosthuyse (éd.), Montpellier, Bibliothèque d’Études Germaniques et Centre-Européennes, 1998.
Brecht 98, Poétique et Politique, sous la direction de Michel Vanoosthuyse, Montpellier, Bibliothèque d’Études Germaniques et Centre-Européennes, 1999.
France–Allemagne. Passions croisées, Karl-Heinz Götze, Michel Vanoosthuyse (éd.), Cahiers d’Études Germaniques, 2001.
Fascisme et littérature pure. La fabrique d’Ernst Jünger, Marseille, Agone, 2005.
Alfred Döblin, Théorie et pratique de l’« œuvre épique », Paris, Belin, « Voix allemandes », 2005.
L’Allemagne insolente, études réunies par Michel Vanoosthuyse, Cahiers d’Études Germaniques, 2007.
Les vacances allemandes du KG 37476, récit, Paris, l’Harmattan, 2016.
Traductions et préfaces
Alfred Döblin, Voyage babylonien, Paris, Gallimard, « L’imaginaire », 2007.
Alfred Döblin, Wallenstein, Marseille, Agone, 2012.
Alfred Döblin, Écrits sur la littérature (1913–1948), Marseille, Agone, 2013.
←18 | 19→ Le corps de la marquise
Parmi les récits de Kleist, La Marquise d’O… possède une particularité directement en rapport avec les problèmes de voix et de mode narratifs. Une lecture même rapide du texte permet de relever que la part de ce que Platon nomme la « diégésis », la critique anglo-saxonne le « telling », les Allemands la « berichtende Erzählweise » et qu’on nommera en français faute de mieux le « récit pur », y est moins importante que dans d’autres récits kleistiens, tels Michael Kohlhaas ou Le tremblement de terre au Chili ; on observe qu’ici plus qu’ailleurs domine la scène, dont le dialogue, mené le plus souvent à l’indirect régi, se donne comme le procès-verbal d’un dialogue qu’il serait facile d’émanciper de toute subordination à l’instance narrative. On notera que la fonction dévolue par Kleist à cette dernière est réduite : le rôle du narrateur est principalement celui d’un introducteur et régisseur de verbes déclaratifs (il dit, elle répliqua, elle répondit, etc.) et de metteur en scène signalant les gestes, les attitudes, les placements et déplacements du corps dans l’espace. Si bien que Rohmer, qui a porté La Marquise au cinéma, insiste sur la facilité de la transmodalisation, c’est-à-dire de la traduction d’un médium dans l’autre :
Il apparaît que la nouvelle ne fournit pas seulement le sujet d’un film, mais qu’elle est déjà un vrai scénario sur lequel peut s’appuyer le travail du metteur en scène sans la médiation d’une adaptation1.
Rohmer montre d’ailleurs dans son film que les sommaires narratifs, eux aussi, sont traduisibles en dialogues : c’est ainsi, par exemple, qu’il met le court sommaire présentatif qui ouvre le récit dans la bouche de deux ou trois personnages en train de converser.
La forte présence de dialogues et l’absence conjointe du narrateur en position de commentateur constituent certainement un des facteurs qui contribuent à transformer la nouvelle en énigme et à susciter l’activité herméneutique du lecteur ; il existe d’autres facteurs visant le même effet, comme la célèbre paralipse du début, c’est-à-dire l’omission volontaire d’un élément fondateur de la situation, un trou du texte qu’on ne cherche à localiser ni ne localise qu’après-coup, qu’autant qu’il y a grossesse avérée et qu’il faut bien assigner un lieu et un temps à l’acte sexuel que le texte dérobe et dont il n’est pas dit, dont il n’est dit nulle part, qu’il s’agit d’un viol, ce qui ouvre à l’imagination de l’herméneute des horizons supplémentaires. Cette ruse du texte va de pair avec le parti pris de focalisation externe dont Kleist fait un usage non exclusif (il y a en particulier une exception notable au centre du texte sur laquelle on reviendra : le retour de la marquise dans son domaine est en effet traité ←19 | 20→ en focalisation interne, ce que Rohmer traduit justement par un monologue), mais néanmoins dominant ; cette convention narrative, on le sait, interdit d’entrer dans la « conscience » des personnages, donc dans leur psychologie, et oblige à inscrire celle-ci dans les gestes, les attitudes, les rougeurs, les pâleurs, bref le corps, et donc dans une symptomatologie dont l’interprétation n’est toutefois pas livrée. Le dit des sentiments est traduit en monstration physique : d’une certaine manière, la marquise, par exemple (mais aussi, dans une moindre mesure, le comte) parle moins qu’elle n’est parlée par son corps. Celui-ci n’est pas représenté (il n’existe pas de portrait physique de la marquise), mais il est présent dans les signes qu’il livre : la marquise s’évanouit, rougit, baisse les yeux, s’absorbe dans son travail, se déchaîne, etc. ; c’est ce langage du corps qui dit ses sentiments, sans que cette gestuelle soit accompagnée de parole explicative.
Les herméneutes, ayant comme la nature horreur du vide, tentent de pallier l’absence d’explication par l’invention de schémas interprétatifs destinés à donner une cohérence à des comportements en apparence incompréhensibles. Cela vaut d’abord pour la marquise, dont certaines des réactions, énigmatiques pour les autres personnages, le sont aussi au premier regard pour le lecteur. C’est ainsi, par exemple, qu’on peut fournir trois ou quatre interprétations différentes, parfois complémentaires, de la réaction de rejet et de fuite que suscite chez la marquise dans sa retraite l’irruption inopinée du comte. Ces interprétations ont leur vraisemblance, l’ennui est qu’on ne peut en affirmer ni en infirmer aucune. La plus courante est celle du refoulement (qui s’appuie sur cette phrase trop belle en l’occurrence : « je ne veux rien savoir »), mais refoulement de quoi ? De la représentation traumatisante du viol ? Mais il est dit que la marquise est évanouie. Faut-il alors penser que son corps se souvient et que cette mémoire parle ici ? Mais où sont les indices confortant cette explication ? Ou bien faut-il penser qu’elle n’a fait que fermer les yeux, mais c’est tomber dans la trivialité, qui consiste à suggérer que la femme violée l’a cherché – lecture triviale que Kleist lui-même ironise dans l’épigramme bien connu paru en avril–mai 1808, soit un an après la première édition du récit :
Ce roman n’est pas pour toi, ma fille. Évanouie ! Quelle farce ! Elle ne fit, je le sais, que fermer les yeux2.
Depuis toujours donc les interprètes s’enfoncent dans le trou du texte et il n’est pas rare qu’ils en ressortent l’esprit lesté de bien des imaginations. Le texte de Kleist est une machine à fantasmes. Mais une construction énigmatique si peu avare d’indices de toutes sortes, un « coup de texte » si patent, presque si grossier, est lui-même un piège dont on peut se demander s’il ne détourne pas d’un autre enjeu, qui ne concerne ni la marquise, ni le comte, ni leurs affaires, mais Kleist et le sens qu’a pour lui pareil récit de viol, de conception immaculée/maculée, et de réparation. Le locuteur/scripteur Kleist cède la place à des énonciateurs derrière lesquels il s’efface, d’autant mieux qu’il choisit une structure moins épique que ←20 | 21→ dramatique, et donc plus ouverte sur la polyphonie, d’autant mieux aussi que l’instance narrative est absente et que la focalisation externe projette les conflits intimes dans l’objectivité d’un spectacle – il n’empêche : c’est quand même Kleist qui parle ici, de ses conflits intimes et, pour tout dire, de sa relation au sexe et au beau sexe.
Quand on est moins obnubilé par l’énigme et le problème de sa résolution, on se crée les possibilités d’une approche d’un fait de structure qui, d’une certaine manière, entre en contradiction avec celui de l’énigme (qui repose sur la distillation d’informations partielles et donc sur une attente du nouveau) : il s’agit du phénomène de la répétition.
Quatre moments dramatiques et à forte charge émotionnelle scandent en effet le texte : il s’agit des quatre rencontres qui mettent en présence les deux protagonistes principaux du récit, seuls ou pris dans le groupe (l’homme est toujours seul, la femme toujours accompagnée, sauf une fois). Le comte apparaît une première fois à la marquise et l’arrache des mains de ses violeurs (pour la prendre à son tour, mais le lecteur l’ignore encore) ; il surgit une seconde fois dans la famille alors qu’on le croyait mort ; il surprend la marquise dans le domaine où elle s’est retirée seule, après avoir été chassée de la maison de ses parents ; et enfin, c’est lui qui se présente devant la mère et la fille le fameux 3 à 11 heures, alors qu’on ne l’attendait pas. Ces épisodes ont en commun de ne pas être préparés par des annonces et de créer la surprise ; le comte a toujours l’initiative : il est à chaque fois une apparition. Il apparaît une première fois à la marquise « comme un ange du ciel » ; il apparaît ensuite à la famille, tel Lazare ressuscité d’entre les morts, comme un « esprit » ; il apparaît à la marquise alors qu’elle est tranquillement installée sous sa tonnelle ; il apparaît enfin au jour fatidique où doit se résoudre l’énigme (qui, à dire vrai, n’a plus guère de mystère pour le lecteur un tant soit peu attentif). Les apparitions du comte tiennent parfois du surgissement miraculeux, et elles sont toujours le résultat d’une effraction, du franchissement d’une frontière : le comte est à la fois passe-muraille et trompe-la-mort. On croit se débarrasser de lui, et le voici qui surgit derechef. Chaque fois un effet de surprise est créé, proche de la sidération, entraînant la paralysie de la parole, la perte de connaissance, la dérobade, la fuite : un moment de désordre incontrôlé, un instant où ça chavire, où çà s’affole, où ça réagit de façon physique, instinctive et, par deux fois, violente.
Le texte semble décliner ainsi diverses modalités masculines de prise de possession. Masculines, parce que c’est l’homme qui a l’initiative de la surprise et la femme qui est l’objet à prendre. C’est l’homme qui se montre, s’arrange parfois narcissiquement et perversement pour prolonger l’instant où on le regarde et jouir de l’effet. En allant vite en besogne, on pourrait dire qu’on a là comme une figure inversée de la vie de Kleist : là où le Kleist de la vie réelle ne cesse de se dérober et de fuir, le comte avance, conquiert, surgit, se dresse, jaillit : il paraît indéniable que ces métaphores rendent compte d’une dimension incontestable du texte et que ce comte ithyphallique en quelque sorte est aussi un rêve de Kleist, dont on n’ignore pas les problèmes qu’il avait de ce côté-là. ←21 | 22→
Si l’on s’en tient là cependant, on réduit la fiction littéraire à n’être que le lieu imaginaire et consolateur où s’annulent les impuissances et les peurs de la vie et, dans ce cas particulier, on fait bon marché des différences de traitement des rencontres en question. Car leur ressemblance ne doit pas effacer les distinctions nécessaires. Si on les considère dans leur succession, on obtient un texte qui, dans un raccourci fulgurant de quarante pages, figure une manière de passage de la barbarie (celle du mâle primitif qui prend sexuellement possession de la femme contre sa volonté et la soumet à son besoin sexuel) à la civilisation et à la domestication du sexuel (le contrat de mariage négocié, la famille), en passant par un stade intermédiaire, une forme atténuée de la prise de possession (le violeur se fait chasseur rusé, la bête cherche à plaire, l’imagination de viol fait place à l’imagination de séduction). On a donc affaire à une sorte de socialisation progressive du fantasme initial, un refoulement de la pulsion archaïque, et on peut dire que ce texte, ainsi considéré, possède une dimension anthropologique. Mais celle-ci est évidemment assujettie à une histoire singulière, mettant aux prises une femme et un homme particuliers, et cette histoire place le mouvement de domestication du sexuel sous un signe précis. Si la barbarie cède devant la civilisation, c’est que la pulsion archaïque, voire sadique du début (il s’agit aussi de salir ce qui est pur, souiller ce qui est blanc, comme l’identification de la marquise avec le cygne couvert de boue le suggère) réclame réparation. La conquête de l’objet (qui n’a ici strictement rien à voir avec du donjuanisme) est soumise à une considération sociale conventionnelle (éviter le scandale en sauvant les apparences) et morale (réparer la faute) : elle s’effectue dans le but de rétablir un ordre, et un ordre conçu de part en part dans une tête masculine. Ce thème est d’ailleurs annoncé métaphoriquement dès le début : le comte allume l’incendie et s’emploie à l’éteindre, « le tuyau à la main » (sic), et il y déploie une énergie forcenée. La hâte du comte vise l’annulation des effets, voire, dans un premier temps, leur prévention (épouser la marquise pour éviter le scandale) et, au-delà, la réintégration dans l’ordre social et familial, en l’occurrence le mariage.
Or ce projet masculin, dont la réalisation devrait apporter un double bénéfice (le corps de la marquise et la bonne conscience retrouvée) ne cesse de se heurter à des obstacles, à des refus, et d’entrer en confrontation avec l’autre. Car la femme est certes cet être violenté, puis rejeté, humilié, moqué – il existe une souffrance de la femme avilie et abandonnée ; il y a un tragique de la marquise, écartelée entre ce que sa conscience lui dit (je suis innocente, aucun homme ne m’a touchée depuis mon veuvage) et ce que son corps lui dit en même temps (j’attends un enfant), et condamnée, y compris auprès des plus proches, à ne pouvoir faire prévaloir l’innocence sur le soupçon. Mais il faut être attentif à cette page singulière (qui est différente des autres par le mode narratif choisi, se trouve au centre du récit et figure un tournant), où la marquise, au terme d’un processus intérieur qui la fait accéder au rang de sujet autonome, ose ce geste inouï, provocateur, défiant les conventions sociales, la convenance bourgeoise et l’ordre voulu par les hommes : faire connaître aux yeux du monde une vérité qui la livre au ridicule et au discrédit auprès des médiocres. Et la marquise ne va pas cesser de déjouer les ←22 | 23→ attentes du comte. La frénésie réparatrice de celui-ci et sa course contre le temps ne rendent que plus remarquables ses échecs successifs. Il ne cesse de prendre des coups. Il ne réparera pas selon les scénarios qu’il a prévus et organisés dans le but d’être en paix avec sa conscience et la morale établie, mais il lui faudra payer aux conditions imposées. Et il devra payer par là où il a péché : par une série de débandades. Une scène spectaculaire, contrepoint de la scène initiale de la conquête brutale, le montre muet, en situation de pénitent, les yeux baissés, baisant le bas de la robe de la colonelle, à qui il demande l’absolution ; il est revêtu des attributs de la virilité (il porte l’uniforme qu’il avait lors de la prise de la citadelle), mais il est à genoux. La marquise a été grugée, lui sera Gros-Jean : loin d’être sensible à la repentance, la marquise se soulève contre l’obscénité qu’il y aurait à s’arranger conventionnellement avec l’ignominie de celui qu’on aime. Les victoires espérées par le comte sont autant d’épreuves soldées par des défaites. Son chemin est en fin de compte moins celui du conquérant que celui du masochiste : c’est un parcours semé d’attentes, d’espoirs déçus, de rebuffades et d’humiliations. Il lui sera certes à la fin beaucoup pardonné, mais à des conditions qui ne sont pas les siennes, et que la marquise impose même à sa famille. Car c’est elle qui gère le temps ; et c’est elle aussi qui choisit de faire la confidence amoureuse sur laquelle s’achève le texte.
Cet abaissement réitéré de la superbe et du pouvoir masculins et, en contrepartie, cette élévation de la femme en la personne de la marquise, sont les signifiés primordiaux de ce récit. Si cette analyse est juste, il faut alors tenter de comprendre ce qui se joue ici pour Kleist. La correspondance, qui est le seul document autobiographique que nous possédons de cet auteur, peut y aider.
Dans les lettres à la fiancée, Wilhelmine von Zenge, qu’il a laissée mijoter pendant cinq ans, Kleist se présente à la fois en pédagogue pédant, en Pygmalion et en aimable réactionnaire. Quelques exemples :
Divers exercices de réflexion pour Wilhelmine von Zenge.
[…] Afin de ne pas exercer ton seul entendement, chère Wihelmine, mais aussi les autres facultés de l’âme, je veux poser un petit problème à ton imagination. Tu devras me décrire la situation qui correspond le mieux à l’idée que tu te fais du bonheur futur dans le mariage3.
Je vais te décrire l’épouse qui peut maintenant me rendre heureux et c’est là la grande idée que je médite pour toi. […] L’idée de faire de toi un jour un être parfait exalte en moi les forces vitales. […] Oh ! mets cette pensée comme un pavois de diamant sur ta poitrine : je suis née pour être mère. Que toute autre pensée, tout autre désir recule devant cette cuirasse impénétrable ! Quel autre but la terre aurait-elle à t’offrir, qui ne soit pas méprisable ? Elle n’a rien qui puisse te donner autant de valeur que l’éducation de natures nobles. […] Bonne nuit, Wilhelmine, ma fiancée, un jour ma femme, un jour la mère de mes enfants4. ←23 | 24→
[…] Je ne veux pas d’une fille achevée, aussi parfaite soit-elle. Je dois la former à moi, l’éduquer, si je ne veux pas qu’il en aille avec elle comme avec l’anche de ma clarinette. On peut en acheter des douzaines à la foire, mais quand on les utilise aucune ne rend un son pur5.
Ces quelques exemples permettent de rendre compte de ce qui s’exprime à maints autres endroits de la correspondance : le souhait masculin d’enfermer la femme dans le cadre idéalisé du mariage et dans son rôle de mère, qui correspondraient à sa « nature » ; l’affirmation des prérogatives du mâle, qui se donne pour mission de former la femme selon ses vœux, mais se garde de jamais l’affronter ; et corollaire : l’absence de tout désir. La correspondance révèle un Kleist noué à lui-même, à son sexe, effrayé par l’autre féminin et peu disposé à lui concéder une liberté ; et ce n’est pas un hasard si le seul désir qui s’exprime dans ces lettres est de nature homosexuelle, le seul corps érotique, celui d’un garçon, l’ami von Pfuel : Narcisse s’aime à travers une figure sublimée de lui-même :
Tu restituais dans mon cœur l’époque des Grecs, j’aurais pu dormir avec toi, cher garçon, tant mon âme entière te tenait embrassé ! J’ai souvent regardé ton beau corps avec les véritables sentiments d’une jeune fille. Il pourrait réellement servir de modèle à un artiste. À travers lui peut-être, si j’en avais été un, j’aurais imaginé l’idée d’un dieu. Ta tête, petite, bouclée, posée sur un cou épais, deux épaules larges, un corps vigoureux, le tout donnant une image idéale de la force comme si tu avais été façonné d’après le plus beau des jeunes taureaux sacrifiés à Zeus. À travers les sentiments que tu as éveillés en moi, j’ai compris toute la législation d’un Lycurgue et ses conceptions sur l’amour entre adolescents. Viens vers moi […]. Je ne me marierai jamais, sois pour moi femme, enfants, petits-enfants !6
Ce beau corps fort et désirable, regardé par les yeux éblouis de Kleist en jeune fille, il apparaît bien dans le récit qui nous intéresse, à cela près que la jeune fille Kleist est une jeune veuve au regard subjugué de laquelle le comte apparaît « beau comme un jeune dieu », après l’avoir possédée. Qu’ici s’insinue à peine masqué un fantasme homosexuel, est clair. Mais ce qui est décisif, c’est que cette figure de mâle sublime, désirant et désirable, ne cesse dans la fiction de prendre des coups ; et que le « jeune dieu » rate de son côté tous les siens (y compris le premier, qu’il vole) ; qu’en revanche la femme est présentée comme accédant à l’autonomie ; et que le texte de fiction reconnaît l’altérité de la femme, quand les lettres ne cessent de la nier et quand, dans la vie, l’homme Kleist ne cesse de la fuir ; dans la vie et dans les lettres, les projets d’installation avec la chère Wilhelmine sur un lopin de terre au cœur de la Suisse profonde au milieu des vaches et une kyrielle de bambins braillards sont ce qu’ils ne cesseront jamais d’être : de la pure Schwärmerei, du rêve creux jamais investi réellement par le désir, ni jamais transformé ni transformable en réalité, une pure référence littéraire – une rêverie rousseauiste, engendrée par ←24 | 25→ l’impossibilité de vivre dans le monde, parce que la vie dans le monde implique justement que l’on sorte de soi, exige confrontation, combat et désir :
Hélas, chère Ulrike, je ne trouve pas ma place parmi les hommes, c’est une triste vérité, mais c’en est une7.
Je veux m’arracher à tous les liens qui me forcent sans cesse à désirer, à envier, à rivaliser. C’est seulement dans le monde qu’il est douloureux d’être peu de chose, non en dehors de lui8.
C’est la folie de mon cœur exalté, de ne jamais pouvoir se contenter de ce qui est et de vouloir ce qui n’est pas9.
Le texte de fiction, lui, s’aventure dans le territoire de l’autre, il fait du sujet un sujet pour l’autre. La femme n’y est pas cet être supposé inconsistant, fait pour la subordination, mais une liberté avec laquelle, une fois qu’elle est reconnue et acceptée, il est possible de bâtir. La fiction réalise ce que la vie refuse, parce qu’elle risque ce que la vie n’ose pas : la confrontation avec l’altérité et sa reconnaissance. C’est pourquoi celui qui parle dans le texte de fiction n’est pas identifiable à celui qui parle dans les lettres : la fiction n’est pas simplement le lieu où se déposent les peurs et les impuissances, elle n’est pas le prolongement de la biographie, mais plutôt le lieu où celle-ci se corrige, où se sondent des terrains nouveaux et s’explorent des territoires inconnus, ici la femme reconnue dans son être propre.
(2000)10
Résumé des informations
- Pages
- 404
- Année de publication
- 2021
- ISBN (Relié)
- 9782807616967
- ISBN (PDF)
- 9782807616974
- ISBN (ePUB)
- 9782807616981
- ISBN (MOBI)
- 9782807616998
- DOI
- 10.3726/b17820
- Langue
- français
- Date de parution
- 2021 (Juillet)
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 404 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG