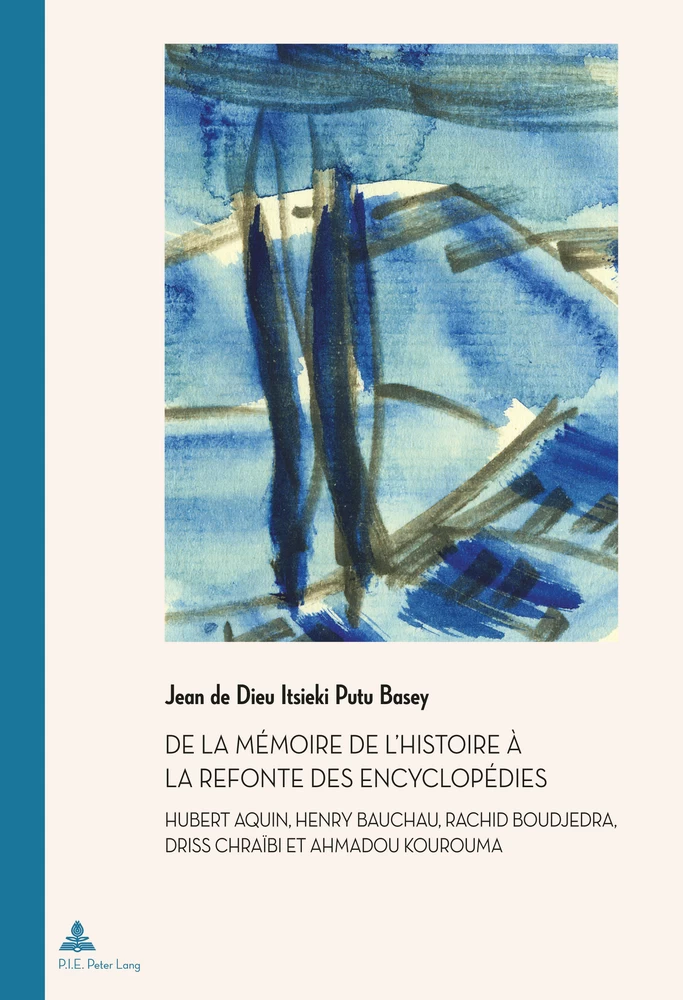De la mémoire de l’Histoire à la refonte des encyclopédies
Hubert Aquin, Henry Bauchau, Rachid Boudjedra, Driss Chraïbi et Ahmadou Kourouma
Résumé
Cinq écrivains francophones, cinq territoires, tous différents à maints égards. Cinq styles également mais cinq tentatives, homologues, pour dire en français hors de France des Histoires et des destins pris dans des situations occultées par les discours dominants.
À la croisée des théories sémiotique, herméneutique, philosophique et postcoloniale, cette étude transversale montre que les fictions francophones proposent souvent, et de façon comparable, une refonte des paradigmes des imaginaires en s’efforçant d’imprimer un cours nouveau à l’Histoire comme aux façons de la dire.
Dès le xixe siècle et Charles De Coster, les romans francophones se sont adossés à l’Histoire pour la réinterpréter. Dissidence, désir de réappropriation et d’invention de nouveaux langages ont été ainsi à l’ordre du jour de façons de dire – et de faire vivre – des identités singulières, minorisées. Leur confrontation avec les Histoires monumentales, anglaise ou française par exemple, et leurs discours, créait une irrésolution. Ces textes la transformèrent en invention d’un transcendant d’un autre ordre, tout sauf monolithique.
Ce livre montre que les romans francophones construisent un éventail de savoirs et d’images à même de corriger falsifications, oublis et silences de l’Histoire monumentale. Chaos, absurdité, voire folie, ne débouchent pas forcément sur du nihilisme. La fictionnalisation du réel dans les espaces francophones ne s’arrête donc pas au constat de la négativité mais commence en ce point aveugle.
Où l’on voit que de ces « périphéries », auxquelles on aimerait réduire les littératures francophones, naissent des œuvres inventives, qui sont précisément le fruit des marges, et la nécessité de créer d’autres formes d’approches du fait littéraire et des œuvres.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos du directeur de la publication
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Advance praise
- Remerciements
- Table des matières
- Introduction
- Première Partie Mémoire du désastre, histoire des résistances
- Chapitre I Survivre à la violence et à l’humiliation coloniale (Monnè, outrages et défis d’Ahmadou Kourouma)
- Conjurer la menace d’effondrement de la dynastie des Keita
- L’événement fatal : la prise de Soba par l’armée française
- « Les lois du Blanc et les besognes du Nègre » : impôt de capitation et travaux forcés
- L’idéal républicain : une autre imposture ?
- Chapitre II Nier la négation, se forger dans la violence de la guerre (Le Régiment noir d’Henry Bauchau)
- « Dans la tanière du tigre » : la machine de la cruelle violence occidentale
- Dans le feu de la guerre, la rencontre : advenir à soi, retrouver le sens avec l’Autre
- Un déchirant repositionnement éthique : « Il faut libérer l’esclave »
- Cheval Rouge et l’Instituteur John : mythologie d’un homme nouveau
- Chapitre III Pour ne point périr : le manifeste de la résistance berbère (La Mère du printemps et Naissance à l’aube de Driss Chraïbi)
- Le Berbère du xxe siècle : « un vieux coq à la recherche de l’ombre et de l’oubli » ?
- Le Berbère des temps anciens : un résistant héroïque et légendaire
- La guerre du temps : « entrer dans les conquérants, corps et âme »
- Chapitre IV Rire de l’histoire pour survivre à la castration originelle (Les 1001 années de la nostalgie de Rachid Boudjedra)
- Les figures boudjedriennes de la dialectique historique
- Survivre dans le désert du temps présent
- L’envers et l’endroit des Mille et une nuits
- Deuxième Partie D’une mémoire, l’autre : autofiction et histoire
- Chapitre V La grande muraille et le sein de pierre (La Déchirure d’Henry Bauchau)
- La blessure originelle : faille destinale et enjeux mémoriels
- L’incendie de Sainpierre : la mémoire du désastre de la guerre
- Le « sein de pierre » ou « l’enfance disjointe par l’ambigüité de la mère »
- La Grande Muraille : du dedans et du dehors, le péril de la décapitation
- Chapitre VI La blessure à l’épaule de l’ennemi : premier acte de la dialectique aquinienne de l’histoire (Prochain épisode d’Hubert Aquin)
- Une histoire d’amour contrarié
- Une certaine incohérence ontologique
- Une histoire des révolutions manquées ?
- La blessure à l’épaule de l’ennemi
- Chapitre VII L’étreinte vénéneuse « deuxième épisode » de la dialectique historique (Trou de mémoire d’Hubert Aquin)
- Dans la « faille » de l’Histoire, un « astre » affranchi de la faute originelle
- Portrait du révolutionnaire en pharmacien : les jumelles de l’anamorphose
- L’étreinte vénéneuse ou le « crime parfait » : deuxième épisode de la dialectique historique
- Troisième Partie Deux paraboles de l’histoire
- Chapitre VIII La parabole de l’épilepsie et du livre volé (L’Antiphonaire d’Hubert Aquin)
- L’Antiphonaire ou l’Histoire comme récitatif et reproduction
- Le Livre volé ou l’Histoire comme fabrication
- L’épilepsie ou comment transformer la maladie en force pour vaincre
- Chapitre IX Le dératiseur et les rongeurs : viol et conflit des mémoires (L’Escargot entêté de Boudjedra)
- La fatalité scellée dans le graphe nominal : autofiction de l’entre-deux
- La dialectique du soleil et de l’ombre : un conflit de mémoires
- Contre le raccourci greco-latin : réhabiliter la mémoire originelle
- Quatrième partie Les routes de l’imaginaire
- Chapitre X Assumer l’héritage de la pauvreté
- Éléments pour une théorie de la refonte d’imaginaires
- La nouvelle geste prométhéenne : déconstruction des symboles mortuaires et construction des mythes alternatifs
- Assomption de l’individualité et quête d’une nouvelle socialité
- Une esthétique de la transfiguration : réinventer l’humain par l’art
- Conclusion
- Index
- Titres de la collection
Jean de Dieu Itsieki Putu Basey
De la mémoire de l’Histoire
à la refonte des encyclopédies
Hubert Aquin, Henry Bauchau,
Rachid Boudjedra, Driss Chraïbi
et Ahmadou Kourouma

Collection
« Documents pour l’Histoire des Francophonies / Théorie »
n° 43
La collection « Documents pour l’Histoire des Francophonies » bénéficie du soutien des Archives & Musée de la Littérature.
Cette publication a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.
Illustration de couverture :© Christian Rolet (détail), collection privée, photographie Alice Piemme / AML
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. PETER LANG s.a.
Éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2017
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com brussels@peterlang.com
ISSN 1379-4108
ISBN 978-2-8076-0379-0
ePDF 978-2-8076-0380-6
ePub 978-2-8076-0381-3
Mobi 978-2-8076-0382-0
DOI 10.3726/b11190
D/2017/5678/39
D/2017/5678/32
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche NationalBibliothek »
« Die Deutsche NationalBibliothek » répertorie cette publication dans la « Deutsche Nationalbibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site <http://dnb.de>.
À propos du directeur de la publication
Docteur (Ph. D.) en études littéraires de l’université Laval (Québec), Jean de Dieu Itsieki Putu Basey enseigne les littératures francophones à l’Institut supérieur pédagogique de la Gombe (Kinshasa / RD Congo). Ses recherches portent sur les imaginaires des sociétés en mutation, l’identité, la mémoire historique et les médiations symboliques des romans issus des espaces francophones. Il a publié, par ailleurs, des oeuvres personnelles telles Les Écailles de l’espérance (2013).
À propos du livre
Au sommaire de ce livre, les oeuvres de cinq écrivains que l’on rapproche rarement : l’Algérien Rachid Boudjedra, le Belge Henry Bauchau, l’Ivoirien Ahmadou Kourouma, le Marocain Driss Chraïbi et le Québécois Hubert Aquin.
Cinq écrivains francophones, cinq territoires. Cinq styles également mais cinq tentatives homologues, pour dire en français hors de France des Histoires et des destins pris dans des situations occultées par les discours dominants.
Dès le XIXe siècle et La Légende d’Ulenspiegel de Charles De Coster, les romans francophones s’adossent à l’Histoire pour la réinterpréter. À travers ce désir de réappropriation et de création, de nouveaux langages expriment et font vivre des identités singulières, toujours minorisées. Leur confrontation avec les Histoires monumentales, anglaise ou française par exemple, et leurs discours, fi nit par ne plus déboucher sur des contradictions irrésolues.
Construire un éventail de savoirs et d’images à même de corriger falsifications, oublis et silences de l’Histoire monumentale devient l’oeuvre des romans francophones. La fi ction procède ainsi à une refonte des encyclopédies même lorsqu’elle met en scène le chaos, l’absurdité ou la folie.
Des « périphéries », auxquelles on aimerait réduire les littératures francophones, naissent des oeuvres inventives. Ainsi, celles des cinq auteurs abordés par ce livre ; une invitation claire à la nécessité de créer d’autres formes d’approches du fait littéraire et des oeuvres.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Documents pour l’Histoire des Francophonies
Les dernières décennies du XXe siècle ont été caractérisées par l’émergence et la reconnaissance en tant que telles des littératures francophones. Ce processus ouvre le devenir du français à une pluralité dont il s’agit de se donner, désormais, les moyens d’approche et de compréhension. Cela implique la prise en compte des historicités de ces différentes cultures et littératures.
Dans cette optique, la collection « Documents pour l’Histoire des Francophonies » entend mettre à la disposition du chercheur et du public, de façon critique ou avec un appareil critique, des textes oubliés, parfois inédits. Elle publie également des travaux qui touchent à la complexité comme aux enracinements historiques des francophonies et qui cherchent à tracer des pistes de réflexion transversales susceptibles de tirer de leur ghetto respectif les études francophones, voire d’avancer dans la problématique des rapports entre langue et littérature. Elle comporte une série consacrée à l’Europe, une autre à l’Afrique et une troisième aux problèmes théoriques des francophonies.
La collection est dirigée par Marc Quaghebeur et publiée avec l’aide des Archives & Musée de la Littérature qui bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Archives & Musée de la Littérature
Boulevard de l’Empereur, 4
B-1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 413 21 19
Fax +32 (0)2 519 55 83
Conseillère éditoriale : Nicole Leclercq
Remerciements
Cette recherche ne se serait pas réalisée, sans l’intervention de beaucoup de personnes qui, dans la patience – l’apprentissage n’étant pas aisée à l’automne de la vie – mais avec beaucoup de rigueur, m’ont apporté leur précieux concours.
Je dis ma profonde gratitude à Madame Anne-Marie Fortier dont, déjà avant la thèse, les conseils m’ont permis de franchir les rudes étapes de cette recherche. Le présent travail doit beaucoup à sa rigueur et à sa perspicacité. Gratitude aussi à Marc Quaghebeur qui, déjà au Congo m’a apporté un appui inestimable, et n’a cessé pendant la rédaction de cette thèse de me faire bénéficier de ses riches expérience et connaissance des francophonies littéraires. Je remercie Mesdames Christiane Kegle (Université Laval), Samia Kassab (Université de Tunis), Cristina Robalo-Cordeira (Université de Coimbra) et Monsieur Richard Saint-Gelais (Université Laval) dont les critiques et remarques éclairées m’ont permis d’améliorer la qualité de cette étude. Je n’oublie pas mon premier maître, Antoine Lema Va Lema, qui a guidé mes pas dans la recherche et me couvre toujours de son attention. J’en sais gré à Madame Émilienne Akonga Edumbe qui, telle Antigone sur le chemin de son père et frère aveugle, m’a soutenu de son bras vaillant.
Mes années de formation à l’Université Laval auront imposé les pires sacrifices à ma famille et surtout à mes enfants. Je voudrais les remercier de leur patience et de leur soutien moral. Le grain semé dans la douleur germe et, sûrement, il portera des fruits qui effaceront nos larmes.
Gratitude, enfin, à toutes et tous qui m’ont apporté l’indispensable chaleur humaine. Les liens tissés dans les tourments survivront et nous serviront de socle pour l’avenir.←9 | 10→ ←10 | 11→
Table des matières
Mémoire du désastre, histoire des résistances
Survivre à la violence et à l’humiliation coloniale (Monnè, outrages et défis d’Ahmadou Kourouma)
Conjurer la menace d’effondrement de la dynastie des Keita
L’événement fatal : la prise de Soba par l’armée française
« Les lois du Blanc et les besognes du Nègre » : impôt de capitation et travaux forcés
L’idéal républicain : une autre imposture ?
Nier la négation, se forger dans la violence de la guerre (Le Régiment noir d’Henry Bauchau)
« Dans la tanière du tigre » : la machine de la cruelle violence occidentale
Dans le feu de la guerre, la rencontre : advenir à soi, retrouver le sens avec l’Autre
Un déchirant repositionnement éthique : « Il faut libérer l’esclave »
Cheval Rouge et l’Instituteur John : mythologie d’un homme nouveau
Pour ne point périr : le manifeste de la résistance berbère (La Mère du printemps et Naissance à l’aube de Driss Chraïbi)
Le Berbère du xxe siècle : « un vieux coq à la recherche de l’ombre et de l’oubli » ?
Le Berbère des temps anciens : un résistant héroïque et légendaire
La guerre du temps : « entrer dans les conquérants, corps et âme »←11 | 12→
Rire de l’histoire pour survivre à la castration originelle (Les 1001 années de la nostalgie de Rachid Boudjedra)
Les figures boudjedriennes de la dialectique historique
Survivre dans le désert du temps présent
L’envers et l’endroit des Mille et une nuits
D’une mémoire, l’autre : autofiction et histoire
La grande muraille et le sein de pierre (La Déchirure d’Henry Bauchau)
La blessure originelle : faille destinale et enjeux mémoriels
L’incendie de Sainpierre : la mémoire du désastre de la guerre
Le « sein de pierre » ou « l’enfance disjointe par l’ambigüité de la mère »
La Grande Muraille : du dedans et du dehors, le péril de la décapitation
La blessure à l’épaule de l’ennemi : premier acte de la dialectique aquinienne de l’histoire (Prochain épisode d’Hubert Aquin)
Une histoire d’amour contrarié
Une certaine incohérence ontologique
Une histoire des révolutions manquées ?
La blessure à l’épaule de l’ennemi
L’étreinte vénéneuse « deuxième épisode » de la dialectique historique (Trou de mémoire d’Hubert Aquin)
Dans la « faille » de l’Histoire, un « astre » affranchi de la faute originelle
Portrait du révolutionnaire en pharmacien : les jumelles de l’anamorphose
L’étreinte vénéneuse ou le « crime parfait » : deuxième épisode de la dialectique historique←12 | 13→
La parabole de l’épilepsie et du livre volé (L’Antiphonaire d’Hubert Aquin)
L’Antiphonaire ou l’Histoire comme récitatif et reproduction
Le Livre volé ou l’Histoire comme fabrication
L’épilepsie ou comment transformer la maladie en force pour vaincre
Le dératiseur et les rongeurs : viol et conflit des mémoires (L’Escargot entêté de Boudjedra)
La fatalité scellée dans le graphe nominal : autofiction de l’entre-deux
La dialectique du soleil et de l’ombre : un conflit de mémoires
Contre le raccourci greco-latin : réhabiliter la mémoire originelle
Assumer l’héritage de la pauvreté
Éléments pour une théorie de la refonte d’imaginaires
La nouvelle geste prométhéenne : déconstruction des symboles mortuaires et construction des mythes alternatifs
Assomption de l’individualité et quête d’une nouvelle socialité
Une esthétique de la transfiguration : réinventer l’humain par l’art
La question que j’aborde dans ce livre, l’écriture de la mémoire et la réinterprétation de l’Histoire dans les fictions romanesques francophones, s’inscrit dans la problématique des rapports complexes du roman à l’Histoire. Pour cerner ces rapports, on peut se référer notamment à Michel Zeraffa, pour qui le roman « est lié à [la] réalité par excellence informe [de] l’histoire, dont tout récit propose une interprétation »1. Davantage, à son avis, « l’apparition du genre romanesque signifie essentiellement qu’il n’est pas de société sans histoire, ni d’histoire sans société. Le roman est le premier art qui signifie l’homme d’une manière explicitement historico-sociale »2. L’interdépendance des deux champs et le défi d’interprétation que met en lumière Zeraffa disent aussi ce que Paul Ricœur appelle « la bifurcation fondamentale entre récit historique et récit de fiction »3. Entre ces « ennemis complémentaires »4, selon l’expression d’Élisabeth Arend, les liens sont d’autant plus complexes qu’en tant que quête de vérité, l’ambition des romanciers croise – voire, le plus souvent, fait concurrence à – celle des historiens de métier. La même complexité s’observe dans la manière dont la fiction romanesque intègre la donne historique et donc, dans la façon dont elle représente l’Histoire. Comme l’indique Peyronie, à côté des œuvres d’époque, « romans dont l’action est située dans la contemporanéité de leur auteur, mais qui prennent fortement en compte la configuration historique des événements qu’ils évoquent »5, on compte nombre d’autres, « qui situent leur action dans une époque largement révolue et n’ont, à l’inverse, aucun souci de la dimension historique du monde qu’ils représentent »6. Si les premières fictions peuvent être quali←15 | 16→fiées d’historiques, les secondes dont le rapport à l’histoire est plutôt distancié, peuvent être qualifiées de méta-historiques. Car elles constituent surtout des contre-histoires : se faisant parfois essai, le roman y engage une réflexion dans laquelle la réalité historique convoquée devient prétexte et ne sert plus que de ressort à la fiction. Dans tous les cas, les représentations fictionnelles de l’Histoire semblent poursuivre un double objectif : d’une part, ainsi que le dit Gisèle Séginger, aussurer la « transmission d’un témoignage historique, dans la connaissance et l’interprétation de l’histoire, dans la construction d’une culture voire d’une identité »7 et, d’autre part, servir comme un moyen efficace de « dévoilement et d’une représentation de l’invisibilité de l’histoire, de son sens caché, méconnu, dénié, de ses ambiguïtés ou de son indicible »8.
Ces rapports de complicité, ou plus souvent de dissonance et de concurrence, s’observent dans les romans francophones, adossés depuis leur émergence à l’Histoire qu’ils réinterprètent sans cesse. Attestée par les travaux des pionniers9 de la recherche dans ce champ littéraire, la prégnance de l’Histoire fait toujours l’objet du discours critique. Gasquy-Resch, par exemple, estime que la littérature québécoise est née de la « contrainte de l’histoire, qui l’amène à chercher une compensation dans le passé, un refuge dans la légende, dans les mythes du terroir qui montrent la non-acceptation de la réalité de son contexte socio-économique »10. Pour Élisabeth Arend, Dagmar Reichardt et Elke Richter, « l’interrogation du passé et la réflexion sur l’histoire accompagnent les littératures francophones pendant tout le xxe siècle et s’intensifient de nos jours »11. La collection « Documents pour l’Histoire des Francophonies » des Archives & Musée de la Littérature (Bruxelles), qui s’est récemment enrichi d’un volume sur Les Sagas dans les littératures francophones12, avait déjà←16 | 17→ publié Les Écrivains francophones interprètes de l’Histoire13. Pour cerner la complexité des rapports du roman francophone à l’Histoire, cet ouvrage articule la réflexion sur « les questions axiales de la filiation, de la dissidence, de l’appropriation de l’Histoire propre comme de la confrontation »14, lesquelles inscrivent une dialectisation dont l’irrésolution révèle « des traces et des ruptures en lieu et place d’une Histoire monumentale »15. Embrassant l’Histoire, la fiction accoucherait donc d’une problématicité essentielle car, disent encore Beïda Chikhi et Marc Quaghebeur, « qu’il s’agisse du deuil colonial, de la prise en compte de l’histoire des populations originaires ou des récits issus des nouveaux migrants, c’est à une déstabilisation foncière des modèles d’interprétation qu’on assiste »16. Dans son essai sur la littérature québécoise, Nepveu souligne « l’ambiguïté accompagnant toute réactivation d’un passé quel qu’il soit : le conflit entre lucidité et mythification, entre volonté d’atteindre la vérité objective de ce passé et le désir de puiser dans celui-ci un sens transcendant, totalisant, mythique »17. Selon lui, le résultat globalement négatif de cette entreprise révélerait « notre passé comme histoire de notre incapacité à être, comme histoire de notre échec à entrer dans l’histoire »18. Formulé ainsi en des termes cinglants, l’argument de Nepveu fait mieux que porter à sa plus haute incandescence la problématicité de la relation entre fiction et histoire : il est surtout provocateur. Mais en prenant cette position extrême, il permet de relancer la réflexion et, comme je le tenterai dans ce livre, de reprendre à nouveaux frais la lecture des œuvres afin de vérifier si, au-delà de cette négativité et, peut-être même grâce à elle, les fictions ne suggèrent pas quelques pistes de dépassement. En effet, dans cette problématique, la question principale me paraît celle des enjeux mêmes de l’écriture fictionnelle de l’Histoire, telle que l’envisage notamment Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction ?19 Telle que la formule également Michael Kohlhauer dans son avant-propos à Fictions de l’Histoire : « Comment, et pour←17 | 18→quoi, en quelles circonstances et selon quelles motivations, l’écrivain ou l’artiste […] ont-ils travaillé à écrire le roman inachevé de l’Histoire ? »20.
En réponse à ce questionnement essentiel, les études sur les romans francophones mettent suffisamment en lumière les modalités et, surtout, les circonstances et les motivations des mises en fiction de l’Histoire. Une singulière poétique de l’histoire et de la mémoire est ainsi exposée, avec ses moyens : métaphorisation et allégorisation ; humour, ironie, dérision et parodie ; décalage, mise à distance ou inscription en creux ; expression du divers ou de l’informe. Toute une panoplie de procédés toujours renouvelés est déployée pour faire avouer à la farce de l’Histoire ses ruses, ses masques, ses truquages et ses hilarantes mystifications. Les ouvrages sur la question montrent bien que, qu’elles dépendent des trajectoires individuelles des auteurs ou de l’histoire particulière de leur société, les motivations de la réécriture de l’Histoire participent du désir de corriger l’oubli et les falsifications, de dénoncer des injustices, bref de rétablir la « vérité » sur ce qui a été. « Écrire ce qui est conté, c’est garder sa trace, c’est une mesure de sécurité pour œuvrer contre l’oubli »21, affirme Karin Holter à propos de l’œuvre d’Assia Djebar. Selon Yves Clavaron,
l’une des missions que s’assignent les écrivains postcoloniaux est […] de construire un autre discours sur l’Histoire récente ou contemporaine de l’Afrique, de relire les événements à l’aune d’autres valeurs que celles léguées par la métropole coloniale et de montrer également que le continent noir n’est pas entré dans l’Histoire avec l’arrivée des Européens, contrairement aux allégations du discours colonial.22
Dans ce registre des finalités, le discours critique met aussi en évidence une négativité et des ambiguïtés au regard desquelles s’avère nécessaire une autre lecture des œuvres. Certes, Beïda Chikhi et Marc Quaghebeur soulignent justement qu’« Entre filiation et dissidence, le jeu dialectique qui s[e] noue dessine un nouvel horizon pour l’homme »23 et Alain Mascarou insiste sur la « vision ouvertement progressiste, militante, de←18 | 19→ l’Histoire »24 chez des auteurs comme Édouard Glissant. Mais, dans son ensemble, le discours critique n’en aboutit pas moins à ce qui semble un nihilisme consacrant, comme le fait la provocation de Pierre Nepveu, la déshérence des peuples sur les marges de l’Histoire. La critique considère avec raison que le roman africain se pose en concurrent des sciences de l’homme, qu’il « se fait donc l’écho d’un riche éventail de savoirs »25, que sa « science » l’érige en concurrent de l’Histoire. Mais la connaissance ainsi construite n’est-elle pas laminée par la démonstration, non moins insistante, du paradigme du « chaos, absurdité, folie »26 ? En concluant ainsi sur la négativité, la critique ne baisse-t-elle pas hâtivement sa garde ? Je veux dire : la tâche de l’interprétation qui est à l’origine même de la fictionnalisation du réel s’achève-t-elle au constat de cette négativité ou, au contraire, commence-t-elle à ce point aveugle ? Je n’oublie pas la pertinente remarque de Jacques Dubois selon laquelle les romans, ou certains au moins, « ont le mérite de ne jamais instituer leur savoir en dogme, de nous rappeler que ce savoir est inséparable d’une élaboration fictionnelle et en conséquence de le tempérer d’un doute moqueur »27. Mais, pour ne point trahir l’engagement des auteurs ni méconnaître l’horizon éthique d’une écriture produite chez la plupart de ces romanciers comme réponse, substitut ou prolongement d’un agir politique, ne peut-on pas considérer aussi que les romans francophones instaurent le doute et l’incertitude comme les conditions de production d’un sens – et donc d’une connaissance – qu’il revient à l’interprétation d’établir ? Éclairante paraît, à ce propos, cette remarque de Paul Ricœur : « Que la littérature moderne soit dangereuse n’est pas contestable. La seule réponse digne de la critique qu’elle suscite […] est que cette littérature vénéneuse requiert un nouveau type de lecteur : un lecteur qui répond »28. Dans cette perspective, je soutiendrais que ce n’est pas seulement pour faire vivre au lecteur l’expérience du désenchantement ou de la complexité du monde que les romanciers francophones décrivent avec insistance le chaos, l’absurdité, la folie et autres maladies, tels que les analyse, notamment, Bernard Mouralis29 ou les contributeurs du dossier déjà évoqué de la revue Présence Francophone.←19 | 20→ Le désastre ou, selon les mots de Yannick Gasquy-Resch, « la décomposition psychologique [et] la dévastation ontologique »30 sont bien montrés dans les romans, mais j’estime – et dans cette étude je voudrais montrer – que ce regard ironique vise aussi à susciter le processus de transformation des imaginaires.
Je formule donc l’hypothèse que, sous la plume des romanciers francophones, la réécriture de l’Histoire et tous les effets (démystification, démythification, désenchantement, désillusion, etc.) qu’elle produit ne constituent point leur propre fin ; en éclairant les zones d’ombre de la mémoire officielle et de la mémoire collective, en mettant en lumière les ambiguïtés, les paradoxes et dysfonctionnements des systèmes sociaux, les romanciers cherchent bien plutôt à trouver dans les aléas et les tumultes mêmes de l’Histoire les forces et les stratégies pour lui imprimer un nouveau cours. En lisant les textes dans cette optique, je voudrais montrer que l’écriture de la mémoire de l’Histoire n’est que le prétexte, mieux, le révélateur d’une entreprise plus importante de refonte des encyclopédies. Je m’attacherai donc à mettre en lumière la nature épistémologique et les médiations symboliques des fictions historiques des romans francophones. Car je suis d’avis que si elles s’ancrent dans un désastre originel qu’elles nomment diversement « outrage », « déchirure », « naufrage », « défaite totale » et mettent en scène des personnages désemparés, « patriotes des frontières défoncées », ainsi que les qualifie Hubert Aquin, c’est pour mieux connaître le passé, mieux comprendre l’Histoire afin de donner un sens au présent, de construire des passerelles pour l’avenir.
L’intérêt majeur de cette étude réside donc dans la mise en lumière de la fonction heuristique des romans francophones. Cet aspect important affleure le discours critique ou s’inscrit dans ses interstices, mais la fonction médiatrice des fictions historiques dans les romans francophones n’est pas encore suffisamment mise en relief. La contribution que je voudrais y apporter consistera à montrer comment les écrivains francophones entreprennent de nier la négation dans laquelle veut les enfermer l’Histoire. Brisant ce que Barthes appelle l’« interdiction faite à l’homme de s’inventer »31, leurs fictions suggèrent aussi des possibilités de remédiation aux maux de l’Histoire qu’elles révèlent au grand jour. Ainsi, en dernière analyse, j’espère montrer la portée pragmatique des fictions romanesques francophones : à leur manière, ces paraboles de l’Histoire travaillent à convaincre l’habitant du « monde disloqué » qu’elles dessinent la nécessité, voire l’urgence, de trouver par lui-même les moyens adaptés à sa condi←20 | 21→tion et à son contexte afin d’infléchir le cours de l’Histoire. Façon aussi, pour les romanciers de dire que si l’homme affecté par l’Histoire ne se fait point résolument le maître de son destin, il n’en aura peut-être jamais de valeureux.
Cela dit, je ne nie pas que cette question a déjà fait l’objet d’investigation, souvent indirectement et, à ma connaissance, explicitement dans L’Afrique, entre passé et futur32 de Kasereka, qui s’attache à montrer – et il le fait avec brio – « comment se négocie ou devrait se négocier, aujourd’hui, […] l’utopie d’une Afrique nouvelle passant par une nouvelle cohérence d’être, une nouvelle articulation de soi comme sujet de l’histoire personnelle et collective, […] la réforme de notre entendement et l’institution d’un nouvel imaginaire social […] »33. Kasereka souligne l’importance de la littérature en tant que « lieu où, […] les expériences cruciales et décisives de la destinée d’un peuple […] se cristallisent dans des images, des récits, des symboles qui orientent sa manière de se représenter et d’envisager l’avenir »34. Il met en dialogue les théoriciens de la postcolonie et quelques romanciers (Kourouma, Ngandu Nkashama, Mudimbe), en raison de leur quête commune d’« une sémiologie des langages symboliques »35. Mais, à l’instar du discours critique général, Kasereka ne tire des romans que la forte démonstration de la crise dont il cherche les voies de dépassement chez les philosophes et autres politologues. D’où la structure particulière de son ouvrage : dans la première partie, les « Signes et imaginaire de la crise » sont illustrés par des œuvres romanesques, tandis que les pistes de solution dans la deuxième (« Une autre Afrique est possible ») et la troisième partie (« Pouvoir de la pensée et éthique de l’intelligence ») convoquent exclusivement des philosophes. Pareille structure repose sur le postulat implicite qu’au mieux, la littérature susciterait les problèmes ou fournirait les meilleures formulations (mises en scène) des questions, tandis que la philosophie serait la plus à même de les résoudre.
Dans cette étude, je me démarquerai de la négativité attachée à la littérature afin de montrer que les fictions historiques des romans francophones proposent une dialectique des questions-réponses. Autant – et peut-être même plus – que la pensée philosophique, elles déploient un véritable pouvoir d’invention ; elles ouvrent des trouées de l’imaginaire et des routes du possible. Chez Henry Bauchau, par exemple, Émilienne←21 | 22→ Akonga Edumbe36 montre bien le parcours de métamorphose du sujet, de la déchirure à la réhabilitation. Je voudrais analyser ce processus dans le projet global de refondation de l’ordre social, de réinvention de l’humain et de recréation du monde. Me servira de pierre de touche dans cette entreprise, le paradigme de L’Écologie du réel à l’enseigne duquel Pierre Nepveu décrypte la littérature québécoise. S’il commence par le constat provocateur d’une incapacité du Québec à entrer dans l’Histoire – « La littérature québécoise dit le mythe d’une entrée dans l’Histoire par la porte de l’absence d’Histoire »37 –, c’est qu’à l’instar des écrivains eux-mêmes, il lui fallait « dans un premier temps surenchérir, tuer ce que l’on a en soi de faux, d’emprunté, d’aliéné, de colonisé, dans l’espoir de retrouver la pure présence à soi et au réel, c’est-à-dire au vide et au néant[,] seule base à partir de laquelle une transformation du réel, une praxis redevient possible »38. Le cadre ainsi tracé, Nepveu entreprend ensuite une rigoureuse analyse des œuvres pour montrer que « la littérature québécoise est, à la lettre, une fiction [fabrication, selon le premier sens de « fingere, fingo, is, fixi, fictum » (façonner)] : élaboration de significations, de symboles, de mythes à l’intérieur d’un espace-temps spécifique »39. Herméneutique40, sa démarche permet à Nepveu de montrer, ainsi que le résume son sous-titre, qu’au-delà des mises en scène « d’un effondrement splendide du sens de l’histoire, d’un désastre de la raison »41, dans les ambiguïtés mêmes de l’« errance […] du “cassé” ontologique »42, œuvre puissamment dans cette littérature une dialectique qui transforme le récit de la dépossession en procès de fondation.
***
J’adopterai la même démarche herméneutique afin de reconstruire, dans le détour des fictions qui jouent habilement de l’allégorie, l’horizon des significations des romans francophones. Toutes les fictions de mon corpus offrant des représentations du désastre historique originel pour lequel elles suggèrent des pistes de dépassement, j’adopterai dans les analyses qui suivent le schéma herméneutique de la question-réponse, tel←22 | 23→ que Hans Robert Jauss en présente la théorie et en esquisse la pratique dans Pour une herméneutique littéraire43. À l’instar du paradigme de « mort et renaissance » développé par Pierre Nepveu dans L’Écologie du réel, le schéma herméneutique de la question-réponse permet de mettre en lumière « la continuité médiatisante de l’expérience esthétique dont l’effet [est] d’exposer les horizons de mondes lointains, de les transcender et de les médiatiser par rapport à l’horizon présent »44. À la lumière de ce schéma, on peut montrer que le questionnement des romanciers francophones vise à réaliser et à maintenir l’ouverture des possibilités car, « sans l’ouverture du questionnement, dont la négativité radicale est le savoir de notre non-savoir, l’expérience en tant que prise de conscience de ce qu’on ne sait pas encore ou de ce à quoi on ne s’attendait pas ne serait pas possible »45. Afin d’approcher au plus près les questionnements de sens et les (re)constructions de significations à l’œuvre dans les textes que j’analyse, j’utiliserai aussi les outils de la sémiotique et de la pragmatique. Jauss lui-même ouvre la voie à cet enrichissement méthodologique, notamment en faisant son profit de la sémiotique d’Iouri Mikhailovich Lotman46 et de la pragmatique de Karlheinz Stierle47 et Wolfgang Iser48. Pour Jean-Marie Klinkenberg, qui récuse la réduction de la sémiotique à la seule étude des relations fixes entre signifiants et signifiés, la pragmatique est partie intégrante de la sémiotique. Précisément, elle est « la partie de la sémiotique qui voit le signe comme acte »49. La complexité et la subtilité des moyens que mobilise la médiation de la fiction pour agir sur l’allocutaire (destinataire ou lecteur) sont bien explorées par Umberto Eco50, dont les ouvrages me seront aussi d’un grand apport. Afin de mieux cerner les stratégies discursives grâce auxquelles les fictions mettent en lumière les mensonges ou les falsifications de l’Histoire et déconstruisent toutes espèces de mythes, je m’inspirerai également des travaux d’Oswald←23 | 24→ Ducrot51. Ces théories m’aideront à mettre en lumière les ressorts discursifs de la refonte des encyclopédies : langage oblique, superposition des voix et autre polylinguisme à la Bakhtine52.
***
Résumé des informations
- Pages
- 446
- ISBN (Broché)
- 9782807603790
- ISBN (PDF)
- 9782807603806
- ISBN (ePUB)
- 9782807603813
- ISBN (MOBI)
- 9782807603820
- DOI
- 10.3726/b11190
- Langue
- français
- Date de parution
- 2017 (Juin)
- Publié
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2017. 442 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG