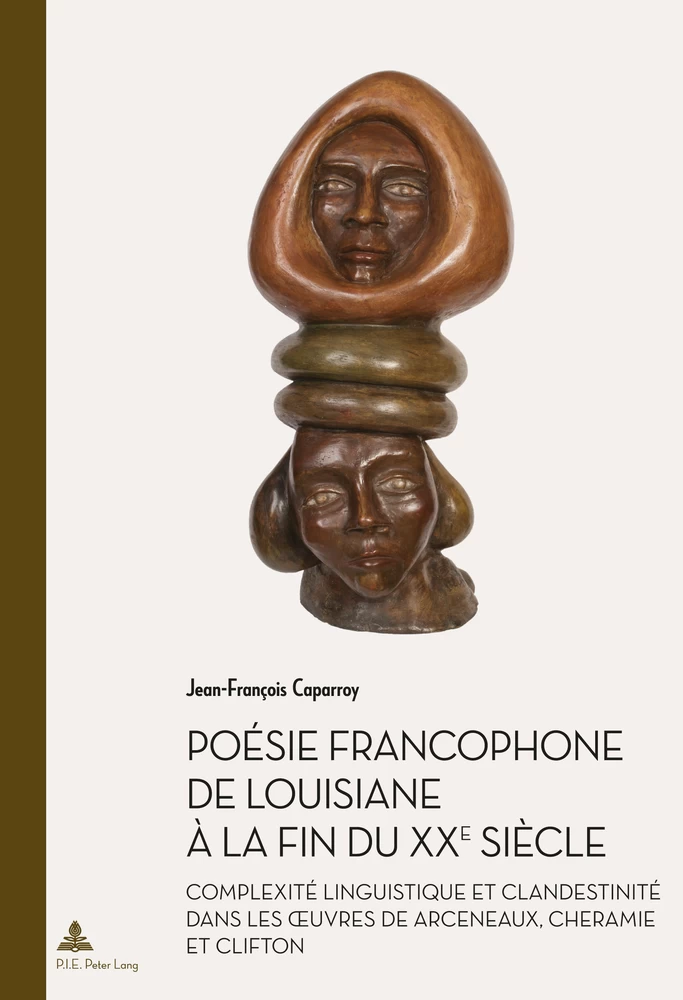Poésie francophone de Louisiane à la fin du XXe siècle
Complexité linguistique et clandestinité dans les œuvres de Arceneaux, Cheramie et Clifton
Résumé
Pourquoi Jean Arceneaux, Deborah Clifton et David Cheramie – trois poètes francophones louisianais – font-ils le choix de se représenter sous les traits du monstre ? L’étude comparée des recueils Cris sur le bayou, Suite du loup, À cette heure la louve et Lait à mère met en évidence l’existence d’un espace intertextuel, métaphorisé par les poètes eux-mêmes sous les traits du « pays des loups ».
Les errances de leurs doubles poétiques dessinent de la sorte les fondations d’un nouveau mythe américain. L’esthétique du louvoiement et la prolifération d’une monstruosité formelle, tels sont les artéfacts poétiques mis en place par ces auteurs.
Fidèles à une forme de pensée clandestine, leurs recueils donnent libre cours à une inversion des valeurs sociales, esthétiques et linguistiques, laissant le vide et le silence d’une condition d’aliéné devenir matériau d’une entreprise d’exploration mnésique à des fins de réhabilitation du soi.
Une expérience rare, peut-être ultime, en tous les cas unique. Façon de reconquérir une langue française au potentiel performatif décuplé, faisant de l’Autre anglophone redouté le complice médusé d’un rituel poétique de déconstruction et d’auto-gestation.
En quoi les Amériques n’ont pas fini de nous interpeller.
Extrait
Table des matières
- Cover
- Documents pour l’ Histoire des Francophonies
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Remerciements
- Avertissement
- Préface (Beïda Chikhi)
- Introduction
- Qui sont les franco-louisianais ?
- La naissance d’une poésie contemporaine
- Une poésie moderne et américaine
- Première partie. Du constat de vide et de silence radical à la création d’un espace poétique inaliénable
- 1 Le poète face au vide et au silence
- A. Renaître du vide et du silence
- a) Le poète et son entour, le constat de vide et le silence de la langue
- b) Dans la solitude fondamentale de l’écriture
- c) Silence de neige
- B. Cris sur le bayou, la profession de foi testamentaire d’un mort-né
- a) 1980, Cris sur le bayou, un vagissement de révolte
- b) Dans l’ombre du nouveau-né, la mort s’immisce à pas de loup
- c) L’héritage sclérosé
- C. Une pensée nihiliste et la définition de soi par la perte
- a) Une pensée articulée autour du « rien », du « arien »
- b) Une pensée du trop tard
- c) Coupable de briser le silence ?
- 2 Dire le vide, écrire le silence
- A. Dans un corps à corps avec le silence
- a) Écrire le silence
- B. Écrire le silence : une folie qui mène à écrire la folie
- a) Le rapport à la société et la posture de folie
- b) Une mort dérisoire
- c) Schizophrénie linguistique, une pathologie poétique
- 3 Une topologie poétique
- A. Le poète exclu de sa propre culture, en marge de la marge
- a) Le pays, ou ce qu’il en reste : vivre en marge des anglophones
- b) Vivre en marge des francophones
- c) L’entre-deux : un lieu à construire et où se construire
- B. L’entre-deux comme vocation poétique
- a) Une poésie de l’intime
- b) Le creux, espace de repli privilégié ?
- C. La reconnaissance d’un espace poétique singulier : le non-lieu poétique, territoire inaliénable du monstre
- a) La clandestinité
- b) Le non-lieu poétique
- Deuxième partie. L’exploration du non-lieu poétique : aventure orphique et invention nécessaire d’une figure de passeur
- 1 Passage vers le non-lieu poétique et figures de passeurs
- A. Le poète crée un passeur : quand je s’invente un alter ego
- a) Le monstre comme seuil symbolique
- b) Le monstre : signe ou tache ?
- c) Le loup-garou : invention d’un alter ego
- B. Différents médias du passage, par lesquels l’alter ego peut se projeter dans le non-lieu poétique
- a) Le miroir et l’être
- b) La voiture, la route et l’espace
- c) L’enfance : un lieu de passage
- 2 Une expérience orphique, de la photographie abîmée au négatif
- A. L’évanescence, un seuil poétique de la mémoire
- a) La mémoire oblitérée, une histoire à trous
- b) Le refus des figures tutélaires
- c) L’évanescence comme procédé de la quête
- B. La quête d’une mémoire : descente orphique et archéologie du négatif
- a) La mémoire comme Eurydice
- b) Un double procédé mémoriel, entre quête rationnelle et quête poétique
- c) Descente orphique et quête du négatif : vers une archéologie de la mémoire
- d) De l’avalement à l’auto-dévoration
- C. Dans la descente le poète est fait prisonnier de l’entre-deux, captif d’une temporalité monstrueuse
- a) Cheramie : entre deux apocalypses
- b) La temporalité dans le texte d’Arceneaux
- c) Clifton : la louve ne doit pas exister, ou l’agonie perpétuelle
- 3 Tentative de fuite dans le double et implacable co‑errance de l’alter ego
- A. De la tentation à la tentative de fuite dans le double
- a) Couper le lien avec le réel, un fantasme ?
- b) Le voyage, ou la fuite
- c) L’autre côté du miroir, le masque comme vrai visage
- B. L’irrévocable co-errance de l’alter ego : la défense par le mouvement
- a) De la fuite à la co-errance
- b) Le recours à la danse
- c) La danse rituelle
- C. Une poétique du louvoiement, l’acceptation d’une incomplétude
- a) Une esthétique du louvoiement
- b) Le rapport au catholicisme : la parodie de la figure christique et le rejet d’une philosophie du rachat de la faute
- Troisième partie. Les effets de la monstruosité
- 1 La monstruosité transfigure le texte (écriture et auto-gestation)
- A. La langue monstrueuse
- a) Pluralité linguistique : création ou barbarie poétique ?
- b) Mots difformes, excroissances linguistiques et agglutinations stylistiques
- B. Le texte, un corps monstrueux
- a) Le texte comme relique
- b) Mélange des genres et monstruosité formelle
- c) Le texte fragmenté comme corps symbolique défiguré : de la schizophrénie poétique à la réinvention de soi
- 2 La découverte de soi
- A. La mise en forme d’un imaginaire radical
- a) La transcription du vide
- b) Monstruosité : un effet de signification
- B. Le monstre errant et son secret
- a) Quand l’homme et le loup s’apprivoisent l’un l’autre
- b) Soi-même comme le territoire d’un tabou
- 3 Les effets de la monstruosité sur l’autre
- A. Tenir l’anglophone à distance
- a) Le texte littéraire, un cheval de Troie
- b) Proclamer un territoire inaliénable
- B. Fasciner l’autre
- a) Une stratégie de l’autre
- b) L’amour
- c) Revitaliser la culture et la langue ?
- Conclusion
- Bibliographie
- Annexes
- Glossaire du vocabulaire et des expressions franco-louisianaises
- Poèmes
- Index
- Dans la collection
Documents pour l’ Histoire des Francophonies
Les dernières décennies du xxe siècle ont été caractérisées par l’ émergence et la reconnaissance en tant que telles des littératures francophones. Ce processus ouvre le devenir du français à une pluralité dont il s’ agit de se donner les moyens d’ approche et de compréhension. Cela implique la prise en compte des historicités de ces différentes cultures et littératures.
Dans cette optique, la collection « Documents pour l’ Histoire des Francophonies » entend mettre à la disposition du chercheur et du public des travaux qui touchent à la complexité comme aux enracinements historiques des Francophonies et qui cherchent à tracer des pistes de réflexion transversales susceptibles de tirer de leur ghetto respectif les études francophones, voire d’ avancer dans la problématique des rapports entre langue et littérature. Elle comporte une série consacrée à l’ Europe, une autre aux Afriques et une troisième aux problèmes théoriques des Francophonies.
La collection est dirigée par Marc Quaghebeur et publiée avec l’ aide des Archives & Musée de la Littérature qui bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Archives & Musée de la Littérature
Boulevard de l’ Empereur, 4
B-1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 519 55 76
Fax +32 (0)2 519 55 83
Conseillère éditoriale : Nicole Leclercq
Jean-François Caparroy
Poésie francophone de Louisiane à la fin du xxe siècle
Complexité linguistique et clandestinité dans les oeuvres de Jean Arceneaux, David Cheramie et Déborah Clifton
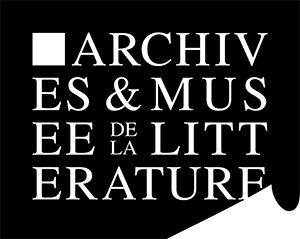
Collection
« Documents pour l’ Histoire des Francophonies / Amériques »
Vol. 42
La collection « Documents pour l’ Histoire des Francophonies » bénéficie du soutien des Archives & Musée de la Littérature.
Cette publication a fait l’ objet d’ une évaluation par les pairs.
Illustration de couverture : © Betânia Vargas, « Totem du Nouveau monde ». Reproduction photographique Alice Piemme / AML.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’ éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. Peter Lang s.a.
éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2017
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com ; info@peterlang.com
ISSN 1379-4108
ISBN 978-2-8076-0080-5
ePDF 978-2-8076-0081-2
ePUB 978-2-8076-0082-9
Mobi 978-2-8076-0083-6
DOI 10.3726/b10745
D/2017/5678/05
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Bibliothek »
“Die Deutsche NationalBibliothek” répertorie cette publication dans la « Deutsche Nationalbibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site http://dnb.ddb.de.
À propos de l’auteur
Ancien étudiant du Centre international d’études francophones, Jean-François Caparroy est docteur en Littérature et civilisations françaises (Université Paris IV).
À propos du livre
Pour beaucoup, la Louisiane apparaît comme un continent perdu des Francophonies. La question est plus complexe. Elle mérite l’attention.
Pourquoi Jean Arceneaux, Deborah Clifton et David Cheramie – trois poètes francophones louisianais – font-ils le choix de se représenter sous les traits du monstre ? L’étude comparée des recueils Cris sur le bayou, Suite du loup, À cette heure la louve et Lait à mère met en évidence l’existence d’un espace intertextuel, métaphorisé par les poètes eux-mêmes sous les traits du «pays des loups».
Les errances de leurs doubles poétiques dessinent de la sorte les fondations d’un nouveau mythe américain. L’esthétique du louvoiement et la prolifération d’une monstruosité formelle, tels sont les artéfacts poétiques mis en place par ces auteurs.
Fidèles à une forme de pensée clandestine, leurs recueils donnent libre cours à une inversion des valeurs sociales, esthétiques et linguistiques, laissant le vide et le silence d’une condition d’aliéné devenir matériau d’une entreprise d’exploration mnésique à des fi ns de réhabilitation du soi.
Une expérience rare, peut-être ultime, en tous les cas unique. Façon de reconquérir une langue française au potentiel performatif décuplé, faisant de l’Autre anglophone redouté le complice médusé d’un rituel poétique de déconstruction et d’auto-gestation.
En quoi les Amériques n’ont pas fi ni de nous interpeller.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Table des matières
Du constat de vide et de silence radical à la création d’un espace poétique inaliénable
1 Le poète face au vide et au silence
A. Renaître du vide et du silence
a) Le poète et son entour, le constat de vide et le silence de la langue
b) Dans la solitude fondamentale de l’écriture
B. Cris sur le bayou, la profession de foi testamentaire d’un mort-né
a) 1980, Cris sur le bayou, un vagissement de révolte
b) Dans l’ombre du nouveau-né, la mort s’immisce à pas de loup
C. Une pensée nihiliste et la définition de soi par la perte
a) Une pensée articulée autour du « rien », du « arien »
c) Coupable de briser le silence ?
d) La définition de soi par la perte
2 Dire le vide, écrire le silence
A. Dans un corps à corps avec le silence
B. Écrire le silence : une folie qui mène à écrire la folie
a) Le rapport à la société et la posture de folie
c) Schizophrénie linguistique, une pathologie poétique←7 | 8→
A. Le poète exclu de sa propre culture, en marge de la marge
a) Le pays, ou ce qu’il en reste : vivre en marge des anglophones
b) Vivre en marge des francophones
c) L’entre-deux : un lieu à construire et où se construire
B. L’entre-deux comme vocation poétique
b) Le creux, espace de repli privilégié ?
C. La reconnaissance d’un espace poétique singulier : le non-lieu poétique, territoire inaliénable du monstre
L’exploration du non-lieu poétique : aventure orphique et invention nécessaire d’une figure de passeur
1 Passage vers le non-lieu poétique et figures de passeurs
A. Le poète crée un passeur : quand je s’invente un alter ego
a) Le monstre comme seuil symbolique
b) Le monstre : signe ou tache ?
c) Le loup-garou : invention d’un alter ego
B. Différents médias du passage, par lesquels l’alter ego peut se projeter dans le non-lieu poétique
b) La voiture, la route et l’espace
c) L’enfance : un lieu de passage
2 Une expérience orphique, de la photographie abîmée au négatif
A. L’évanescence, un seuil poétique de la mémoire
a) La mémoire oblitérée, une histoire à trous
b) Le refus des figures tutélaires
c) L’évanescence comme procédé de la quête
B. La quête d’une mémoire : descente orphique et archéologie du négatif
b) Un double procédé mémoriel, entre quête rationnelle et quête poétique←8 | 9→
c) Descente orphique et quête du négatif : vers une archéologie de la mémoire
d) De l’avalement à l’auto-dévoration
C. Dans la descente le poète est fait prisonnier de l’entre-deux, captif d’une temporalité monstrueuse
a) Cheramie : entre deux apocalypses
b) La temporalité dans le texte d’Arceneaux
c) Clifton : la louve ne doit pas exister, ou l’agonie perpétuelle
3 Tentative de fuite dans le double et implacable co-errance de l’alter ego
A. De la tentation à la tentative de fuite dans le double
a) Couper le lien avec le réel, un fantasme ?
c) L’autre côté du miroir, le masque comme vrai visage
B. L’irrévocable co-errance de l’alter ego : la défense par le mouvement
a) De la fuite à la co-errance
C. Une poétique du louvoiement, l’acceptation d’une incomplétude
a) Une esthétique du louvoiement
b) Le rapport au catholicisme : la parodie de la figure christique et le rejet d’une philosophie du rachat de la faute
1 La monstruosité transfigure le texte (écriture et auto-gestation)
a) Pluralité linguistique : création ou barbarie poétique ?
b) Mots difformes, excroissances linguistiques et agglutinations stylistiques
B. Le texte, un corps monstrueux
b) Mélange des genres et monstruosité formelle
c) Le texte fragmenté comme corps symbolique défiguré : de la schizophrénie poétique à la réinvention de soi
A. La mise en forme d’un imaginaire radical
b) Monstruosité : un effet de signification←9 | 10→
B. Le monstre errant et son secret
a) Quand l’homme et le loup s’apprivoisent l’un l’autre
b) Soi-même comme le territoire d’un tabou
3 Les effets de la monstruosité sur l’autre
A. Tenir l’anglophone à distance
Résumé des informations
- Pages
- 446
- Année de publication
- 2017
- ISBN (Broché)
- 9782807600805
- ISBN (PDF)
- 9782807600812
- ISBN (ePUB)
- 9782807600829
- ISBN (MOBI)
- 9782807600836
- DOI
- 10.3726/b10745
- Langue
- français
- Date de parution
- 2016 (Novembre)
- Publié
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2017. 446 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG