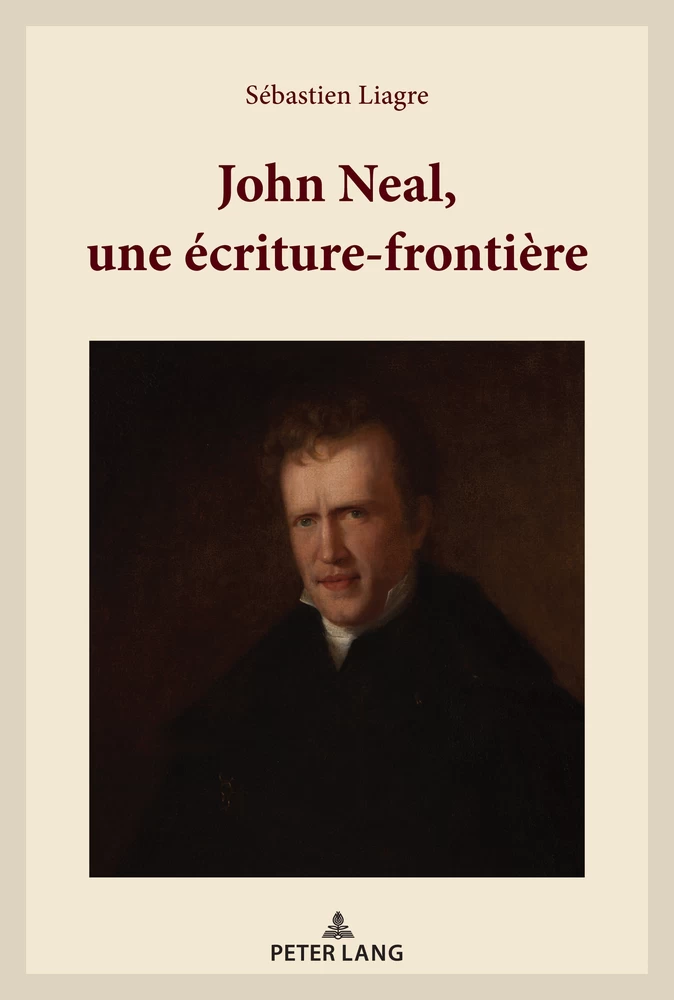Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Title
- Copyright
- About the author
- About the book
- This eBook can be cited
- SOMMAIRE
- INTRODUCTION
- RÉSUMÉS DES QUATRE ŒUVRES DU CORPUS
- Chapitre 1 L’ÉLAN VITAL, L’ESTHÉTIQUE DE L’EXCÈS
- Chapitre 2 ENTRE NATION ET DISSÉMINATION
- Chapitre 3 LES NOUVELLES ÉCRITURES
- Chapitre 4 VERS LE NOUVEL AMÉRICAIN : LA CENTRALITÉ DE L’INDIEN
- Chapitre 5 LE MYTHE NEALIEN SERA INDIEN
- Chapitre 6 BLANC OU INDIEN : LE CHOIX DE NE PAS CHOISIR, UNE FRONTIÈRE FLOUE
- Chapitre 7 ÉPILOGUE : LE RÊVE ULTIME
- CONCLUSION
- BIBLIOGRAPHIE
- INDEX
- TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
L’objectif ici affiché est clair : offrir une perspective novatrice sur la littérature américaine du premier xixe siècle. Peu de grands auteurs dans cette période — Cooper, Irving — et de trop nombreux auteurs restés dans leur ombre : la critique ne s’est pas encore emparée de cette littérature. Le présent ouvrage propose donc un nouveau chemin critique pour mettre à profit la valeur ajoutée que représente une connaissance approfondie d’un écrivain singulier et singulièrement peu étudié, mais qui compte pourtant dans cette littérature américaine des commencements. L’étude ambitionne de réinscrire John Neal dans le contexte intellectuel et artistique d’après la guerre de 1812, celui d’une Amérique aux visées nationalistes. Que signifiait alors « être américain » en littérature ? La quête identitaire était amorcée mais non encore finalisée. John Neal (1793–1876), qui avait pleinement conscience des enjeux esthétiques, politiques, théologiques et sociétaux de son temps, apporte son éclairage. Originaire de Portland, Maine, il connaît sa période d’écriture la plus créative entre 1817 et 1835, une période peu connue quoique importante de ce que l’on appelle désormais le long xixe siècle (1789–1914). Neal serait donc un auteur antéclassique, si l’on considère que la période du premier canon américain s’ouvre avec Emerson en 1835 et se termine avec la guerre de Sécession. Pourtant, la présente étude choisit de faire œuvre anticanonique car ce canon américain n’est jamais que rétrospectif, rétroactif et sélectif, un « après-coup » en quelque sorte. Alors oui, oublions le sacro-saint canon, ou, à défaut, admettons d’emblée qu’il puisse être caduc, obsolète : John Neal mérite d’y figurer, car il a fait œuvre nationale, il a contribué à l’avènement du « grand roman américain », initialement conceptualisé en 1868 par le romancier John W. De Forest : « the Great American Novel—the picture of the ordinary emotions and manners of American existence1 ». C’est bien la « filiation » nealienne — ce mot palindrome convient mieux à ce croisement, celui d’un héritage et d’une descendance — que j’entends mettre en lumière. Pour ce faire, je m’appuie principalement sur quatre textes majeurs de l’auteur : deux romans, Rachel Dyer (1828) — centré sur la « chasse aux sorcières » à Salem en 1692, et Brother Jonathan (1825, trois volumes, ancré dans l’Amérique révolutionnaire de 1776), ainsi que sur deux nouvelles explorant le rapport à l’Indien, « Otter-Bag » (1829) et « David Whicher » (1832).
Ce propos liminaire aborde cinq points qui clarifieront l’objet de l’étude : après avoir défini ce que je nomme l’« écriture-frontière » nealienne et exposé ses enjeux, j’indiquerai la démarche critique retenue ainsi que l’état de la critique nealienne. L’articulation de l’ouvrage et le choix des œuvres seront ensuite explicités.
L’écriture-frontière
Qu’est-ce qu’une « frontière » ? Est-elle imaginaire, affective ou bien réelle ? Une limite territoriale pour l’Amérique ou une limite inscrite sur une page de texte ? Fort logiquement, je souhaite poser d’emblée ce que j’entends par les concepts polysémiques de « frontière » et d’« écriture-frontière », en m’appuyant notamment sur les analyses proposées par Homi Bhabha dans Les Lieux de la culture : une théorie postcoloniale et par Cécile Roudeau dans La Nouvelle-Angleterre : Politique d’une écriture. Récits, genre, lieu. La problématique de l’écriture-frontière nealienne s’articule autour des trois acceptions principales du terme frontière :
La frontière est une ligne de partage, une ligne de démarcation à dépasser, un seuil, un point de départ et non une ligne de repli ; ce n’est pas une ligne de rupture nette, bien au contraire : elle engage tout un jeu de tensions et de paradoxes, qui peuvent notamment se résoudre par une forme d’hybridation. Ainsi, la structure dialectique n’est pas la seule pour penser la frontière.
En effet, la frontière peut aussi se concevoir comme un espace ambivalent, un lieu de passage. Homi Bhabha parle d’un « espace de liminalité », un espace où l’on subit « l’insupportable épreuve de l’effondrement de la certitude2 ». C’est un lieu de négociation qui permet l’articulation d’éléments antagoniques (Bhabha 64). Elle affiche le monde inconfortable, le « mi-chemin », le monde « non défini » (48), elle devient une zone d’interpénétration. La frontière est un lieu de chevauchement, un site innovant de collaboration, un espace interstitiel générant de nouveaux signes d’identité. Elle est ce lieu où « se négocient les expériences intersubjectives et collectives d’appartenance à la nation » (30), une zone intermédiaire, labile, un territoire du possible.
Mais la frontière sait également être un processus, la ligne pionnière en mouvement de Frederick Jackson Turner. Approcher la frontière, dit Homi Bhabha, c’est approcher l’au-delà, « ce moment de transit où l’espace et le temps se croisent pour produire des figures complexes de différence et d’identité, de passé et de présent, d’intérieur et d’extérieur, d’inclusion et d’exclusion ». De là un sentiment de désorientation, une perturbation de direction (29–30) : assurément, cette ligne mouvante autorise les reconfigurations.
« L’écriture-frontière » procède en premier lieu du positionnement de John Neal, qui écrit en 1825 dans Blackwood’s Edinburgh Magazine3 à propos d’un romance historique : « [It was] full of good sense, which we have no sort of patience with; surcharged with historical truth, which nobody cares for; crowded with sober stuff, the insupportable accuracy of which were enough to dampen the poetical ardour of the whole nation4 ». Le ton est donné : Neal, qui a passé toute sa vie dans les zones urbaines de la côte Est, sera paradoxalement constamment à la marge, motivant la problématique développée, celle de l’exploration d’une écriture-frontière qui vient subvertir et se substituer aux limites de tous ordres, une écriture nourrie tant par l’indéfinitude de son support que de son objet d’étude, l’Américain, dont il s’attache à proposer une vision alternative. Car il y a bien un côté expérimental dans l’écriture nealienne : l’espace dynamique qu’est la frontière permet la décomposition puis la recomposition de la nation américaine autour de l’Américain que John Neal se refuse à enfermer dans une définition stérile, en le plaçant à la frontière entre le défini et le pas encore défini, ou le pas défini du tout ou qui n’est pas destiné à l’être. Cela revient à dire que ce qui se joue dans cette écriture qui érige la frontière en méthode, c’est purement et simplement le tracé des contours de l’Américain, le sien. Ainsi, se précisera la contribution de John Neal à l’écriture américaine.
John Neal n’a pas choisi de déplacer sa frontière vers l’Ouest ou le Nord-Ouest, ni même au-delà du Mississippi. Il écrit dans des lieux-frontières : le Connecticut, le Maine, des marges géographiques, linguistiques, ethniques, prises comme espaces de liberté, des espaces où une Amérique nealienne peut advenir. Mais l’on pourrait tout autant affirmer que Neal écrit dans une Amérique qui n’a pas encore de lieu. Cette frontière en mouvement, Neal la recrée dans son écriture : une écriture que l’on peut difficilement circonscrire, fluctuante, une écriture de la transition qui se joue — joue — des frontières. Son écriture est frontière en ce sens qu’elle cartographie l’Amérique. C’est l’écriture qui est frontière. C’est l’écriture qui est le lieu où se dessine l’Amérique. Cette écriture est celle de la limite, de l’entre-deux, elle oscille entre une critique de l’esprit impérialiste anglais et une défiance quant à la façon dont l’Amérique postrévolutionnaire s’est structurée. L’écriture nealienne tente de rendre compte, de construire ou de saisir une américanité, ensemble parfois hétéroclite et contradictoire de représentations. Elle est par conséquent l’écriture de la « différance » derridienne5, de l’écart, l’écart par rapport aux références des Vieux et Nouveau Continents.
Soyons clair, l’écriture nealienne n’est pas une écriture de la réappropriation des marges pour le récit communautaire. C’est au contraire une écriture incertaine, l’écriture d’un moi clivé, l’écriture personnelle d’un rapport au monde, une écriture qui ne cherche pas à inscrire l’Amérique naissante dans une « destinée manifeste » narcissique. De sorte que le centre de gravité de cet ouvrage est l’indéfinitude, l’indétermination, la potentialité, la porosité de cette écriture-frontière caractérisée par l’absence de partition claire, et que l’on osera appeler « américaine » parce qu’elle est libérée. La frontière est l’espace de l’incertain, qu’il soit de nature conceptuelle, historique ou ethnique, et cet incertain, parfois poussé jusqu’à son paroxysme, pourra s’inscrire dans l’écriture nealienne tout autant que dans les événements eux-mêmes, en une oscillation permanente. Les faisceaux de cette écriture, se constituant en un point de rencontre (« meeting point ») au sens où l’entend Frederick Jackson Turner (28), finissent pas faire sens. Pourtant, par sa singularité même, elle reste un entracte, un intermède dans l’histoire littéraire américaine.
John Neal est donc un écrivain excentrique, littéralement. Il n’entend pas proposer une écriture du centre, de la loi, du cadre, du juste milieu. Critique et romancier à la fois, il est bien placé pour observer les sutures entre les genres et les manipuler ; sa prose protéiforme pourra se lire comme une illustration des propos de Jacques Derrida : « un texte ne saurait appartenir à aucun genre. Tout texte participe d’un ou de plusieurs genres, il n’y a pas de texte sans genre, il y a toujours du genre et des genres mais cette participation n’est jamais une appartenance. » (Derrida 2003 264) Faire fi des cadres et des limites, Neal s’y emploie. Ce n’est ni une écriture populaire, ni une écriture journalistique. Non. Neal se rêve avant-gardiste, chantre d’une écriture « américaine », mais avant de pousser les frontières, Neal part du centre, de la Bible, de l’Anglais, de la common law de Blackstone, pour aller au-delà de ce centre américain qui n’en est finalement pas un. S’éloigner du centre, afin de rendre sa visibilité à l’écriture dite « américaine », matérialiser la frontière, en sortant du cadre : voilà la mission de John Neal. Afin de donner l’impulsion, le récit se recentre sur ses marges (Roudeau 2012 36–37) : transgressif, il traite moins de l’Histoire, moins de l’influence anglaise en tant que telle, que de la femme, de la sexualité, du Yankee, du dialecte, ou de l’Indien. John Neal le frontalier écrit donc toujours à l’extrême limite, et ses constructions sont par essence fragiles. Cet acte d’aller au-delà, de franchir la frontière, l’écriture nealienne hésite parfois à le faire : elle est, répétons-le, l’écriture de l’entre-deux, entre écrit et oral, loyaliste et patriote, Indien et Blanc... Dans l’espace qu’offre l’écriture nealienne, le futur est incertain, le passé, parfois inexistant. Elle offre un instantané, un présent perpétuel, hors des limites du temps, un monde fragmenté, en élaboration, moins dans une dialectique d’opposition que d’interpénétration. Car contre toute attente, la limite n’est pas stérile, la limite n’est pas contraignante. Heidegger estime dans sa conférence « Bâtir, habiter, penser » que « La limite n’est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être. » (Heidegger 183) De fait, l’écriture-frontière constitue une ligne de crête fluctuante, d’où comprendre les spécificités d’une nation naissante. Elle cristallise, elle rend possible parce qu’elle autorise les oscillations, la double perspective. La frontière devient non seulement une ligne à franchir, mais aussi un espace à occuper, « sometimes a line and sometimes a space » (Fussel 17). Lieu de toutes les contradictions, elle n’est plus une simple lisière, une limite territoriale fixe entre le monde civilisé et une nature à l’état brut mais un seuil dynamique appelant l’expansion d’un entre-deux incertain, à la fois territoire neutre et zone de créativité. Ce terme métonymique est donc vecteur de mouvement, de transition, une zone liminale convenant parfaitement à Neal, passé maître dans l’art difficile d’« habiter la frontière » (Speck 2004). Et c’est là que « l’écriture-frontière » prend tout son sens, l’écriture étant aussi, pour Barthes, « destruction de toute voix, de toute origine ». « L’écriture, c’est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. » (Barthes 1984 63) Écrire à la frontière, écrire la frontière, écrire le neutre ou se réécrire. Notons dès à présent et plus généralement que mes références à la notion de « neutre » s’appuient sur le sens que Roland Barthes lui donne dans Le Neutre. Notes de cours au Collège de France, 1977–1978, à savoir un espace qui déjoue le paradigme (Barthes 2002 31), marqué par le vacillement des valeurs, étranger à tous les sens imposés.
Si, à la veille de son départ précipité pour Baltimore, Neal se dépeint lui-même comme « a compound of contradictory properties » menaçant de le conduire à l’autodestruction, ce Yankee autodidacte est malgré tout convaincu d’une chose, et il l’écrit en 1826 dans « Yankee Notions », alors même que paraît aussi cette année-là sur la scène américaine « l’homme sans mélange » (« the man without a cross ») de The Last of the Mohicans :
Oil and water have been mixed heretofore; and why may not fire and water be mixed—or snow and fire, poetry and mathematics, literature and law, truth and falsehood, great wisdom with great folly? (Neal 1826d 446)
Avec aplomb, c’est une entreprise de déconstruction que propose un John Neal un brin provocateur qui s’ingénie à créer de nouvelles entités en conjuguant les contraires, en mariant le théorème et le poème, la vérité et le mensonge, la sagesse et la folie. Et le fait est que le récit détermine une zone — une frontière — où tout devient possible, y compris, semble-t-il, les émulsions les plus improbables. Improbables, puisque, comme le note très justement Cécile Roudeau6, le miracle est de courte durée : le mélange entre l’eau et l’huile ne peut en effet être forcé, les deux substances n’étant pas miscibles. Il suffit de toute façon de consulter la définition que donne le Webster de 1828 du mot « mixture » pour s’en convaincre : « In chimistry, mixture differs from combination. In mixture, the several ingredients are blended without an alteration of the substances, each of which still retains its own nature and properties ». « Mixed », « Mixture », ces termes réapparaissent régulièrement dans la prose nealienne. Quel est donc l’enjeu dans ces mélanges et que produisent ces rencontres improvisées ? En dépit des réagencements, il apparaît difficile d’aboutir à une quelconque désessentialisation. Par contre, l’espace des possibles, l’espace frontière ainsi ouvert est lui bien réel, et Neal ne manque pas d’en faire usage dans son approche des genres, des races et des nationalités. Quant aux frontières binaires, elles n’ont plus lieu d’être : morceler l’identité, mettre les catégories en crise, tel est le credo nealien. Les frontières seront immanquablement perméables. Alors, qu’il soit question dans les analyses à venir de fusions, de superpositions, d’amalgames ou de mélanges, complets ou, bien plus souvent, incomplets et imparfaits, il convient avant tout de garder à l’esprit que la « frontière » nealienne se conçoit comme un espace d’échange, un mode d’articulation et de réarticulation qui, répétons-le, met les catégories en crise. Remodeler. Refonder. Rebondir. Plus qu’un lieu, la frontière est un espace de temps limité, l’instant où se noue une relation, mettant à profit une circonstance. Autrement dit, la rencontre est pour partie contingente, jamais forcée. Cet espace qui permet de subtiles alchimies, des processus en constante évolution et des dosages novateurs autorise non pas une redéfinition, mais plutôt une réinvention du féminin et du masculin comme de l’Indien et du Blanc.
Démarche critique
De Brother Jonathan, David Macbeth Moir avait estimé, après lecture du manuscrit original : « It is extremely powerful—and, what is more to the purpose, its power is of a kind that is unhackneyed and original7 ». L’objet est nouveau, il se construit au fil de l’analyse et il appelle une démarche critique nouvelle adaptée à un certain type de textualité, car il sera difficilement soluble dans une rhétorique académique. En effet, les outils d’analyse ne sont pas toujours adaptés à un concept de frontière glissante, tantôt zone de partage, zone trouble ou zone de mélange. Entendons-nous bien, il n’est pas question ici d’utiliser John Neal comme un faire-valoir, et l’analyse de son écriture ne se concevra pas comme un dialogue à sens unique avec des auteurs plus connus — Charles Brockden Brown, James Fenimore Cooper, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne... — dont le seul but serait de réintégrer John Neal dans le panthéon national des auteurs de second ordre. Non, Neal sera étudié en lui-même, pour lui-même, pour son écriture idiosyncratique si caractéristique. Ainsi, l’un des mérites de cette étude passionnée est de livrer au lecteur un John Neal sans filtre : son texte, abondamment cité, vibre à nouveau et les analyses comme les extraits cités sont bien souvent inédits. C’est une étude exploratoire qui se veut un espace de découverte, quitte à emprunter des chemins de traverse, quitte à s’égarer, parfois. Cette méthode de composition nécessite plus de temps et d’espace, mais elle s’avère gratifiante dans le cas présent : il est nécessaire de revenir au texte, de partager de nombreuses pages de cet auteur méconnu qu’est John Neal afin de participer à la construction d’un appareil critique portant sur cette littérature américaine des commencements, un appareil critique qui sera utilisé par la critique française et américaine. Ouvrir de nombreuses pistes de réflexion, livrer des pistes critiques qui éclairent chacune à leur manière des pans différents de l’œuvre exubérante et multiple de Neal, telle est l’ambition de cette étude qui offre également des outils critiques qui ne se limitent pas à l’univers de Neal.
La démarche critique adoptée emprunte par certains aspects au néo-historicisme, si l’on entend par là la conviction qu’un travail littéraire doit être analysé au regard de son époque, de son lieu, de son auteur, bref, de son contexte politique et littéraire. En effet, le contexte culturel proche et la chronologie ont souvent guidé mes choix de lecture et d’analyse, motivés par la volonté de réinscrire la posture esthétique de Neal dans l’histoire littéraire de la jeune Amérique. J’ai consulté le corpus nealien électronique à ma disposition pour vérifier la validité de telle ou telle hypothèse, de telle ou telle influence intertextuelle, et, dans la plupart des cas, ce sont les auteurs et penseurs antérieurs ou contemporains de John Neal que j’ai sollicités afin de proposer des analyses érudites. Il n’y a pas de volonté de ma part de mettre en scène la « mort de l’auteur8 » ou une quelconque crise de l’intentionnalité. Plutôt Montaigne que René Girard donc, pour parler du mensonge. Plutôt le Webster de 1828 que le Merriam-Webster.
Je tiens néanmoins à préciser que la démarche qui vient d’être présentée n’est absolument pas sectaire. Ici, pas d’inféodation, pas d’approche étroitement historiciste et circonscrite par l’intention même de l’auteur. J’accorde de la valeur, et ce de façon répétée, à l’« après-coup », à cet événement B qui permet de revisiter A à la faveur d’un mouvement antichronologique extrêmement fécond9. N’en déplaise aux puristes, j’ai ainsi très logiquement refusé de me priver de l’aide toujours précieuse des cours de Gilles Deleuze à Vincennes, de ceux de Roland Barthes sur La Préparation du roman et Le Neutre, des causeries radiophoniques de Gaston Bachelard ou des analyses de Northrop Frye et Lucien Jerphagnon pour ne citer que quelques-unes de mes sources d’inspiration conceptuelle — ma préférence va généralement aux défricheurs de textes. Il convient en effet de garder à l’esprit, comme le rappelle Pontalis lorsqu’il revient sur la métaphore freudienne de l’archéologue, que l’on ne ramène jamais à la lumière du jour ce qui a été enfoui, c’est-à-dire que l’auteur n’aura pas forcément le dernier mot (Pontalis 13). Si son apport est indéniable, force est de constater que ce que j’exhume moi, ce à quoi je réagis moi, ce peut être autre chose que ce qui a été enfoui. Il n’y a pas de résurrection du passé mais reconstruction d’un passé. Néo-historicisme, après-coup, j’entends conjuguer ces approches, avec bonheur.
Mais cette étude pionnière — en ce sens qu’elle n’est, comme son objet, pas dans l’air du temps — est avant tout une étude textualiste : sans pour autant faire de Neal le styliste incomparable qu’il n’est peut-être pas, j’entends mettre en évidence l’originalité et la cohérence d’un texte trop souvent conspué pour sa prolifération et ses excès en tout genre. Alors bien sûr, on reproche à bon nombre de romanciers américains du début du xixe siècle leur manque de rigueur et leur penchant pour l’excès, visible dans leurs intrigues. Mais qui pourrait aujourd’hui contester leur influence pionnière déterminante ?
J’ai délibérément choisi d’être à l’écoute du texte, d’en épouser les méandres, d’en emprunter les impasses éventuelles, de faire marche arrière, pour avancer de nouveau. J’ai choisi de défricher, parfois laborieusement, afin de tenter d’atteindre le cœur de cette écriture démonstrative, envoûtante et passionnée. Dans cette étude, vous ne trouverez pas de développements poussés relatifs à telle ou telle perspective théorique. Le recours à la théorie se fera autrement, de façon régulière mais nécessairement plus restreinte, en contexte, en cours d’analyse de détail. Au regard du désert critique entourant l’œuvre de John Neal, mon ambition est de proposer une lecture très personnelle pour faire « parler » les textes du corpus. La méthode ne variera pas : entrer dans les plis d’un texte qui ne se laisse que rarement dénuder, quitte à se laisser emporter — parfois — par le poète du cœur qu’est John Neal. Explorer les articulations internes, déplier les significations, lier les motifs, en convoquant les textes le plus souvent possible, en se livrant à des micro-analyses, prendre le temps, creuser, quitte à en oublier, parfois, de prendre de l’altitude... Si cela induit de fait une certaine dissémination, je l’assume, même si je tiens à souligner la structure nécessairement diffractée de la démarche, reflet d’une écriture-frontière kaléidoscopique qui se diffracte et se décline en itinéraires alternatifs, sans être nécessairement systématisable. Restituer l’esprit du texte est primordial. En ce sens, ma démarche peut en partie être assimilée à celle d’un historiciste, mais à une différence près : la conscience aiguë que le texte doit primer sur le contexte d’écriture.
L’approche méthodologique choisie, celle d’une voie médiane théorisée par Antoine Compagnon entre le néo-historicisme et les écoles davantage attachées à la lettre du texte10, n’est donc paradoxale qu’en apparence. L’analyse littéraire ici menée s’inscrit avant tout dans l’exploration d’une écriture, sans pour autant négliger les facteurs sociaux et culturels conditionnant cette écriture qui cherche en retour à peser au-delà de la seule scène littéraire. On touche là au cœur de la méthode proposée, celle d’une intimité avec les textes qui intègre avec finesse à l’analyse un mode de regard de l’histoire et du contexte, sans que ce type de lecture soit exclusif. Les développements minutieux qui donnent toute sa force de persuasion à cet ouvrage n’ont pas pour objectif d’afficher en permanence la surabondance du texte, mais bien de mettre en perspective l’acte créatif de John Neal, et le degré de conscience qui était le sien au moment de l’écriture, conscience, par exemple, de l’américanité d’un style à la frontière entre écriture et oralité. À ce titre, les multiples analyses de détail ici proposées brillent par leur convergence : le geste métafictionnel est partie prenante dans l’écriture nealienne qui se préoccupe d’elle-même et se met en scène. Théâtrale, elle interroge et s’interroge sur sa raison d’être. La matière phonique de la langue prime sur le texte ou semble s’y substituer : la mise en mots devient mise en voix, et le lecteur se mue en auditeur, en spectateur.
Le statut de l’exemple est primordial, le texte est primordial. Citer est une question d’honnêteté. Je me suis toujours efforcé de thématiser le foisonnement, la surabondance du matériau à ma disposition, en citant généreusement un texte source difficilement accessible et pourtant nécessaire à ma démonstration, au vu de la réflexivité de l’écriture nealienne, de son aptitude à éclairer ses propres mécanismes. Il ne s’agit évidemment pas de perdre le lecteur mais bien de l’exposer autant que possible à la lettre : les citations se suffisant parfois à elles-mêmes, la glose s’avère superflue ; de là une relative sobriété du commentaire, car le texte doit nous parler. Évitant d’imposer une lecture univoque, l’analyse se dévoile au fur et à mesure et laisse percevoir le matériau découvert. Suggérer avant de convaincre, la démarche est assumée. Et si d’aucuns y voient un mimétisme avec le texte nealien, j’assume ce mimétisme, érigé en méthode : chez Neal, la confusion n’est qu’apparente, les enchevêtrements d’intrigues font sens, et cela doit être montré avant d’être démontré. Les apports théoriques s’appuient sur le décryptage attentif du texte dans ses moindres détails. L’objectif est de saisir l’insaisissable, de le communiquer au lecteur ou mieux, d’inclure le lecteur dans cette démarche active de recherche et d’exploration de la profusion nealienne distinctive.
La méthode déployée est avant tout poétique au sens où l’entend Gaston Bachelard11, mythopoétique — au sens de Northrop Frye12 — et plus généralement herméneutique, ce que laissent entendre certains titres de parties (« La Bible, socle stable, matrice créative » ; « L’eau et les rêves »). Une seule solution pour le lecteur : se laisser emporter par le tourbillon émotionnel proposé, par la folie des protagonistes, par les dédoublements en cascade et la dilution des mythes et des identités ; mais ce caractère profus du texte ne lui donne pas seulement un charme un brin suranné, il répond également à une logique assumée de complexification des filiations, de remise en question des finalités. Le réel résiste constamment à l’écrivain, et la classification du monde sensible devient souvent problématique. C’est probablement cet interstice créatif qui constitue le plus grand défi et le plus grand succès de l’écriture nealienne : elle expérimente, reconstruit en déconstruisant, traçant une nouvelle frontière, une nouvelle trace, une trace écrite. La frontière est bien là, aussi. Et ce ne sont pas des jeux de mots oiseux : en créant — ou du moins en utilisant — le mot-valise d’écriture-frontière dès le titre, je souhaite offrir toutes ces pistes d’investigation au lecteur. Il a aussi une efficace : celle de compliquer à dessein les généalogies, de défier les téléologies. Il y a dans l’écriture de Neal une résistance à démêler les fils du réel jusqu’au dernier, jusqu’au partage et à la distribution du sensible en taxinomies. J’y verrai là peut-être la plus grande réussite de la fiction nealienne et de cette littérature américaine naissante, qui ne se fait qu’en défaisant, dans l’expérimentation constante des formes, dessinant une frontière, formelle cette fois, frontière de l’écriture même. N’est-elle pas là, cette « frontière », ou, du moins, n’est-elle pas là aussi ?
État de la critique nealienne
Parmi les cent quarante-deux romans américains (publiés entre 1789 et 1830) répertoriés par Lillie Loshe dans son étude The Early American Novel, figurent dix romans de James Fenimore Cooper, huit de Charles Brockden Brown et huit de John Neal (Loshe 92–94), qui a en effet beaucoup écrit : plus d’une vingtaine de romans — souvent de très gros livres —, une vingtaine de nouvelles et une centaine d’articles. Or, il n’existe à ce jour aucune réédition moderne de ses romans. La quasi-totalité des sources primaires consultées pour cette étude l’a par conséquent été sous forme numérisée, principalement par Google dans le cadre du « Google Books Library Project ». Tel est le cas des deux romans de notre corpus : l’exemplaire de Rachel Dyer provient de la bibliothèque de l’université de Harvard. Pour Brother Jonathan — imprimé à Londres à 2000 exemplaires par William Blackwood, dont moins de 500 furent vendus13 — deux exemplaires ont été croisés, celui de la bibliothèque bodléienne et celui de la bibliothèque de l’université de Harvard. Quant aux deux nouvelles de notre corpus, « Otter-Bag » et « David Whicher », initialement parues dans le magazine annuel The Token14, elles ont été retranscrites dans l’anthologie The Genius of John Neal éditée par Benjamin Lease et Hans-Joachim Lang. On l’avait déjà compris, John Neal n’est pas l’auteur le plus étudié de la littérature américaine, loin s’en faut.
Difficile, dans de telles conditions, d’entretenir un dialogue avec la critique pour s’inscrire dans une tradition d’exégèse d’exploration du texte. Qu’il me soit donc à ce stade permis de procéder à une mise au point nécessairement rapide : le champ de la critique nealienne est très peu fourni, y compris dans les revues spécialisées comme Early American Literature. Un seul Ph. D. à ce jour — « The Life and Works of John Neal », largement biographique et largement inaccessible — a été consacré à John Neal par Irving T. Richards en 1932. L’autre thèse, française, soutenue en 2015, est le point de départ du présent ouvrage. Une anthologie regroupant les articles de Neal portant sur l’art a été réalisée par Harold Dickson en 1943, à laquelle vient s’ajouter l’anthologie de Benjamin Lease et Hans-Joachim Lang The Genius of John Neal : Selections from his Writings (1971), regroupant articles, nouvelles et extraits de romans. L’intérêt pour Neal est quelque peu relancé dans les années 1970, avec la parution de deux monographies ; la première, That Wild Fellow John Neal and the American Literary Revolution de Benjamin Lease (1972), est sans doute la plus pertinente, même si les analyses de Lease demeurent parcellaires, ne définissant pas une véritable direction critique que l’on pourrait confirmer ou infirmer. Tout au plus visent-elles — et c’est déjà beaucoup — à replacer John Neal dans la chronologie des lettres américaines, à sa juste place. L’entreprise est incomplète, le balayage nécessairement de surface en raison de la taille de l’objet d’étude, l’œuvre touffue d’un auteur embrassée dans sa totalité. La deuxième monographie — John Neal de Donald A. Sears (1978) — s’inscrit dans une logique similaire. Est-il besoin de le souligner, ces ouvrages — accompagnés de leurs précieuses références bibliographiques permettant de retrouver sur la Toile les textes originaux de John Neal — ont toutefois constitué pour la présente étude une base de travail indispensable. En 1983, est publiée l’étude orientée de Fritz Fleischmann, A Right View of the Subject, Feminism in the Works of Charles Brockden Brown and John Neal, qui propose une lecture sociétale et féministe des textes, sur laquelle il m’a été possible de m’appuyer pour mettre en évidence la prééminence de l’héroïne nealienne.
Si seulement une petite dizaine d’articles notables portent spécifiquement sur John Neal entre 1950 et 2010, et n’abordent que des points biens spécifiques de sa prose, tel son utilitarisme supposé (King 1966), ou sa contribution à la pérennisation littéraire du dialecte yankee (Martin 1959), il faut cependant tout particulièrement mentionner l’article de David J. Carlson, « “Another Declaration of Independence”: John Neal’s Rachel Dyer and the Assault on Precedent » (2007), qui aide à mieux appréhender l’engagement de Neal contre le légalisme en vigueur, insupportable à l’avocat de profession qu’il était, et qui explicite la démarche libératrice dont l’homme nealien se veut être l’aboutissement. Ce dernier article est d’ailleurs inclus dans l’ouvrage collectif dirigé par Edwards Watts et David J. Carlson, paru en 2012, John Neal and Nineteenth-Century American Literature and Culture, regroupant douze articles non concertés mais de qualité, qui ont généralement permis de corroborer certaines des analyses du présent ouvrage, relatives à la formation de l’Américain nealien : notamment l’hybridation du héros (Pethers 2012), ou l’absence de récit construit autour de la haine de l’Indien (« Indian Hater narrative ») dans les pages nealiennes (Watts 2012), ouvrant la voie à une amorce de rapprochement avec l’Indien. Dans l’esprit de mes propres conclusions, Matthew Wynn Sivils relève la pertinence de l’utilisation faite des lieux de mort pour orchestrer une renaissance, tandis que Jonathan Elmer met en évidence la dialectique mensonge / vérité à laquelle lecteurs et Américains en gestation sont confrontés.
Mais mes remerciements vont surtout à John Neal lui-même, pour son attitude réflexive par rapport à sa fiction, à travers les innombrables analyses et autoanalyses présentées dans ses romans et articles critiques, biographiques ou autobiographiques15. Appliquées au corpus de cette étude, elles sont à l’origine de bon nombre des perspectives ici développées, alimentant cette relecture critique informée et problématisée de ses textes majeurs. Toutefois, précisons à nouveau, si besoin était, que la prise en compte des apports personnels de Neal ne s’est jamais transformée en une confiance aveugle : je me suis efforcé, malgré un long compagnonnage avec l’auteur, de maintenir une distance salutaire.
L’élaboration de cet ouvrage n’est donc pas une simple compilation d’opinions critiques. Pour étayer mes analyses, outre les études récentes consultées, ce sont aussi les sources primaires qui ont joué un rôle essentiel, au premier rang desquelles les écrits contemporains de la période d’écriture de John Neal, y compris des traités proto-anthropologiques et religieux, ainsi que de nombreux essais publiés par l’auteur lui-même dans des périodiques d’époque (Blackwood’s, The Portico, The Yankee). Cette étude pourra par conséquent être consultée avec profit par tous ceux qui s’intéressent à la naissance de la littérature américaine et au regard qu’elle porte sur le rôle de l’Indien.
Cohérence d’ensemble
Il est essentiel de pouvoir comprendre le cheminement de la démonstration qui a abouti à l’articulation de ces analyses, et de pouvoir s’y reporter ultérieurement en cas de besoin. Il s’agit donc bien ici de mettre en évidence la colonne vertébrale de cette étude. Le plan de l’ouvrage s’adapte à la pratique particulière de l’auteur, en partant du centre, celui d’une écriture nealienne oralisée, voire auralisée, une écriture qui s’entend à mesure qu’elle s’étend. À partir de cet épicentre que constitue cette langue orale couchée sur le papier, l’étude procède par expansion, en s’articulant autour d’une inflexion propre à John Neal, autour d’un basculement constant, de l’écriture à l’Américain qu’elle fait naître. Installant l’excès au cœur d’une écriture-frontière courtisant parfois le chaos, Neal décompose pour mieux y recomposer sa nation américaine, ses Américains, ses Américaines, et son Yankee, si particulier. Ce faisant, il affiche sa foi, sa foi en l’homme, et renoue avec les forces ancestrales de l’Amérique : l’Indien ne saurait être une pièce rapportée dans la fiction nealienne. Afin d’articuler la problématique de la frontière avec le concept d’identité, le plan de cette étude épouse les contours du « je ». De sorte que « l’écriture-frontière » devient une écriture en mouvement, celle d’une quête intérieure qui glisse progressivement du « je » — nealien, yankee, croyant — vers cet autre, l’Indien — cet autre « je ». Des contours du « moi » aux contours de l’autre, du connu vers l’inconnu, de l’étroit au large, du « je » à la nation, à la wilderness16, cette étude propose la structuration progressive d’un sens. De centripète, le mouvement devient centrifuge. Du « moi », de la nation, du centre, vers la marge. Quitter Ginger Town. Quitter New York. Quitter Philadelphie. Quitter la maison des assemblées, la meeting-house de Salem. Gagner Casco, gagner Indian Old Town, gagner la frontière. Fuir vers la marge, fuir le cadre, le quadrillage, en un mot fuir le « réel » pour la wilderness, « a state of disorder » nous indique le Webster ; fuir pour le rêve indien et les frontières canadiennes du nord du Maine. L’Américain nealien, placé au cœur de ces romans de désapprentissage qui sont aussi des romans de l’introspection, doit être un marginal. C’est cette dynamique que l’on retrouve dans le plan adopté : l’écriture-frontière accompagne le cheminement d’un même pionnier, du capitan à l’introverti qui doute, avant de se confronter réellement à l’autre. Comprendre d’où l’on vient — se frotter à la Bible, aux emblèmes de nation, à ses manques —, avant d’aller vers l’autre, celui de la frontière, l’Indien.
Aussi, la structure même de l’ouvrage est mimétique, pyramidale, progressant en terme de volume de l’étroit au large entre les parties une et six.
Dans la première partie, « L’élan vital, l’esthétique de l’excès », sont utilisées, comme dans les autres parties du reste, toutes les acceptions de la frontière précédemment définies. L’écriture-frontière est ce processus créateur qui organise les contours du « je », car, comme pourrait le laisser entendre l’intitulé de cet ouvrage — « John Neal, une écriture-frontière » —, à travers ses textes, John Neal l’égotiste parle de lui. Beaucoup. Et il passe allègrement de l’autoportrait au portrait de l’autre. L’écriture du « moi », dépliée, devient écriture de l’autre, propice aux images du cœur. Car si Neal est « au front », il n’est pas tant théoricien que fantassin. Comme Montaigne, il est le tenant d’un humanisme pratique : il ne « pense » pas l’Américain, il le vit, il le fait vivre, il le déforme, le déconstruit jusqu’au cœur pour le reconstruire. Il convient à nouveau à ce stade de mettre en avant l’originalité et la cohérence des choix d’un écrivain trop souvent conspué pour son « écriture de l’excès », travers qui représente au contraire un des intérêts majeurs de son œuvre. La surabondance et l’excès sont assurément au cœur du style et du projet de John Neal. L’outrance nealienne — que le carnavalesque bakhtinien éclaire — s’appuie sur des corps théâtralisés, hypertrophiés, échevelés, nus, métissés, empoisonnés ou inertes. Il faut y voir le signe d’une résistance à cadrer le réel, la marque d’une écriture qui courtise le chaos. Excessifs, baroques, ses Américains habitent dès lors une frontière conçue comme un espace d’indétermination où naissent les possibles, une scène de théâtre, un incubateur pour des prématurés nealiens suroxygénés : difformes, grotesques, en permanence à la limite, extra-vagants au sens où l’entend Thoreau17, ils viennent ébranler les bornes du paradigme, dans ce que l’on pourra qualifier d’« esthétique de l’écart » (Roudeau 2012 38, 325).
Dans la deuxième partie, « Entre nation et dissémination », les contours de la nation nealienne se dessinent, en pointillé. Avant ce que F. O. Matthiessen nomme American Renaissance, il y a l’écriture de la naissance, celle des années 1820. John Neal ne se satisfait pas d’une « autre déclaration d’indépendance dans la grande république des lettres » : cette littérature en devenir, il la porte, notamment avec sa série d’articles novateurs, « American Writers », publiée en 1824–1825 dans Blackwood’s. Mais ne nous y trompons pas, Neal veut une littérature nationale, pas une littérature nationaliste, son récit n’est pas national au sens où l’entend George Bancroft (1–4). Certes, on y trouve les congrégations puritaines, les rassemblements et la ferveur révolutionnaire, mais le récit n’est plus communautaire, c’est l’intimité du foyer national, c’est l’individu, le Yankee — son Américain — que Neal s’emploie à circonscrire, tout en se refusant à en délinéer les contours avec précision. Car la signification du vocable « américain » ne va assurément pas de soi : instable, elle ne saurait être tenue pour acquise. Neal serait en quelque sorte l’écrivain « aux aguets » de Deleuze18, celui qui s’inscrit à la limite, écrivant « pour les » / « à la place des » femmes — Neal est l’un des premiers féministes —, idiots, bêtes, sauvages, Yankees. Et Neal innove, en introduisant deux modèles yankees distincts. Ce faisant, il réintroduit l’écart, matérialisé dès le titre du roman Brother Jonathan : or, the New Englanders. Ce trait d’union séparant l’Angleterre du Nouveau Monde, ce lieu instable, John Neal l’habite, s’attachant à maintenir les deux pôles en tension. Le gothique s’américanise. L’écriture-frontière nealienne devient dès lors un fabuleux entre-deux, un espace de dialogue entre Britanniques et Américains, loyalistes et patriotes. La ligne de démarcation entre les littératures anglaise et américaine sera l’oralité, ce « talking on paper » qu’il revendique : John Neal écrit en effet sur la ligne mouvante entre les genres. La voix de la nation s’est diffractée : adepte d’une oralité vernaculaire anticipant Twain, il fait entrer cet autre, le Yankee (Brother Jonathan), en littérature. L’écriture-frontière a son État, sa voix, sa tessiture américaine, polyphonique, yankee, virginienne, noire, indienne. Oui, l’écriture nealienne découpe à la scie sauteuse les pièces du puzzle dialectal américain, les frontières internes de l’Amérique, mettant ainsi à profit cette particularité américaine du premier xixe siècle soulignée par Thomas C. Upham dans la préface de ses American Sketches (1819) : « [The American writer] would not be limited to the delineation of a particular cast of character in the defect of well-defined national features » (14–15). L’objet de l’étude est bien là, dans la volonté de s’interroger sur l’apport de John Neal à une littérature américaine qui, tout en étant incontestablement l’héritière de la littérature britannique au niveau linguistique, littéraire et plus largement culturel, revendique malgré tout avec vigueur sa nouveauté et sa puissance créatrice. Neal écrit sur des êtres de la frontière, des êtres qui remettent en question les préceptes inculqués et pour lesquels les liens familiaux se sont distendus, dans une société désorganisée, une société qui se cherche un centre. Dans une nation en construction qui s’écrit aussi en lignes brisées, brèches et béances, l’épistolière et couturière de Brother Jonathan, Edith Cummin, est un personnage-clé : elle assemble les mots, les fragments de manuscrits, les fragments d’étoffe, rétablissant de fait une linéarité discursive parfois mise à mal. Artiste excentrique, adepte de la confection de courtepointes (« quilting »), elle opère les sutures, les raccords qui aident l’Amérique nealienne à se fédérer.
La troisième partie, « Les nouvelles écritures », placée sous le patronage de la Bible, poursuit la construction du « je » en partant du centre, du cœur puritain de l’Amérique, pour le tirer progressivement vers la marge. Afin de délinéer ce « je » américain encore fragmenté, l’écriture nealienne se fait réécriture des Écritures : les protagonistes christiques, prêcheurs et prophètes patentés, y affichent une foi syncrétique, quaker, unitarienne ou déiste. À certains égards proche de l’utilitarisme évangélique de William Paley, cette quête centrifuge, affichant sa foi en l’homme, s’inscrit en contrepoint aux dogmes religieux. Le « je » christique de la diégèse se cherche une vérité, les cadres se croisent : de la loi divine à la loi humaine, de la vérité substantielle — inaccessible — à la vérité circonstancielle, l’écriture-frontière cherche à délimiter un nouveau paradigme. Centrifuge, elle mène les héros au bord de l’abîme, mais elle est aussi et surtout l’écriture du pli, de la jointure, celle qui sait se regarder dans le miroir : elle accomplit un travail herméneutique, sorte d’autoanalyse salutaire du rapport aux Saintes Écritures, à travers le rêveur éveillé Walter Harwood et son récurrent « Pourquoi devrait-t-il vivre ? » (« Why should he live? »), ou encore à travers George Burroughs, décortiquant un système légaliste inique, le tout dans une atmosphère parfois gothique qui sied à l’introspection. George Burroughs, Jonathan Peters, Walter Harwood, sont des radicaux, héritiers de Jeremy Bentham et John Stuart Mill, des étrangers christiques, des hors-la-loi en quête de vérité, qui aspirent à s’extirper de l’enclave puritaine, à réinventer leur rapport à la Bible, car il y a toujours, en arrière-plan, ce trope théologique. Paradoxalement, ce sont donc aussi des hommes de l’espace médian, ils peuplent une zone indécise, frontière, entre christianisme et athéisme, foi et rationalisme. La texture et le cœur de l’Amérique nealienne se nourrissent de ces dialectiques, de cette indéfinitude. La frontière, dans cette esthétique qui est aussi une éthique, est un front tout autant qu’une arène où l’on négocie en permanence, où l’Américain s’adapte aux circonstances : l’écriture nealienne est une écriture de l’interstice, elle naît de cette vérité qui se dérobe, jamais figée, une écriture du présent discordant, en équilibre entre un passé dont elle ne veut plus et un futur incertain, une écriture qui ne trace pas de ligne claire, une écriture de la contingence, de circonstance étymologiquement parlant, non une écriture « hors-sol ». L’émergence de cette vérité de circonstance laisse entrevoir une définition possible de la littérature de la jeune Amérique. L’écriture nealienne donne lieu à la constitution d’un mythe indiano-américain, agrégat unique d’inspiration biblique tout autant que de légendes issues de la cosmologie iroquoise. Le propos va par conséquent désormais se resserrer autour de l’idée forte de l’étude, à savoir la constitution d’une littérature nationale à travers la figure d’un Américain, être de transition et hybride dont l’américanité passe par l’exhumation de l’Indien qui se trouve en lui. Car on se doutait bien que la quête du « je » américain, orchestrée par « l’écriture-frontière », allait finir par rencontrer cet autre, l’Indien, dont la figure, analysée en contrepoint de celle de Cooper, est la promesse d’une identité américaine dynamique, mobile et non essentialisée. Entre la clairière puritaine et la wilderness du Grand Esprit, la dichotomie n’était donc qu’apparente. Le protagoniste nealien quitte l’enclos mortifère, traverse la frontière, puis franchit les tumuli réagrégés par John Neal. Cette rencontre est l’objet des chapitres 4, 5 et 6.
Dans la partie 4 : « Vers le nouvel Américain : la centralité de l’Indien », la marge colonise le centre : l’Indien prérévolutionnaire s’anime, retrouve une voix, et détrône les héros épiques occidentaux. Quant aux deux génies tutélaires qui structurent l’écriture de Brother Jonathan, ils sont indiens.
La partie 5 en est la suite logique : « Le mythe nealien sera indien » vient compléter les contours du « je » nealien. Northrop Frye soutient en effet dans Le Grand Code que c’est le mythe qui marque les contours d’une culture :
Le véritable intérêt du mythe est de tracer une circonférence autour d’une communauté humaine et de regarder à l’intérieur vers cette communauté, non d’enquêter sur les opérations de la nature. [...] la mythologie n’est pas une réaction directe à l’environnement naturel : elle fait partie de cette couche isolante d’imagination qui nous en sépare. (Frye 1984 81)
Si le mythe nealien est indien, c’est que l’écriture nealienne s’approche de la tradition orale indienne, tradition dont Walter Channing, déplorant l’absence de caractère national, demandait l’intégration afin d’établir une littérature proprement américaine. Dans une langue qui aurait ravi John Neal alias Jehu O’Cataract, Walter Channing estime donc dès 1815, dans la North American Review :
The language of the Indian [...] is now elevated and soaring, for his image is the eagle, and now precipitous and hoarse as the cataract among whose mists he is descanting. In the oral literature of the Indian, even when rendered in a language enfeebled by excessive cultivation, every one has found genuine originality. (Channing 313–314)
Details
- Pages
- 506
- Publication Year
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9783034331081
- ISBN (ePUB)
- 9783034331098
- ISBN (MOBI)
- 9783034331173
- ISBN (Softcover)
- 9783034326803
- DOI
- 10.3726/b20451
- Language
- French
- Publication date
- 2023 (June)
- Keywords
- XIXe siècle Littérature américaine Yankee Indien Réforme
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 506 p., 2 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG