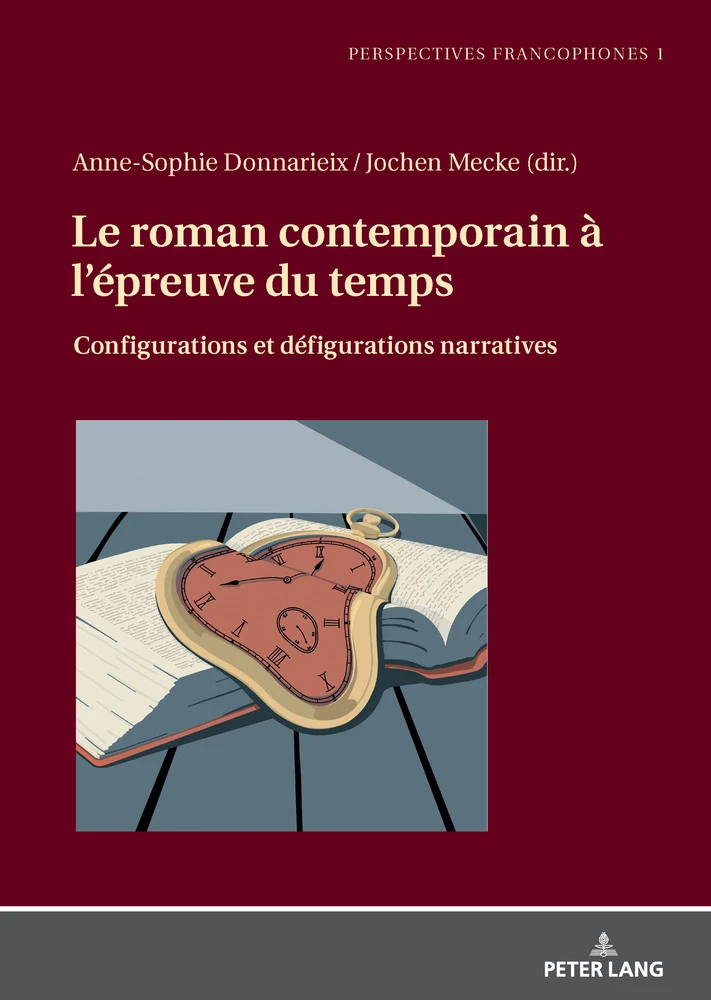Le roman contemporain à l’épreuve du temps
Configurations et défigurations narratives
Summary
Les contributions réunies dans ce volume entreprennent de sonder les enjeux de notre époque en revenant sur les configurations et défigurations temporelles à l’œuvre dans le roman francophone.
Excerpt
Table Of Contents
- Page de couverture
- Page de faux-titre
- Page de titre
- Page de droits d'auteur
- Sommaire
- Introduction
- Configurations, défigurations…
- Pour une théorie du temps et du temps narratif
- Le temps face à l’Histoire
- L’inversion du temps. Les narrations archéologiques en littérature contemporaine
- La fin du monde au présent : temporalités apocalyptiques de la littérature française contemporaine
- Les temps de la révolution. Mémoires et destins contemporains de la révolution dans les fictions d’Antoine Volodine et de Lucie Taïeb
- Panorama et recadrage. La mise en récit de l’Histoire dans Conquistadors (2009) d’Éric Vuillard
- Temps de l’énigme – énigmes du temps : Chevreuse de Patrick Modiano et La Vengeance m’appartient de Marie NDiaye
- La nuit des temps. Entretien avec Sylvie Germain
- Simultanéités et éclatements narratifs
- La fiction par temps quantique(s)
- Muriel Pic et la (re/dé)composition du temps
- L’irréversible et l’inachevable : voix, rythme et récit dans La langue d’Anna de Bernard Noël
- Histoires de la nuit : récit du présent
- Temporalités subjectives, temporalités collectives
- Une (dé)figuration francophone contemporaine du temps. La plus secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr
- Fréquenter la gare sans prendre le train. Défigurations du temps ferroviaire chez Martine Sonnet et Joy Sorman
- Mémoires traumatiques et défigurations du temps. Kamouraska et Les Fous de Bassan d’Anne Hébert
- Métamorphoses du temps et de l’espace dans Les Solidarités mystérieuses de Pascal Quignard
- En attendant du travail. Sur la temporalité du chômage dans le roman contemporain
- Études de cas : les temporalités de Jean-Philippe Toussaint
- L’en deçà du temps. Esthétiques de l’infra-temporel chez Jean-Philippe Toussaint
- Modalités contemporaines de la simultanéité dans M.M.M.M. de Jean-Philippe Toussaint
- Entre prospective et rétrospections : le temps dans La Clé USB et Les Émotions de Jean-Philippe Toussaint
- Des écritures du temps. Entretien avec Jean-Philippe Toussaint
- Notices sur les autrices et auteurs
Jochen Mecke & Anne-Sophie Donnarieix
Configurations, défigurations…
Temporalité et roman
Dès ses origines, le roman est intimement lié au temps. D’une part, parce que celui-ci constitue une dimension matérielle incontournable de tout récit oral ou écrit. Depuis les récitations des aèdes grecs et les rhapsodes de l’Antiquité, le texte se construit, s’énonce et s’entend dans le temps – ce temps du discours même qui préside à l’élaboration, à la scription puis à la lecture du texte écrit. D’autre part, le roman se construit comme le récit d’une histoire ou d’une suite d’événements. Cette temporalité « diégétique » est nécessaire à notre compréhension des structures du récit, notamment chronologiques lorsqu’elles s’attachent au modèle épique (chansons de gestes, fresques historiques), au parcours initiatique ou familial d’un personnage (Bildungsroman, récits de filiation) ou aux itinérances spatiales (du récit de voyage aux enquêtes de terrain). Le temps du discours constitue à cet égard une norme narrative qui permet de comprendre les détours régulièrement effectués par les récits qui dérogent à la chronologie, brusquent, inversent ou bouleversent l’ordre du récit avec force ellipses, répétitions ou itérations, simultanéités narratives et plus généralement tout type d’anachronie voire d’achronie lorsqu’il n’est plus guère possible d’identifier quelque « ordre » temporel que ce soit.
Cette double détermination du roman par le temps s’inscrit dans une longue tradition de l’histoire littéraire1. Elle a en outre bénéficié d’une attention continue au xxe siècle, sous la plume de critiques attentifs aux interactions liant les régimes temporels du signifiant et du signifié, les conditions de production d’un discours et l’agencement diégétique du récit. Pour le linguiste Émile Benveniste, c’est le langage et plus précisément l’acte d’énonciation (le « temps linguistique ») qui nous permet d’appréhender la catégorie générale du temps à travers les « temps verbaux » grâce auxquels nous structurons, dans la langue, nos expériences et représentations2. Gérard Genette souligne quant à lui l’importance d’une approche narratologique qui confronte l’ordre temporel des événements, dans le discours narratif, à l’ordre temporel de ces mêmes événements dans l’histoire racontée3. Paul Ricoeur encore, qui consacre aux notions de « temps » et de « récit » une réflexion en trois volumes, fait de la « mise en intrigue » la seule manière d’appréhender une temporalité sinon fuyante, contradictoire, impossible à saisir sans la médiation du récit4.
Les temps modernes
Avec l’avènement de la modernité, le temps ne constitue plus seulement une dimension centrale de la forme du roman, il semble également en devenir le thème, voire l’obsession principale. Certains critiques comme Wyndham Lewis n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’une « Time-School of Literature », une « école littéraire du temps5 ». Ce phénomène atteint une ampleur particulière dans les textes des grands auteurs de la modernité tels que Marcel Proust, James Joyce, Ezra Pound ou Thomas Mann. Leurs romans en effet constituent autant d’expériences littéraires liées à la recherche du temps, à sa modélisation par les mots, à la captation de ce qui, du temps, se refuse à nos chronologies quotidiennes et à l’agencement romanesque traditionnel. D’autre part, ils témoignent également d’un phénomène culturel plus large, celui de la modernisation de la société occidentale étudiée par le sociologue allemand Hartmut Rosa qui démontre combien les conditions de vie, les moyens de production et de communication, les structures sociales et économiques sont alors marquées par un processus d’« accélération » [Beschleunigung]. Pour reprendre les termes de Rosa : « Als leitende Hypothese dient dabei die Vermutung, dass Modernisierung nicht nur ein vielschichtiger Prozess in der Zeit ist, sondern zuerst und vor allem auch eine strukturell und kulturell höchst bedeutsame Transformation der Temporalstrukturen und –horizonte selbst bezeichnet und dass die Veränderungsrichtung dabei am angemessensten mit dem Begriff der sozialen Beschleunigung zu erfassen ist.6 » Cette « accélération sociale » se reflète dans l’esthétique romanesque de l’époque dont les œuvres les plus représentatives multiplient les stratégies littéraires visant à la création de temporalités dilatées, morcelées ou éclatées, comme Ulysses (James Joyce), Mrs. Dalloway ou To The Lighthouse (Virginia Woolf), À la recherche du temps perdu (Marcel Proust), Der Zauberberg (Thomas Mann), Manhattan Transfer (John Dos Passos) ou Berlin Alexanderplatz (Alfred Döblin). Aussi cette nouvelle conscience du temps ne se manifeste pas uniquement dans l’orientation thématique des œuvres les plus représentatives de l’esthétique moderne, mais s’articule aussi et surtout autour d’une recherche plus fondamentale de nouvelles formes esthétiques capables d’en transposer l’expérience7.
C’est avec l’avènement de la modernité que la catégorie temporelle devient un étalon essentiel de l’évolution de l’histoire littéraire. La multiplication des courants avant-gardistes se succédant à un rythme soutenu, du futurisme au dadaïsme puis au surréalisme, et jusqu’à l’existentialisme ou l’absurde, semble indiquer que le temps est devenu la conditio sine qua non de la littérature moderne8, fondée sur un impératif de rupture avec les esthétiques précédentes. Dorénavant, ce que l’on pourrait appeler avec Kant « l’impératif catégorique de la modernité9 » (c’est-à-dire l’innovation) valorise avant tout l’originalité des œuvres et des mouvances, liant étroitement la légitimation de la valeur littéraire à la ‘nouveauté’ des formes textuelles et contribuant, de fait, à une accélération sensible de la chronologie du champ littéraire10. Cette accélération atteindra son apogée lorsque, sous l’impulsion d’autrices et d’auteurs comme Nathalie Sarraute, Claude Simon ou Alain Robbe-Grillet, la littérature ira jusqu’à déconstruire l’idée même de cohérence chronologique en inscrivant la narration dans un temps désancré, subjectif, lacunaire ou profondément insaisissable11. Si le roman moderne met en branle les formes traditionnelles de la représentation du temps à l’intérieur de la diégèse comme du discours narratif, il répond donc tout aussi bien à l’accélération de la société moderne qu’à celle qui constitue sa propre condition spécifique. Et il n’est guère étonnant que les critiques littéraires aient partagé cette fascination pour le temps, eux-mêmes analysant la littérature moderne depuis la perspective privilégiée de la temporalité.
Postmodernités et temporalités de l’extrême contemporain
Or que reste-t-il de ces structures temporelles dans la littérature d’aujourd’hui ? Quelles sont les temporalités sociales, économiques et culturelles qui modèlent notre rapport au monde depuis l’entrée dans le troisième millénaire ? Quelle actualité la notion d’ « accélération » affiche-t-elle encore à notre époque, et comment imprègne-t-elle le geste critique dans sa détermination des évolutions littéraires ? Le temps constitue-t-il toujours l’une des préoccupations centrales des écrivaines et écrivains ou bien se voit-il relayé par d’autres catégories ? Quelle place occupe la recherche de nouvelles formes temporelles dans la pratique romanesque contemporaine ?
S’interroger aujourd’hui sur la temporalité romanesque ne va pas de soi. Dans le sillage de ce que l’on nomme désormais communément le « spatial turn » des sciences humaines, l’attention accrue portée aux dimensions géographiques, migratoires ou environnementales semble paradoxalement reléguer le temps, si longtemps au cœur des réflexions littéraires, à une catégorie surannée. À ce déplacement de la focale critique s’ajoute une certaine gêne dans l’appréhension théorique des temporalités contemporaines : si le schème du « retour » est régulièrement invoqué pour circonscrire les évolutions du roman contemporain depuis les années 1980, celui-ci hérite aussi des fantasmes et des inquiétudes d’une époque fascinée par l’imaginaire de sa propre fin12 – fin des « grands récits » selon Jean-François Lyotard13, « fin de l’Histoire » selon Francis Fukuyama14. La notion même de « postmodernité » témoigne d’un rapport ambigu à l’articulation temporelle dans le geste critique, puisqu’elle est définie comme une époque historique marquée à la fois par la « fin de la modernité » et de ses temporalités spécifiques, et par la relation qu’elle conserve pourtant toujours avec celle-ci, ses problématiques et ses questionnements – ambiguïté dont témoigne bien sûr le préfixe « post ». Aussi la question se pose-t-elle de savoir comment et sur quels fondements théoriques décrire aujourd’hui notre présent et sa littérature face à des structures téléologiques régulièrement désavouées, voire phagocytées par la prépondérance de l’espace.
L’idée d’un remplacement du temps par l’espace repose toutefois sur une dialectique problématique, opposant deux entités qui gagnent au contraire à être pensées ensemble15. Si l’on suit en effet la théorie de Heidegger, le temps se caractérise par une « non-présence » fondamentale16 ; il ne peut être représenté qu’à travers des formes spatiales, qu’elles soient cycliques, linéaires ou stratifiées. Et à l’inverse, l’espace est toujours ancré dans le temps. Pour reprendre les termes de Jacques Derrida, il est l’Autre du temps, le non-être du temps17. Partant, le passage de la modernité à la postmodernité serait peut-être moins à comprendre comme une évolution du temps vers l’espace que comme le glissement de certaines temporalités modernes vers de nouvelles modalités de configuration.
Configurations, défigurations
Les contributions réunies dans ce volume sont reliées entre elles par l’hypothèse selon laquelle la littérature de l’extrême contemporain hérite certes des problématiques de la modernité, mais qu’elle leur apporte des réponses esthétiques contrastées. À partir de la notion de « configuration narrative » proposée par Paul Ricoeur pour désigner la cohérence logique et temporelle recréée par le travail d’agencement discursif et la mise en relation d’éléments sinon hétérogènes et désancrés de toute chronologie18, nous avons souhaité interroger les articulations spécifiques aux temporalités du roman contemporain. Le présent volume explore ainsi les modalités innovantes de représentation du temps dans l’imaginaire et le discours romanesques, mais aussi les transformations et défigurations qu’y subissent des temporalités plus anciennes issues de la tradition littéraire. Car si le roman contemporain s’émancipe des expérimentations formalistes de la première moitié du xxe siècle, ses temporalités n’en apparaissent pas moins altérées, déformées, fragmentées ou mouvantes – multipliant les strates, jouant d’incohérences, proposant aussi de nouvelles durées simultanées, suspendues ou fuyantes, parfois même « surnaturelles19 » lorsqu’elles réinvestissent des principes magiques qui accaparent jusqu’au temps de l’énonciation.
Plusieurs champs de réflexion s’ouvrent alors à l’analyse. D’un point de vue théorique, comment comprendre et désigner les régimes d’altération temporelle à l’œuvre dans le roman contemporain? Est-il possible d’appréhender la délinéarisation des axes chronologiques depuis les concepts mobilisés parfois pour décrire notre rapport contemporain au temps, qu’ils soient issus des sciences humaines (temporalité « mémorielle20 » selon Pierre Nora, « présentisme21 » de François Hartog) ou des sciences naturelles et technologiques (des théories quantiques aux expériences de temporalités virtuelles) ? Quelles figures président à ces nouveaux imaginaires (cycliques, elliptiques, entropiques) et comment les appréhender depuis les perspectives offertes par les domaines de la narratologie, de la stylistique ou de la réception ? Peut-on rendre féconds les apports des études spatiales pour appréhender des temporalités labyrinthiques, frontalières ou archipéliques, voire identifier de nouveaux « chronotopes22 » romanesques ?
D’autre part, comment analyser les défigurations du temps face au récit historique dont le roman contemporain métamorphose si volontiers les formes, depuis les fresques transséculaires imprégnées de légendes et de mythes (notamment dans les textes de Sylvie Germain) et jusqu’aux régimes obsessionnels d’un temps resté bloqué à l’heure des traumatismes collectifs (chez Nicole Caligaris ou Patrick Modiano) ? Comment envisager les fictions dystopiques ou post-apocalyptiques qui déforment le futur à l’aune des désastres du passé ou des inquiétudes du présent, comme dans les romans d’Antoine Volodine, de Lucie Taïeb ou de Léonora Miano ? Et qu’en est-il des écritures fantastiques ou contrefactuelles qui inversent le temps de l’histoire, le dilatent, l’évident, en font dévier le cours, notamment chez Bernard Lamarche-Vadel, Valérie Ovaldé, ou dans les récits contre-historiques de Laurent Binet ?
Quant aux modalités énonciatives, à quels dispositifs recourent les écrivain.es ? Dans quelle mesure les instances narratives contribuent-elles à désorganiser l’agencement temporel du texte, depuis les tentatives de « roman quantique » entreprises par des auteurs comme Christian Garcin ou Philippe Forest, et jusqu’aux recherches postmodernes du temps perdu dans les cycles de Jean-Philippe Toussaint ? Entre décalage et simultanéité, quel rôle joue la démultiplication des voix narratives dans le récit-choral, de Laurent Mauvignier à Assia Djebar, ou le dédoublement insolite des narrateurs dans un roman tel que L’Anomalie de Hervé Le Tellier ? Quelle place réserver à la question des temporalités collectives et subjectives dans un monde où la question des communautés se fait de plus en plus pressante, qu’elles soient ouvrières, familiales, culturelles ou politiques ? Et qu’en est-il des représentations du temps à l’œuvre dans les écritures francophones, notamment québécoises, africaines ou caribéennes, qui s’inscrivent dans des traditions littéraires et critiques distinctes de celles de la France métropolitaine ? Ces réflexions ont guidé les rencontres qui se sont tenues à l’Université de Regensburg en juin 2023, dont ces actes sont issus, et donnent également leur structure au présent volume.
Parcours de lecture
Les quatre parties de l’ouvrage sont précédées par des prolégomènes théoriques dans lesquels Jochen Mecke retrace de manière détaillée les généalogies du roman contemporain en regard de ses traditions littéraires, et les ambiguïtés de l’analyse de ses temporalités. Il propose ainsi des jalons théoriques et historiques pour l’étude des temporalités romanesques et suit l’hypothèse d’un tournant majeur de leurs structures et de leurs fonctions esthétiques au seuil du xxie siècle.
La première partie, intitulée « Le temps face à l’Histoire » s’ouvre sur le bouleversement des structures historiques du roman : téléologies inversées, mises en récit problématique de l’Histoire et de ses traumatismes belliqueux, révolutionnaires ou coloniaux, ou encore pratiques rétrospectives et investigatrices de romans qui interrogent le temps à rebours, depuis notre présent. Dans un premier article, Dominique Viart présente ce qu’il nomme des « narrations archéologiques ». À travers l’exemple d’Alain Nadaud, il revient sur ces nombreux récits contemporains qui, au lieu de restituer le cours naturel des événements historiques auxquels ils se réfèrent, entreprennent de sonder le passé depuis notre présent. À l’aide d’un imaginaire rétrospectif qui procède par inversion temporelle et donne lieu à un travail d’enquête (avec ses approximations et ses impasses, sa subjectivité assumée, ses défauts de transmission), Viart montre que ces récits inscrivent la littérature d’aujourd’hui dans un régime d’historicité qui trahit encore une large « inquiétude du passé ». L’article de Jean-Paul Engélibert porte sur les temporalités apocalyptiques de la littérature contemporaine et étudie le contrepoint qu’elles proposent au régime de « présentisme » décrit par François Hartog. Au fil des lectures de Pierre Alferi, Marie Darrieussecq, Michel Houellebecq et Antoine Volodine, le temps est envisagé dans la perspective d’un kaïros, moment de prise de conscience absolue, qui fait table rase du présent et oriente ces fictions vers une lecture à la fois politique et théologique en tant qu’elles mettent en place un récit de la conversion. C’est aussi depuis le prisme politique que Cécile Chatelet étudie les représentations de la révolution dans l’œuvre d’Antoine Volodine et de Lucie Taïeb. Sensible aux enjeux du régime dystopique, l’autrice ausculte les structures temporelles à l’œuvre et envisage le récit révolutionnaire selon un double mouvement d’effacement du passé et de scepticisme profond quant à l’avènement possible d’un futur meilleur. Révolution d’un autre genre, le roman Conquistadors (2009) d’Éric Vuillard est ensuite envisagé comme paradigmatique d’une forme d’agencement temporelle spécifique de l’auteur (« la méthode Vuillard ») dont Christian von Tschilschke analyse les structures fragmentaires et suggestives au fil d’une lecture détaillée, en arguant que le principe d’oscillation entre présence et distance sur lequel elles se fondent, inscrit le texte dans le genre du roman historique postmoderne. Ursula Bähler quitte les rives de l’Histoire coloniale pour explorer des passés à la fois plus proches et plus intimes : en relisant Chevreuse de Patrick Modiano et La Vengeance m’appartient de Marie NDiaye, elle analyse les pratiques de l’écriture d’enquête et distingue dans les textes deux modes de saisie du temps révolu, qu’unit pourtant la même articulation narrative autour d’une parole littéraire réitérée, de nature presque incantatoire, qui cherche le sens sans jamais l’épuiser. Cette première partie se clôt par un entretien inédit avec Sylvie Germain, mené par Anne-Sophie Donnarieix, dans lequel l’autrice revient sur sa pratique littéraire et son évolution, depuis les fresques historiques si singulières de ses premiers textes, inscrits sous le sceau d’une temporalité légendaire et hallucinatoire, et jusqu’à ses romans les plus récents, attentifs aux temporalités intimes et placés directement dans l’actualité contemporaine.
La deuxième partie de l’ouvrage, « Simultanéités et éclatements » est consacrée à l’étude des régimes narratifs mobilisés pour déconstruire la linéarité du récit : temporalités discursives parallèles ou instantanées, prismes énonciatifs subjectivisés ou superposés à travers lesquels la narration désarticule l’ordre chronologique des événements. Anne-Sophie Donnarieix revient sur l’attirance de toute une génération d’écrivains pour l’imaginaire quantique et ses modalités de représentation temporelle. À travers la lecture de trois romans de Michel Rio, Jean-Philippe Toussaint et Philippe Forest, l’autrice questionne les implications narratives et les enjeux épistémologiques du motif quantique en arguant d’un rapport ambigu du roman à la stabilité du savoir scientifique qui se joue régulièrement, derrière ses atours ludiques, sur le fil de l’inquiétude. Les trois articles suivants offrent des lectures de textes choisis qui attestent l’amplitude des déformations temporelles à l’œuvre dans le roman contemporain. À partir d’Affranchissements de Muriel Pic, Elisa Bricco revient sur la manière dont la narration procède à un détournement de la notion même de temps ; par collage graphique et plurilingue, éclatement générique et superposition d’intrigues, le texte met en scène une narration de l’errance que Bricco étudie au fil de trois temporalités analytiques : celle de l’enquête, celle de l’autobiographie, et celle de la lecture. Lucie Bourassa s’attèle quant à elle à l’étude du roman québécois La langue d’Anna de Bernard Noël, monologue fictif inspiré par l’actrice Anna Magnani, et souligne en quoi le récit, au fil d’une structure anaphorique obsédante, fait du monologue le lieu d’une parole littéraire qui lutte contre la linéarité et avance par ruptures, retours et séquences inachevées pour exprimer une temporalité de « l’inscrutable », celle de la psyché humaine. Enfin, l’article de Claire Olivier examine la temporalité événementielle à l’œuvre dans Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier. L’événement, compris comme élément disruptif qui distingue un « avant » et un « après », ne fournit plus ici d’orientation chronologique ; il se condense plutôt dans un instant anodin, commun à tous les personnages, d’une « épaisseur temporelle » avant tout littéraire et dont Olivier étudie les caractéristiques prosodiques et stylistiques.
La troisième partie, « temporalités subjectives, temporalités collectives », interroge l’expérience du temps dans son rapport au sujet et à la communauté, et entreprend d’étudier les inflexions du prisme individuel ou collectif sur l’expérience anthropologique du temps, et sa mise en discours. C’est ainsi à l’intersection entre deux formes de temporalité culturelle que se situe l’analyse de Jean-Marc Moura. À partir de La plus secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, l’article développe deux lectures possibles du roman : l’une, liée à la temporalité de l’écrivain africain, l’autre, propre à l’auteur international dont la consécration française par le Prix Goncourt, qui couronne pour la première fois un écrivain noir, s’inscrit aussi dans le cadre d’une temporalité francophone « opportune », aux ressorts à la fois politiques et éditoriaux. Wolfram Nitsch déplace la focale analytique vers une autre forme de temporalité collective, mais non moins culturelle, celle du temps ferroviaire. La gare est envisagée comme lieu privilégié d’une expérience temporelle liée, historiquement à l’émergence d’une culture transnationale et moderne de la ponctualité, mais qui donne aussi lieu dans les deux textes de Joy Sorman (Paris Gare du Nord) et Martine Sonnet (Montparnasse monde) à des réflexions de nature anthropologique et esthétique sur la perception du temps. Dans un article consacré à deux textes d’Anne Hébert, Dagmar Schmelzer revient à la question historique mais s’intéresse surtout à la subjectivisation déformante de ses mémoires traumatiques collectives dans le roman québécois. Si le temps y prend des formes littéralement pathologiques, c’est qu’il structure un récit de soi marqué par le retour du refoulé collectif que l’autrice propose de lire de manière métonymique comme la résurgence des traumatismes propres à l’histoire du Québec. Saïda Arfaoui propose quant à elle une lecture des temporalités subjectives à l’œuvre dans Les Solidarités mystérieuses de Pascal Quignard. Fondé sur l’absence de toute image originaire, le roman devient le lieu d’une transfiguration continue qui émancipe les personnages de la chronologie temporelle et renégocie, par la voie romanesque, nos ontologies intimes. Enfin, l’article de Teresa Hiergeist croise les approches socioculturelles et narratologiques pour appréhender les modes de représentation de la temporalité du chômage dans le roman contemporain, mis en regard du rôle social dévolu au travail dans la littérature depuis le xixe siècle. À partir de Cadres noirs de Pierre Lemaître et Les renards pâles de Yannick Haenel, Hiergeist explore le potentiel expressif du motif du chômage face aux défis sociaux de la précarité, et replace les deux textes dans un courant littéraire ambivalent qui critique, tout en la reconduisant, la logique marchande du capital.
La dernière partie de l’ouvrage propose en guise de conclusion une étude de cas : celle de l’œuvre romanesque de Jean-Philippe Toussaint mise en regard de l’évolution de ses structures temporelles. Si ces premiers romans, depuis La Salle de bains, Monsieur, L’Appareil-photo et La Télévision mettent en place, selon l’expression de Jochen Mecke, une esthétique de l’« infra-temporel » qui privilégie les temporalités entropiques, les moments d’arrêt et les pratiques discursives elliptiques, freinant toute impression d’écoulement temporel, ses romans ultérieurs font évoluer cette conception romanesque. Evelyne Thoizet analyse ainsi les modalités contemporaines de la simultanéité dans le cycle « M.M.M.M. » (Faire l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie, Nue) où la fuite en avant du temps est contrebalancée par une narration qui procède par scènes et tableaux simultanés construits autour de dispositifs visuels et acoustiques. L’étude d’Isabelle Dangy se poursuit par la lecture des romans La Clé USB et Les Émotions qui font suite au cycle de Marie et ménagent une temporalité dont les structures ne s’organisent plus dans une simultanéité dispersive, mais engagent plutôt une oscillation perpétuelle entre rétrospections et anticipations qui est commune aux deux romans et érige la suspension temporelle en moteur romanesque. Enfin, un entretien inédit avec Jean-Philippe Toussaint mené par Jochen Mecke clôt cette dernière partie, et envisage la production romanesque de l’auteur depuis une perspective temporelle panoramique, de ses premiers romans et jusqu’aux derniers textes parus.
1 Thomas Mann est l’un des premiers romanciers à souligner de manière explicite, dans Der Zauberberg, cette double détermination temporelle du récit qui servira ensuite de fondement à toutes les théories et méthodes de l’analyse du temps romanesque. Cf. Thomas Mann, Der Zauberberg, Frankfurt am Main, Fischer tb, 1988 [1922], p. 570-571. Voir aussi l’analyse de Gérard Genette, Figures III, « Discours du récit », Paris, Seuil, 1972, p. 67-273.
2 La temporalité, selon Benveniste, « est produite en réalité dans et par l’énonciation. De l’énonciation procède l’instauration de la catégorie de présent, et de la catégorie du présent naît la catégorie du temps ». Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. II, Paris, Gallimard, 1974, p. 83.
3 Gérard Genette, « Discours du récit », p. 78-79.
4 Paul Ricoeur, Temps et récit, vol. I, Paris, Seuil, 1983, p. 85.
5 Wyndham Lewis, Time and Western Man, London, Chatto & Windus, 1927, p. XX.
Details
- Pages
- 336
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631891612
- ISBN (ePUB)
- 9783631891629
- ISBN (Hardcover)
- 9783631891353
- DOI
- 10.3726/b20274
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (July)
- Keywords
- Temporalité Temps Fiction contemporaine Roman contemporain Roman français et francophone Postmoderne Apocalypse Archéologie
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 336 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG