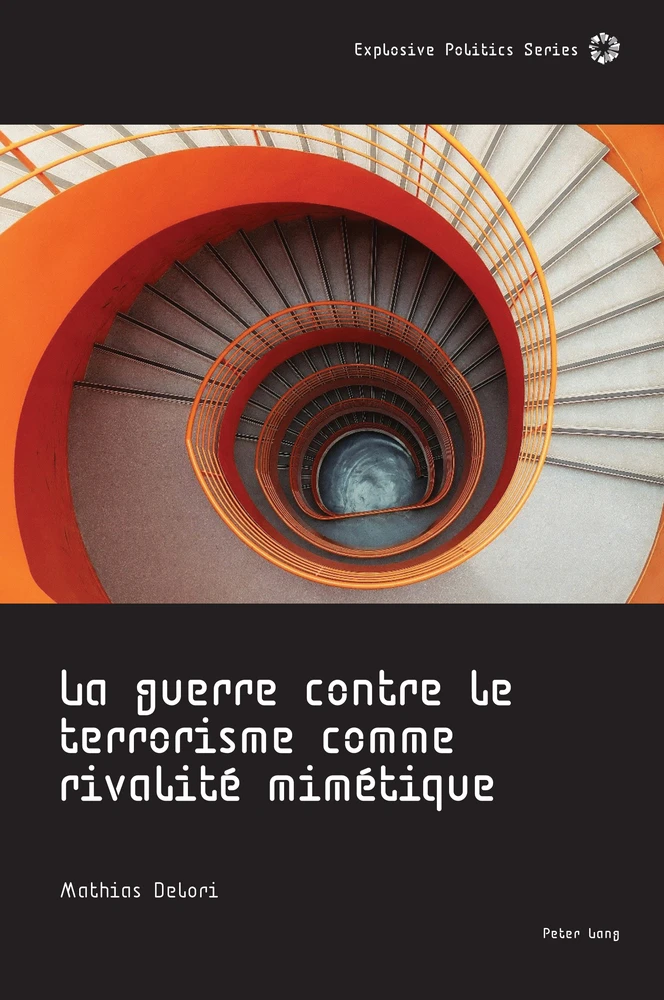La guerre contre le terrorisme comme rivalité mimétique
Summary
(Didier Bigo, préfacier de ce livre)
Les notions de fanatisme et d’impérialisme permettent-elles sérieusement d’expliquer le terrorisme et les guerres contre celui-ci? Et si notre comprehension de ces phénomènes devait être repensée à l’aune de ce que René Girard appelle le mimétisme, à savoir l’idée selon laquelle les uns et les autres s’imitent pour produire, ensemble, l’escalade de la violence? S’appuyant sur une enquête socio-historique à base d’archives et d’entretiens, l’auteur analyse comment djihadistes, responsables politiques, journalistes et pseudo experts en «radicalisation» ont pendant trente ans sapé la réflexion stratégique pour produire un monde où les attentats ont répondu aux bombardements et les bombardements aux attentats.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Liste des illustrations
- Préface de Didier Bigo
- Remerciements
- Note sur le recours à l’écriture inclusive
- Liste des abréviations
- Introduction
- Première partie Comment construire l’objet (contre-) “terroriste”
- Chapitre 1 L’escalade
- De la rivalité non-violente à la guerre conventionnelle (1991–1997)
- Les attentats et bombardements indiscriminés de l’année 1998
- La torture comme réponse au terrorisme de masse (2001–2002)
- Le choc et l’effroi en Irak (2003–2004)
- La désescalade contre-insurrectionnelle (2005–2011)
- Le regain de violence contingent des années 2010
- Le transfert de risque vers les civils des pays bombardés
- La multiplication des groupes djihadistes
- Le retour de flamme dans les pays bombardants
- Chapitre 2 Les théories alternatives
- Une montée aux extrêmes au sens de Clausewitz ?
- L’idéologie radicale des uns
- Le fanatisme supposé des djihadistes
- L’effroyable normalité du djihadisme
- Le “parler musulman” de la guerre asymétrique
- Les motifs cachés des autres
- Des politiques de puissance déguisées
- Les intérêts économiques et bureaucratiques
- Se rendre populaire
- Chapitre 3 Pour une étude réflexive de la violence
- Le principe de symétrie
- Pragmatisme djihadiste et mythologie contre-“terroriste”
- Les acteurs croient-ils en leurs mythes ?
- Comprendre et objectiver les cadres de guerre
- La vigilance épistémologique
- Terroristes ou résistants ?
- Les définitions positives du terrorisme
- De l’étude du terrorisme à celle du “terrorisme”
- Quelle théorie de la rivalité mimétique ?
- Les désirs mimétiques
- Le cercle vicieux de la vengeance
- La construction sociale du mécanisme victimaire
- La question du dévoilement
- Deuxième partie Les cadres du mécanisme victimaire
- Chapitre 4 La (dis)simulation
- Les attentats n’ont pas eu lieu
- Les sidérations après les attentats
- Une guerre sans mort n’est pas une vraie guerre
- Le complexe militaro-industriel du divertissement
- De la difficulté de s’informer
- La transsubstantiation des bombes anti-djihadistes dans le journal Le Monde
- La politique différenciée du deuil public
- La baisse tendancielle du taux d’information
- La maîtrise militaire de “l’environnement informationnel”
- Chapitre 5 Le temps
- La vengeance différée des “terroristes”
- La guerre préventive
- Torturer pour sauver des vies
- Les bombardements humanitaires d’urgence
- La co-construction de l’urgence contre-“terroriste”
- Chapitre 6 Le droit
- La légitimité divine des “terroristes”
- Le jus ad bellum contre-“terroriste”
- Les combattants illicites
- La légalisation de la torture
- Le rituel des bombardements légaux
- PID
- ROE
- CDE
- Les procès des intérimaires
- Chapitre 7 L’altérisation
- Les “mécréants”
- L’imaginaire orientaliste contre-“terroriste”
- Les mollahs fous
- Libérer les femmes orientales
- L’esprit arabe
- Le jeu de miroir inversé
- Civilisés et barbares
- La vie et la mort
- Les violences maîtrisées et totales
- Conclusion : l’impossible réflexion stratégique
- Ouvrages ou articles cités
- Titres de la collection
La guerre contre le terrorisme comme rivalité mimétique
Mathias Delori
 PETER LANG
Oxford - Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York
PETER LANG
Oxford - Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York
Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek.
The German National Library lists this publication in the German National Bib liography; detailed bibliographic data is available on the Internet at http://dnb.d-nb.de.
A catalogue record for this book is available from the British Library.
Library of Congress Control Number: 2024059524
Cover image: Photo de Maxime Lebrun sur Unsplash.
Cover design by Peter Lang Group AG
ISSN 2633-8203
ISBN 978-1-80374-655-5 (print)
ISBN 978-1-80374-656-2 (ePDF)
ISBN 978-1-80374-657-9 (ePub)
DOI 10.3726/b22156
© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne
Published by Peter Lang Ltd, Oxford, United Kingdom
info@peterlang.com - www.peterlang.com
Mathias Delori has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identified as Author of this Work.
All rights reserved.
All parts of this publication are protected by copyright.
Any utilisation outside the strict limits of the copyright law, without the permission of the publisher, is forbidden and liable to prosecution. This applies in particular to reproductions, translations, microfilming, and storage and processing in electronic retrieval systems.
This publication has been peer reviewed.
À propos de l’auteur
Mathias Delori (il/lui, né en 1978) est politiste et chargé de recherche CNRS (HDR) au CERI de Sciences Po Paris. Ses travaux portent sur les études critiques sur la guerre, la paix et la sécurité.
À propos du livre
“L’essai le plus systématique dans la remise en cause de manière raisonnée des analyses sur le (contre)terrorisme contemporain.”
– Didier Bigo, préfacier de ce livre
Les notions de fanatisme et d’impérialisme permettent-elles sérieusement d’expliquer le terrorisme et les guerres contre celui-ci? Et si notre compréhension de ces phénomènes devait être repensée à l’aune de ce que René Girard appelle le mimétisme, à savoir l’idée selon laquelle les uns et les autres s’imitent pour produire, ensemble, l’escalade de la violence? S’appuyant sur une enquête socio-historique à base d’archives et d’entretiens, l’auteur analyse comment djihadistes, responsables politiques, journalistes et pseudo experts en «radicalisation» ont pendant trente ans sapé la réflexion stratégique pour produire un monde où les attentats ont répondu aux bombardements et les bombardements aux attentats.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Préface de Didier Bigo
Mathias Delori présente un livre important qui restera dans la littérature française sur la violence politique comme l’essai le plus systématique dans la remise en cause de manière raisonnée des analyses sur le (contre)terrorisme contemporain. Il opère en deux grands moments. Une critique de la doxa de la littérature sur le terrorisme et le contre-terrorisme fondée sur l’analyse des cadrages que les différentes lectures géopolitiques et leurs relais médiatiques opèrent. Une analyse relationnelle des mécanismes de la violence inspirée des études qui réfléchissent sur la rivalité mimétique. Sa critique est exemplaire en ce sens qu’elle ne se situe pas, comme beaucoup d’autres, qui se contentent d’inverser le discours idéologique, en opposition avec le discours dominant. Elle déconstruit patiemment, minutieusement, et logiquement, tous les aprioris que les théories qui approchent le terrorisme à partir d’un seul acteur violent fanatisé, ou par un duel d’identités préconstituées (et radicalement opposées) considèrent comme des données naturelles, des évidences. Pour ces dernières, le terrorisme est le mot pour désigner le mal absolu, mais il ne peut s’appliquer qu’à l’autre, jamais à eux, qui ne font que se défendre contre l’odieux ; le contre-terrorisme est ainsi une violence justifiée en soi. C’est le seul moyen de mettre fin, par une violence juste à la violence injuste de départ. Le contre-terrorisme comme la guerre se veut alors le dernier mot souverain de la violence, la seule solution pour ramener la paix et la sécurité.
Mathias Delori ne refuse pas en bloc ces arguments. Il étudie comment sur les trente dernières années, loin de ramener la paix, le contre-terrorisme a conduit à relancer la violence et a tendu vers une dynamique de l’escalade qui aurait pu à plusieurs moments s’inverser, si l’extension du nombre d’acteurs impliqués en tant que victimes, perpétrateurs, ou considérés comme soutien actif à l’ennemi, n’avait pas pris le dessus, à la suite de ce que l’on pourrait appeler une suspicion à l’égard de tous ceux qui refusent de s’engager dans le camp de la “juste cause”. Il ne s’agit donc pas vraiment, comme certains l’avaient prophétisé après le 11 septembre 2001 d’un duel de volontés qui conduit à l’escalade entre deux acteurs et qui risquait de déboucher sur l’utilisation d’armes de destruction massive. Loin d’une polarisation inexorable menant au duel final entre deux forces, il a existé au contraire une forte dissymétrie des forces en présence, tant sur l’usage de la force que sur celui des moyens médiatiques, et on a assisté plutôt à la multiplication d’acteurs hétérogènes, à des alliances qui se renversent, à la réactivation d’anciens conflits et à la dissémination internationale de la violence et de ses modes opératoires. Seulement, il est difficile pour les acteurs du contre-terrorisme de se départir d’un raisonnement stratégique au sens Clausewitzien quand on analyse le terrorisme sous l’angle de la guerre, qu’elle soit dite hybride, secrète, ou même “sale”, à partir du moment où l’on pense qu’elle est la solution et que les militaires ou les services secrets doivent donner le “la” sur lequel doivent s’accorder les services de police, les gardes-frontières, la justice. Devant des échecs, la tentation est forte d’ajouter des moyens pour continuer la même stratégie au lieu d’en changer, et ce malgré les remarques de Paul Watzlawick qui avait déjà signalé que ceci conduit à des “ultra solutions” c’est-à-dire un moyen d’échouer avec encore plus de succès1. Parler de guerre, faire semblant de faire la guerre, faire une guerre à sens unique par une répression disproportionnée, ne sont pas des registres permettant de sécuriser et pacifier, ils font plutôt le contraire. Pourquoi continue-t-on néanmoins ? Est-ce parce qu’il est difficile de se déprendre des croyances initiales, certains diraient de la doxa qui a entouré depuis le départ la sédimentation de l’accusation de terrorisme en essayant de la transformer en une notion objective par le biais du droit national et des conventions internationales ?
Details
- Pages
- XXIV, 262
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9781803746562
- ISBN (ePUB)
- 9781803746579
- ISBN (Softcover)
- 9781803746555
- DOI
- 10.3726/b22156
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (March)
- Keywords
- Terrorisme / terrorism Contre-terrorisme / counter-terrorism Rivalité mimétique / mimetic rivalry Guerre globale contre le terrorisme / Global war on terror Cercle vicieux de la vengeance / vicious circle of vengeance
- Published
- Oxford, Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, 20XX. XXIV, 262 pp., 1 fig. col., 1 fig. b/w.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG