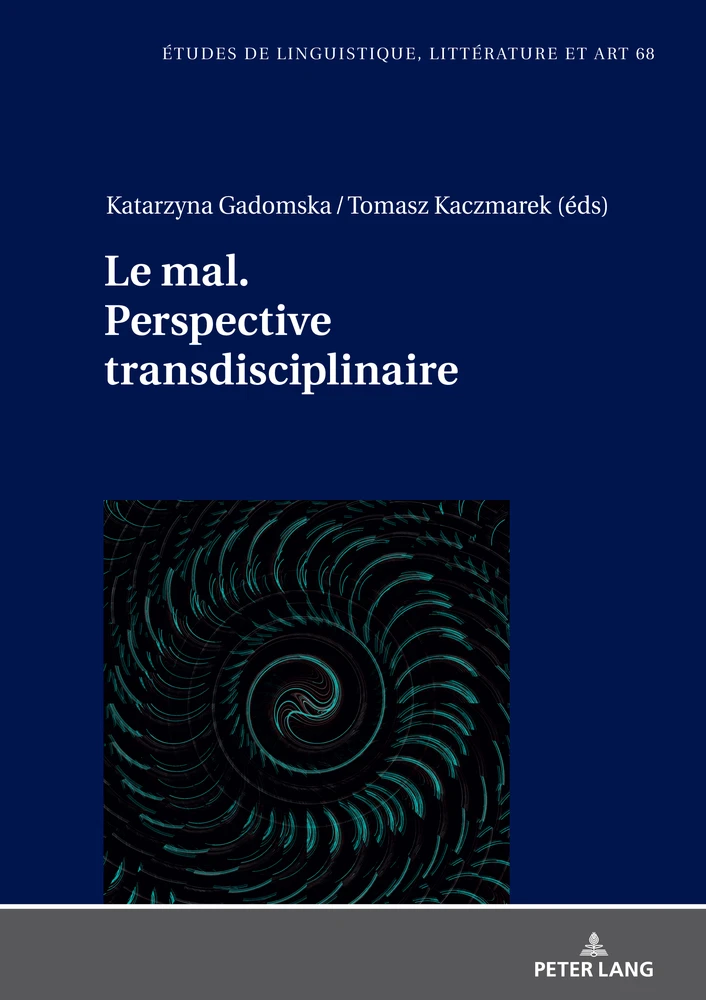Le mal. Perspective transdisciplinaire.
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Liste des auteurs
- Préface par Katarzyna Gadomska et Tomasz Kaczmarek
- Première Partie: Le Mal en littérature
- 1 Le Mal et la littérature mainstream
- La figure d’Adolf Eichmann dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell
- La vengeance au féminin : Alexandre Civico et Marcia Burnier sous la tutelle de Virginie Despentes
- Le rayonnement des ténèbres dans La Puissance des ombres de Sylvie Germain
- De la violence à la renaissance : Poétique du Mal dans le texte de Malika Mokeddem
- Différentes formes de mal dans l’œuvre d’Ananda Devi
- Le mal dans les mémoires traumatiques conflictuelles au prisme de trois romans de la littérature francophone algérienne : Maïssa Bey, Entendez-vous dans les montagnes, 2002, Boualem Sansal, Le village de l’Allemand, 2008, Kaouther Adimi, Au vent mauvais, 2022.
- Le mal physique et le mal moral dans la littérature carcérale au Maroc : L’expression du trauma dans les témoignages sur Tazmamart
- 2 Le Mal et la littérature populaire
- Barbe Bleue : réécritures contemporaines d’une figure polymorphe du mal
- Thomas Owen et le phénomène fantas(ma)tique : Le mal moral au coin de la rue
- Déclinaisons du mal: Marseille 73 de Dominique Manotti
- Une Dichotomie du Mal : Entre la peste vindicative et le crime inévitable dans le roman policier Pars vite et reviens tard de Fred Vargas
- Deuxième Partie: Le Mal et les arts du spectacle
- La déshumanisation à l’écran : le cas du génocide rwandais de 1994
- Le mal dans La Tragédie de Déirdré (1938) de Robert-Edward Hart.
- « La quête d’une demeure dans l’expérience du mal : Le Malentendu de Camus »
- Entre rhinocérite et Covid-19 : la maladie comme métaphore du Mal dans Rhinocéros d’Eugène Ionesco
Préface par Katarzyna Gadomska et Tomasz Kaczmarek
La constation que la littérature, surtout contemporaine, est fascinée ou contaminée du mal est un truisme. Pourtant, si l’on regarde de plus près certains textes aussi bien du mainstream littéraire que de la littérature populaire, on remarque vite l’omniprésence du mal sous toutes ses formes possibles : le mal physique (meurtres, viols, tortures et souffrances, sadisme), le mal psychique (cruauté, tortures psychiques), le mal moral (crimes et fautes), le mal métaphysique (inhérent à la nature du monde imparfait), enfin le mal lié au discours du pouvoir (corruption, mensonge, violence, atteinte à la liberté d’expression, violation des droits de l’homme, pratique de la torture, « raison d’État »). D’où vient cette véritable obsession contemporaine du mal et comment définir ce phénomène transculturel, transhistorique et transdisciplinaire ?
Il n’est pas étonnant que la philosophie, dès ses origines jusqu’à nos jours, se penche sur le problème du mal. En suivant la logique antique, la définition du mal présuppose celle du bien car il faut que nous ayons l’idée du bien pour que la notion du mal ait un sens. Le bien et le mal, notions antagonistes, binaires mais complémentaires, existent dans tous les systèmes religieux, mythologiques, culturels. En conséquence, penser l’idée du mal sans penser l’idée du bien (et l’inverse) n’est pas possible.
Comment pourtant réconcilier l’existence du mal avec l’existence de Dieu ? C’est une question et un problème logique auxquels se heurtent la majorité des religions. Si le monde a été créé par Dieu, le mal est également une création divine ? Une réponse souvent donnée à cette aporie est « privatio boni », c’est-à-dire le mal en tant que tel n’est pas, il se réduit à la privation du bien.
Pour sa part, Spinoza souligne la relativité du mal et du bien : « bien et mal ne se disent que d’une façon relative ; à tel point qu’une seule et même chose peut être dite bonne et mauvaise selon qu’elle est envisagée sous des rapports divers » (1969 : 10). En commentant la pensée spinozienne, Gilles Deleuze remarque que « […] la grande théorie rationaliste d’après laquelle le mal n’est rien est sans doute un lieu commun du XVIIe siècle. Mais […] Spinoza va la transformer radicalement […] Si le mal n’est rien selon Spinoza, ce n’est pas parce que seul le Bien est et fait être, mais au contraire parce que le bien n’est pas plus que le mal, et que l’Être est par-delà le bien et le mal » (1983 : 45) Face au phénomène du mal, Kant aborde un autre problème important : l’homme est-il responsable du mal ? Est-il un être diabolique ? Le mal a sa source dans un penchant. Quelle que soit l’universalité de ce penchant, il ne conditionne pas mais présuppose au contraire la disposition au bien qui est la véritable nature de l’homme, selon Kant (de Curbert, 218 : 52).
Parmi les problèmes et paradoxes que l’existence du mal suscite dès la nuit des temps, quelques-uns semblent avoir une importance particulière vue leur récurrence : la question de savoir ce qu’il est et pourquoi il existe. Est-ce que le bien et le mal sont-il des notions relatives dépendant de l’époque, de la civilisation ou la culture ? Ou bien, sont-ils absolus ?
L’importance de ces questions est intensifiée par deux guerres mondiales et l’existence des systèmes totalitaires. La « banalité du mal » contredit-elle l’hypothèse kantienne ? À ce propos, Levinas parle de « l’arbitraire irréductible du mal ‘méchant’, du mal sans répondant ni réponse » (cité par Neppi, 2000 : 70). Ainsi, le mal constitue un scandale et un défi à la pensée philosophique et au logos, et est l’indicible et l’innommable.
Là où la philosophie et la religion se heurtent à une suite de difficultés logiques, morales insolubles, la littérature trouve un matériau dont la richesse semble être inépuisable et elle s’attache à présenter l’attirance contemporaine du mal, souvent accompagnée de répulsion. La littérature permet donc de vivre le mal en sa totalité, d’être confronté à toutes ses formes, de faire face à toutes ses horreurs et atrocités et d’affronter les figures du mal les plus repoussantes et terrifiantes. Les lecteurs peuvent en tirer une véritable jouissance, un plaisir car leur expérience du mal n’est que fictive, donc vécue en pleine sécurité. Le discours littéraire sur le mal ne sert pas à l’expliquer, le juger ou le justifier mais à illustrer toutes ses facettes ténébreuses, y inclus celle inscrite profondément dans les abîmes de l’âme humaine. La littérature et le mal, inséparables selon Georges Bataille, permettent d’un côté une identification du lecteur au héros par le postulat d’une fraternité immorale du genre humain ; de l’autre côté pourtant, l’union du mal et de la littérature montre que le mal est ce que fait mon semblable, mon double (fantastique/fantasmatique) et pas moi. En travestissant la phrase sartrienne : « Le mal, c’est les autres ». Cette polyvalence du discours littéraire, ambigu, sur le mal contribue à augmenter son « énigme », pour reprendre le terme ricœurien ainsi que son succès auprès des lecteurs.
En dehors de la question philosophique, il est aussi intéressant de se pencher sur l’expression directe du mal, donc, d’étudier ses principes esthétiques. Cette problématique se manifeste d’une manière pertinente dans le théâtre. Le drame, qui selon ses prescriptions canoniques, n’existe pas sans conflit, illustre bien une confrontation et une opposition d’ordre intellectuel ou passionnel entre deux ou plusieurs forces morales, tout en symbolisant un antagonisme patent entre le bien et le mal. Dans ce contexte de l’affrontement qui est à l’origine même de toute action dramatique, peu nombreuses sont les pièces de théâtre qui évitent un motif cruel. Que l’on pense au Théâtre des cruautés de Richard Verstégan (1588), où l’auteur exhibe sans ambages des persécutions à l’époque des guerres de religions, ou, au « théâtre de la catastrophe » de Howard Barker, on assiste à l’expression de la violence souvent physique que le bourreau inflige à ses victimes. Les scènes sanguinaires du théâtre du Grand-Guignol sont aussi à ce sujet exemplaires. Ce théâtre parisien se caractérise par la critique virulente de la société et de la nature humaine, et surtout, par la représentation directe de la violence, de l’horreur et de l’érotisme ainsi que par la création d’une tension dramatique reposant en grande partie sur l’implication émotionnelle des spectateurs. De ce point de vue, le théâtre est véhiculaire du mal que l’on peut considérer comme un principe par excellence esthétique sans que l’aspect philosophique ou l’ancrage psychologique en soient complètement dépourvu. Ainsi, sous l’emprise de Guy de Maupassant et d’Edgar Allan Poe, André de Lorde, qui écrivait pour le théâtre parisien d’épouvante, semble tourner le dos aux images effrayantes de tortures et de toutes autres sortes d’exactions physiques pour privilégier les scènes au cours desquelles le mal se déploie à un niveau moral et psychologique. C’est dire que, loin de mettre en avant une dimension spectaculaire de la cruauté qui se manifeste à travers l’affrontement corporel, le dramaturge français tente de bouleverser les nerfs du public par la volonté d’instaurer sur scène une atmosphère de plus en plus mystérieuse autant que sinistre, tout en provoquant des réactions de panique. Qui plus est, au tournant du XXe siècle, on est témoin des textes de théâtre qui se concentrent sur le mal se traduisant par le conflit intersubjectif censé démontrer la violence physique. Dès lors, on a affaire à une cruauté psychique qui est peut-être moins visible, mais qui est en réalité beaucoup plus sournoise et perverse. En lisant, à ce propos, les drames de Strindberg, force nous est de constater à quel point la parole devient l’instrument du viol et du « meurtre psychique » de l’autre dans son intimité. À part le conflit intersubjectif, il est aussi intéressant d’évoquer l’expression de la cruauté métaphasique (la cruelle fatalité de l’existence humaine) qui conduit inévitablement au conflit intrapsychique se déroulant, comme dans les œuvres de l’écrivain suédois ou les activités théâtrales d’Antonin Artaud, idéateur du « théâtre de la cruauté », sur le plan de l’âme détraquée et désarmée face à un monde aussi terrifiant qu’indifférent.
Notre monographie propose d’étudier le phénomène du mal de manière transdisciplinaire : en littérature, aux cinéma et théâtre contemporains, d’expression française afin de montrer ses mutations et facettes multiples chez les auteurs si diversifiés comme : Albert Camus, Eugène Ionesco, Jonathan Littell, Ananda Devi, Dominique Manotti, Fred Vargas, Malika Mokeddem, Maïssa Bey, Boualem Sansal, Kaouther Adimi et d’autres.
Nous voudrions répondre aux questions suivantes : comment définir le mal ? Quelles sont les figures porteuses du mal ? Existe-t-il une esthétique et une poétique particulières du mal dans la littérature mainstream et dans la littérature populaire ? Quels axes thématiques et quels auteurs sont inextricablement liés au mal ?
Il est également intéressant pour nous de rendre compte de la spécificité des moyens, procédés, techniques utilisés par la littérature, le cinéma et le théâtre contemporains afin d’élucider un peu le mystère du mal.
Details
- Pages
- 222
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925911
- ISBN (ePUB)
- 9783631925928
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921555
- DOI
- 10.3726/b22289
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- le viol le crime le sadisme les souffrances Le mal le totalitarisme le théâtre des cruautés la violence le bourreau la victime les tortures le sang
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 222 pp., 1 fig. col.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG