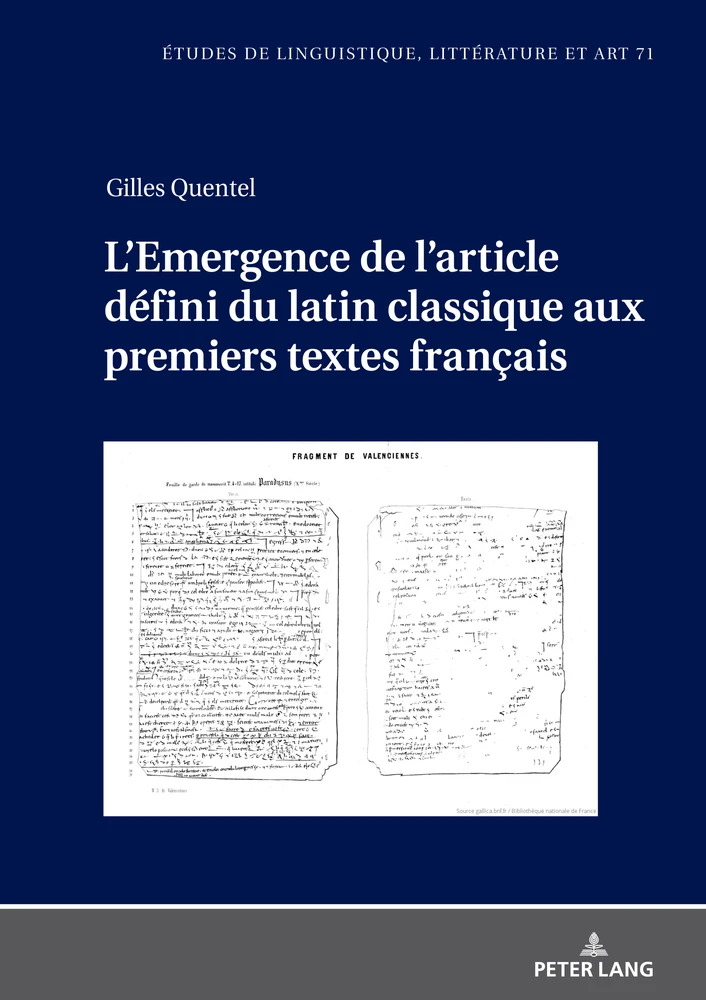L'Emergence de l'article défini du latin classique aux premiers textes français
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction
- 1 Fonction de l’article défini
- 1.1 Anaphore, deixis et détermination
- 1.2 Rôles de l’article défini et du déterminant démonstratif
- 1.3 Phases pragmatique et sémantique
- a La phase pragmatique
- b La phase sémantique (homophorique)
- 1.4 Le Cycle of Definiteness de J. Greenberg
- 1.5 La chronologie de Kupreyev
- 1.6 Contraintes syntaxiques à l’emploi du determinant démonstratif
- 1.6.1 Contexte non anaphorique
- 1.6.2 Contexte anaphorique
- 1.6.3 Anaphores définies exclusives
- 1.6.4 Anaphores démonstratives exclusives
- 1.6.5 Rôle du lien hypo-/hyperonymique
- 1.6.6 Rôle et nature du modifieur
- 1.6.7 Article défini devant l’antécédent
- 1.6.8 Rôle de l’attribution
- 1.6.9 Pour résumer :
- 2 Du démonstratif latin ille à l’article défini en ancien français
- 2.1 Traits morphologiques et diachronie
- 2.2 Motivations à la transformation
- 2.3 Syntaxe des démonstratifs latins
- 2.3.1 Is
- 2.3.2 Hic
- 2.3.3 Ipse et Idem
- 2.3.4 Iste
- 2.3.5 Ille
- 2.4 Morphologie historique
- 2.5 L’hypothèse du latin populaire
- 2.6 L’influence du substrat celtique
- 3 Evolution des déictiques latins
- 3.1 Le latin classique
- 3.1.1 Caton – De Agri Cultura (160 av. J-C)
- 3.1.2 Cicéron : Lettres à Atticus (-60/-59)
- 3.2 Le latin médiéval
- 3.2.1 Sidoine Apollinaire : Epistulae
- 3.2.2 Grégoire de Tours : Histoire des Francs (574)
- 3.2.3 Eginhard : Vie de Charlemagne (825)
- 3.2.4 Usage des déictiques dans la prose littéraire médiévale
- 3.2.5 Anthimus, De observatione ciborum (511).
- 3.2.6 Chartes mérovingiennes : textes juridiques (670-716)
- 3.3 Remarques sur l’usage des déictiques latins au Moyen-Age
- 3.3.1 La question de l’article chez les grammairiens latins
- 3.3.2 Evolution des rôles attribués aux déictiques latins
- 4 L’article défini dans les premiers textes français
- 4.1 Serment de Strasbourg 842 :
- 4.2 Séquence de sainte Eulalie (880) :
- 4.3 Fragment de Valenciennes (ou le Sermon sur Jonas) (940) :
- 4.4 Vie de saint Léger (980) :
- 4.5 Passion du Christ de Clermont (980) :
- Conclusions
- Bibliographie
Introduction
La question de l’origine de l’article défini dans les langues romanes a fait l’objet de très peu d’études directes et systématiques. Les principaux travaux consacrés au sujet sont ceux de Leonard Adams (1967), et, plus récemment, les articles qu’y ont consacré A. Carlier et W. de Mulder (2006 et 2010). Ailleurs, la question est, le plus souvent, abordée sous l’angle morphologique, c’est-à-dire celui de l’évolution diachronique du pronom latin ille. R. Ostra exposait déjà cet état de l’art en 1991 :
Pourtant on ne peut pas dire que ce problème ait attiré l'attention de beaucoup de linguistes. Les travaux où l'article est étudié dans une perspective diachronique sont consacrés le plus souvent à l'aspect morphologique de son évolution ou aux descriptions que des grammairiens en ont faites, mais sa genèse et son expansion progressive ne sont étudiées que très rarement et de façon contingente (Ostra, 1991 :9).
L’objectif que nous nous sommes assigné dans le présent exposé est donc de décrire de façon chronologique l’émergence systémique de l’article défini dès le moment où il est détectable. Détectable non pas en tant que lemme particulier mais en tant que fonction associée à un mot. La distinction est essentielle, comme on le verra. La description de cette émergence doit répondre à certaines questions qui sont :
Ce sont ces quatre aspects du problème que nous allons tenter d’examiner ici.
Pour tenter de répondre à ces questions, l’étude qui suit s’attachera dans un premier temps à délimiter les concepts d’indexicalité, d’anaphore, d’actualisation et de détermination, afin de circonscrire respectivement les rôles de l’article défini contrastivement à ceux du déterminant démonstratif dans la langue française contemporaine. L’étape suivante consistera en un examen systématique des contraintes syntaxiques pesant sur l’un et sur l’autre, afin, par la suite, de déterminer si l’usage que le latin fait de sa propre série déictique correspond au déterminant ou à l’article. Cette étape sera suivie d’un descriptif diachronique de l’évolution du système déictique latin vers celui du français. Une fois ce cadre théorique posé dans ses aspects diachronique et fonctionnel, la seconde partie de l’étude sera consacrée à l’analyse d’exemples depuis le latin classique jusqu’aux premiers textes français (IXème et Xème siècles).
Abréviations et raccourcis :
- abl. : ablatif
- adjectif : adjectif qualificatif
- AF : Ancien Français
- article : article défini et indéfini
- dat. : datif
- DD : Déterminant (adjectif) démonstratif
- défini : article défini
- gén. : génitif
- NC : nom commun
- nom. : nominatif
- P1…6 : 1ère…6ème personne (selon la notation de morphologie historique où P4…6 = P1…3 du pluriel)
- PIE : proto-indo-européen
- PP : pronom personnel
- relative : proposition subordonnée relative
1 Fonction de l’article défini
1.1 Anaphore, deixis et détermination
Les notions d’anaphore, de deixis, d’actualisation, de définitude et de détermination sont centrales pour circonscrire les propriétés sémantiques de l’article défini, et il semble, avant toute autre considération, nécessaire de les délimiter. Car, ce qui distingue fondamentalement le déterminant démonstratif de l’article, c’est entre autres l’affaiblissement de la deixis, comme l’indiquent Ernout et Thomas (1953 :191). L’exercice n’est pas aussi évident qu’il peut paraître de prime abord quand il s’agit de distinguer la teneur déterminative de l’article comparativement à celle du démonstratif, qui sont intimement liés sur les plans morphologiques et sémantiques.
La deixis est une forme d’indexicalité linguistique qui désigne un élément situé dans une deixis origo. La notion est vaste et difficile à délimiter. Entre autres problèmes, l’espace de ce deixis origo est l’objet de controverses (voir ci-dessous). Il existe de nombreuses études consacrées à la deixis, et presque autant d’interprétations et de définitions de cette notion (voir à ce sujet Kleiber, 1986 & 1989). Nous n’en exposons ici que les bases théoriques qui serviront notre propos. Nous comprendrons que la deixis est une forme d’indexicalité qui désigne un référent du contexte, du co-texte, ou d’une culture contextuelle connue du destinataire par le biais d’une relation exophorique, endophorique ou homophorique respectivement. Elle suppose une deictic origo (point d’origine où est situé le référent). Les locutions déictiques se caractérisent par un référent variable, un sens constant, et une quasi-absence de contenu descriptif. Elle requièrent une résolution indexicale (Levinson, 2006 :103) pour être intelligibles. Ce qui distingue fondamentalement la deixis de l’indexicalité, c’est le fait que le symbole désignateur est exclusivement un mot ou une expression (déictique), et non pas un geste ni un cri, par exemple. Un déictique est donc une catégorie d’indexical. Le démonstratif est un exemple emblématique de déictique : son référent varie, son sens est constant, et son contenu descriptif est vague : « cette chose que je montre » ; de même, le sens de déictiques comme « ici » ou « hier » a un contenu descriptif lâche : « cet endroit où je suis », « le jour d’avant celui d’aujourd’hui »…
Pour comprendre où se situe l’article défini dans ce spectre de l’indexicalité et de la deixis, il faut considérer le processus chronologique de grammaticalisation (nous emploierons ce terme plutôt que celui de « réanalyse ») suivant :

En effet, ce qui distingue entre autres le pronom du déterminant démonstratif et, par suite, de l’article défini, c’est la contrainte syntaxique chez ces deux derniers. Le déterminant démonstratif ne désigne que le nom qui le suit immédiatement, alors que le pronom pointe le référent par le biais de son antécédent, et est de ce fait beaucoup plus mobile. Dans l’autre sens, le déterminant démonstratif établit une relation exophorique plus fréquemment que l’article défini :
Details
- Pages
- 142
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631923405
- ISBN (ePUB)
- 9783631931684
- ISBN (Hardcover)
- 9783631923399
- DOI
- 10.3726/b22603
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (February)
- Keywords
- Chartes mérovingiennes linguistique historique syntaxe ancien français article défini latin médiéval gaulois démonstratifs morphologie historique déictiques latins Ste Eulalie St Léger Serments de Strasbourg
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 142 pp., 5 fig. b/w, 15 tables
- Product Safety
- Peter Lang Group AG