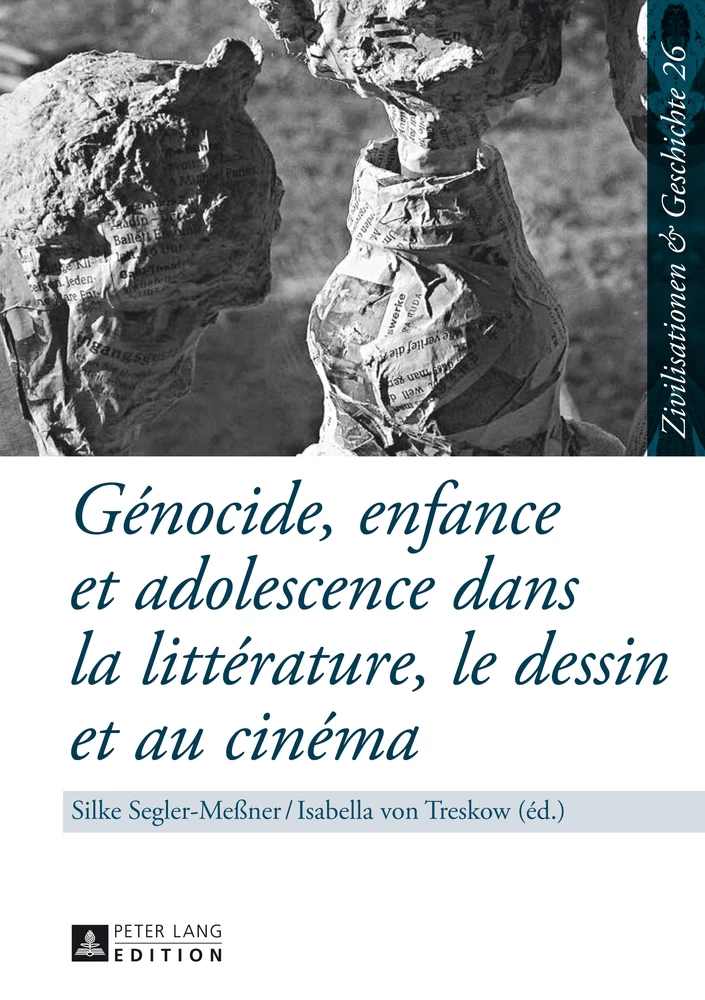Génocide, enfance et adolescence dans la littérature, le dessin et au cinéma
Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur/l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Genocide, Childhood and Youth in Literature, Drawing and Film
- Genocide, Childhood and Youth in Literature, Drawing and Film
- Genozid, Kindheit und Jugend in Literatur, Zeichnung und Film
- Table des matières
- Avant-propos : Vivre la persécution, symboliser la catastrophe
- Bibliographie
- OUVERTURE
- Catastrophes – Conflits – Génocides. Le Savoir Survivre de la Littérature
- La réalité vécue
- Le jardin du savoir
- Le sol et le sang – l’expérience de la guerre civile
- La vie des disparus et la vie disparue
- La vie des autres ou l’autre vie
- Bibliographie
- I. DANS LE CAMP
- « Et la vie continue » (Uri Orlev) – Fictions pour la jeunesse et poésie du camp
- Une œuvre pour l’enfance
- Poésie de l’enfance dans le camp
- Bibliographie
- « L’enfant des camps » comme figure paradigmatique radicale de la vulnérabilité
- Bibliographie
- « Lointains sont les horizons dorés/ Où l’enfant joue à la balle » (C. Pineau) L’emploi de l’image enfantine dans les témoignages clandestins du camp de Buchenwald (1942-45)
- La construction de l’enfant et de l’enfance dans la littérature
- Témoignages de la vie concentrationnaire
- L’image de l’enfant et de l’enfance dans les poèmes de l’Anthologie des poèmes de Buchenwald (1946)
- L’enfance – image de l’insouciance et de l’idylle
- L’enfant comme topique de la vulnérabilité
- Conclusion – l’image de l’enfant et de l’enfance dans la poésie concentrationnaire : le signe d’une « richesse sémantique »
- Bibliographie
- Annexe
- Quand les enfants juifs dessinent le génocide
- Bibliographie
- INTERMÈDE
- Enfants de génocide : traumatisme extrême et le « propulseur d’affect »
- Introduction
- Enfants persécutés
- Événement traumatique unique, traumatisme cumulé, traumatisme continuel
- Méthode
- Thèmes émergents dans les entretiens
- Rupture générationnelle et processus central
- Perforation
- Création d’espace
- Distorsion de l’âge
- ‹ Ce qui › est raconté et ‹ comment › on le raconte – Contenu et affects dans les entretiens
- Lien traumatique prédominant
- Lien générationnel prédominant
- Evacuation d’affects
- Le propulseur d’affect
- Les concepts élaborés dans cette étude en comparaison avec la formation de théorie contemporaine
- La « perforation » en comparaison avec les concepts établis
- La « création d’espace » – en comparaison avec les concepts établis
- La « distorsion de l’âge » en comparaison avec les concepts établis
- La « régulation des affects » et la « mémoire » dans une perspective interdisciplinaire
- Vignette clinique illustrant le « propulseur d’affect »
- Remarques finales
- Bibliographie
- II. TÉMOIGNER
- Poétiques de la lisière – Les textes d’enfants rescapés de la Shoah, entre « création testimoniale » et genre autobiographique
- A la lisière du témoignage
- A la croisée des formes et des genres, entre autobiographie et témoignage
- L’enfance traquée comme figuration symbolique de l’autobiographie
- Poétique(s) du no man’s land
- Bibliographie
- Ne te retourne pas – Récits d’enfants juifs persécutés en France
- 1. Débuts et conditions d’élaboration des récits d’enfants persécutés
- 2. Les procédés linguistiques
- 3. Les titres des récits
- Bibliographie
- Témoignages d’enfants tutsis : mémoires singulières, paroles transversales, (re)constructions collectives
- Bibliographie
- La survie de l’enfant : pour une mémoire transgénérationnelle après le génocide au Rwanda
- 1. L’enfant et la mémoire transgénérationnelle
- 2. La figure de l’enfant mort
- 3. La figure de l’adolescent-rescapé
- 4. Le récit de survie
- 5. Pour un travail de réconciliation
- Bibliographie
- Il était une fois un enfant qui racontait un génocide
- La parole du témoin du génocide : une adresse au lecteur
- Quand l’aîné des orphelins témoigne du génocide
- Le génocide par une narration entrelacée
- Quand l’enfant s’initie au crime et interroge les juges
- Un langage d’enfant pour expliquer l’origine du génocide
- En guise de conclusion : le symbole d’un incipit
- Bibliographie
- III. LA REPRÉSENTATION DE L’ENFANT ET DU JEUNE
- L’enfant : topos ou réel ? La question des enfants dans les récits des déportés-écrivains
- 1. De l’effroi au méta effet de réel
- 2. Des nouveau-nés
- 3. Sur le fil du pathos
- 4. Mise à distance et contre-empathie
- 5. Conclusion
- Bibliographie
- Le souvenir en devenir. La position de l’enfant, stratégie d’actualisation dans les récits lazaréens de Jean Cayrol
- Pourquoi l’enfant ?
- Le Lazaréen, « personnage-enfant »
- Le récit lazaréen, « récit-enfant »
- Le « lecteur-enfant » des récits lazaréens
- Une poétique de la contagion
- Bibliographie
- Rétrospectives d’un peuple errant : le regard de l’enfant sur l’Holocauste dans deux romans de Sandra Jayat
- La construction d’un peuple errant : les parallèles entre Roms et Juifs
- Le regard de l’enfant dans deux romans de Sandra Jayat
- Parallélisation – Roms et Juifs dans La Longue Route d’une Zingarina (1978)
- Rapprochement et Distanciation – Roms et Juifs dans La Zingarina ou l’Herbe Sauvage (2010)
- Conclusion
- Bibliographie
- Fort – da. Le trauma, le jeu et la littérature
- Ouverture
- Mot/muet
- Le potentiel de quelques sons
- O-o-o-o-da
- H – la hache/la bretelle élastique
- Volte-face
- Ficelle/rayage
- Bibliographie
- Les voix et les figures de l’enfance – Quelques aspects des représentations dans la fiction sur le génocide des Tutsi
- 1. Enfants, orphelins et aînés
- 2. Corps et sexualité
- 3. Voix et paroles
- 4. L’errance de l’enfance
- Bibliographie
- CLÔTURE
- Berceuse à Auschwitz
- Les auteurs
- Julia Blandfort
- Eléonore Diarra
- Hartmut Duppel
- Ottmar Ette
- Isabelle Galichon
- Katrin Hoffmann
- Aurelia Kalisky
- Suzanne Kaplan
- Judith Kasper
- Emilie Lochy
- Philippe Mesnard
- Catherine Milkovitch-Rioux
- Catalina Sagarra
- Silke Segler-Meßner
- Josias Semujanga
- Isabella von Treskow
- Index des noms de personnes
- Index des noms de lieux
- Titres de la collection
| 9 →
Avant-propos : Vivre la persécution, symboliser la catastrophe
La parole de l’enfant et du jeune, le regard qu’ils portent sur les conflits ethniques meurtriers, ainsi que la représentation de l’enfant et de l’adolescent liée à la violence génocidaire constituent un champ de recherches exceptionnel pouvant être appréhendé dans un grand nombre de perspectives, en recourant à des approches méthodiques très variées. Ce livre, dont les contributions sont issues d’un colloque qui a eu lieu en janvier 2012 à l’Aby-Warburg-Haus de l’Université de Hambourg, se propose d’offrir de telles perspectives et approches des domaines de la littérature et des médias, de la philosophie, de la psychanalyse et de la sociologie, tout en menant un dialogue interdisciplinaire entre les chercheurs franco-, anglo- et germanophones spécialisés dans le domaine de l’histoire et de la représentation de la violence collective et des génocides.
Au centre de ce livre se trouve l’expérience des mineurs ainsi que la perception et la représentation des jeunes à travers deux « cas » paradigmatiques du XXe siècle, la Shoah en Europe et le génocide des Tutsi au Rwanda et, au-delà, les persécutions national-socialistes contre les résistants politiques et les Roms, ainsi que des cas imaginaires de guerre civile ou religieuse. La présence des enfants et des adolescents dans les propos et dans les textes de fiction, dans les récits et les témoignages, dans le cinéma, la poésie, les dessins, les entretiens et les théories portant sur l’inhumanité sous toutes ses formes avant, durant et parfois même après la persécution nous pousse à interroger ces formes d’énonciation aussi bien que les catégories, images et idées qui dirigent la perception. Car les concepts de l’enfant et de l’enfance prolongée jusqu’à la jeunesse paraissent difficiles à cerner. Des idées vagues obscurcissent souvent l’intérêt porté à l’expérience de l’enfant lors des violences extrêmes et à l’usage topique de l’« enfant ». Trop fréquemment, elles embrouillent l’appréhension d’un savoir méritant d’être pris au sérieux. La vision est entravée par une perception de l’enfance comme un stade passager, le concept de l’enfant sombrant dans l’asymétrie entre l’adulte et celui considéré comme immature, une conception dans le cadre académique par ailleurs issue d’une culture européenne qui tendait et tend toujours à inclure tous ceux et toutes celles âgés de moins de dix-huit, voire de vingt-et-un ans, dans la catégorie du non-comprenant, passif ou rebelle. « Mineur » est un terme à double sens. Les limites entre objectivité et subjectivité se perdent dans le passé de tous ceux et toutes celles qui réfléchissent sur l’enfance et y intègrent des pensées et émotions provenant aussi bien des expériences personnelles que des codes de l’ordre symbolique contextuel. Le concept ← 9 | 10 → d’enfant se heurte à celui d’adulte et le sert en même temps. De plus, l’enfant inspire à l’adulte de manière assez unanime – et certainement pas totalement infondée – l’envie de son insouciance (présumée, bien évidemment), ainsi que des sentiments de nostalgie ou de pitié. On en retrouve les affirmations et les diverses positions dans le matériel examiné dans les contributions à cette publication. Pour leur part, les concepts de jeunesse et d’adolescence mènent aux idées de l’âge adulte, ils comprennent par conséquent l’initiation, le sérieux, la prise de responsabilité. Les idées autour de la figure de l’enfant et de l’adolescent font germer l’imagination. Il n’est guère étonnant que les études traitant du rapport entre l’enfant, l’enfance, la jeunesse d’un côté et la violence génocidaire de l’autre soient variées et que le champ doive être parcouru dans maintes directions, d’autant plus que la définition du terme de « génocide » n’est pas conventionnalisée, comme vient de nous le rappeler Benjamin Lieberman,1 et que la question de ses causes aussi bien que celle de ses conséquences, jusqu’aux questions de refoulement, de mémoire et de réconciliation, donnent toujours à réfléchir.
L’analyse de la relation entre l’enfant et les génocides joue un rôle primordial dans les recherches actuelles, comme le révèlent aussi les discussions publiques qui, dans le cas de la Shoah, voient dans les enfants-témoins le dernier lien vivant entre le passé et le présent et, dans celui du Rwanda, fustigent la violence génocidaire utilisant les enfants comme instruments du pouvoir, aussi bien comme victimes que comme personnes poussées à la violence, devenant ainsi des représentants actifs de l’agression. Pour ce qui est de l’idée de l’enfant-bourreau ou de l’enfant-soldat, Manon Pignot vient d’ailleurs de dénoncer à juste titre, dans l’introduction de son livre L’Enfant-soldat – XIXe-XXIe siècle, avec Laure Wolmark, la confusion de l’enfant et de l’adolescent concernant le rôle actif des mineurs.2 Dans cette vision, une des intentions de ce livre est de s’approcher de la perspective des jeunes eux-mêmes et de réfléchir sur notre image de l’enfance et de la jeunesse.
Si le présent volume propose aux lecteurs quelques-uns des approches et angles d’attaque qui élucident des aspects divergents de la position des mineurs par rapport aux violences collectives extrêmes, notamment la Shoah et le génocide au Rwanda, c’est d’abord dans un souci de précision critique vis-à-vis du vécu, du dit, du montré et de l’écrit. En outre, afin de montrer que le champ autorise le recours à ← 10 | 11 → des points de vue critiques très divers, mais aussi pour bénéficier de toute une gamme de propos touchant le sujet, on a présenté ici les résultats de recherches et de réflexions. D’ailleurs, la signification des textes, des entretiens et des films n’est pas forcément liée à un genre : la réflexion peut être donnée sous forme fictive, tandis que le document côtoie souvent la fiction.
L’éventail de textes et de films traités dans cette publication va de la poésie jusqu’à l’exemple de Hurbinek et des entretiens et témoignages « directs » jusqu’au film Ruanda – Le jour où Dieu est parti en voyage (2009) réalisé par Philippe Van Leeuw. De toute évidence, la prise de parole et la représentation des jeunes ne se limite pas à des formes précises. Cependant, quelques genres sont choisis plus que d’autres et les attentes du public changent. Dans le domaine de la Shoah, on constate quant au récit personnel une évolution des moyens d’expression : avec la publication du journal d’Anne Frank, l’enfant a repris une fonction de figure mémorielle incarnant, d’une façon exemplaire, la victime innocente. D’un côté, on remarquera une confusion depuis l’immédiat après-guerre puisqu’on résuma sa position d’auteur à une « Kinderstem », une « voix d’enfant ». Le succès de son Dagboek a été relancé en France par la redécouverte en 1994 du Journal d’Hélène Berr, ici et là surnommée « l’autre Anne Frank », et la publication de ce texte en 2008. D’autre part, le recours à l’enfant va croissant. Partant du fait que le témoignage, récit mettant en avant la subjectivité de l’auteur qui donne une garantie par sa parole remplaçant la voix, donc le corps, devient le mode d’expression par excellence des XXe et XXIe siècles, et étant donné que le témoignage promet par le biais du pacte autobiographique un accès direct aux catastrophes historiques, la perspective de l’enfant peut de plus en plus être envisagée comme la source d’un savoir opprimé, poussant le public à un regard critique sur des concepts établis. Depuis la parution des livres de Ruth Klüger, Georges-Arthur Goldschmidt et Imre Kertész, la transmission littéraire par les victimes ou témoins très jeunes fait partie d’une écriture qui joue avec les genres, témoignage et autobiographie, problématisant ainsi les limites de la perception. De plus, des romans démontrent la perméabilité entre la narration fictionnelle et l’expérience personnelle. Citons à titre d’exemple Jakob der Lügner (Jakob le menteur), écrit par Jurek Becker (1969). Vus de près, les textes et propos d’entretiens mettent en question l’idée trop facile car « unidimensionnelle » de l’enfant comme « victime exemplaire »,3 comme le souligne Philippe Mesnard dans Témoignage en résistance. Pour le génocide des Tutsi, c’est Jean Hatzfeld qui nous livre avec Dans le nu de la vie (2007) les premiers témoignages de l’enfant-témoin, dont le statut textuel reste à interroger. Les textes de Boubacar Boris Diop, Abdourahman A. Waberi, Véronique Tadjo, Tierno Monénembo, entre autres, qui ont été écrits à l’initiative du festival Fest-Africa, cherchent à répondre littérairement au devoir d’une mémoire ← 11 | 12 → génocidaire, mêlant également les genres et les perspectives. Or, dans le corpus des témoignages écrits en langue française, les mineurs victimes et témoins occupent une place déterminante dans la transmission de l’expérience du traumatisme, ce que Catalina Sagarra, Silke Segler-Meßner et Josias Semujanga cherchent à accentuer. Tandis que Vénuste Kayimahe ouvre son récit autobiographique France-Rwanda : les coulisses du génocide en décrivant la souffrance et la mort violente de sa fille aînée, les textes de Berthe Kayitesi, d’Annick Kayitesi ou de Révérien Rurangwa offrent au lecteur l’expérience génocidaire de ces adolescents survivants. La composition de romans concernant le génocide au Rwanda reste, tout comme pour ce qui est de la représentation romancée de la Shoah, une entreprise plus délicate, puisque la fictionnalisation de la terreur fait toujours débat, de même qu’au cinéma. Souviens-toi Akeza !, de Reine-Marguerite Bayle, est l’exemple d’une publication des années 1990 analysée dans ce volume par Eléonore Diarra, tout comme Génocidé (2006), de Révérien Rurangwa, l’auteur-témoin déjà mentionné.
Le panorama du matériau donne à réfléchir aussi bien sur les formes que sur la représentation du passé et la fonction de l’enfant et du jeune pour la transmission du savoir, y compris celui de l’enfance et de l’adolescence. A ce sujet, force est de constater que la perception de l’enfant ou de l’adolescent diffère grandement, non seulement selon les genres et selon les circonstances, mais aussi selon les contextes plus restreints, notamment culturels, comme l’exposent Catherine Coquio et Aurélia Kalisky dans l’Avant-propos de leur l’anthologie L’Enfant et le génocide, publiée en 2007. Il en résulte que la variété des formes se marie dans le présent volume à une approche historique et que les contributions traitent un corpus varié aussi bien du point de vue de la forme que du point de vue du moment de sa production. L’intérêt pour la prise en compte de l’axe historique est en général moins grand qu’un intérêt systématique. L’un des buts de cette publication est d’élargir par endroits l’horizon d’étude. D’une part, on y trouve des études portant sur les premiers textes esquissés ou écrits dans les camps nazis où, par exemple, l’enfant devient l’image d’une vie meilleure ou de la vie même comme le démontre Hartmut Duppel : les poèmes rédigés à Buchenwald pointent la dureté de l’internement à travers les motifs de l’enfant et de l’enfance qui servent entre autres l’idée d’évasion et de nostalgie, des idées qui préparent l’opposition enfant-adulte dans les textes d’après-guerre et soutiennent la topique du prisonnier des camps redevenu enfant. Elle transparaît dans les propos, y compris les romans, de Jean Cayrol qui tient à inquiéter profondément le lecteur par une instrumentalisation volontairement étrangère de l’idée de l’enfant et du jeune, un sujet que Katrin Hoffmann problématise dans ses propos autour du romanesque lazaréen de Cayrol. D’autre part, on y présente des tentatives actuelles de prendre connaissance du passé, afin de discuter à voix haute l’avenir, par exemple pour ce qui est des Roms français – au centre de l’argumentation de Julia Blandfort – ou des Tutsi au Rwanda. La dimension du futur ← 12 | 13 → devient enfin prédominante là où on détecte le passage du paradigme de la « mémoire » au paradigme du « savoir » et du « savoir vivre ensemble », dimension idéelle aussi bien que littéraire développée par Ottmar Ette qui attire l’attention sur Lost City Radio de Daniel Alarcón, paru en 2007.
L’objectif de se faire informer par les mineurs eux-mêmes et de mesurer le retentissement de ce qu’ils ont vécu à travers leurs paroles et leurs dessins nous mène à nous tourner plus attentivement vers les formes d’expression choisies par eux. C’est Emilie Lochy qui analyse dans cette publication les dessins réalisés au sein même des camps et représentant le quotidien des enfants juifs à l’intérieur de ceuxci. Les jeunes font en général facilement valoir le pouvoir créateur du langage, sa vitalité, et ils profitent de l’économie de la poésie autant que de sa polysémie. De surcroît, la poésie interroge le statut de la parole, en effet radicalement mis en question par la persécution et les mécanismes de la cruauté et du mensonge des systèmes répressifs nazis. Les jeunes, même les très jeunes, le savaient autant que ceux plus âgés. Nous l’apprenons par exemple des récits d’enfants cachés, récits qui sont analysés pour la première fois dans une perspective systématique par Isabella von Treskow. Que devient la splendeur de la poésie face au génocide ? Interné à Bergen-Belsen, Uri Orlev met en avant, dans son impulsion lyrique, l’ampleur tragique des pensées communes. Il pèse avec acuité le poids des mots : « Et la vie continue », écrit-il après l’assassinat de sa mère, « Je comprends une telle formule ».4 Catherine Milkovitch-Rioux et Isabelle Galichon interrogent les stratégies de la représentation utilisées par les jeunes auteurs, Uri Orlev et d’autres. L’analyse se porte également sur les manières de re-présentation de l’enfant comme figure de la vulnérabilité et sur l’image de l’acte de destruction par l’Autre. Finalement, les textes comme ceux d’Uri Orlev reflètent à la première personne la capacité de manier le langage dans toute sa qualité de système de symboles.
L’acte créateur enfantin, le jeu avec les sons, les mots, le rythme et les mélodies tel qu’il se fait jour dans la poésie, peut également être deviné dans les quelques paroles entendues par Primo Levi à Auschwitz : l’enfant nommé Hurbinek, qui devient explicitement témoin à travers le témoignage de l’auteur de La tregua (La trève, 1963), nous expose à ses essais de s’exprimer par la langue. Ces essais et leur représentation dans la littérature nous instruisent sur les difficultés de communication dans les conditions traumatisantes. Que les balbutiements des enfants, les hésitations ou bégaiements soient considérés comme maladroits et défaillants est signe d’un sens spécifique de la perfection non pas des mineurs, mais des adultes. Différentes réflexions sur la figure de Hurbinek d’une part et sur le phénomène des bredouillements ← 13 | 14 → du petit enfant de l’autre sont présentées dans ce volume par Judith Kasper, Philippe Mesnard et Aurélia Kalisky qui s’intéresse de plus au pouvoir créateur des récits autobiographiques d’enfants et de jeunes exposés à la persécution et à l’extermination de masse organisées par les nazis. Capter la parole d’enfant reste une activité plutôt rare et toujours difficile. Les projets comme Dukundane Family, dont nous informe Catalina Sagarra, démontrent la responsabilité de l’adulte, le devoir de se mettre à l’écoute et l’enjeu mémoriel de la reconstruction linguistique de l’expérience.
Si Catherine Coquio et Aurélia Kalisky donnent dans L’Enfant et le génocide un aperçu des différentes positions sur le sujet de la Shoah et les témoignages, la publication de Victoria Hertling Mit den Augen eines Kindes – Children in the Holocaust, Children in Exile, Children under Fascism (1998) entame le sujet du point de vue des lettres et des études cinématographiques, tandis que l’étude de Suzanne Kaplan, Children in Genocide – Extreme Traumatization and Affect Regulation (2008) présente une approche psychanalytique dont l’application à l’analyse des textes narratifs se révèle féconde. Ces études fournissent avec d’autres, comme celles d’Anny Dayan Rosenman, de Philippe Mesnard et d’Eva Lezzi, des repères stimulant un dialogue interdisciplinaire tenant notamment compte du fait, qui a trop souvent échappé aux critiques, que les enfants sont les victimes d’une forme particulière de violence génocidaire, que la perspective enfantine – fût-elle adoptée par un adulte – élargit notre connaissance des événements, aussi du point de vue des émotions, que leur approche du monde nécessite une analyse spécifique et que l’emploi de l’image des enfants et des adolescents, de l’enfance et de la jeunesse ne fournit jamais ce qu’il promet : l’innocence.
Le colloque « Quand les enfants écrivent les génocides : théories – textes – témoignages » (19 au 21 janvier 2012) ainsi que la présente publication ont pu être réalisés grâce à la généreuse contribution financière du projet EVE – Enfance, Violence, Exil de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et à sa directrice Catherine Milkovitch-Rioux, Clermont-Ferrand, que nous tenons à remercier particulièrement. C’est également avec l’aide de l’Université de Hambourg que le colloque a pu se dérouler dans des conditions matérielles très confortables. Nous remercions le personnel de l’Institut für Romanistik à Hambourg, avant tout Franziska Kutzick et Raffaella Palamidessi Fares pour leur aide à la préparation et à l’organisation du colloque et Griseldis Hemkendreis pour son assistance lors de l’enregistrement des conférences. Notre reconnaissance va de plus à Katrin Hoffmann qui a fourni l’épreuve pour le dépliant, l’affiche et la couverture de cette publication.
Nous tenons à exprimer notre grande gratitude à Emmanuelle Brun, Regensburg, pour sa traduction de l’article de Suzanne Kaplan, et nous profitons de ← 14 | 15 → l’occasion pour remercier Pauline Février, Sibille Adam, Julia Blandfort et Arnaud-Serge Tiémélé de Regensburg ainsi qu’Emmanuel Faure, Berlin, pour avoir révisé les contributions et nous avoir aidées à établir les textes dans leur version de la présente édition. Enfin, nous remercions Anna Larissa Walter qui a contribué avec beaucoup de savoir et de patience aux corrections et à la mise en page.
Bibliographie
Coquio, Catherine/Kalisky, Aurélia (dir.), L’Enfant et le génocide. Témoignages sur l’Enfance pendant la Shoah, Paris, Robert Laffont, 2007, p. LXXII-LXXV.
Hertling, Viktoria (dir.), Mit den Augen eines Kindes – Children in the Holocaust, Children in Exile, Children under Fascism, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1998.
Kaplan, Suzanne, Children in Genocide – Extreme Traumatization and Affect Regulation, London, International Psychoanalytical Association, 2008.
Lieberman, Benjamin, « From Definition to Process: the effects and roots of genocide », New Directions in Genocide Research, études réunies par Adam Jones, Abingdon, Routledge, 2012, p. 3-16.
Mesnard, Philippe, Témoignage en résistance, Paris, Stock, 2007.
Orlev, Uri, « Et la vie continue » (7 oct 1944), Poèmes écrits à Bergen-Belsen en 1944 en sa treizième année, Paris, Éclat, 2011, p. 46.
Pignot, Manon/Wolmark, Laure, « Introduction – ‹ Enfants-soldats › ou ‹ ado-combattants › ? Pour une histoire longue de l’enrôlement précoce », L’Enfant-soldat. XIXe-XXIe siècle. Une approche critique, études réunies par Manon Pignot, Paris, Armand Colin, 2007, p. 5-13.
1 Cf. Benjamin Lieberman, « From Definition to Process: the effects and roots of genocide », New Directions in Genocide Research, études réunies par Adam Jones, Abingdon, Routledge, 2012, p. 3-16.
2 Cf. Manon Pignot, Laure Wolmark, « Introduction – ‹ Enfants-soldats › ou ‹ ado-combattants › ? Pour une histoire longue de l’enrôlement précoce », L’Enfant-soldat. XIXe-XXIe siècle. Une approche critique, études réunies par Manon Pignot, Paris, Armand Colin, 2007, p. 5-13. Philippe Mesnard critique également cette confusion dans sa contribution et dans Témoignage en résistance, Paris, Stock, 2007.
3 Cf. Témoignage en résistance, op. cit., p. 134.
4 Uri Orlev, « Et la vie continue » (7 oct 1944), Poèmes écrits à Bergen-Belsen en 1944 en sa treizième année, Paris, Éclat, 2011 (Shirim mi-Bergen-Belzen, 1944, 2005), p. 46. Nous citons la traduction.
| 17 →
| 19 →
Catastrophes – Conflits – Génocides. Le Savoir Survivre de la Littérature
Résumé des informations
- Pages
- 360
- Année
- 2014
- ISBN (PDF)
- 9783653035322
- ISBN (ePUB)
- 9783653988857
- ISBN (MOBI)
- 9783653988840
- ISBN (Relié)
- 9783631647615
- DOI
- 10.3726/978-3-653-03532-2
- Langue
- français
- Date de parution
- 2014 (Mars)
- Mots clés
- Genozid Kindheit Trauma Mediale Repräsentation Ruanda Buchenwald Auschwitz Erinnerungskultur
- Published
- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 360 p., 2 ill. en couleurs, 1 ill. n/b, 2 tabl.