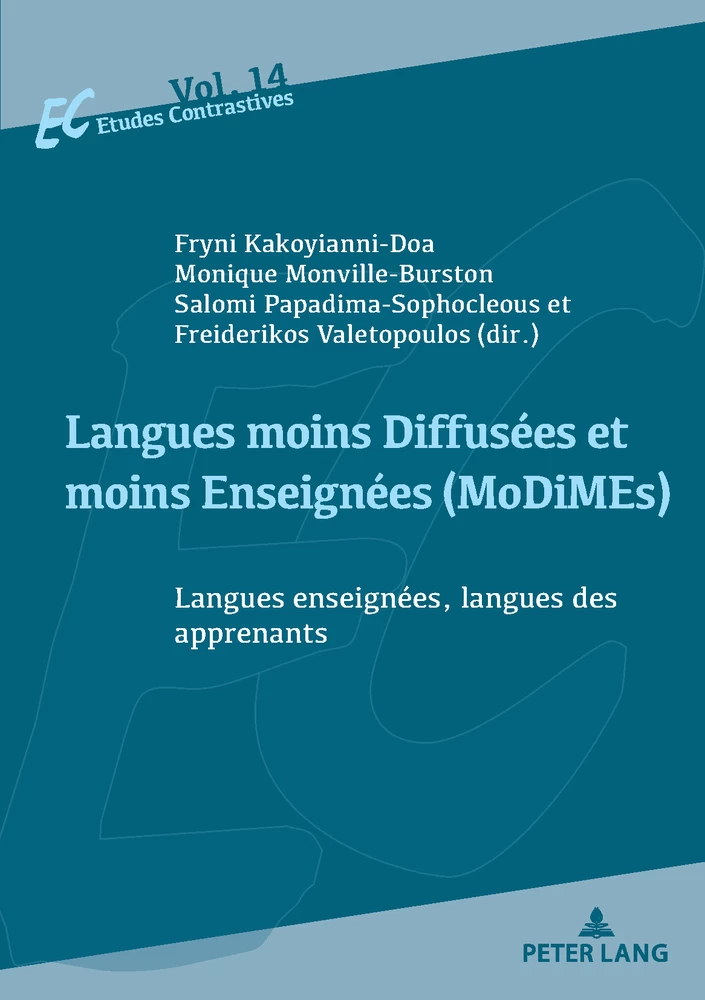Langues moins Diffusées et moins Enseignées (MoDiMEs)/Less Widely Used and Less Taught languages
Langues enseignées, langues des apprenants/Language learners’ L1s and languages taught as L2s
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos du directeur de la publication
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Table des matières
- Introduction
- Partie 1 – Enseignement plurilingue
- Krystyna Szymankiewicz: Les compétences professionnelles des futurs enseignants de français langue étrangère : valorisation du plurilinguisme
- Radosław Kucharczyk: Enseigner le français aux élèves polonophones à l’époque du plurilinguisme. Vers une approche réflexive et stratégique
- Magdalena Sowa: Le mystère de la langue disparue. Y a-t-il de la place pour le français dans l’enseignement professionnel en Pologne ?
- Partie 2 – Cultures éducatives et obstacles à l’apprentissage
- Jolanta Sujecka-Zając: L’impact des cultures éducatives des apprenants sur leur savoir-apprendre en langue étrangère. Le cas des élèves polonais en classe de langue
- Maciej Smuk: Barrières dans l’apprentissage du FLE aux yeux des étudiants polonophones
- Partie 3 – Corpus d’apprenants : marqueurs de discours
- Antonin Brunet: Didactique de corpus d’apprenants : piste de réflexion pour mieux identifier les compétences de ces derniers
- Laurie Dekhissi: La construction de la cohésion textuelle chez des apprenants turcophones de FLE
- Partie 4 – Appropriation des systèmes linguistiques
- Maro Patéli: Analyse d’erreurs de prononciation chez l’usager hellénophone du français : le cas de [ø]; et de [œ]
- Stéphanie Gobet: Exemples de formes linguistiques privilégiées par les enfants sourds pour établir la fonction sujet en français écrit
- María Victoria Soulé: Similar but not the same: Differences between the Spanish Preterit/Imperfect and the Greek Aoristos/Paratatikos oppositions and their consequences for teaching and learning
- Conclusion
Introduction
Par langues MoDiMEs, langues Moins Dites et Moins Enseignées (en anglais Less Widely Used Less Widely Taught – LWULWT), on fait référence à des langues étrangères qui sont peu enseignées en comparaison, selon les situations, avec l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand, qui sont, elles, considérées comme des langues « plus diffusées et enseignées ». Le terme MoDiMEs couvre donc dans le monde occidental un éventail allant de langues « majeures », comme le chinois, le russe, le japonais ou l’arabe, à des langues parfois dites « rares, petites », c’est-à-dire ayant peu de locuteurs et étant faiblement diffusées (y compris les langues régionales). Mais l’appellation MoDiME n’est pas sans poser problème car les langues n’assument pas le même statut dans les divers systèmes éducatifs. En Australie, par exemple, le chinois, le japonais et l’indonésien, largement enseignées dans les écoles comme L2, ne peuvent plus être considérées comme MoDiMEs. En effet l’échelle « +/- dit/enseigné » est liée à des facteurs de nature politique, éducative, sociolinguistique ou psycholinguistique qui font naître des problématiques didactiques variées. Il convient donc dans toute recherche ou projet d’étude engageant des langues MoDiMEs de définir quel point de vue sera choisi et quelle(s) problématique(s) seront abordées.
La perspective adoptée dans le présent ouvrage est particulière et doit donc être éclaircie. Tous les articles concernent l’enseignement de langues étrangères à des apprenants dont la langue maternelle/première est MoDiMe au sens défini ci-dessus (grec moderne, polonais, turc, serbe, langue des signes). Quant aux langues à acquérir (ici le français et l’espagnol) qui sont normalement considérées comme non-MoDiMEs sur l’échelle « +/- dit/enseigné », leur statut devient quasi-MoDiME dans certaines situations étudiées par les contributeurs au volume. En effet, dans ces situations, dans le contexte européen, le français et l’espagnol, par opposition à l’anglais – et à d’autres langues –, sont devenus des langues étrangères tertiaires ou des langues peu présentes dans le système scolaire.
Le volume Langues Moins Diffusées et Moins Enseignées : langues enseignées, langues des apprenants regroupe des articles sélectionnés après ←9 | 10→le colloque international du même titre qui a eu lieu à Nicosie en juin 2017. Ce colloque, co-organisé par l’Université de Chypre, l’Université technologique de Chypre et l’Université de Poitiers, s’inscrivait dans une suite de rencontres scientifiques qui avaient permis d’inciter une réflexion sur l’enseignement du français langue étrangère (FLE) à des apprenants natifs de langues MoDiMEs.
Lors de la première rencontre en 2015 (Valetopoulos et al., 2016), il s’était avéré que tant les enseignants que les chercheurs sont confrontés à des difficultés diverses, telles que l’absence d’études contrastives solides et complètes, la connaissance très partielle chez les professeurs de FLE de la première langue (L1) des apprenants et de leurs cultures, l’influence des L2 sur l’apprentissage du FLE comme L3, etc.
En mai 2016, un deuxième colloque a eu lieu à Istanbul, co-organisé par l’Université d’Istanbul et l’Université de Poitiers. Son objectif principal était de nouveau de réunir des chercheurs et des enseignants s’intéressant à l’enseignement du FLE aux locuteurs de langues MoDiMEs, mais aussi d’ouvrir un débat sur les priorités pour l’enseignement du FLE à des apprenants dont la L1 est syntaxiquement et phonétiquement éloignée du français. Les travaux se sont concentrés sur la place de l’oral dans l’enseignement.
La troisième édition de cette série de rencontres scientifiques, qui a eu lieu à Nicosie en 2017, a eu pour objectif d’élargir le champ de la réflexion et d’explorer de nouvelles pistes portant non seulement sur l’enseignement du FLE à des apprenants locuteurs de langues MoDiMEs (par exemple le français ou l’anglais à des apprenants grecs), mais aussi sur l’enseignement des langues MoDiMEs à différents publics (par exemple le turc ou le grec à des apprenants allophones).
Cette réflexion a paru indispensable car, d’un point de vue didactique, il existe à notre connaissance peu de travaux permettant aux futurs enseignants d’avoir une idée globale des difficultés rencontrées par les apprenants locuteurs de ces langues, comme les langues slaves mais aussi le grec, le turc, l’estonien, etc., parfois très éloignées génétiquement du français malgré leur proximité géographique. D’un point de vue linguistique, cet échange a permis, dans une approche contrastive, de faire apparaître des similitudes et des divergences entre les différentes interlangues des apprenants qui ont des L1, L2 ou même des L3 diverses.
Les traits et particularités des langues examinés dans les articles sont variés : phonologie, syntaxe, sémantique du TAM, pragmatique, contextes éducatifs, situations plurilingues, etc. Il en est de même des ←10 | 11→approches théoriques des recherches et des méthodologies qui leur sont associées : linguistique du corpus, modèle dépendanciel de la syntaxe, analyse contrastive, développements récents en didactique des langues et des cultures (stratégies d’apprentissage, motivation et attitudes des apprenants), approche verbo-tonale, théories du plurilinguisme.
Ce volume rassemble dix articles qui se construisent autour de deux axes principaux :
1) Facteurs liés au contexte d’apprentissage qui ont un impact sur l’enseignement de la langue étrangère (FLE) à des locuteurs de langues MoDiMEs. Cet axe est constitué de deux parties : a) Éducation plurilingue et b) Cultures éducatives et obstacles à l’apprentissage.
2) Analyses de la langue des apprenants, difficultés d’apprentissage d’ordre linguistique et comparaison des systèmes de la L1 et de la nouvelle langue. Deux parties composent cet axe : a) Corpus d’apprenants : marqueurs de discours et b) Appropriation des formes linguistiques de la L2 (FLE, espagnol langue étrangère).
Partie 1 – Enseignement plurilingue
Cette première partie est consacrée à l’étude des différents facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur l’apprentissage, tels que le plurilinguisme, les politiques linguistiques ou les décisions prises par les ministères de l’Éducation et les établissements scolaires/universitaires. Le plurilinguisme est étudié tout d’abord du point de vue de l’enseignant. Il est analysé par Krystyna Szymankiewicz qui s’interroge sur les compétences dont il faut munir les futurs enseignants de FLE en Pologne pour qu’ils fassent profiter les apprenants de leur profil plurilingue. L’auteure présente une réflexion sur les compétences professionnelles à développer pendant la formation initiale et propose un mini-référentiel de compétences spécifiques à acquérir par les futurs enseignants. Radosław Kucharczyk, quant à lui, prend le point de vue de l’apprenant et discute le recours au répertoire langagier des élèves lors du processus d’enseignement/apprentissage des langues. L’auteur présente une étude empirique, menée auprès d’élèves polonophones apprenant le français en tant que L3, et analyse les démarches qui pourraient encourager chez les apprenants le recours stratégique aux ressources de leurs répertoires langagiers. Si ces deux auteurs examinent comment on peut adopter ←11 | 12→le plurilinguisme comme levier pour améliorer les compétences des enseignants et des apprenants, Magdalena Sowa se tourne vers une problématique préoccupante, celle de la faible présence du français dans l’offre pédagogique des établissements de formation professionnelle en Pologne. Occupant la quatrième position des langues les plus enseignées dans l’enseignement généraliste, le français n’a pas réussi à s’implanter dans les programmes d’enseignement des écoles de métier et y est devenu une langue MoDiME. L’auteure propose des solutions censées contribuer au regain d’intérêt pour le FLE dans les écoles de métier en Pologne.
Partie 2 – Cultures éducatives et obstacles à l’apprentissage
Deux autres articles ont pour objectif de réfléchir sur les cultures éducatives et sur les barrières au processus d’appropriation des langues qu’on peut imputer aux apprenants eux-mêmes. Ainsi, Jolanta Sujecka-Zając analyse la notion de culture éducative comme système d’habitudes et de représentations collectives pouvant avoir une influence sur le savoir-apprendre des élèves en classe de langue et, en même temps, sur leurs résultats dans l’apprentissage des langues étrangères. Prenant comme public-cible les apprenants polonophones, elle s’intéresse aux modèles d’enseignement basés sur l’écrit, l’autorité de l’enseignant et les méthodes traditionnelles et démontre que, pour les apprenants interrogés, les relations apprenant-enseignant sont fondées plus sur la peur, la soumission et l’obéissance que sur le partenariat et la confiance. Dans la même ligne de pensée, Maciej Smuk se concentre sur la question des barrières dans l’apprentissage des langues. Celles-ci peuvent être d’origines diverses, dues à des circonstances externes et objectives, mais aussi aux attitudes et représentations des apprenants. Certaines d’entre elles sont profondément enracinées dans des facteurs spécifiques, propres à la culture d’origine de l’apprenant. L’auteur considère plus particulièrement les idées reçues, y compris les préacquis appartenant à la psychologie populaire, et les croyances volatiles, peu fiables et souvent nuisibles, que chaque milieu véhicule tout au long de son histoire.
Details
- Pages
- 194
- Publication Year
- 2020
- ISBN (Softcover)
- 9782807612501
- ISBN (PDF)
- 9782807612518
- ISBN (ePUB)
- 9782807612525
- ISBN (MOBI)
- 9782807612532
- DOI
- 10.3726/b16130
- Language
- French
- Publication date
- 2019 (December)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 194 p., 8 ill. n/b, 35 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG