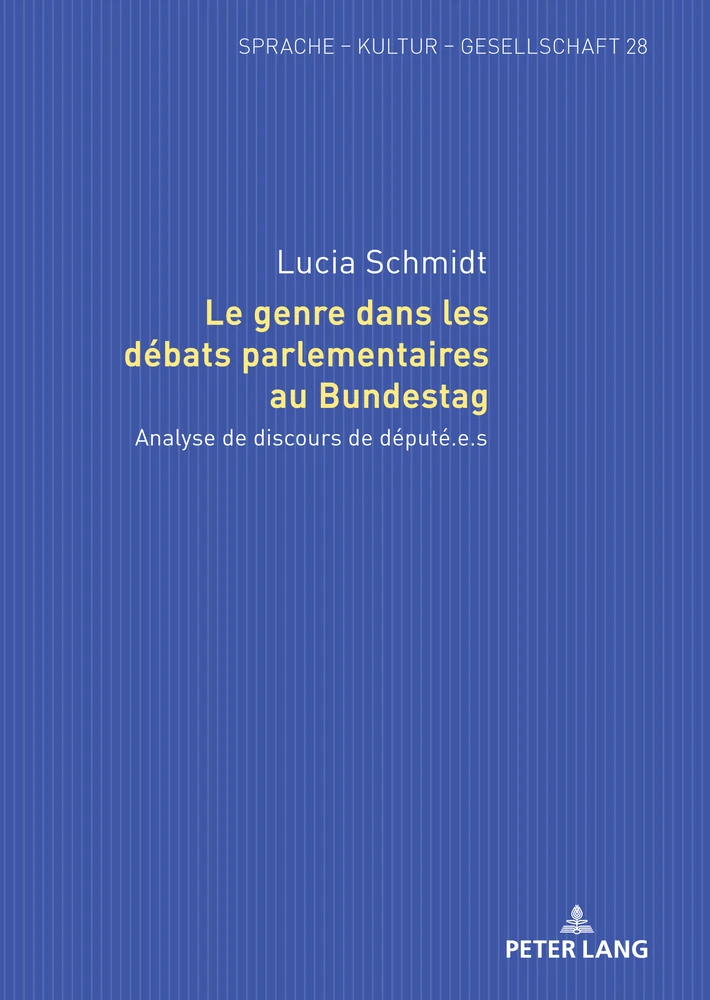Le genre dans les débats parlementaires au Bundestag
Analyse de discours de député.e.s
Summary
Ainsi, cet ouvrage interdisciplinaire offre des analyses tant quantitatives que qualitatives mettant en lumière la construction du genre dans les discours politiques.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Liste des abréviations
- Introduction
- 1 Politique et discours
- 2 Le genre en politique : enjeux sociologiques et discursifs
- 3 Les débats parlementaires sous le prisme du genre : état de l’art et hypothèses
- 4 Corpus et méthode
- 5 Analyse des spécificités : première approche du corpus, lexique et domaines politiques
- 6 Énonciation élocutive et délocutive
- 7 Adresse et référence à autrui : indexicaux de la deuxième personne et appellatifs
- 8 Les Zwischenrufe, entre polémique et approbation
- Conclusion
- Tables des figures et des tableaux
- Bibliographie
- Index
Introduction
« Une femme qui voterait les lois, discuterait le budget, administrerait les deniers publics, serait tout au plus un homme. »
Charles Nodier
L’Europe littéraire, 4 mars 1833
« Nous ne comprenons pas plus une femme législateur qu’un homme nourrice. »
Pierre-Joseph Proudhon
Le Peuple, 14 avril 1849
À l’occasion de sa première prise de parole devant l’Assemblée nationale de Weimar le 19 février 1919 – qui fut par la même occasion le premier discours de l’histoire parlementaire allemande prononcé par une députée –, l’élue du Parti social-démocrate Marie Juchacz a eu les mots suivants :
C'est la première fois en Allemagne qu'une femme, libre et égale, peut s'adresser au peuple dans un parlement, et je voudrais constater ici, en toute objectivité, que c'est la révolution qui a permis, en Allemagne aussi, de surmonter les vieux préjugés.1
Si l’enthousiasme et l’optimisme s’expriment par son propos, il est probable que ses espoirs aient été déçus si elle avait su qu’il faudrait encore attendre près de 86 ans avant qu’une femme ne tienne un premier discours, devant le parlement allemand, cette fois en tant que chancelière. Les « vieux préjugés » qu’elle estimait surmontés, ceux qui maintenaient les femmes loin des affaires publiques et de la vie politique, ont (eu) la vie dure.
Perspective et contexte
Les femmes allemandes pénètrent donc dans l’arène politique en 1919. Cependant, outre qu’il ait fallu attendre 2005 pour voir l’arrivée d’Angela Merkel au poste de chancelière fédérale, la présence des femmes au sein du parlement – Reichstag puis Bundestag – demeure modeste: n’ayant jamais dépassé le seuil des 10 % jusque dans les années 1980, leur proportion stagne autour d’un tiers des élu.e.s depuis la fin des années 19902. Dès lors, il n’est qu’un pas à franchir pour supposer que les « vieux préjugés » décrits par Marie Juchacz n’ont pas encore été entièrement surmontés dans le monde politique allemand contemporain. Les préjugés auxquels elle fait allusion ne sont rien d’autre que les stéréotypes de genre.
On peut supposer que les femmes sont confrontées à des barrières formelles et informelles, non seulement à l’entrée dans le monde politique mais également dans l’exercice de leurs mandats. Ainsi du système électoral, du sexisme à l’intérieur et à l’extérieur du parlement ou encore des mécanismes d’autocensure. Ne disposant pas de la légitimité historique des hommes, leur prise de parole politique est potentiellement entravée par la persistance de ces stéréotypes.
La politique est étroitement liée à l’exercice du pouvoir, dont les femmes ont longtemps été systématiquement tenues éloignées, en étant reléguées au sein de la sphère privée ; les stéréotypes de genre ne prédisposent pas non plus les femmes à cet univers marqué par la confrontation partisane et la compétition: au masculin l’agentivité et la rationalité ; au féminin l’orientation vers autrui et l’émotionalité (cf. Eckes 2010) – autant de qualités a priori défavorables à l’exercice des affaires publiques. Le genre, système de catégorisation binaire, hiérarchisé et profondément ancré dans notre société (cf. Bereni et al. 2013) et est de ce fait une composante majeure de notre identité.
Partant des conditions sociohistoriques que nous venons d’évoquer, notre analyse portera sur le parlement allemand, le Bundestag, en ce qu’il s’agit d’un espace qui se veut autant représentatif que possible du peuple, donc de la société allemande contemporaine. Le parlement est en outre un des lieux de confrontation politique par excellence, même si la mise en scène individuelle ou partisane prend le pas sur une véritable délibération, ce qui n’entrave en rien son caractère compétitif, mais au contraire le renforce : il s’agit de créer l’adhésion du ou de la destinataire principal.e du débat – l’électeur.rice – tout en l’emportant sur l’adversaire politique (cf. Burkhadt 2003).
Du fait des progrès indéniables des décennies passées relatifs à l’émancipation des femmes, il n’est plus possible de les considérer aujourd’hui comme de simples incongruités politiques et statistiques ; de même, l’image d’un.e bon.ne politicien.ne est également associée aujourd’hui à des qualités relationnelles et altruistes, auparavant dépréciées. À l’inverse, est-ce que, pour reprendre les mots de Charles Nodier, les femmes aujourd’hui en charge du vote des lois, du budget et des deniers publics sont devenues des hommes (politiques), en adoptant les codes et le comportement de ces derniers? Ou pour reprendre ceux de Proudhon, les femmes législatrices nous sont-elles devenues, pour les mêmes raisons, compréhensibles et intelligibles ? À travers ces interrogations se pose celle de savoir si le discours parlementaire est encore marqué par des différences de genre ou s’il s’est unifié, homogénéisé, au point que l’on puisse dorénavant dire qu’une femme est un(e) député(e) comme un(e) autre ?
Nous supposerons pour notre part que la persistance des stéréotypes de genre n’échappe pas à l’univers politique, le parlement étant de surcroit un espace prototypique de la sphère publique traditionnellement masculinisée : la prise de parole des femmes y reste liée à des problématiques pouvant relever tout autant des attentes et réactions de leurs allocutaires que de l’existence de styles communicatifs influencés par le genre. Ces derniers pourraient s’expliquer par une intériorisation des stéréotypes de genre, mais aussi par la construction intentionnelle d’un ethos genré.
Ancrage théorique et méthodologique
Cette analyse semi-outillée interrogera plus précisément l’existence d’éventuelles différences linguistiques liées au genre dans les débats parlementaires du Bundestag.
Sur le plan théorique, ce travail est ancré dans l’analyse du discours (cf. Busse/Teubert 2013, Charaudeau/Maingueneau 2002), laquelle s’applique à considérer le discours en lien étroit avec ses conditions de production, les rapports de force étant un objet de recherche privilégié notamment de ses courants critiques (cf. Wodak 2002, Jäger 1999). Notre travail est essentiellement descriptif, en ce qu’il n’a pas de visée transformatrice. Cependant, nous partageons avec les courants critiques de l’analyse du discours un intérêt pour les faits sociaux et les structures de domination.
L’analyse énonciative apparait comme particulièrement adaptée à nos objectifs, car elle s’interroge quant à l’inscription du locuteur ou de la locutrice dans son énoncé (cf. Kerbrat-Orecchioni 1999, Maingueneau 2007). Les différents procédés au travers desquels le ou la locuteur.rice y imprime – ou non – sa marque peuvent en effet laisser transparaitre l’influence du genre. De même, la convocation des travaux relevant de la politolinguistique germanophone (par exemple Burkhardt 2003, Klein 2014) nous permettra d’appréhender la structure et le fonctionnement du langage politique, tandis que les recherches en linguistique du genre (par exemple Kotthoff/Nübling 2018, Ayaß 2008) nous fourniront des hypothèses plus générales quant à l’expression du genre dans la communication.
Nous nous appuierons à cette fin sur un vaste corpus numérisé de verbatims des débats parlementaires, plus précisément des Aktuelle Stunden, extrait du corpus GermaParl3 englobant une période de presque 20 années et contenant un volume discursif de plus de six millions de mots, qui sera exploité à l’aide du logiciel CQPweb (cf. Hardie 2012). Le choix d’un corpus récent (1996-2015) s’explique par la volonté d’interroger l’impact du genre à une période actuelle, qui, malgré l’évolution des rôles de genre dans la société, connait toujours une stagnation de la part des femmes parmi les député.e.s. On peut également supposer que, compte tenu des évolutions socio-historiques évoquées, les marques du genre observables sont subtiles.
L’étendue du corpus est un atout pour notre travail afin de minimiser voire pallier autant que possible les inévitables biais de l’analyse du discours. Notre démarche sera en effet quantitative d’une part, en ce que nous aurons recours à des méthodes statistiques, mais elle s’appuiera d’autre part sur un constant retour au texte (cf. Mayaffre et al. 2019) et la convocation d’autres données, extralinguistiques, qui conditionnent le discours.
Structure
La notion de politique sera abordée dès le premier chapitre. Nous y verrons que le politique est un domaine intrinsèquement linguistique. Nous questionnerons cette notion sous ses différents aspects structurels et performatifs, et nous évoquerons également ses articulations avec la notion de pouvoir. À cet égard, les questions de légitimité et de leadership des acteurs.rices politiques s’avèreront particulièrement pertinentes une fois examinées à la lumière du genre.
Nous présenterons ensuite les disciplines et approches à la croisée desquelles se situe le présent travail, lesquelles guideront nos analyses. Ainsi de la politolinguistique de tradition germanophone, qui nous permettra d’apprécier les principales caractéristiques du discours politique, tout en nous fournissant notamment des outils d’analyse lexicale ; au plan discursif, les courants d’analyse du discours français et germanophone, en ce qu’ils envisagent le discours en lien avec son contexte de production sociohistorique ; les courants critiques – axés sur les faits sociaux – ainsi que les courants descriptifs – partant des phénomènes linguistiques.
Le deuxième chapitre sera consacré à la notion de genre et à son incidence en politique et plus généralement dans la sphère publique. Ce chapitre se proposera également d’aborder la conquête de la vie publique par les femmes, dont elles ont longtemps été tenues à l’écart. La linguistique du genre, et plus précisément sa branche communicationnelle, s’intéresse aux différences linguistiques entre hommes et femmes, les styles « féminins » étant souvent considérés comme le reflet intériorisé de leur position inférieure. Une recension de plusieurs travaux de linguistique du genre nous permettra de relever des marqueurs susceptibles d’intéresser notre analyse.
Le troisième chapitre évoquera plusieurs études intéressant la prise de parole des femmes en politique, et notamment dans l’exercice d’un mandat de députée, tant au sein du parlement que dans les médias. Celles-ci révèleront que les femmes sont davantage la cible de techniques de domination – parfois simplement réduites à leur corps – qui tendent à les disqualifier sur la scène politique. Le genre apparaitra en outre comme un marqueur puissant du style linguistique des orateurs.rices et notamment de l’aisance à prendre la parole en public ou à adopter une posture assertive – lesquelles s’avèreront l’apanage principal des hommes, les femmes manifestant au contraire un sentiment d’illégitimité. De même, le style linguistique de ces dernières fera apparaitre un ethos empathique pragmatique, dénué de polémique et de la compétitivité exacerbée propre au jeu politique.
Le corpus sera présenté au sein du quatrième chapitre. Dans un premier temps, le Bundestag sera appréhendé comme communauté discursive, avec ses groupes parlementaires, ainsi que les caractéristiques discursives inhérentes au débat parlementaire. Les particularités de ce corpus numérisé et de son exploitation semi-outillée nécessiteront des précisions sur sa constitution, son annotation et ses métadonnées. Les fonctionnalités les plus importantes du logiciel CQPweb seront expliquées, ainsi que les biais liés à l’analyse de verbatims parlementaires, notamment les modifications effectuées par les sténographes. La méthodologie du travail, consistant en une analyse semi-outillée, sera ensuite abordée. Ainsi, nous partirons d’une analyse inductive, portée par le corpus, pour ensuite affiner les spécificités qui nous sembleront pertinentes, dans une analyse cette fois-ci basée sur le corpus.
Dans le cinquième chapitre, nous procèderons de façon inductive en effectuant un calcul des spécificités des corpus F (discours des femmes) et M (discours des hommes). Ce calcul révèlera les lemmes suremployés dans chacun de ces corpus par rapport à l’autre. Du fait que les listes des mots sur- et sous- utilisés dans chaque corpus révèleront des lemmes renvoyant à des ressorts politiques (par exemple celui des finances), nous comparerons nos résultats avec la répartition des discours sur les différentes séances ainsi qu’avec l’appartenance des orateur.rices à une commission parlementaire. En effet, ce sont le plus souvent les membres des commissions concernées qui sont amené.e.s à prendre la parole. Nous verrons ainsi s’il existe une répartition des domaines politiques en fonction du genre. L’analyse des spécificités comprend également des lemmes non thématiques, par exemple des pronoms, qui seront l’objet des chapitres suivants.
Le sixième chapitre reprendra certaines de ces spécificités qui nous paraissent pertinentes et sera structuré en fonction des procédés énonciatifs (cf. Charaudeau 2019) : l’énonciation élocutive, subjective, s’oppose à l’énonciation délocutive, caractérisée par l’objectivation du discours. Les procédés élocutifs abordés seront entre autres les verba dicendi ainsi que les verbes de la revendication à la première personne, renforçant l’énoncé, et les modalisateurs épistémiques comme marqueurs d’atténuation de l’énoncé. Les procédés délocutifs, participant de l’objectivation du discours et pouvant ainsi relever de l’assertivité, seront notamment abordés au travers des pronoms indéfinis et des structures conditionnelles.
Le septième chapitre sera consacré à l’énonciation allocutive dans les discours, c’est-à-dire la façon dont les orateurs.rices s’adressent, mais également réfèrent à autrui. L’analyse de cette dimension se fera par le biais des indexicaux de la deuxième personne et des appellatifs, qui regroupent diverses formes d’adresse – collectives ou individuelles, introductives ou intradiscursives. Plusieurs notions susceptibles d’être pertinentes pour notre problématique interviendront dans notre analyse : ainsi par exemple de la polémicité, lorsque l’adversaire est la cible des adresses. La relation qu’entretient le ou la locuteur.rice avec son auditoire, au travers notamment d’adresses collectives, peut également être révélatrice d’une posture d’orateur.rice.
Le huitième et dernier chapitre portera enfin sur les interruptions, les Zwischenrufe, élément dialogique qui fait intervenir dans l’analyse non seulement l’orateur.rice mais en même temps l’interrupteur.rice. Elles nous intéresseront d’abord au titre des interrrupteurs.rices, s’agissant de la fréquence des interruptions commises, mais également de leur teneur. Quant à cette dernière, nous distinguerons deux valeurs opposées : les interruptions polémiques et approbatives ; parmi les interruptions polémiques, nous tenterons d’appréhender leur degré de polémicité : l’identification des interpellations directes – voire ad hominem – pouvant constituer des indices en ce sens. Enfin, nous tenterons de déterminer si le sexe des orateurs.rices affecte la probabilité d’être interrompu.e.
1 Original : « Es ist das erste Mal, daß in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf, und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, daß es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. », cf. Deutscher Bundestag, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw03-frauenwahlrecht-rezitation-587156 [dernière consultation : 22/05/2024].
2 Cf. Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages (version numérique), chapitre 3.6, [dernière consultation : 22/05/2024].
3 Cf. https://github.com/PolMine/GermaParl [dernière consultation : 22/05/2024].
1 Politique et discours
1.1Politique, langage et pouvoir
1.1.1Politique et langage
Dans une acception très large, la politique peut être comprise comme toute coordination de l’action de plusieurs personnes ou groupes; on parle par exemple de politique d’entreprise (cf. Lenz / Ruchlak 2018 : 171). Mais la notion de politique est plus souvent limitée au domaine étatique, comme en témoigne l’étymologie du mot : dans la Grèce antique, le terme politikè (téchne) signifiait l’art de la gestion des affaires publiques, de la vie collective, en d’autres termes la gouvernance d’un État (cf. Engi 2006 : 238, Duden 2001 : 617, Bonnafous / Tournier 1995 : 67-68). Elle a pour support nécessaire la confrontation des intérêts divergents qui traversent tout groupement d’individus – jusqu’à la société prise dans son ensemble. Mais cette divergence d’intérêts se retrouve jusque dans la situation personnelle des acteurs.rices politiques : iels peuvent en effet poursuivre tant un intérêt collectif (général ou partisan) que strictement individuel (par exemple être réélu.e) (cf. Blühdorn 1995 : 96-97).
En sciences politiques, on distingue habituellement trois dimensions à la notion de politique : polity, politics et policy.
Il peut en premier lieu être question du système politique, c’est-à-dire des institutions et des normes qui le régissent, à commencer par la Constitution et dans une moindre mesure les lois. Cet aspect structurel est appelé polity dans la tradition anglo-saxonne (cf. Niehr 2014 : 14). Ces structures ayant été conçues et mises en place par des hommes, à une époque où le fait politique leur était quasi-exclusivement réservé, elles ont reproduit en leur sein l’exclusion des femmes qui avait cours dans la sphère publique.
La seconde dimension à laquelle renvoie le terme politique découle de la première et vise les processus et actions politiques, lesquels s’inscrivent dans ce cadre structurel et les institutions qui en sont issues. Ces procédures discursives de négociation, de délibération et de gouvernance, que l’on désigne par politics (cf. Niehr 2014 : 14), sont le reflet des structures au sein desquelles elles prennent place, mais peuvent également influer sur celles-ci. La dimension discursive sera au cœur de notre analyse des discours parlementaires sous le prisme du genre (doing gender). Au (doing) politics, on pourra ajouter le being a politician, l’ethos construit par les hommes et les femmes politiques.
On distingue enfin une troisième dimension, celle des différents domaines d’intervention politiques qui découle elle aussi des précédentes. S’y matérialisent concrètement les orientations politiques actées dans le cadre décisionnel des politics et où s’exerce notamment l’action de l’administration, comme la santé, l’éducation ou l’économie (qui renvoient aux expressions de « politique budgétaire », « politique sociale », « politique éducative », etc.). Ces policies (cf. Niehr 2014 : 14, Lenz / Ruchlak 2018 : 171) occuperont également une place centrale dans notre travail, car elles peuvent refléter la répartition des « tâches » entre les sexes.
Details
- Pages
- 374
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631896037
- ISBN (ePUB)
- 9783631896044
- ISBN (Hardcover)
- 9783631896020
- DOI
- 10.3726/b22398
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Stéréotypes de genre Linguistique énonciative Textométrie TAL Discours politique Analyse du discours
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 374 S., 2 farb. Abb., 29 Tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG