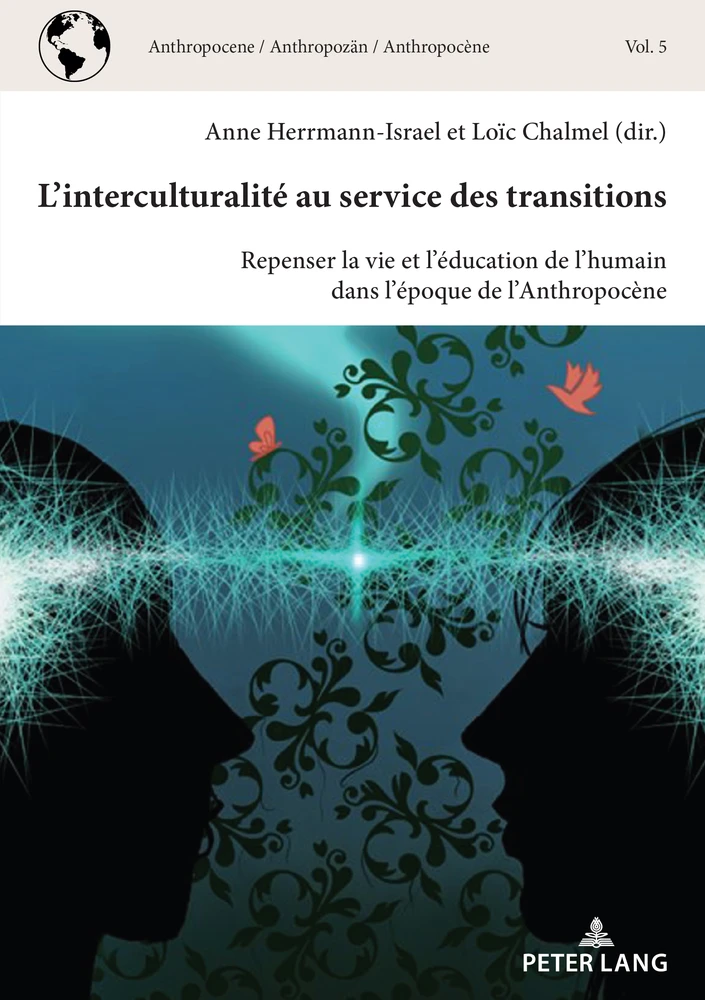L’interculturalité au service des transitions
Repenser la vie et l’éducation de l’humain dans l’époque de l’Anthropocène
Résumé
Les contributions proposées se déclinent autour des notions de transition et d’interculturalité qui soutiennent tant la réflexion autour de nouveaux paradigmes et le questionnement d’enjeux complexes que la formation à la lecture critique et à la prise de conscience à travers divers outils pédagogiques.
Forts d’un constat - « plus nous avancerons en Anthropocène, moins il y aura de transitions, plus il y aura de ruptures » (Nathanaël Wallenhorst, UCO) -, d’une ressource - « l’interculturalité est un réacteur en puissance des transitions humaines à mener. Activons-le ! » (Éric Hueber, UHA) - et d’une visée éducative - « éclairons, conscientisons la jeunesse du monde pour qu’ils deviennent les vrais acteurs d’un transition réussie » (Sarah Alavi, ESTA) -, cet ouvrage ouvre le débat sur ce vaste chantier éducatif à refonder.
Avec des contributions de : Sarah Alavi, Johann Chalmel, Loïc Chalmel, Valentine Erné-Heintz, Virginie Grandjean, Renaud Hétier, Anne Herrmann-Israel, Gregory Kotnarovsky, Laurent Muller, Rodolfo Orjuela, Jean-Michel Pérez, Nathanaël Wallenhorst.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- List of illustrations
- Introduction: L’interculturalité au service des Transitions
- PARTIE I Penser de nouveaux paradigmes en éducation et en formation à l’époque de l’Anthropocène
- CHAPITRE 1 Une enfance résistante à l’époque de l’Anthropocène (Renaud Hétier)
- CHAPITRE 2 Micro-violences en Éducation : paradoxes, contractions et perspectives à l’époque de l’Anthropocène (Jean-Michel Perez et Laurent Muller)
- CHAPITRE 3 L’inclusion sociale des personnes avec déficience intellectuelle : question de cohérence interculturelle ? (Virginie Grandjean)
- CHAPITRE 4 État des lieux et prospective de l’Université française à l’heure des transitions (Anne Herrmann-Israel)
- PARTIE II Enjeux complexes pour un monde désirable et durable à faire advenir à l’époque de l’Anthropocène
- CHAPITRE 5 Entre tradition et modernité, une transition agricole porteuse d’héritages et d’expériences ou comment mettre en champs une créativité soucieuse de durabilité (Valentine Erné-Heintz)
- CHAPITRE 6 Le véhicule à conduite automatisée : entre rupture et transition technologique (Rodolfo Orjuela)
- PARTIE III Former à la lecture critique et à la prise de conscience pédagogique face à l’urgence environnementale à l’époque de l’Anthropocène
- CHAPITRE 7 La datation de l’entrée à l’époque de l’Anthropocène. Synthèse d’un débat à destination des enseignants (Nathanaël Wallenhorst)
- CHAPITRE 8 D’une rencontre disciplinaire entre deux enseignants-chercheurs au développement d’une pédagogie innovante sur les questions énergétiques (Sarah Alavi et Grégory Kotnarovsky)
- Réflexion conclusive - Ouverture (Loïc Chalmel et Anne Herrmann-Israel)
- Titres de la collection
PARTIE I Penser de nouveaux paradigmes en éducation et en formation à l’époque de l’Anthropocène
En lien avec les champs de l’éducation, de la formation et du handicap, l’objectif de cette première Partie est de présenter plusieurs pistes de réflexions éducatives critiques (fondements, représentations, politiques institutionnelles, pratiques et postures éducatives) et prospectives reliées à l’interculturalité et/ou à l’époque de l’Anthropocène.
CHAPITRE 1 Une enfance résistante à l’époque de l’Anthropocène
Renaud Hétier, Université d’Angers, LISEC UR 2310
L’Anthropocène n’est pas seulement un problème écologique d’une ampleur sans précédent, dont la menace pèse sur l’avenir. Il est aussi l’expression d’un déséquilibre profond, qui est tout à la fois économique, anthropologique et psychique, ce qui suppose une compréhension interculturelle et interdisciplinaire. Le système capitaliste dans son fonctionnement même repose sur une exploitation illimitée des ressources humaines et naturelles. Il provoque, de ce fait, outre de l’exploitation, de la domination et des inégalités, de l’épuisement, dans la mesure où tant les forces humaines (physiques et psychiques) que le système-Terre sont limités. Sur ce fond, ce système économique a engagé un processus psychique paradoxal. Pour s’équilibrer, le sujet actuel éprouve le besoin de consommer une grande quantité d’énergie, d’objets, de produits. C’est précisément ce qui correspond aux réquisits de ce système économique, qui a besoin tout à la fois que les individus aspirent à consommer précisément ce qui est produit et veuillent travailler autant que possible, entretenant ainsi la reproduction de ce système. Sans cette consommation intensive, l’individu risque lui-même désormais l’effondrement, faute de savoir ni compter sur ses propres ressources ni sur les ressources de son environnement naturel. Autrement dit, l’économie capitaliste a bien trouvé le moyen de son entretien : elle a d’abord coupé les individus de leurs ressources, avant de les faire dépendre des compensations qu’elle leur vend, ce qui fait qu’il n’y a plus besoin de les contraindre : ils consomment intensément par peur de leur propre effondrement, par peur du vide.
Dans cette contribution, il s’agit de se saisir de la dimension éducative du problème. La transition est alors à comprendre aussi du point de vue anthropologique (et pas seulement énergétique), comme réorientation des fins de l’existence humaine, dès l’enfance. C’est bien dès l’enfance et souvent par l’éducation elle-même que se met en place une aliénation aux mécanismes économiques que nous avons décrits, qui tout à la fois font dépendre et empêchent de développer ses propres forces (l’un entraînant l’autre). Non seulement les enfants sont-ils devenus eux-mêmes des consommateurs et prescripteurs auprès de leurs parents, mais encore se joue-t-il pour eux une expérience fondatrice de l’existence. La peur de l’ennui, de la frustration, mais aussi celle du retard (en termes de compétences) conduit à ce que les enfants soient toujours occupés et ceci par des activités le plus souvent marchandisées. Les enfants s’habituent par leurs occupations à ne pas puiser dans leurs propres ressources (imagination, mémoire, créativité, etc.) et dans le même mouvement à ne pas les développer. Le manque de confiance en ses propres ressources qui en découle fait logiquement dépendre fortement de ressources qu’on pourrait dire artificielles et marchandisées. C’est cette disposition des individus, formée dès l’enfance, à craindre un certain effondrement si les objets habituellement consommés venaient à manquer, qui réclame une transition anthropologique. En suivant cette hypothèse, il importe alors de repenser profondément l’aménagement des conditions de l’enfance et l’éducation, pour tout à la fois favoriser un accomplissement subjectif et une certaine indépendance, des ressources propres à assurer une résistance à son propre effondrement et à désarmer l’emballement économique conduisant à l’Anthropocène.
1. Derrière l’Anthropocène, un capitalocène
Un débat a lieu pour savoir comment dater le début de l’Anthropocène. Au plus tard, celui-ci commencerait avec la « grande accélération » des années 1950 (augmentation en flèche de la population mondiale et de la consommation de ressources naturelles et notamment fossiles). Au plus tôt, on pourrait considérer que le début des civilisations entraîne une exploitation de ressources et notamment de terres qui commencent à déséquilibrer le renouvellement de la nature. Le choix que nous faisons ici est intermédiaire : il désigne le système capitaliste comme étant le moteur de l’Anthropocène. Pourquoi cela ? Parce que c’est avec les débuts de ce système que s’initie vraiment un principe d’exploitation généralisée des ressources. Ce terme d’exploitation est important dans notre propos, dans la mesure où il vaut aussi bien pour les prélèvements faits dans la nature et bientôt le rejet de déchets et de polluants que pour l’exercice d’une domination d’envergure mondiale sur les humains. Non seulement, donc, cette exploitation déséquilibre-t-elle directement les équilibres naturels, mais encore atteint-elle aussi un certain équilibre anthropologique, faisant le lit d’une nouvelle manière de vivre, tendant à consommer de manière illimitée à défaut de savoir compter sur ses propres ressources (subjectives et mésologiques). Cette nouvelle manière de vivre, bien évidemment, devient le moteur de l’exploitation, tout à la fois en entretenant le fonctionnement du système et en le faisant finalement reposer sur la demande des individus eux-mêmes, en ayant de moins en moins besoin de recourir, comme aux débuts (installation de comptoirs en Afrique et en Asie, conquête de l’Amérique, mise en place de l’esclavage et du travail forcé, etc.), à la violence. C’est bien ce ressort de l’exploitation qui doit nous intéresser dans la visée de comprendre le problème de l’effondrement humain en question.
Résumé des informations
- Pages
- 160
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9782875748324
- ISBN (ePUB)
- 9782875748331
- ISBN (Broché)
- 9782875748317
- DOI
- 10.3726/b22195
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Novembre)
- Mots Clés (Keywords)
- Education Interculturalité Transitions
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 160 p., 5 ill. en couleurs, 5 ill. n/b, 2 tab.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG