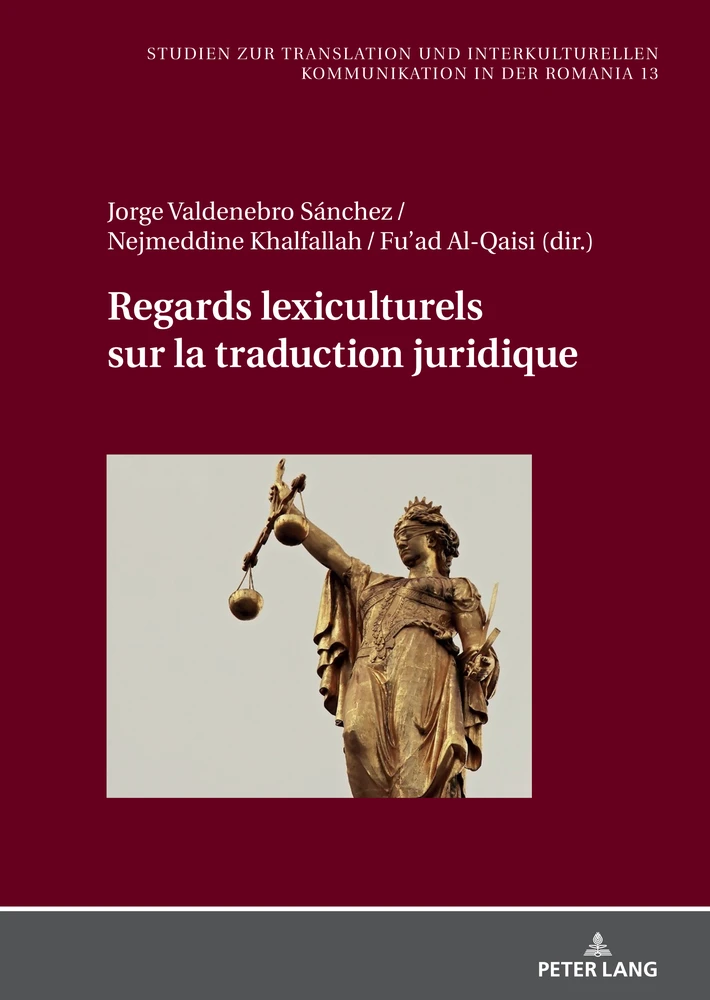Regards lexiculturels sur la traduction juridique
Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- TABLE DES MATIÈRES
- TRADUCTION JURIDIQUE. CADRE CONCEPTUEL
- LA TRADUCTION JURIDIQUE: UN TRANSFERT LEXICULTUREL COMPLEXE
- L’ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS, UNE AFFAIRE DE MOTS
- POUR UNE APPROCHE CONCEPTUELLE DE LA TRADUCTION JURIDIQUE. DOMAINE FRANÇAIS–ARABE
- COURT JUDGMENT LEX-ICON IN CRIMINAL CODES: ONLINE COURT JUDGMENTS IN FRANCE, THE UNITED KINGDOM AND SPAIN. PROPOSED TRANSLATION MODEL: FRENCH– ENGLISH–SPANISH
- TRADUCTION JURIDIQUE. APPROCHE VARIATIONNELLE
- LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA DESDE UN ENFOQUE JURITRADUCTOLÓGICO: LAS SUCESIONES EN ESPAÑA Y EN CHILE
- TRADUCCIÓN JURÍDICA Y VARIACIÓN DIATÓPICA EN INGLATERRA, ESPAÑA Y COLOMBIA. EL CASO DE THEFT, ROBBERY Y BURGLARY
- LES VARIANTES TOPOLECTALES DU LEXIQUE JURIDIQUE: LA TRADUCTION DES TERMES «JUGE», «COUR» ET «TRIBUNAL» DU FRANÇAIS VERS L’ARABE
- LA SOCIEDAD PROTAGÓNICA, PROTAGONISMO DEL PUEBLO, PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: PROPOSITION JURITRADUCTOLOGIQUE POUR LA CONSTITUTION VÉNÉZUÉLIENNE
- TRADUCTION JURIDIQUE ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES
- LA TRADUCTION DES RÉALITÉS JURIDICO-CULTURELLES ESPAGNOLES VERS LE FRANÇAIS PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE: UNE ÉTUDE DE CAS
- LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES À L’ÉPREUVE DE LA TRADUCTION JURIDIQUE. L’EXEMPLE DE LA CRIMINALITÉ EN COL BLANC EN DROITS FRANÇAIS ET ITALIEN
- MANIFESTACIONES DEL PRECEDENTE LINGÜÍSTICO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN A PARTIR DE UN CORPUS DE ENCARGOS REALES
- TRADUCTION JURIDIQUE EN DROIT DES RÉFUGIÉS: ENJEUX ET PERSPECTIVES
- MÉDIATION JURICULTURELLE ET ACCOMMODATION LINGUISTIQUE DANS LE GLOSSAIRE BILINGUE DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE
- TRADUCTION JURIDIQUE ET TRADITION RELIGIEUSE
- DEUX ACTES DISCURSIFS PUNISSABLES. LA DIFFAMATION ET LE QADF SONT-ILS ÉQUIVALENTS ?
- LA TRADUCTION JURIDIQUE À L’ÉPREUVE DE LA RÉMINISCENCE CULTURELLE: LE CAS DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
- TRADUCTIONS NOSTALGIQUES
Sorbonne Université
LA TRADUCTION JURIDIQUE: UN TRANSFERT LEXICULTUREL COMPLEXE
Résumé: Cet article questionne la spécificité du regard lexiculturel en matière de traduction juridique en ces termes: observe-t-on une différence de traduction selon les branches du droit? La problématique ici consiste à se demander si la division ou la subdivision opérée par la science juridique en catégories ou champs de spécialité a une influence sur le processus de traduction. La juritraductologie, jeune discipline, sert à décrire, analyser et théoriser l’objet à traduire et l’objet traduit en tant qu’objet appartenant au domaine du droit et utilisé par le droit. Elle fournit un cadre d’analyse interdisciplinaire, en droit et en traductologie, tel le degré de juridicité dont la variabilité peut être inhérente aux branches du droit. De même, elle procède à des classifications tel le caractère horizontal et vertical de la traduction juridique qui permettent d’observer des spécificités selon que la traduction juridique porte sur un texte de droit international ou de droit national. La combinaison de ses cadres conceptuels juritraductologiques constituera le fil rouge de l’analyse du regard lexiculturel posé sur la traduction juridique. Finalement la vigilance du traducteur sera attirée sur la spécificité du processus à suivre selon le type de textes.
Mots-clés: traduction juridiqueméthodologietransfert lexicultureljuritraductologie.Keywords: legal translationmethodologylexicultural transferlegal translation science.Abstract: This article examines the specificity of the lexicultural approach to legal translation in the following terms: is there a difference in translation depending on the branch of law? The question here is whether the division or subdivision of legal science into categories or fields of specialisation has an influence on the translation process. Juritraductology, a young discipline, serves to describe, analyse and theorise the object to be translated and the object translated as an object belonging to the field of law and used by the law. It provides a framework for interdisciplinary analysis, in law and translatology, such as the degree of legality, the variability of which may be inherent in the various branches of law. Similarly, it classifies the horizontal and vertical nature of legal translation, which makes it possible to observe specificities depending on whether the legal translation concerns a text of international or national law. The combination of these juritraductological conceptual frameworks will form the common thread of the analysis of the lexicultural view of legal translation. Finally, the translator’s attention will be drawn to the specific nature of the process to be followed depending on the type of text.
1. INTRODUCTION
Les organisateurs de ce Colloque international, que je tiens à remercier très chaleureusement pour leur invitation à présenter cette conférence plénière, ont tracé dans leur appel à communication la trame de mon intervention. L’axe 5 de l’appel questionne la spécificité du regard lexiculturel en matière de traduction juridique en ces termes: «peut-on observer une différence de traduction selon les branches du droit? Plus on tend vers le droit international public, plus on trouve aisément des équivalents. Inversement, plus on tend vers les statuts personnels et les codes pénaux où les charges culturelles sont plus présentes, plus on affronte des difficultés. Peut-on noter que l’harmonisation des termes et des notions à travers la traduction universelle où chaque notion a un équivalent, dans toutes les langues du monde, contribue à niveler les sens et à effacer les nuances?».
Avant de répondre aux problématiques soulevées, il convient à titre liminaire de s’interroger sur le sens même de la notion de «transfert lexiculturel» en traduction juridique. La lexiculturologie a pour objet d’étudier la lexiculture, c’est-à-dire la «culture en dépôt dans ou sous certains mots, dits culturels, qu’il convient de repérer, d’expliciter et d’interpréter» (Galisson, 1999, p. 480). En traduction juridique, il s’agit des termes à forte «charge juridique» (Cornu, 2005, p. 210) qui présentent une teneur sémantique supplémentaire en complexifiant sa compréhension mais dont la signification est partagée par la communauté des juristes de cette culture. En filigrane se profile les notions de discours de spécialiste versus de profane, la charge culturelle étant l’apanage du premier. La juritraductologie qui «décrit, analyse et théorise l’objet à traduire et l’objet traduit en tant qu’objet appartenant au domaine du droit et utilisé par le droit» (Monjean-Decaudin, 2012, p. 405) insère la lexiculture dans la notion du degré de juridicité. Le «degré de juridicité» est composé de deux paramètres qui, selon les cas, se cumulent l’un l’autre. Le premier paramètre réside dans le contenu en science et en langue juridiques que renferme le texte source, à savoir sa teneur en vocabulaire juridique, en concepts juridiques et en culture juridique. Pour l’évaluer, la question à se poser est la suivante: combien faut-il avoir de connaissances en droit et en langage juridique source1 pour comprendre et traduire le texte source? Le deuxième paramètre porte sur les effets juridiques qu’entraîne le texte et/ou sa traduction. Pour le savoir, la question à se poser serait la suivante: le texte (qu’il soit ou non juridique) et/ou sa traduction ont-ils des effets contraignants? Autrement dit, quelle autorité ou force juridique présente-t-il? Si les deux paramètres sont négatifs, le degré de juridicité est nul. Si les deux paramètres sont positifs, le degré de juridicité atteint son niveau maximum. Enfin, si l’un des deux paramètres seulement est positif, alors le degré de juridicité est variable (Monjean-Decaudin, 2007, p. 94).
La problématique ici consiste à se demander si la variabilité du degré de juridicité est inhérente aux branches du droit, c’est-à-dire à la division ou à la subdivision opérée par la science juridique en catégories ou champs de spécialité? Pour y répondre, il convient de rappeler ce que sont les branches du droit.
Héritée du droit romain, la summa divisio distingue les domaines du droit public et du droit privé, tant au niveau du droit international que de celui du droit national (dit interne également). Le schéma suivant représente la division sur laquelle va se fonder et se structurer notre analyse.

Figure 1.Les branches du droit
L’analyse juritraductologique opère une distinction entre la traduction effectuée dans un contexte de droit international public, qu’elle dénomme traduction verticale, et la traduction réalisée de droit à droit qu’elle dénomme traduction horizontale. Si ces notions seront explicitées dans chacune des deux parties qui articulent cet article, il peut d’ores et déjà être apporté quelques précisions.
Au niveau du droit national, une subdivision apparait entre les diverses sous-branches (droit public, droit privé, voire droit mixte) dans lesquelles s’insèrent le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit pénal, le droit de la procédure, le droit fiscal, le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, etc., et dont la classification est propre à chaque ordre juridique. Ces strates sont autant de niveau de spécialité laissant présager un degré terminologique de plus en plus affiné.
Aux fins de notre démonstration, la problématique ici consiste à se demander si certaines branches et sous-branches du droit auraient développé une terminologie à plus forte charge culturelle que d’autres, rendant le transfert lexiculturel d’une langue et d’un droit à l’autre plus ou moins aisé. De l’analyse juritraductologique, il ressort que le transfert lexiculturel est plus ou moins complexifié, selon que la traduction porte sur le droit national ou sur le droit international.
2. TRADUCTION HORIZONTALE DU DROIT NATIONAL: UN TRANSFERT LEXICULTUREL COMPLEXIFIÉ
La traduction horizontale, à savoir de droit à droit, présente des caractéristiques qui s’inscrivent dans un large spectre de diversité de situations. Une présentation des caractéristiques de la traduction horizontale ou territorialisée (1) est un préliminaire nécessaire pour comprendre les raisons de la complexification du transfert lexiculturel (2). Enfin une illustration de la complexité du transfert lexiculturel sera apportée par des exemples de traduction de l’espagnol vers le français (3).
2.1. Caractéristiques de la traduction horizontale: une traduction territorialisée
La traduction horizontale est le processus de transfert lexiculturel d’un texte de droit d’un État en vue de restituer un énoncé dans le droit et la langue d’un autre État et libellé sous une forme intelligible (Monjean-Decaudin, 2010 p. 702). Il s’agit d’une traduction de droit à droit qui requiert un fort ancrage dans les cultures juridiques source et cible, telle que la figure ci-dessous l’illustre.

Figure 2.La traduction horizontale
La diversité des situations de production d’une traduction horizontale est telle qu’elle ne peut être décrite de manière exhaustive. Toutefois, une caractéristique principale se dégage de la traduction horizontale: elle est réalisée dans des contextes différents pour remplir une fonction dans l’ordre juridique d’un État. Elle relève de règles propres à l’État dans lequel elle est destinée à produire des effets. Que le donneur d’ordre soit une institution publique, un organisme privé, un professionnel du droit ou non, la traduction horizontale trouve sa raison d’être dans divers contextes de droit que nous illustrerons ici par trois exemples.
Tout d’abord, la traduction juridique peut être effectuée dans un contexte de droit international privé. C’est le cas dès lors que deux personnes de nationalités différentes se marient, ont des enfants, divorcent ou décèdent ou dès lors que deux entreprises de nationalités différentes établissent des relations d’affaires en signant, par exemple, un contrat de vente internationale de marchandise ou une cession de brevet2. La traduction a pour fonction de permettre de faire valoir des droits ou de faire reconnaître une situation juridique par une administration d’un État: l’autorité parentale sur des enfants mineurs, l’attribution successorale d’un bien, le non-respect d’une clause d’un contrat, etc.
Puis, la traduction peut intervenir dans un contexte scientifique et servir soit à connaître le droit étranger, soit à faire connaître son propre droit à l’étranger. Dans ce cas, elle porte sur des ouvrages doctrinaux mais également sur des textes normatifs (constitution, code, lois, etc.). Par exemple, les autorités publiques françaises ont fait traduire par Juriscope les codes français en langues anglaise et espagnole en vue de leur diffusion sur le site de Légifrance3. En outre, la traduction d’ouvrages rédigés en langue étrangère permet la divulgation des travaux en science juridique. Par exemple, les travaux de Kelsen ont été, entre autres, traduits en français, anglais, tchèque, hongrois, polonais et japonais. Une illustration du fait que nous vivons dans un monde traduit mais également que nous travaillons dans une science traduite et que la traduction est au service de la connaissance du droit.
Enfin, la traduction juridique peut également être effectuée dans un contexte judiciaire afin d’œuvrer à l’administration de la justice. Dans ce cas, elle permet soit le dialogue entre les autorités judiciaires des États comme dans le cadre de la traduction d’un mandat d’arrêt européen ou d’une commission rogatoire internationale, soit le dialogue entre l’autorité judiciaire et le justiciable qui ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure (Monjean-Decaudin, 2012, p. 37 et 123). La justesse terminologique, comme aboutissement du processus traductif, présente des enjeux notables en justice. «Or lorsqu’on sait par expérience qu’un seul mot est de nature à changer la face d’un procès, on perçoit l’acuité du problème» (Michaud, 1985, p. 267). En effet, «bien des batailles juridiques, bien des décisions judiciaires tournent autour de mots, voire de traductions, plus qu’autour de faits» (Groffier et Reed, 1990, p. 3). Les enjeux prennent davantage d’intensité quand la traduction est une garantie procédurale et de la qualité de celle-ci dépend le sort du justiciable.
La traduction horizontale est rattachée à une culture nationale territorialisée, le traducteur doit pleinement maîtriser les concepts juridiques source et cible convoqués par la traduction, d’où la complexité de sa réalisation.
2.2. Raisons de la complexification du transfert lexiculturel
L’une des difficultés majeures de la traduction horizontale réside dans le transfert lexiculturel qu’elle doit opérer. La compatibilité ou l’incompatibilité des droits convoqués lors de l’opération traductionnelle va être un facteur plus ou moins facilitant de la comparaison des concepts juridiques à traduire. Le découpage de la réalité juridique peut poser problème car l’angle de perspective et d’analyse est susceptible de varier d’un droit à l’autre. En outre, la langue juridique vient ajouter une difficulté supplémentaire, notamment en cas de variations linguistiques dans les langues parlées dans plusieurs États, comme cela est le cas de l’espagnol qui est la langue officielle ou co-officielle dans vingt-et-un pays. De fait, le droit et la langue espagnole diffèrent selon les ordres juridiques, ce qui est un facteur de complexification du transfert lexiculturel. En effet, la raison est historique et remonte à la source même du droit. Si le droit existe depuis la nuit des temps c’est-à-dire depuis que les sociétés existent, il n’en demeure pas moins que la science juridique est une création bien plus récente. Les Romains ont été les premiers à créer la science juridique en la conceptualisant, en la codifiant et en en organisant l’enseignement destiné à former les juristes. Et c’est à partir de là que, au fil du temps et des vicissitudes historiques de l’humanité, va naitre la subjectivité conceptuelle voire dogmatique du droit. Selon les cultures juridiques, des familles de droit émergent et des disparités de conceptualisation apparaissent, même si depuis le milieu du xxe siècle, le droit international public tend à mondialiser certains concepts (les droits humains, par exemple) et à harmoniser les cultures juridiques. Cependant, et à ce jour, la complexité du transfert lexiculturel perdure pour des raisons juridiques, c’est-à-dire du fait des divergences de conceptualisation des règles, et pour des raisons linguistiques, c’est-à-dire du fait de la manière spécifique que chaque droit a d’exprimer sa propre réalité juridique.
Par conséquent, traduire le droit s’avère être une tâche ardue car le droit n’est pas une science exacte. Le traducteur doit se prémunir de toute tentation de «juricentrisme» (Monjean-Decaudin, 2010, p. 704):
Le juricentrisme consiste à traduire coûte que coûte, au détriment de la culture juridique source, un terme ou un concept sans équivalence par un terme ou concept propre à son droit et à sa langue. Il s’agit de tirer à soi le droit étranger pour l’amener vers la terminologie ou le concept de son propre système de pensée juridique, dénaturant à la fois le droit source et la traduction. L’équivalence ainsi établie porte une empreinte culturelle juricentrée sans permettre de véritable transfert de sens.
2.3. Illustration de la complexité du transfert lexiculturel de l’espagnol vers le français
Afin de démontrer la complexité du transfert lexiculturel lors de la traduction de termes juridiques de l’espagnol vers le français, deux exemples de difficulté modérée seront présentés. Pour un exemple de difficulté maximale, il vaut mieux consulter le processus précis et mené par étapes pour la traduction de deux recours des procédures civile et pénale espagnole, le recurso de reposición et le recurso de reforma (Monjean-Decaudin, 2012, p. 327 s.).
Le premier exemple de difficulté modérée porte sur la traduction de deux termes espagnols apparaissant dans un retour de commission rogatoire internationale. Il s’agit des termes «exhorto» et «comisión rogatoria». La particularité qui peut constituer une complexité pour le traducteur profane du droit est que ces deux termes se traduisent de la même manière en français. Est cité, ci-dessous, l’extrait dans lequel ces deux termes apparaissent dans la même phrase:
En respuesta a EXHORTO dimanate de este Juzgado, de fecha 24 de enero de 2008, con n° de procedimiento 00038024/2007 y NIG 0000000220070034, referido a Comisión Rogatoria Internacional procedente del Tribunal de Apelación de Burdeos (Francia), se informa de lo siguiente: […]
Le terme exhorto est à utiliser dans le cadre de la procédure judiciaire sur le territoire espagnol. Il se réfère à la coopération que les organes judicaires, limités par leurs compétences territoriales respectives, peuvent se solliciter réciproquement afin d’obtenir l’exécution d’actes de procédure destinés principalement à l’obtention de preuves. Sa traduction en français est «commission rogatoire».
Résumé des informations
- Pages
- 344
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631906248
- ISBN (ePUB)
- 9783631906255
- ISBN (Relié)
- 9783631906231
- DOI
- 10.3726/b21895
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Septembre)
- Mots Clés (Keywords)
- Traduction juridique juritraductologie lexiculture droit comparé
- Publié
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 344 p., 10 ill. n/b, 13 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG