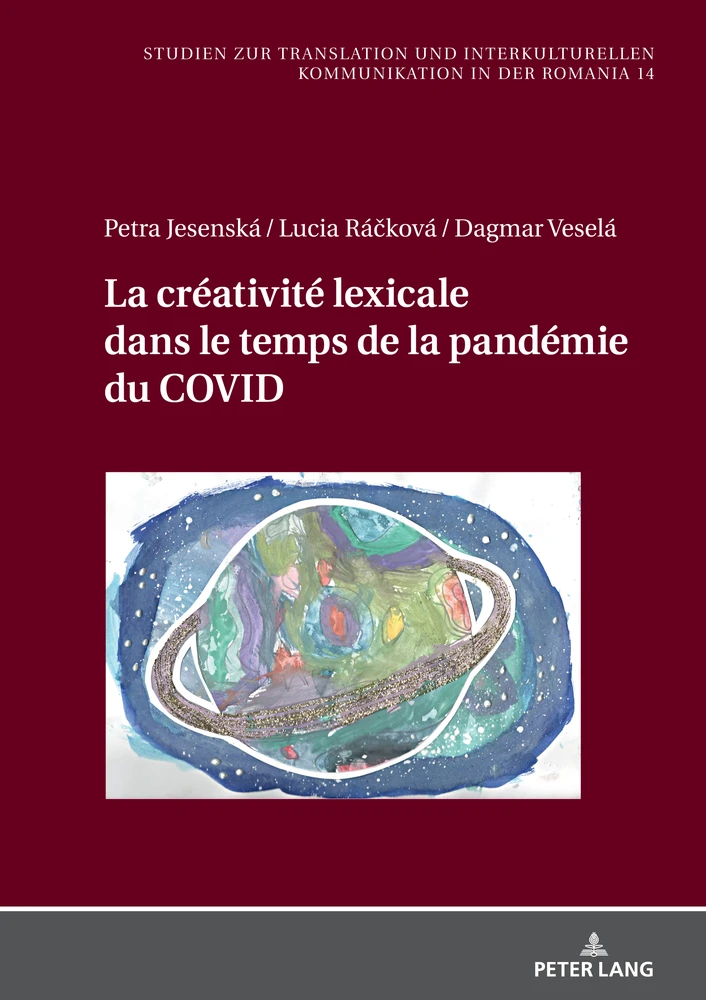La créativité lexicale dans le temps de la pandémie du COVID
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Préface
- Introduction
- Remarques méthodologiques transversales (Lucia Ráčková)
- 1. Les potentialités lexicales du discours médiatique sur la crise sanitaire dans la presse britannique. Le cas de Daily Telegraph (Petra Jesenská)
- 2. L’identification et la classification des néologismes dans le discours sur la crise sanitaire. L’exemple de Libération (Lucia Ráčková)
- 3. Le potentiel lexicogénétique des préfixes au sein des innovations linguistiques résultants de la crise sanitaire. Corpus Le Monde (Dagmar Veselá)
- Conclusion
- Table des matières
- Ind ex
Préface
La langue évolue avec les besoins de ses locuteurs, comme lʼa montré la pandémie de COVID-19. Face à une situation mondiale sans précédent, la communication a pris une importance vitale dans nos sociétés, entraînant lʼapparition de nombreux nouveaux mots. Pour sʼadapter rapidement, scientifiques, politiciens, journalistes et citoyens ont modifié leur manière de parler. Durant la première année, plusieurs néologismes sont apparus pour nommer cette nouvelle réalité. Certains mots se sont banalisés, d’autres, réactivés, ont gagné en usage, et certains se distinguent par leur expressivité. La langue s’est aussi intellectualisée, intégrant des termes spécialisés dans le langage courant par le biais de la déterminologisation. La crise pandémique de Covid-19 a donc aussi révélé l’importance de son potentiel néologique dans le domaine des médias amenés à rendre compte de cette situation inédite. Selon E. Reichwalderová & M. Blaschke (2023), beaucoup de ces mots ont déjà perdu le trait de nouveauté sous l’influence de leur utilisation active quotidienne. Certains néologismes, en revanche, apparaissent comme des mots revitalisés car leur emploi actif dans la pratique linguistique n’est intervenu qu’avec l’avènement de la nouvelle réalité.
La présente publication est le résultat du projet de recherche VEGA No.1/0748/21 « Le potentiel lexicogénétique du discours médiatique sur la crise », qui vise une étude contrastive des dispositifs linguistiques sélectionnés dans le discours contemporain sur la pandémie de coronavirus présent dans les communications médiatiques. Ce projet vient combler une lacune dans les études de cette grave crise sanitaire du point de vue lexical, en se basant sur la linguistique de corpus. Les éléments lexico-morphologiques sélectionnés présentent un intérêt en termes de caractéristiques productives, internationales et traduisibles. Le potentiel lexicogénétique des paradigmes préfixaux et suffixaux en français et en anglais est étudié avec une attention particulière pour les néologismes.
Dans ce cadre, le premier chapitre, rédigé par P. Jesenská, analyse les moyens linguistiques et les particularités sémantico-pragmatiques du discours politique sur la crise pandémique dans les médias britanniques. Il examine les paradigmes affixaux permettant de tracer et prédire l’évolution du lexique de crise, avec pour objectif d’analyser la créativité lexicale dans la formation de néologismes pendant la pandémie (2020-2022), en tenant compte des spécificités de chaque vague.
L’autrice du premier chapitre rappelle que la première vague de la pandémie de Covid-19 se produit en Europe à la fin de l’hiver (janvier / février) et au début du printemps (mars / avril) 2020. La deuxième vague survient en 2021 et la troisième arrive à la fin de l’année 2021 et au début de 2022. Les répercussions originairement liées aux mesures anti-pandémiques se font pourtant sentir même en 2023. Cette brève récapitulation est, d’après elle, nécessaire pour comprendre l’évolution de l’intérêt de la communauté académique à ce sujet (non seulement) du point de vue linguistique. Alors qu’en 2020, c’étaient plutôt la consternation, l’incertitude, la peur et l’improvisation qui prévalaient à différents niveaux (aspects sanitaires, mortalité élevée, confinement, impacts psychologique et économique sur la société, etc.), plus tard (en 2021 – 2022), des attitudes rationnelles prennent place afin de rendre la situation plus transparente sur le plan médiatique, médical, logistique, etc., notamment dans le cadre du développement des vaccins qui, une fois administrés, devaient permettre un retour rapide à la vie normale, d’avant la pandémie.
Avant d’arriver à l’analyse des expressions choisies, l’autrice s’est aussi donné pour objectif d’observer les approches différentes du lexique anglais du Covid que présentent les œuvres contemporaines de recherche scientifique dépassant le cadre de la linguistique générale par la tendance à une approche multidisciplinaire. Elle constate que dans la communauté académique internationale de chercheurs, il y a un intérêt prédominant pour le traitement de ce thème à travers l’optique pédagogico-didactique. La plupart des études s’intéressent au lexique pandémique du point de vue de la pratique pédagogique ou des impacts pour la pratique scolaire pendant la période d’enseignement et d’apprentissage à distance.
Dans l’environnement académique slovaque, de plus en plus d’experts prêtent attention à la communication de crise, même si on voit encore un large terrain à explorer, y compris celui d’une classification du lexique anglais qui proposerait des liens interdisciplinaires vers la sociolinguistique et la pragmalinguistique. Le lexique du Covid dans l’espace médiatique slovaque et anglophone sur un fond comparatif et contrastif reçoit quand même l’attention de certains chercheurs (par exemple Genčiová & Jesenská, 20234337762_Cho_Eng).
Dans le cadre des débats linguistiques, il existe une controverse sur le degré de dynamique des néologismes covidiens au niveau lexical de la langue. Fondamentalement, deux points de vue conflictuels et complémentaires dominent. Le premier est celui qui défend l’idée d’un degré élevé de la dynamique sous la forme de plus de 1 000 unités lexicales générales et spécialisées nouvellement formées dans la langue anglaise (par exemple, Roig-Marín, 2020). La langue anglaise, par une contextualisation actuelle, revitalise des expressions déjà familières telles que face mask, lockdown ou social distancing. Parallèlement, de nouvelles expressions, reflétant la situation de crise, entrent dans la langue. Les expressions spécialisées en anglais sont largement basées sur un arrière-plan gréco-latin. Il n’en a pas été autrement dans le contexte du Covid (par exemple, le terme coronavirus lui-même, était déjà connu dans les années 1960). Le linguiste et lexicographe britannique T. Thorne (2020) observe, pendant la situation pandémique, un certain tournant dans l’approche de la langue, qui consiste à combler les lacunes dans des discours officiels afin d’exprimer des idées en utilisant des expressions qui n’auraient pas été acceptables dans le discours public avant l’ère du Covid, notamment « des surnoms, du jargon, de l’argot, des abréviations, des jeux de mots et des expressions idiomatiques nouvellement inventées » (Thorne, 2020) ou des clichés établis. T. Thorne collecte et catégorise le lexique du Covid depuis 2020. Par sa méthode, il couvre l’orthographe, la sémantique et la sémiotique, y compris les néographies électroniques (virtuelles et hybrides) spécifiques pour la communication par Internet (hashtags, abréviations, majuscules, etc.) : BCV (Before Covid), #Coronatimes (un hashtag sur les réseaux sociaux pour désigner la pandémie) illustrent lʼapparition de nouveaux termes liés à la crise sanitaire. P. Jesenská observe aussi les mécanismes de création lexicale. Par exemple, The Guardian a utilisé « Coronaverse » pour décrire lʼordre socio-économique, et lʼOTAN a désigné le virus comme « Common invisible enemy ». T. Thorne (2020) mentionne dʼautres termes basés sur « corona », comme « Coronasplaining » (expliquer la crise à ceux qui la maîtrisent mieux) et « Coronaspiracy theories » (théories du complot autour du Covid-19), ainsi que sur « Covid » (covidiots, Covid marshals). Il souligne aussi lʼévolution lexicale entre 2020 et 2022.
Quant à l’approche de l’autrice, elle a étudié la présence du lexique néologique lié au Covid principalement dans le périodique britannique The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk), qui est considéré comme un quotidien national traditionnel avec une portée internationale, caractérisé par un journalisme de qualité et objectif. Le journal mentionné a créé, au moment de la crise sanitaire mondiale, une section distincte nommée Coronavirus, où on regroupait toutes les informations sur la pandémie et des questions connexes. P. Jesenská et A. Genčiová (2023) ont décelé au total 59 200 contributions liées à la problématique du Covid dans le journal en question.
P. Jesenská a ensuite observé trois vagues de pandémie au cours de la période d’étude 2020-2022, en fonction desquelles elle a extrait les données pour son analyse.
Dans le cadre du thème principal de la présente publication, la première des trois auteures a expliqué et synthétisé les notions de base longuement discutées dans le domaine de la formation des mots ainsi que celles liées à la motivation de la formation de néologismes en anglais ; l’instabilité de la perception de l’affixe et de l’affixoïde dans le paradigme de la dynamique de l’enrichissement lexical de la langue dans le contexte des pratiques productives de formation de mots en anglais contemporain en ce qui concerne la création de néologismes liés au lexique de la crise, à savoir par exemple si le morphème corona est plutôt un affixe (concrètement un préfixe, et donc un morphème fonctionnel libre) ou bien une base de formation indépendante à partir de laquelle on dérive.
Le deuxième chapitre de la publication se concentre sur le discours médiatique de la crise sanitaire (2020 – 2020) présenté dans le quotidien Libération qui, d’après une étude de E. Cartier, J.-F. Sablayrolles & al. (2018 : 10), a décelé un grand nombre de néologismes (seconde place parmi les journaux français les plus productifs des néologismes, précédé seulement par L’Express).
Tout d’abord, l’autrice évoque la question des unités lexicales dorénavant peu utilisées qui se sont réintroduites dans le lexique sur la crise sanitaire, avec un sens modifié ou élargi. Cet aspect de l’actualisation du sens jouera un grand rôle dans l’identification et dans la classification des néologismes analysée par l’autrice.
Ensuite, elle présente également l’état des lieux de la recherche sur le lexique de la crise du Covid-19 et cela dans l’espace francophone (Benabid & Kethiri, 2021 ; Atcero, 2023) et dans d’autres études dans le monde rédigées en français. Elle met en avant de nombreuses études réalisées dans la revue italienne Repères-Dorif (Favart & Silletti (drs.), 2021, Altmanova, Murano & Preite (dirs.), 2022).
Le cadre théorique et méthodologique de sa recherche suit deux objectifs principaux : le premier permet d’identifier et de classifier des néologismes dans le discours médiatique contemporain français sur la crise sanitaire et le deuxième propose l’analyse du potentiel créatif des affixes (préfixes et suffixes) quant à la formation des néologismes dans le cadre de ce même discours.
Dans la partie analytique, l’autrice entame sa propre réflexion à partir des vingt mots-clés tirés de son propre corpus Libération sélectif, enregistré dans Sketch Engine, un outil d’analyse informatique de textes procurant de précieuses informations statistiques. Comme le tri des potentiels néologismes est nécessaire, elle en collecte un échantillon qui éclaire les procédés léxicogenétiques mis en question. Elle distingue, dans une première étape, les néologismes des apparitions trompeuses et cela non grâce au sentiment subjectif de néologicité, mais en s’appuyant sur les dictionnaires de référence (Dictionnaire de l’Académie française (9e la plus actuelle version, 2023, en ligne), Dictionnaire Le Robert et Le Trésor de la Langue française informatisée) et sur un dictionnaire étymologique (Mathieu-Rosay, 1985).
L’autrice analyse presque 200 unités lexicales. Quant aux hypothèses de sa recherche, elle essaie de voir si le plus grand nombre des néologismes dans le discours médiatique sur la crise sanitaire est représenté par les emprunts à l’anglais ; si (pour former des néologismes) la préfixation est plus productive que la suffixation ; si le préfixe le plus productif sera le préfixe re- (et cela tant pour les verbes, que pour les substantifs) et si parmi les néologismes originaux français, les néologismes de sens seront plus nombreux que les néologismes de forme.
L’autrice du troisième chapitre se fixe trois objectifs principaux. En travaillant sur les articles de presse issus du Monde, elle vise à identifier et classer les néologismes, en particulier ceux formés à l’aide du fractolexème corona, et ceux comportant l’élément Covid. Elle examine ensuite le potentiel lexicogénique des préfixes dans l’ensemble des néologismes répertoriés. Enfin, elle met un accent particulier sur l’importance des anglicismes dans les innovations linguistiques résultant de la crise sanitaire. Dans sa recherche, en complément des dictionnaires de référence, elle s’appuie sur les bases de données France Terme et Termium Plus qui représentent pour elle un corpus d’exclusion. La linguiste établit plusieurs hypothèses. Elle suppose d’abord qu’une proportion considérable des lexies contiendra les fragments Covid ou corona dans leurs dénominations. Elle estime de même que des gens ordinaires participeraient à la désignation de nouveaux phénomènes associés à la crise du Covid-19, mais que leurs “créations” seraient éphémères et n’entreraient donc pas dans les dictionnaires. Ensuite, elle se demande si les préfixes dé-/dés et re/ré présentent un niveau élevé de productivité dans la création des néologismes. Finalement, elle ose croire que les emprunts à l’anglais ne seraient pas dominants dans le contexte des nouveaux besoins de dénominations associés à la pandémie du Covid-19 et que la langue française ferait brillament face aux besoins de dénotation de nouvelles entités générées par la crise pandémique. L’autrice se demande aussi comment les dictionnaires de langue française ou terminologiques et les bases de données terminologiques réputés réagiraient à l’afflux exceptionnellement rapide de néologismes au cours de la période 2020-2022, quels procédés (matrices léxicogéniques) et préfixes s’avéreraient les plus productifs dans la création néologique.
Dans les parties et sous-parties de ces trois chapitres, la lexicologue dresse un état des lieux des recherches dans le domaine du lexique français néologique présent dans le discours médiatique sur la crise pandémique. Elle détaille ensuite les procédés de formation des mots, les outils de la linguistique de corpus et les critères qu’elle a utilisés pour l’identification et la classification des néologismes, ainsi que pour l’analyse du potentiel lexicogénétique des préfixes. Dans le chapitre analytique, l’autrice présente son corpus de recherche et explique avec précision la démarche suivie pour atteindre chaque objectif, basée sur l’utilisation des méthodes de linguistique de corpus, en travaillant avec l’outil Sketch Engine, les dictionnaires et les bases de données mentionnés plus haut. Les données obtenues lui permettent de réaliser une analyse contenant des informations de nature linguistique mais aussi encyclopédique, étayée par des tableaux synthétiques documentant la dynamique présente dans le lexique du français et démontrant la réalisation de lexies nouvelles mais également existantes dans le discours sur la crise au cours des trois vagues pandémiques. Par conséquent, ceci lui permettra d’obtenir une image plus claire des changements au niveau du lexique français et des préférences relatives aux moyens langagiers utilisés au cours de la crise sanitaire pandémique.
Pour effectuer sa recherche, l’autrice se sert, comme les deux autrices précédentes, du logiciel Sketch Engine où elle utilise la fonctionnalité Liste de mots lui permettant de récupérer des listes de fréquence mots, noms, verbes, morphèmes ou mots contenant certains morphèmes à partir du corpus sélectionné. Dans le cadre d’une sélection restreinte, dans son cas aux unités contenant le fragment Covid ou corona, elle a ainsi pu établir des listes de fréquence d’unités lexicales formées sur la base des éléments ci-dessus, la fréquence absolue exprimant le nombre de fois que les mots saisis sont apparus dans le corpus. Ensuite, à l’aide de l’outil Concordancier, elle est arrivée à des exemples d’usage des mots relevés en contexte, ce qui lui a permis de retracer les collocats les plus fréquents. Les exemples d’usage concrets où les unités étudiées apparaissaient en contexte lui ont souvent permis de découvrir leur sens grammatical et lexical.
Details
- Pages
- 286
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631913864
- ISBN (ePUB)
- 9783631913871
- ISBN (Hardcover)
- 9783631913857
- DOI
- 10.3726/b22548
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (March)
- Keywords
- affixe anglicisme conversion déterminologisation discours médiatique formant fractolexème lexique du Covid motivation lexicale néologisme occasionalisme potentiel lexicogénétique préfixation préfixe suffixation suffixe troncation
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025., 286 p., 9 ill. en couleurs, 22 ill. n/b, 67 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG