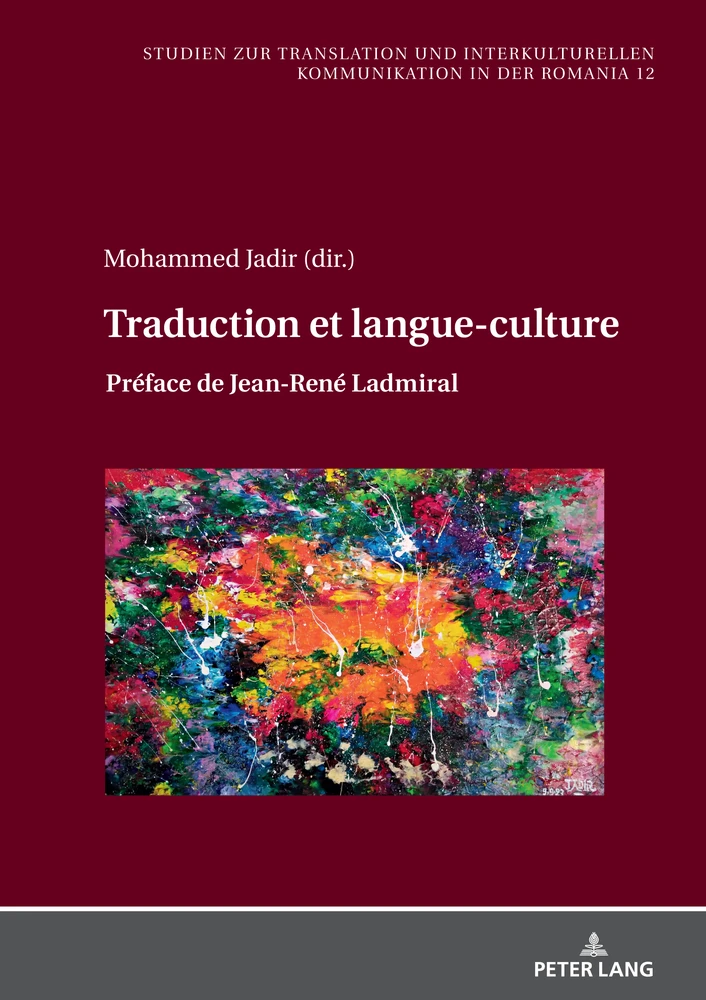Traduction et langue-culture
Préface de Jean-René Ladmiral
Summary
Dans le présent volume sont réunies des contributions qui illustrent diverses perspectives de cette problématique, en faisant appel à près d’une vingtaine d'auteurs relevant de cultures et de langues différentes, mais aussi de différents domaines de l'expérience de traduire. On y trouvera des approches littéraires à même d’apporter des éclairages touchant le plurilinguisme, voire certaines dérives idéologiques, et aussi des approches linguistiques, psychiques, sociologiques et praxéologiques du traduire. Sont prises en compte aussi plusieurs langues, et pas seulement le français, l'anglais et l’arabe.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Préface
- IntroductionLangue-culture et traductionOrdre adéquat ou à inverser ?
- Aspects psychiques, sociologiques et praxéologiques du traduire
- Le texte a-t-il une voix ?
- Les (re)traductions paradoxales Complexité des lieux du sens
- Praxéologie et génétique du traduire La critique proustienne de Bernard de Fallois en italien
- Traduire les culturèmes
- Le bel original et la traduction idéale ou qu’en est-il de la traduction des culturèmes à l’heure de la culture de l’annulation ?
- Traduire les culturèmes dans la littérature marocaine d’expression française
- Intercultural Links in Irish Poetry Soviet Women and the Troubles
- Linguaculture du monde présenté et ses enjeux dans la traduction littéraire
- Guerre de Céline. Enjeux sémantiques sous la loupe d’une traductrice italienne
- Traduire le multilinguisme
- Le multilinguisme dans Madame Orpha de Gevers et ses traductions en néerlandais et en allemand
- L’humour multilingue au service du débat linguistique au Québec. L’exemple des spectacles bilingues, francophones et anglophones de Sugar Sammy
- Traduction de la littérature belge francophone. La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné : quels choix de traduction, en espagnol et en italien, pour ce texte « féministe » ?
- Textes instructifs expliquant le coronavirus aux enfants. Différences culturelles et linguistiques entre les médias français et allemands
- (In)traduisibles littéraires, musicaux et audiovisuels
- Littérature migrante et intraduisibilité. Les exemples de Brick Lane de Monica Ali et de White Teeth de Zadie Smith
- “What’s in a name?” Translation of Terry Pratchett’s novel titles into Russian
- La traduction des anthroponymes – Un métadiscours des infidélités (non-)nécessaires
- The Girl from Two Countries. Translating Dylan, between Minnesota and Musical Memoryscapes
- Traduction d’unités phraséologiques en traduction audiovisuelle
- Auteur.e.s
- Du même auteur
Jean René Ladmiral
Préface
« Le premier instrument du génie
d’un peuple, c’est sa langue »
Stendhal
Langue, culture et traduction : dans ce triangle conceptuel, la traduction est le concept thématique, c’est-à-dire celui qui nous occupe; mais il est clair que les deux autres y sont intimement impliqués. Bien plus, ces deux derniers paraissent inséparables: pas de culture sans langue, qui en est le support ; pas de langue sans culture, qui vient la nourrir. Au point qu’on est porté à fusionner ces deux concepts en un seul.
Ainsi Henri Meschonnic avait-il mis en avant la formule globalisante de culture-langue. Quant à moi, j’ai pris d’emblée le contre-pied de cette proposition en thématisant le concept de langue-culture. Je suis donc très satisfait que Mohamed Jadir ait choisi de reprendre ce concept pour l’intitulé du présent volume et qu’il m’ait fait l’amitié de me demander de le préfacer. Si j’ai tenu à contester l’idée de culture-langue et à inverser l’ordre des deux termes qui s’y trouvent accolés, c’est pour des raisons de fond.
La première raison est que l’idée de culture-langue renvoie tendanciellement au vaste domaine de l’ethnologie que, sous l’influence de la terminologie anglo-saxone, on appelle l’anthropologie culturelle. Ce qui appelle à mes yeux deux ou trois réserves. D’abord : la pensée du regretté Henri Meschonnic, mon ami personnel et adversaire théorique, débouche sur une anthropologie in nuce qui est foncièrement surdéterminée par des prises de position idéologiques et politiques que je critique radicalement. Surtout : la hiérarchie syntagmatique adoptée pour le binôme culture-langue tend à mettre l’accent sur la culture en la globalisant, en sorte que la langue y ferait figure de prolongement particulier. Ce n’est pas faux, mais c’est un point de vue partiel et contestable.
Enfin, d’une façon générale, il convient de ne pas verser dans un culturalisme qui tend à prendre l’ampleur d’un principe d’analyse universel et totalisant, et qui nous entraînerait bien au-delà de notre propos ; au reste, le culturalisme est rarement exempt de connotations idéologiques diverses et il en vient au bout du compte à masquer en partie ce qu’il avait vocation de révéler.
Plus concrètement, il y a aussi ce qu’on pourrait appeler un culturalisme méthodologique qui voudrait identifier la traduction à la communication interculturelle. C’est là une vision tout à fait superficielle, qui correspond à une sorte de mode. De fait, la communication interculturelle désigne un ensemble beaucoup plus large que la traduction et, inversement, tous les aspects de la traduction ne relèvent pas nécessairement de la communication interculturelle. Il y a plus : ce sont deux champs d’étude, certes connexes, mais bien distincts. À titre personnel, j’ai été amené à développer là deux axes de publications spécifiques parallèlement au sein de mes propres recherches ; et ce, même si encore une fois il existe de nombreux points de contact concrets et particuliers entre ces deux domaines.
S’agissant donc de la traduction, il convient encore une fois d’inverser la perspective inhérente au culturalisme et de préférer le concept de langue-culture à celui de culture-langue. En traduction, on part de la langue, des langues, auxquelles la culture ne fait qu’apporter le complément d’éléments circonstanciés qui viennent s’attacher à tel ou tel item linguistique (et qu’on pourra étiqueter comme des « culturèmes »). Cela dit, ce n’est pas qu’une question de mots et c’est pour des raisons précises que je donne toute son importance au concept de langue-culture au sein de la présente entrée en matière.
Quand j’ai proposé ce concept de langue-culture, il y a quelques décennies déjà, je me trouvais m’inscrire avant l’heure dans le mouvement général de ce qui allait devenir le tournant culturel de la traduction et de la traductologie, mais sans minimiser l’importance du facteur linguistique au profit d’un culturalisme envahissant. Il reste qu’on ne traduit pas un texte seulement d’une langue-source (Lo) dans une langue-cible (Lt), mais que la traduction opère un transfert d’une langue-culture (LCo) à une autre langue-culture (LCo).
Plus récemment, est apparu dans ce contexte le concept de culturème, dont il est à bon droit fait amplement usage dans les pages qui suivent. Il est clair que cette notion de culturème est un apport précieux à l’arsenal conceptuel de la traductologie. De fait, il nous donne la monnaie de la problématique du tournant culturel, tout en permettant de maintenir un lien étroit avec la langue. Il y a même lieu d’y discerner une analogie méthodologique avec la linguistique, comme l’indique la terminaison du mot culturème qui rime avec des termes de cette discipline comme phonème, morphème, lexème, etc.
Parallèlement à la double articulation (linguistique), par quoi André Martinet définit ce qu’est une langue, il y a donc lieu de distinguer le prolongement d’une articulation spécifique des éléments culturels. Ainsi sera-t-on amené souvent à circontancier un contenu culturel ponctuel à tel ou tel item linguistique, qu’il s’agisse d’un énoncé ou d’un simple mot, voire d’un syntagme plus ou moins figé, ou même de tout un texte. Au reste, cela vaut pour toute communication quelle qu’elle soit (et pas nécessairement pour la communication interculturelle), mais aussi bien sûr tout particulièrement pour ce cas remarquable de la communication entre langues-cultures que constitue la traduction.
Entre temps, j’avais thématisé le concept de périlangue qui lui aussi contribuait par avance à donner un contenu concret audit tournant culturel, mais pas que (comme on dit maintenant). J’entends par périlangue les éléments de savoir non linguistique implicitement présupposés dans l’usage qu’on fait d’une langue. Il s’agit bien sûr d’abord de données culturelles sédimentées dans la langue comme connotations sémantiques (ou pragmatiques). Cela rejoint le fameux « bagage culturel » sur lequel insistent les auteurs de la théorie interprétative de la traduction (T.I.T). Dans cette logique, le contexte socio-politique, ethno-civilisationnel et historique vient prolonger la dimension proprement culturelle du problème.
Mais, outre ces culturèmes et implicites culturels, qui relèvent très directement de la langue-culture elle-même, il y a aussi des éléments de substrat référentiel qui se trouvent véhiculés tacitement par la langue et que mettent en œuvre certains énoncés. A quoi on pourra ajouter certains traits comportementaux. C’est plus généralement la question des realia. Ce terme a été repris dernièrement par certains auteurs russes et bulgares, qui l’ont traduit en traductologie en le rabattant sur le culturel.
Contre quoi, j’objecte qu’en toute rigueur terminologique, il convient de garder au concept de realia l’acception plus large qui lui revient puisqu’aussi bien il s’agit de tout ce qu’implique un énoncé, au-delà de la langue-culture en elle-même. Il y a là toute une problématique qui trouve son origine dans la lexicographie, ce qu’on a trop tendance à méconnaître. Sans parler du statut morphologique du terme qu’on ignore allègrement…
La langue-culture est aussi le contexte au sein duquel vient s’inscrire le sujet et sa créativité. En traduction, cette dernière prend le visage des deux modalités d’une double auctorialité : celle du traducteur, mais aussi et d’abord celle de l’auteur proprement dit qu’il s’agit de traduire. Il reste que le traducteur est co-auteur ou réécrivain.
Corollairement, un certain comparatisme inhérent à la traductologie prendra pour objet d’analyse concrète et d’investigation théorique les œuvres littéraires, ainsi que des textes moins spécifiquement littéraires. Plus fondamentalement, on voit resurgir sous divers aspects la problématique immémoriale du littéralisme en traduction, qui met en jeu l’opposition entre sourciers et ciblistes. Avec la traduction, c’est l’astreinte à la matérialité textuelle du signifiant qui se trouve mise en cause. Du même coup, la question sémiotique du statut du texte lui-même est à l’ordre du jour. Plus profondément, cela pose le problème philosophique (et même théologique) de notre rapport à l’écrit…
Inutile d’insister sur le fait que dans la relation qui se noue entre Traduction et langues-cultures, ces dernières sont nécessairement au pluriel. Pour en revenir à un niveau proprement élémentaire, il apparaît qu’il y a une diffusion culturelle minimaliste venue se sédimenter jusqu’au sein des fonctions strictement linguistique desdites langues-cultures. C’est ce qu’il nous est loisible de discerner dans le foisonnement phraséologique très diversifié selon les langues ou dans l’idiomacité de leurs sémantiques respectives, démultipliés par la stylistique de l’écriture. Et puis a contrario il y a le défi auquel les noms propres figurant dans le texte-source confrontent le traducteur…
Par ailleurs, si les langues-cultures se rencontrent lors des rendez-vous où les convoque la traduction, il n’est pas moins vrai qu’elles s’entrechoquent aussi dans le champ clos où s’affrontent des identités en conflit. Elles ouvrent un espace où s’entremêlent et se combattent propagande et publicité, prosélytisme et conversions, migrations et métissages… — tout le tumulte des hommes et de leurs sociétés. Entre elles, la traduction jette les passerelles, nécessaires mais toujours fragiles, d’une médiation entre les hommes, leurs passions, leurs intérêts et leurs ambitions. Tant il est vrai qu’il n’est pas rare qu’on meure pour sa langue et pour sa culture.
Je conclurai en remerciant Mohammed Jadir de m’avoir demandé une préface pour ce beau livre, qui réunit plusieurs de celles que je me plais à appeler « mes filles » parce qu’elles ont été plus ou moins mes élèves, mais qu’ayant « grandi » elles sont devenues elles-mêmes des collègues, universitaires et chercheuses, ayant une carrière à elles et surtout une œuvre en cours — sans que pour autant elles en oublient leur vieux maître, auquel elles me font la grâce de leur fidélité intellectuelle et amicale. Outre « mes filles », je retrouve ici des amis et des amies que j’estime, et puis quand même quelques inconnu(e)s que ce m’a été un plaisir de découvrir. J’ai pris soin de ne citer nommément aucun des contributeurs de ce concert traductologique pour éviter que ma préface prenne l’apparence d’un palmarès sélectif, nécessairement subjectif et aléatoire même si on pourra y lire plusieurs références en filigrane… C’est à Mohammed Jadir qu’il revient, dans son Introduction, de présenter en bon maître de maison l’ensemble des invités qu’il a ici réunis. Toujours est-il qu’à mes yeux ce livre prend un peu des allures de réunion de famille, mais d’une famille qui pense, qui écrit et qui, heureusement en l’espèce, publie… En un mot : merci et bravo !
Mohammed Jadir
Introduction Langue-culture et traductionOrdre adéquat ou à inverser ?
Le présent ouvrage Traduction et langue-culture réunit les contributions d’éminents chercheurs et penseurs en matière de traduction et de traductologie qui ont témoigné d’une extrême obligeance en répondant à la problématique qui leur avait été soumise et qui se rapporte au degré d’interconnexions entre les concepts thématiques de « traduction », de « langue » et de « culture » à partir de leur pratique traduisante (ego) ou de leur analyse de l’expérience de traduire d’autres praticiens du métier (alter). Quel rapport entretient la langue avec la culture ? Un rapport d’annexion, de domination et de subordination ou un rapport d’égalité ? La langue est-elle reléguée au rang d’un simple prolongement du paramètre culturel ? La culture étant supposée souvent être co-déterminée par un substrat idéologique et politique. Dans son opération traductive, le traducteur, en tant que médiateur culturel, est-il tenu d’observer le principe « d’ethicité » (Berman, 1999) ou, étant co-auteur, se permet-il des libertés dans son travail sur les deux langues et cultures en contact puisque sa tâche consiste à « briser les barrières vermoulues de sa langue » (Benjamin, 2000 : 259) ?
Le volume compte quatre parties, chacune d’elles consiste en un bon nombre d’études développant quelques aspects pratiques et/ou théoriques de la problématique du transfert linguistique et culturel en traduction. Plus précisément, les contributeurs, issus des quatre coins du globe (Allemagne, Italie, France, Belgique, Roumanie, Maroc, Russie, Pologne, Espagne et Canada), ont mené des réflexions sur des questions ayant trait aux aspects psychiques, sociologiques et praxéologiques du traduire, aux difficultés de traduction des culturèmes et du multilinguisme et, enfin, aux problèmes de l’(in)traduisibilité dans les domaines littéraire, musical et audiovisuel. Je voudrais rappeler, au passage, que le présent ouvrage s’inscrit dans la continuité des productions scientifiques de notre laboratoire ‘Langues, Littératures et traduction’ (LALITRA) que j’ai l’honneur d’initier et de diriger1.
Le titre initialement conçu pour le manuscrit et proposé aux participants est Langue-culture et traduction, mon hypothèse étant que, sans une connaissance approfondie des deux langues source et cible, doublée d’un savoir encyclopédique propre au champ disciplinaire du texte objet du traduire, le processus traductif serait voué à l’échec. Au reste, quand j’ai soumis ledit titre à Jean-René Ladmiral, dans le cadre de nos échanges et concertations réguliers, il m’a suggéré, philosophe qu’il est, de procéder à l’inversion de l’ordre des deux éléments coordonnés. Son argument est que le concept de « traduction », qui est « familier » au récepteur, le préparera à accueillir favorablement celui de « langue-culture » qui lui est moins familier (étrange). Résultat : Traduction et langue-culture. Mon acceptation se voit motivée par plusieurs raisons qui sous-tendent ce nouveau titre, ou, mieux dit, par trois principes universels qui président aussi bien à la production qu’à la stratégie des discours et gouvernent l’interaction verbale.
Avant d’aborder ces principes, j’aimerais rappeler une première inversion de l’ordre en matière du complexe conceptuel thématique de notre titre « langue-culture », découverte lors de la lecture de la Préface dont Jean-René Ladmiral m’a fait honneur en la préparant pour le présent volume : « Ainsi Henri Meschonnic avait-il mis en avant la formule globalisante de culture-langue. Quant à moi, j’ai pris d’emblée le contre-pied de cette proposition en thématisant le concept de langue-culture. » Ladmiral revendique la paternité du concept (« Quand j’ai proposé ce concept de langue-culture, il y a quelques décennies déjà ») qu’on conférait à Meschonnic depuis les années 70 et explique que l’inversion à laquelle il a procédé a été largement motivée (« Si j’ai tenu à contester l’idée de culture-langue et à inverser l’ordre des deux termes qui s’y trouvent accolés, c’est pour des raisons de fond2. »)
Ladmiral critique l’anthropologie culturelle qui est sous-tendue par des positions idéologiques et politiques. Il conteste également la hiérarchie syntagmatique dégagée de la structure positionnelle culture-langue qui focalise la culture en secondarisant substantiellement la langue qui fait office de satellite. Une telle attitude verse, selon le traductologue, dans un culturalisme idéologique et méthodologique qui tend à une identification de la traduction à la communication interculturelle. Je signale au passage que Ladmiral avait thématisé, dans ses Théorèmes (1979), le concept de périlangue dans le cadre d’une dilatation du concept saussurien de langue pour couvrir toutes les présuppositions de son champ socio-culturel. Il visait à « faire place au substrat référentiel, voire à certains traits comportementaux qui accompagnent les énoncés des locuteurs- source. » (ibid., p. 61).
À l’image de la dichotomie culture-langue, instaurée en traductologie, une dichotome parallèle lui fait écho en linguistique. Dans les théories fonctionnelles, on adopte l’hypothèse selon laquelle la description de la structure des langues naturelles ne peut s’effectuer que si ladite structure est reliée à la fonction de communication. Dans les théories formelles, la langue est considérée comme un système abstrait dont la fonction principale est « l’expression de la pensée ». Aussi les propriétés linguistiques de ce système peuvent-elles y être traitées indépendamment de sa fonction communicative.
Étant donné que l’ordre des constituants d’une structure donnée n’est jamais arbitraire, il est pragmatiquement orienté par des buts communicationnels déterminés, les arguments fournis par Jean-René Ladmiral, pour contester le culturalisme et la relégation du linguistique au statut d’un simple prolongement du culturel, s’apparentent aux arguments avancés pour appuyer la pertinence de l’opposition sourcier/cibliste qui a enrichi les autres oppositions antinomiques traductologiques (verres colorés vs verres transparents [Mounin, 1955], équivalence dynamique vs équivalence formelle [Nida, 1964], domestication vs étrangéisation [Venuti, 1995], etc.). Plus précisément, les sourciers s’inscrivent dans une ethnologie de la littérature qui donne lieu à des textes exotiques en langue-cible et les ciblistes visent une esthétique de la traduction qui produit des effets sémantiques équivalents aux effets-sources.
Pour Meschonnic (1973), la traduction « fonctionne texte », elle est l’écriture d’une lecture-écriture, un décentrement, un rapport textuel entre deux textes dans deux langues-cultures que l’annexion efface. Meschonnic (ibid., 309) conteste l’illusion de la transparence en traduction qui transpose l’idéologie dominante valorisant un signifié linguistique transcendantal « (projection philosophique du primat européocentrique, logocentrique, colonialiste de la pensée occidentale) ».
Details
- Pages
- 332
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631899496
- ISBN (ePUB)
- 9783631899502
- ISBN (Hardcover)
- 9783631899489
- DOI
- 10.3726/b21483
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (September)
- Keywords
- traduction traductologie linguistique langue culture linguaculture communication interculturelle décentrement anthropologie culturelle culturèmes multilinguisme diglossie ethnocentrisme,culturalisme annexion illusion de la transparence tournant culturel
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 332 p., 5 ill. n/b, 8 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG