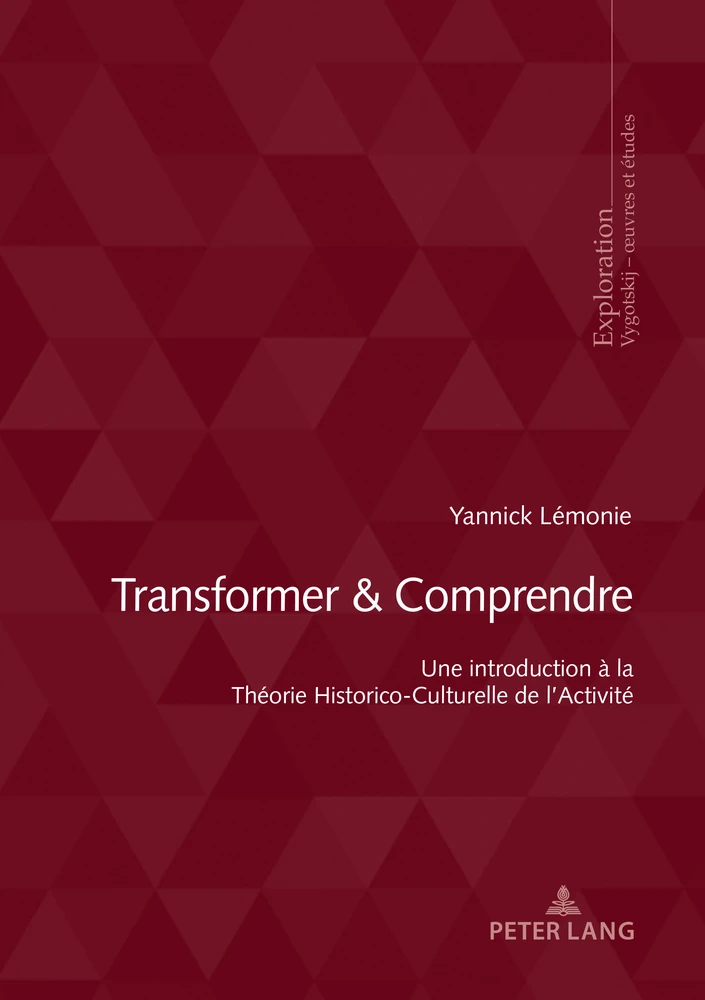Transformer & Comprendre
Une Introduction à la Théorie Historico-Culturelle de l’Activité
Résumé
Ce livre en retrace dans une première partie les développements successifs depuis les travaux des psychologues soviétiques du XXe siècle jusqu’aux développements plus récents. Il propose dans une deuxième partie un éclairage sur les concepts clés et leur mobilisation dans la recherche. Il décrit enfin dans une troisième partie les perspectives d’intervention orientée vers la transformation des systèmes d’activité en expliquant les principes méthodologiques des interventions formatives et du laboratoire du changement.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Préface : L’avenir de la théorie de l’activité est en marche par Yrjö Engeström
- CHAPITRE 1: Introduction. Unité et diversité de la Théorie Historico-Culturelle de l’Activité
- Qu’est-ce que la théorie historico-culturelle de l’activité ?
- Les difficultés d’appropriation de la THCA
- Une ou plusieurs théories de l’activité ?
- L’ancêtre de la théorie historico-culturelle de l’activité : les thèses sur Feuerbach
- L’activité comme processus collectif de transformation
- Positionnement de l’auteur
- Structuration de l’ouvrage
- PARTIE 1 : QUATRE GÉNÉRATIONS DE LA THÉORIE HISTORICO-CULTURELLE DE L’ACTIVITÉ
- Introduction de la première partie
- CHAPITRE 2: La première génération de la THCA et la révolution Vygotskienne
- Les principales étapes scientifiques de la carrière de Vygotsky
- L’approche historico-culturelle de l’activité de Vygotsky : un point d’appui pour des développements ultérieurs
- La nécessité d’une expansion de l’unité d’analyse ?
- CHAPITRE 3: La deuxième génération de la THCA : les travaux de Leontiev
- Quand la théorie historico-culturelle devient la théorie de l’activité : « Kharkov School »
- Les étapes de la formation du concept d’activité chez Leontiev
- Les traits spécifiques de l’activité humaine chez Leontiev
- L’activité humaine est collective. la multiplicité des interprétations de l’exemple de la chasse
- La structure hiérarchique de l’activité humaine
- Le rapport des actions à l’activité
- Les rapports des opérations aux actions
- Le double caractère dynamique du développement de l’activité
- Les apports de Leontiev à la THCA
- Quelques critiques à l’approche de Leontiev
- CHAPITRE 4: La troisième génération de la THCA : du développement du psychisme au développement de l’activité chez Engeström
- Contexte : La difficile transformation des pratiques enseignantes
- Une réponse au cognitivisme dominant
- L’activité collective comme unité d’analyse
- Le système d’activité
- L’incomplétude du modèle d’activité et son caractère idéal typique
- La dimension dynamique d’un système d’activité
- Quatre usages du système d’activité
- Extension vers la troisième génération de la théorie de l’activité
- Avantages et risques de l’extension de l’unité d’analyse
- Quelques critiques à l’approche d’Engeström
- Les apports d’Engeström à la THCA
- CHAPITRE 5: Vers une quatrième génération de la théorie historico-culturelle de l’activité ? Sannino et les utopies réelles
- Les enjeux sociétaux actuels… et leurs causes systémiques
- Les nouvelles technologies de l’information et des communications : une occasion pour transformer la THCA ?
- La nature de l’objet : la notion de « runaway object »
- L’inscription dans une science sociale émancipatrice : les utopies réelles
- L’éradication du sans-abrisme et le travail de Sannino
- Les discussions critiques autour de la quatrième génération de la théorie de l’activité
- Conclusion
- Conclusion de la première partie
- Retour sur l’idée de génération
- Quelques traits typiques d’une filiation commune
- PARTIE 2 : QUATRE CONCEPTS CENTRAUX POUR ANALYSER L’ACTIVITÉ.
- Introduction de la deuxième partie
- CHAPITRE 6 : L’objet de l’activité
- Le concept d’objet et son importance pour la THCA
- Différencier l’objet de l’activité du but des actions
- Les caractéristiques du concept d’objet de l’activité à travers six principes
- Il n’y a pas d’activité sans objet : de l’objet à la délimitation de l’activité
- La controverse sur la notion d’objet
- Identifier les objets et leurs évolutions dans la recherche empirique
- CHAPITRE 7: Le concept de contradiction
- Le concept de contradiction : un concept de la dialectique
- Les contradictions comme moteur du développement des systèmes d’activité
- Les symptômes et manifestations observables des contradictions
- Faire l’expérience des contradictions
- Les contradictions ne sont pas les problèmes, mais leurs causes systémiques
- Des manifestations aux contradictions dans l’analyse de l’activité
- Quatre formes de contradictions
- Pour résumer
- L’apprentissage expansif : apprendre ce qui n’existe pas encore
- L’apprentissage expansif au regard des autres formes d’apprentissage
- La métaphore de l’expansion
- Sources théoriques d’inspiration de la théorie de l’apprentissage expansif
- CHAPITRE 8: L’apprentissage expansif comme processus : le cycle d’apprentissage expansif
- L’apprentissage expansif comme construction d’une zone proximale de développement
- Apprentissage expansif et apprentissage défensif
- Les échelles d’apprentissage expansif et leur articulation
- Analyser les apprentissages expansifs
- L’agentivité transformatrice comme déclencheur de l’apprentissage expansif
- CHAPITRE 9: Le développement comme réorganisation qualitative
- Le caractère problématique d’un concept polysémique et totem
- Le développement comme réorganisation qualitative
- Contradictions, histoire et développement
- Le caractère indéterminé du développement
- Le développement entre « cadre formatif » et conquête collective
- Conclusion de la deuxième partie
- PARTIE 3 : LA DIMENSION INTERVENTIONNISTE DE LA THCA : INTERVENTION FORMATIVE ET LABORATOIRE DU CHANGEMENT
- CHAPITRE 10: La méthodologie du laboratoire du changement
- La légitimité épistémologique des recherches interventionnistes
- Organisation matérielle des laboratoires du changement
- Les principes méthodologiques d’un laboratoire du changement
- Le principe de la double stimulation
- L’agentivité transformatrice
- Le Laboratoire du changement versus quelques principes d’intervention
- Les tâches et les artefacts clés dans un LC
- La phase préalable au laboratoire du changement
- Quelques exemples de laboratoire du changement
- CHAPITRE 11: Les interventions formatives au regard d’autres approches d’intervention
- À la recherche d’un cadre d’analyse pour la comparaison des approches
- Les Design Based Research
- Les Recherches Participatory Design
- Les Participatory Action Research
- Vers des formes d’hybridation ?
- Conclusion de la troisième partie
- Conclusion : l’urgence et la nécessité des apprentissages expansifs au XXIè siècle
- Postface : La direction de la Théorie Historico-Culturelle de l’Activité par Annalisa Sannino
- Références
- Table des illustrations
- Table des tableaux
- Remerciements
Préface : L’avenir de la théorie de l’activité est en marche par Yrjö Engeström
Il y a quinze ans, j’ai publié un article intitulé « L’avenir de la théorie de l’activité : Une ébauche » (Engeström, 2009b). J’y examinais un certain nombre de questions émergentes en tant qu’indicateurs du développement futur de la Théorie Historico-Culturelle de l’Activité (THCA). Il s’agissait notamment de l’importance croissante des « objets en fuite » (runaway object), de la nécessité d’une quatrième génération de théorie de l’activité, de l’importance des nouvelles formes de médiation et des médias numériques, de la nécessité de comprendre les mécanismes clés du développement des activités, du défi de saisir l’autorité et l’agentivité dans la théorie de l’activité, et de la centralité des interventions formatives dans la recherche sur la théorie de l’activité.
Ce que je n’avais pas prévu dans ce document, c’est l’émergence mondialement distribuée de personnes en chair et en os, d’individus et de collectifs, qui prennent des initiatives, s’engagent à long terme et produisent des contributions durables pour faire avancer la théorie de l’activité, à la fois dans la recherche universitaire et dans les efforts pratiques pour transformer les systèmes d’activité dans divers domaines. Un tel mouvement vivant d’acteurs humains a émergé ces dernières années, réparti dans diverses parties du monde. Le livre de Yannick Lémonie en est un puissant témoignage. L’avenir de la théorie de l’activité est en train de se produire grâce aux actions de personnes comme lui.
Ce livre est spécial à plusieurs égards. Il s’agit d’une introduction complète à la théorie historico-culturelle de l’activité – un accomplissement rare en soi. Mais il ne s’agit pas seulement d’un livre sur une théorie. C’est un livre qui interprète et développe la théorie à des fins d’intervention et de transformation. L’ouvrage présente la théorie de l’activité comme « un instrument de puissance et de reprise en main de leur propre travail par les professionnels, un instrument de transformation et de développement d’un pouvoir d’agir collectif, un instrument enfin de production culturelle » (p. 36). C’est exactement l’esprit du mouvement vivant qui porte aujourd’hui l’application et le développement de la théorie de l’activité.
Les questions que j’ai proposées comme marqueurs de l’avenir en 2009 font partie intégrante du présent ouvrage. L’avenir est présent dans ce texte, non plus comme une projection, mais comme un instrument conceptuel et méthodologique opérationnel. La discussion de Lémonie sur les « objets en fuite » en est un bon exemple. Il commence par définir le concept d’objet fugitif, en utilisant la pandémie de COVID-19 comme exemple éclairant. Il souligne que les objets en fuite ne sont pas simplement négatifs ou menaçants ; ils ont un grand potentiel de transformation, « articulant des niveaux d’analyse allant du local au global » (p. 177).
L’auteur élargit ensuite le concept en invoquant l’idée d’Eric Olin Wright sur les utopies réelles et le concept d’Annalisa Sannino sur les utopies mises en œuvre. Ce dernier est présenté en examinant les interventions formatives du Laboratoire du Changement de Sannino en faveur de l’éradication du sans-abrisme en Finlande, un programme de recherche emblématique de la quatrième génération de la théorie de l’activité historico-culturelle. Ainsi, dans cette partie du livre, les concepts d’objet en fuite, de théorie de l’activité de quatrième génération et d’interventions formatives sont organiquement interconnectés. Ils ont été intégrés dans une instrumentalité qui est mise en œuvre quotidiennement.
Ce livre ouvre et développe également des thèmes qui commencent à peine à intéresser les théoriciens de l’activité dans le monde entier. Je voudrais ici mettre l’accent sur deux de ces thèmes. Le premier est le pouvoir et la politique. Certains critiques affirment que la théorie de l’activité a été trop étroitement axée sur les transformations locales, négligeant ainsi les forces politiques plus larges et les relations de pouvoir. Lémonie souligne que ces critiques ont été formulées « avant l’émergence de ce qu’Engeström décrit comme la quatrième génération de la THCA. Cependant, dépasser le localisme d’un ou plusieurs systèmes d’activité en interaction implique un changement d’échelle vers des interventions qui s’attaquent véritablement à l’échelle sociétale. C’est l’objectif de la quatrième génération de la THCA » (p. 253).
Des mesures visant à intégrer la politique dans le cadre conceptuel de la THCA sont effectivement prises, principalement en examinant et en redéfinissant le concept de pouvoir. Les exemples de ce travail proviennent de différents domaines, des études en classe Choudry (2023) aux études sur l’éradication du sans-abrisme (Sannino, 2023) et à la recherche sur les systèmes d’information (Simeonova, Kelly, Karanasios, & Galliers, 2024). Ces études ont en commun de considérer le pouvoir comme « présent dans les actions » plutôt que comme des structures statiques. Cela permet de se rendre compte que « le pouvoir peut être mis en mouvement […] comme le montre l’influence de l’utilisation agentive d’instruments spécifiques proposés par les professionnels à leurs collègues, ainsi que par les chercheurs du Laboratoire du Changement aux participants des interventions » (Sannino, 2023, p. 51).
Le deuxième thème est celui de la dialectique. La dialectique est le fondement épistémologique et méthodologique de la théorie de l’activité. Cependant, en particulier dans les recherches empiriques et interventionnistes, il est souvent difficile de rendre explicite la manière dont la dialectique informe et guide réellement la recherche – il y a un fossé entre les études concrètes et leur philosophie sous-jacente. Lémonie aborde et comble ce fossé, en particulier dans le chapitre 7, consacré au concept de contradiction, et dans le chapitre 10, axé sur les Laboratoires du Changement et les processus de passage de l’abstrait au concret dans ces interventions. Le concept dialectique de contradiction est expliqué avec force à l’aide de trois exemples empiriques, à savoir des études sur la production alimentaire aux États-Unis, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en France, et sur le développement de différents modèles de coworking.
Au chapitre 10, Lémonie aborde la difficile question de la spécification des étapes de la méthode dialectique. « La méthode d’ascension de l’abstrait vers le concret, sans se réduire à un ensemble de règles et de procédures, passe par des étapes que l’on peut décrire. La méthode dialectique peut donc être considérée comme une ‘danse avec le temps’, selon les termes d’Ollman (2008), avec quatre étapes qui vont du présent au passé, puis au futur et enfin au présent. Le cycle idéal typique de l’apprentissage expansif et les sept actions d’apprentissage expansif représentent cette danse dans le temps » (pp. 332-333). L’auteur examine à nouveau des exemples empiriques puissants, montrant que la méthode dialectique est en fait quelque chose d’extrêmement pratique et conséquent dans la recherche d’intervention formative.
La parution d’un tel ouvrage montre clairement que l’avenir de la théorie de l’activité historico-culturelle se joue ici et maintenant.
CHAPITRE 1 :
Introduction. Unité et diversité de la Théorie Historico-Culturelle de l’Activité
Je considère la théorie de l’activité, dans ce sens, comme une famille de pratiques partageant des grands-parents, mais qui, au fil des ans, comme toute famille, a divergé en termes d’intérêts et de caractéristiques (Blunden, 2023, p. iv).
Séparée de la pratique, la théorie est verbalisation impérieuse, déliée de la théorie, la pratique est activisme aveugle (Freire, 1975, p. 11).
Il y a maintenant une trentaine d’années, Engeström (1993, p. 64) formulait l’idée que la Théorie Historico-Culturelle de l’activité (THCA) était un « secret bien gardé du monde universitaire » (p. 64). Depuis cette affirmation, il y a eu un intérêt grandissant dans le monde de la recherche pour cette théorie qui a abouti à une diversification des terrains d’étude et d’intervention, comme à un accroissement exponentiel des références aux travaux initiaux de Vygotsky, Leontiev ou aux travaux plus récents de ce que l’on peut nommer l’école scandinave de la THCA (Daniellou & Rabardel, 2005) en référence aux travaux d’Engeström et de ses collègues.
Le secret apparaît donc aujourd’hui et quelque 30 ans plus tard, pour le moins éventé, largement diffusé au plan international, malgré la difficulté à circonscrire et à s’approprier la THCA et à mobiliser celle-ci dans une pensée dialectique (Langemeyer & Roth, 2006). Ainsi
[…] lorsqu’un chercheur occidental commence à se rendre compte des impressionnantes dimensions de la théorisation qui se cachent derrière l’approche de l’activité, il peut très bien se demander : est-ce que cela en vaut la peine ? Peut-on s’en servir pour produire quelque chose d’intéressant ? Comment effectuer des recherches concrètes sur la base de la théorie de l’activité ? (Engeström, 1993, pp. 64-65)1.
Nous croyons profondément, comme Paulo Freire le suggère dans la citation qui introduit ce chapitre, aux profonds liens qui unissent la théorie à la pratique. La théorie de l’activité n’est pas en ce sens une théorie spéculative. Pas plus elle n’est activisme aveugle. Elle est une théorie profondément « pratique », tournée vers la transformation des activités productives humaines. Elle est activiste et transformatrice et elle place au cœur de sa méthodologie la question de l’intervention (Sannino & Sutter, 2011).
Mais il s’agit d’une théorie exigeante. C’est la raison d’être de cet ouvrage. Il se donne pour ambition de présenter la THCA, ses origines et ses développements passés et émergents, ainsi que son orientation interventionniste.
Qu’est-ce que la théorie historico-culturelle de l’activité ?
La THCA est une « théorie » au sens où elle fournit un ensemble cohérent de concepts, de principes et d’idées permettant l’étude de l’activité humaine (Allen, Karanasios, & Slavova, 2011; Engeström, 1993) : « elle offre des outils pour appréhender l’activité, en étudier empiriquement les composantes individuelles et collectives et en accompagner le développement » (Eyme, 2017, p. 497). Elle s’inscrirait donc mieux, si l’on suit ces premières définitions, dans la catégorie des théories d’analyse, de conception d’études et de description (en tant que théorie permettant de décrire ou de comprendre comment et pourquoi les choses se sont produites), plutôt que dans celle des théories de « prédiction » (pour les distinctions, voir Gregor, 2006).
Pourtant, classer trop vite la THCA dans la catégorie des théories d’analyse ou des théories descriptives serait une profonde erreur. La THCA est avant tout une théorie tournée vers la transformation des pratiques humaines qui mobilise un cadre de pensée dialectique et appuyée sur des valeurs de justice sociale et d’émancipation (Stetsenko, 2015). Elle est une théorie prédictive dans la mesure où elle mobilise la pensée dialectique pour permettre de projeter et de mettre en œuvre un futur souhaitable. Elle n’est pas non plus une théorie simplement descriptive, car elle fournit un cadre permettant d’expliquer l’activité humaine et son développement. Comme le souligne Blunden (2023, p. ix) « La théorie de l’activité est une théorie puissante pour la transformation de la vie humaine en vue de la justice sociale et de l’émancipation » (p. IX). La THCA s’inscrit ainsi dans un modèle de science qui n’est ni neutre, ni purement « contemplatif» (Vianna & Stetsenko, 2014) mais qui au contraire est tourné vers la réalisation d’un futur (Engeström, Rantavuori, Ruutu, & Tapola-Haapala, 2023b), le dépassement du statu quo (Stetsenko, 2022) et la réalisation d’utopies réelles (Sannino, 2020) : elle transcende la dichotomie traditionnelle entre recherche et pratique en réfutant les approches positivistes et empiristes.
Pour autant, l’inscription de la THCA dans cette orientation transformatrice et émancipatrice n’est ni pleinement partagée ni totalement comprise si l’on en juge par la lecture des publications scientifiques actuelles. Une majorité de ces publications s’inscrivent dans une orientation d’analyse qualitative permettant de comprendre et d’expliquer des pratiques actuelles (par ex. Nussbaumer, 2012; Yamagata-Lynch, 2010) sans s’inscrire et mobiliser des méthodologies interventionnistes susceptibles de soutenir des transformations souhaitables dans les activités humaines. Dans cette orientation, la question du futur possible de l’activité humaine reste en suspens et se dilue par la même occasion la dimension « pratique » tout autant que l’ancrage dialectique de la THCA qui permet d’analyser le mouvement passé, présent et potentiellement futur des phénomènes (Langemeyer & Roth, 2006).
Néanmoins, la pertinence des principaux concepts de la THCA semble la rendre de plus en plus attrayante pour une génération de chercheurs qui souhaitent ancrer leur travail dans la réalité des pratiques sociales, en s’affranchissant des frontières disciplinaires. Dans le domaine de la recherche en éducation, Roth, Lee, & Hsu (2009) notent une augmentation exponentielle des références à trois auteurs majeurs du CHAT (Vygotsky, Leontiev et Engeström, respectivement) entre 1987 et 2010. Nous avons fait le même travail avec Vygotsky et Engeström respectivement, sur une période de 25 ans, de 1995 à 2019. Le résultat est le même : l’augmentation du nombre de citations se poursuit après 2010. La figure 1 montre l’augmentation significative de ces citations sur 25 ans, sur la base des données obtenues via Google Scholar.

Figure 1.Augmentation du nombre de citations de deux grands théoriciens de l’activité : Vygotsky et Engeström.
Si la THCA s’est d’abord développée dans le champ de la psychologie à partir des travaux initiaux des psychologues soviétiques, et plus particulièrement de Vygotsky2, ses postulats sur la détermination socioculturelle de l’esprit tout autant que ses racines dans les idées développées par Marx en fait une théorie transdisciplinaire de la vie humaine. La THCA se caractérise par une grande diversité des terrains d’études ou d’intervention. Évoquons ici :
- • Les Interactions Homme-Machine (IHM) et la conception de nouvelles technologies (par ex. Bertelsen & Bødker, 2003; Bødker, 1991; Bødker, Ehn, Sjögren, & Sundblad, 2000; Bødker & Klokmose, 2011; Clemmensen, Kaptelinin, & Nardi, 2016; Kaptelinin & Nardi, 2006, 2018) ;
- • Les organisations de travail (par ex. Blackler, 2011; Blackler, Crump, & McDonald, 2000; Blackler & McDonald, 2000) ;
- • La prévention des risques et maladies professionnelles (par ex. Vilela, Querol, Hurtado, & Lopes, 2020; Vilela, Querol, Lopes, & Virkkunen, 2014) ;
- • L’éducation et la pédagogie (par ex. Hardman, 2008; Stetsenko, 2017; Yamazumi, 2007, 2021) ;
- • La formation des adultes (par ex. Engeström & Keruoso, 2007; Frambach, Driessen, & vander Vleuten, 2014; Larsen, Nimmon, & Varpio, 2019; O’Keefe & Ward, 2018) ;
- • La gestion et les ressources humaines (par ex. Ho, Victor Chen, & Ng, 2016; Tkachenko & Ardichvili, 2017) ;
- • L’agriculture (par ex. Junior, Lesama, & Querol, 2023; Mukute, 2015; Mukute, Mudokwani, McAllister, & Nyikahadzoi, 2018; van der Riet, 2017; Vänninen, Querol, & Engeström, 2015) ;
- • La thérapie (par ex. Holzman, 2006; Vasilyuk, 1991).
Cette liste est bien entendu loin d’être exhaustive. Ce bref panorama conforte l’idée que la THCA constitue un cadre transdisciplinaire propre à favoriser les recherches et les projets d’intervention interdisciplinaires. C’est ce que soulignent Durand & Barbier (2003) en partageant un constat et une conviction relativement au concept d’activité qu’ils jugent intégrateur pour les sciences sociales :
Le constat est que tout se passe aujourd’hui comme si une pression généralisée se manifestait, tendant à formater les objets des sciences sociales en termes d’activité ou en référence à l’activité. La conviction est que même si cette pression se heurte à une organisation compartimentée des champs scientifiques et sociaux, l’activité constitue une entrée privilégiée pour la construction progressive d’outils de pensée transversaux à plusieurs champs de recherches et de pratiques correspondantes (Durand & Barbier, 2003, p. 100).
Sa nature transdisciplinaire tout autant que les valeurs incorporées dans ses concepts centraux font de la THCA une théorie à même de répondre aux enjeux identifiés par des chercheurs en sciences du travail. Ainsi, dans un ouvrage récent, Guérin et al. (2021) énoncent quelques défis à relever pour l’intervention dans les milieux de travail : permettre « l’émancipation par le travail », « bien au-delà de l’émancipation dans le travail », ce qui implique notamment de « changer d’échelle ». Ce changement d’échelle implique pour ces derniers auteurs de « réunir de multiples disciplines : économie, gestion, anthropologie, histoire, géographie, sciences politiques, urbanisme, sciences de l’ingénieur, santé publique, psychologie, droit, etc. » (Guérin, et al., 2021, p. 375). Ces défis sont d’ores et déjà pris en charge par des travaux ancrés dans la THCA qui soulignent la dimension émancipatrice de l’agentivité transformatrice et des processus d’apprentissages expansifs. Relever ces défis implique de retravailler le concept d’activité et de lui rendre sa nature émancipatrice : l’activité n’est pas un processus « déterminé » par des contextes sociotechniques. L’activité c’est davantage le processus par lequel les humains façonnent, construisent et développent ces contextes.
L’abstraction primaire, le concept central de la THCA, conçue ici comme une théorie transdisciplinaire et émancipatrice, est bien entendu le concept d’activité. Non pas celui de comportement, ni celui de pratique et pas plus celui d’action. Vygotsky (1997b) donne un exemple qui illustre comment une abstraction primaire détermine le contenu d’une science à partir de la différence d’observation d’une éclipse de Soleil entre un astronome et un simple curieux. Ce sont les concepts mobilisés par l’astronome qui permettent de transformer un phénomène naturel en objet de connaissance scientifique. L’astronome verra dans l’éclipse autre chose que le simple curieux dans la mesure où il mobilise un ensemble conceptuel dans un projet visant à construire de nouvelles connaissances en astronomie. Dans le cadre de la THCA, c’est essentiellement la manière dont est conceptualisée l’activité qui permet de convertir un phénomène, ce que font des sujets, en un fait scientifique et en une méthodologie de nature émancipatrice. Ici, il est sans doute nécessaire de rompre avec des acceptations de sens commun du concept d’activité (Chaiklin, 2019) :
Un autre défi dans le travail scientifique pratique avec le concept d’activité est celui des similitudes légitimes et des différences importantes dans les significations quotidiennes et scientifiques de l’activité. Le sens quotidien du terme activité se concentre sur les apparences observables, en se référant à des « états » (par exemple, être en mouvement), des « qualités » (par exemple, faire quelque chose) et des « choses » (par exemple, une tâche particulière ; cf. le dictionnaire anglais Oxford). Le sens scientifique se concentre sur les relations essentielles qui sous-tendent ou motivent l’activité (dans un sens quotidien). Dans le langage courant, on peut faire une activité pour effectuer des transformations où son activité est l’action transformatrice. Il n’est pas immédiatement évident que le sens scientifique de l’activité dans ce cas se réfère à des relations structurelles spécifiques au sein des significations quotidiennes. En même temps, on peut dire que l’activité, dans son sens quotidien, est pertinente pour l’activité dans le sens systématique (même si elle n’est pas suffisante et qu’il lui manque les aspects les plus critiques), il est donc trop facile pour les orateurs scientifiques d’utiliser parfois un sens quotidien ou pour les auditeurs d’interpréter un sens scientifique d’une manière quotidienne (Chaiklin, 2019, p. 11).
Les difficultés d’appropriation de la THCA
Cet accroissement des références aux théoriciens de l’activité ainsi que l’élargissement à une multiplicité de disciplines et de terrains d’étude ne sont cependant pas sans poser quelques difficultés pour celui qui souhaite s’approprier la THCA dans la mesure où elle tend à en transformer le contenu conceptuel initial. La THCA est en ce sens une théorie qui « voyage » et se transforme en voyageant. Ainsi, dans un chapitre d’ouvrage récent, Dafermos (2020) souligne que l’accroissement exponentiel des références à la THCA pose de nombreuses questions d’ordres épistémologique, théorique et méthodologique. La réception de la THCA dans de multiples cultures de recherche et d’interventionconstitue pour lui un challenge susceptible de transformer le projet initial duquel cette théorie a émergé :
Les universitaires et les praticiens ont tendance à créer une image fragmentaire d’une théorie qui a émergé dans une culture et un monde de vie historiquement éloignés. Une réception fragmentaire de la théorie est une conséquence inévitable de son « voyage » à travers les pays et les continents. La réception fragmentaire est une illusion objective, plutôt que subjective, liée à l’existence de diverses pratiques sociales de reproduction de la connaissance dans différentes parties du globe. Les chercheurs ont tendance à combiner la théorie initiale avec d’autres théories ou d’autres façons de conceptualiser dans leur contexte (Dafermos, 2020, p. 15).
Le triple voyage de la théorie historico-culturelle de l’activité
Les contextes géographiques
Les théories, comme leurs principaux concepts, voyagent, franchissent les frontières, sont mobilisées dans d’autres cultures de recherche et se transforment inévitablement (Stengers, 1987). Nous n’entendons donc pas nous livrer dans cet ouvrage à une critique d’autres usages possibles des concepts centraux de la théorie de l’activité (activité, développement, contradiction, objet, instruments, médiation, etc.), mais souligner la nécessité de comprendre le projet scientifique et pratique dans lequel ces concepts tirent leurs significations et du point de vue des usages, leur « mode d’emploi ». Mais la difficulté pour comprendre le projet scientifique dans lequel s’inscrivent les concepts de la THCA réside justement dans le voyage géographique et l’internationalisation progressive de la théorie de l’activité. Pour Dafermos (2018) :
Résumé des informations
- Pages
- 480
- Année de publication
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783034351454
- ISBN (ePUB)
- 9783034351461
- ISBN (Broché)
- 9783034351447
- DOI
- 10.3726/b22315
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Novembre)
- Mots Clés (Keywords)
- Théorie Historico-Culturelle de l’Activité Méthodologie Intervention Apprentissage Expansif Développement Travail Dialectique Contradictions Système d’activité Vygotsky Leontiev Engeström Sannino Transdisciplinarité
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 480 p., 48 ill. n/b, 14 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG