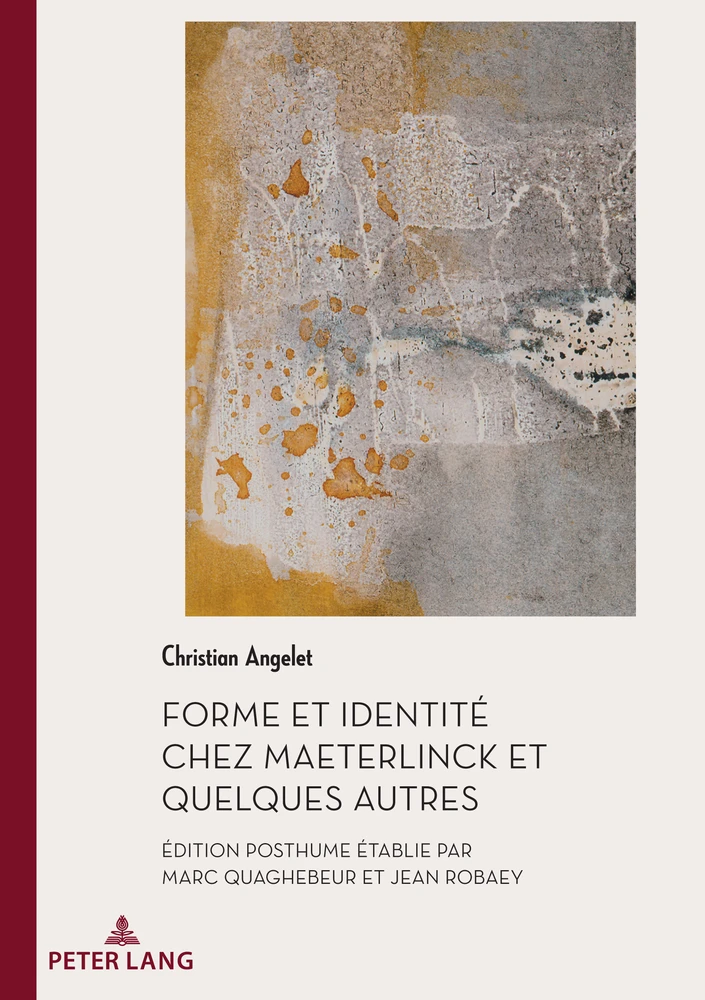Forme et Identité chez Maeterlinck et quelques autres
Edition posthume établie par Marc Quaghebeur et Jean Robaey
Summary
Il le fait en s’attachant tout particulièrement à quelques écrivains flamands de langue française qui en ont fait la renommée. En premier lieu, Maeterlinck à l’œuvre duquel le critique vouait une passion, notamment à travers son action au sein de la Fondation Maurice Maeterlinck. Mais aussi Verhaeren, Rodenbach, Hellens, Baillon ou Willems. Les focalisations concernent également des auteurs tels que Mockel, Crommelynck, Périer, Ghelderode, Compère ou Schneider.
Cette revisitation historique et littéraire se noue dans une subtile dialectique avec ce qui se joue à l’époque en France. Les figures de Rimbaud, Verlaine, Mallarmé ou Gide dialoguent avec les textes de la Belgique Fin de siècle. L’importance, sur une longue durée, du symbolisme en Belgique amène à la structuration du volume en deux parties : autour du symbolisme d’une part, au-delà du symbolisme ensuite
La singularité de l’espace littéraire francophone belge se dégage à fleur de textes. A chaque fois, elle laisse entrevoir la personnalité subtile d’un critique en quête d’une identité idéale telle que la complexité belge peut l’induire.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Présentation : Une identité idéale
- Bibliographie de Christian Angelet
- I AUTOUR DU SYMBOLISME
- Le thème primitiviste de l’existence en confusion : du philosophique au rhétorique
- Symbole et allégorie chez Albert Mockel. Une rhétorique honteuse
- La notion de symbole chez Gourmont et Huysmans
- À propos de Rimbaud : comparaison, métaphore, identification
- Analyse d’un poème de Verlaine : « L’échelonnement des haies… »
- André Gide et la Belgique fin de siècle
- Maeterlinck et Rimbaud : tradition et nouveauté dans Serres chaudes
- Maeterlinck, une jeunesse gantoise
- Le thème de la marionnette dans la pensée critique de Maeterlinck
- Bruges-la-Morte comme carrefour intertextuel
- Verhaeren, Les Villages illusoires et Les Apparus dans mes chemins
- II AU-DELÀ DU SYMBOLISME
- La réalité magique dans L’Habit du mort de Franz Hellens
- Le romancier et ses personnages dans Histoire d’une Marie
- La double interlocution chez Ghelderode et Crommelynck
- Périer, poète de la poésie
- Le théâtre de Paul Willems : thèmes et structures
- Les voix du désir dans Elle disait dormir pour mourir
- Gaston Compère, Je soussigné, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne
- Le Dieu aveugle de Jacques Schneider
- Pavots d’Otto Ganz
- Présentation de Marc Quaghebeur
- Tabula Gratulatoria
Présentation : Une identité idéale
« Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change »
(Mallarmé)
Christian Angelet (Bruges, 31 juillet 1934 – Gand, 3 juin 2021) voua à l’enseignement une part essentielle de sa vie. Il ne donna pas la priorité à la valorisation du remarquable travail scientifique qui fut le sien en matière d’analyse de textes, savoir dont bénéficièrent ses étudiants. Ce travail de chercheur qui sous-tendit son œuvre de transmission académique est disséminé dans de nombreuses publications savantes. Il s’imposait d’en donner connaissance au travers d’un livre, particulièrement pour ce qui a trait aux lettres belges francophones. Ce faisant, nous ne faisons que répondre à l’un des vœux que ses dernières années ne lui permirent pas d’accomplir.
Les figures du dix-huitièmiste, du narratologue inventeur du topos du « manuscrit trouvé » et de l’exégète de l’auteur-préfacier ont, elles, été dignement évoquées dans le volume d’hommage Le topos du manuscrit trouvé que lui ont offert ses collègues en 19991.
Les textes qui traitent du thème de l’homme primitif et du topos de l’existence en confusion – « sorte de fantasme culturel disant que, dans son état originel, avant l’Histoire, l’homme était incapable de penser à part des choses »2– se prêtent plus difficilement à leur réunion tant ils ont été écrits à des dates différentes et font montre d’une continuelle volonté de perfectionnement de la pensée.
Sans lui faire la part belle, notre volume réserve toutefois un chapitre à cette topique que le subtil critique gantois lie à la poétique qui supplanta, au XIXe siècle, la rhétorique traditionnelle. Il s’articule ainsi aux réflexions de l’auteur sur le symbole et l’allégorie qui sont au cœur de ce volume. Celles-ci trament en effet nombre d’études ici rassemblées et tout particulièrement celles qui touchent au symbolisme littéraire et au siècle de Mallarmé. Propos et poèmes de cet écrivain fascinèrent, plus qu’aucun autre, notre auteur.
L’article qu’il consacre à son collègue Louis Bolle3 illustre tout particulièrement sa hantise des spécificités de l’expérience littéraire ainsi que des mécanismes créateurs. La question de la métaphore – on la retrouve dans de nombreux chapitres de ce livre – y est mise en exergue. Celle du rythme également. C’est qu’« il n’existe pas de pouvoir avant l’œuvre ou en dehors d’elle, la technique n’est pas une entité idéale et abstraite. Elle naît en même temps que le poème, dont elle est à la fois la productrice et le produit. »4
Partie rarement citée de l’œuvre critique de Christian Angelet, nous le répétons, alors qu’il y fait montre d’une grande sagacité et qu’elle occupe une part croissante de sa bibliographie à partir des années nonante de l’autre siècle, les articles dédiés à la littérature francophone de Belgique constituent l’essentiel de la matière de ce livre. Le critique y déploie magistralement son art de la lecture minutieuse des textes, sa connaissance profonde du symbolisme en Belgique et en France, comme sa passion des figures de style, soit le cœur même de la littérarité. C’est elle qu’il met au cœur de ses analyses et réflexions, tout en la situant chaque fois, discrètement, dans l’Histoire des lettres.
Christian Angelet ne fut pas seulement professeur des littératures françaises des XVIIIe et XIXe siècles mais aussi, durant ses dernières années d’enseignement, un passeur de la littérature belge francophone. Il accompagna activement le renouveau critique qui avait pris corps dans les années 1980/90, parallèlement à la considération enfin accordée à cette littérature en tant que telle – dans la foulée de la proclamation de la belgitude. L’homme siégea d’ailleurs, plusieurs décennies durant, au Conseil d’administration et au Conseil scientifique des Archives et Musée de la Littérature. Il fut en outre – et longtemps – l’âme de la Fondation Maurice Maeterlinck.
En un sens, cette littérature fut son jardin secret. Dans les dernières décennies de sa vie, il se plut même à la suivre sur le terrain de la création théâtrale : Maeterlinck (et son cher Julien Roy) et Willems, bien sûr, mais aussi les Baladins du Miroir de Nele Paxinou.
Les focalisations sur l’auteur-préfacier, l’existence en confusion et la littérature francophone belge sont plus intimement mêlées qu’il n’y paraît. L’intérêt porté à cette dernière s’inscrit aussi au sein d’une réflexion sur la quête de l’identité, notoirement lisible dans les diverses variations du symbolisme ainsi que dans de nombreux textes du corpus littéraire belge.
Les racines de cette hantise littéraire se trouvent en effet en France : de Buffon à Baudelaire, de Rimbaud à Mallarmé, ou chez Tristan Corbière qui fascina Christian Angelet5. Ce Breton n’est-il pas l’exemple même de l’écrivain éclaté entre langue, littérature et vie ; de l’être foncièrement marqué par « la quête de l’identité du sujet poétique »6 ? Cela vaut également pour André Gide7, écrivain double s’il en est, auquel notre auteur consacra plusieurs études originales, dont celle de ses rapports avec la Belgique fin de siècle, republiée dans ce volume. Cela n’est pas sans renvoyer discrètement à l’histoire belge de notre auteur comme à celle de nombre de ses compatriotes.
Pour un être aussi subtil que Christian Angelet, l’identité ne pouvait qu’être idéale, ce qui explique son intérêt pour le symbolisme plus que pour le naturalisme. On ne cesse de la rechercher mais il ne saurait s’agir de la trouver. Même pas dans la littérature. En un sens, elle s’y trouve même peut-être moins que dans la vie de tout individu mais s’y repère plus volontiers. Ce questionnement de l’identité et de sa recherche se trouve au centre de l’intérêt du professeur de la Katholieke Universiteit Leuven et de la Rijksuniversiteit Gent pour les préfaces, pout le manuscrit trouvé, voire pour maints romans du XVIIIe siècle qu’il revisite. Elle ne s’y limite pas.
On la retrouve bien évidemment au centre du Symbolisme, dans ses variations non homogénéisantes, N’y sont donc pas étrangères la construction de la personnalité ou au contraire sa dispersion telle qu’elle triomphe chez Arthur Rimbaud. Ce dilemme entre vie et littérature, réel et idéal, Stéphane Mallarmé lui donna ses lettres de noblesse définitives. Fil rouge discret mais obsédant de la critique angelettienne, sa pensée est omniprésente dans les écrits de notre auteur. On le découvre notamment dans un chapitre de ce livre : La notion de symbole chez Gourmont et Huysmans. Exemplairement capitale, la figure du sphynx de la rue de Rome était à ce point essentielle que qui osait y toucher déchaînait un séisme chez l’homme aimable et réservé qu’était Christian Angelet.
La Belgique, spécialement francophone, est fille d’une identité complexe qui n’est pas celle voulue par les États-nations, celle-là même que n’a cessé d’exalter la France. Assez logiquement8, notre critique s’est donc intéressé aux Flamands qui écrivirent en français, non seulement les symbolistes, mais aussi ses contemporains – et ce, jusqu’à Nicole Verschoore9. Avec les nuances d’époque qu’il ne faut pas négliger – les lois linguistiques sont passées par là –, tous partagent une situation de double allégeance qui n’est pas étrangère à la marque profonde et singularisante qu’ils ont laissée dans la littérature belge de langue française. Notre auteur ne se disait-il pas francophone chez lui mais néerlandophone, à peine sa porte fermée ?
Rien de déchirant pour autant. Un surcroît d’intelligence et d’acuité en revanche. Là comme ailleurs, Christian Angelet se mouvait avec une grande légèreté et une extrême élégance. Ce tropisme natal ne l’empêcha pas de s’intéresser et d’admirer un Wallon tel que Gaston Compère – partagé, il est vrai, entre les lettres et la musique. À l’auteur de Polders, notre auteur consacra une longue étude, comme à son roman Je soussigné Charles le téméraire, duc de Bourgogne10, autobiographie post mortem d’un personnage historique capital de notre Histoire. Il ne cessa, selon Compère, de se demander qui il était11.
Le problème de l’identité se retrouve, sans que l’analyste ne s’y appesantisse jamais, auprès d’autres figures des lettres belges. La question revêt un aspect psychanalytique chez André Baillon12 tout autant que chez Franz Hellens, là encore deux auteurs flamands de langue française. C’est à Hellens que Christian Angelet a consacré un de ses premiers textes consacrés aux lettres belges. Il l’a prononcé dans cette Sicile qui lui deviendra de plus en plus chère et où il se retrouvera plus tard en compagnie de Paul Willems. Freudienne13, sa contribution au colloque de Catane de 1987 porte sur le concept de déplacement. La « métaphore » ne signifie-t-elle pas littéralement ‘transport, déplacement’ ?
Après ses nombreuses approches des grands écrivains Fin de siècle, le critique gantois ne s’est pas contenté de s’intéresser à quelques écrivains majeurs du premier demi-siècle en Belgique (Hellens, Baillon, Périer, Crommelynck, Ghelderode). Outre Compère, Willems et Verschoore déjà cités, il s’est penché sur les formes d’écriture d’auteurs plus récents, tels Jacques Schneider, Otto Ganz, Michel Ducobu ou Marc Quaghebeur. Chez ces écrivains souvent complexes, il traque toujours les raisons de sens qui les ont amenés à des formes stylistiques spécifiques.
La question identitaire est bien évidemment aussi linguistique dès lors qu’on s’intéresse à un pays tel que la Belgique. Christian Angelet y a réfléchi ainsi qu’on peut notamment le lire dans le jeu de navettes que l’écrivain de langue flamande Karel van de Woestijne14 opère entre lui-même et ses contemporains gantois écrivant en français, les Verhaeren, Maeterlinck ou autres Van Lerberghe. Notre critique a même consacré – mais en italien – un texte à l’état des langues en Belgique15.
Parfait bilingue, Christian Angelet a signé plusieurs études rédigées directement en néerlandais. On les repérera dans la bibliographie exhaustive16 de son œuvre critique que nous avons placée à la fin de ce volume. Il avait une parfaite conscience du génie différent des deux langues. Ainsi, de la faiblesse rythmique du français, ce qui rend d’autant plus précieuse son analyse du rythme chez certains des auteurs retenus dans ce florilège. Jan Herman a parlé17 de « l’incroyable richesse de sa bibliothèque intérieure ». Ne récitait-il pas, avec ravissement, Gezelle ou Van de Woestijne tout autant que ses chers poètes de langue française ?
Sa pensée critique est à la fois primesautière et aiguë. L’homme affirmait qu’il avait tout son texte dans sa tête avant même de l’écrire et que l’écriture allait dès lors de soi. Parfois, le texte qu’il avait en tête, était même déjà si clair qu’il ne l’écrivait plus ; le désir de l’écrire lui était passé. On peut songer à Racine, le très limpide : « Quand il avait ainsi lié toutes les scènes entre elles, il disait : Ma Tragédie est faite, comptant le reste pour rien », écrit Louis Racine dans ses Mémoires. Fluide mais beaucoup plus complexe qu’il y paraît à première vue, le style critique de Christian Angelet se découvrira tout au long de ces pages.
Cette limpidité vivace peut paraître occulter l’ossature intellectuelle d’un propos toujours très articulé en fait. Les auteurs étudiés ne sont pas prétexte à un discours à la fois général et à une théorie personnelle. Ce discours, Christian Angelet ne le tient pas en tant que tel, il le laisse affleurer, conservant ainsi la grâce de la langue. S’il n’a pas construit une théorie de la littérature, sa vision est avérée ainsi qu’on le découvrira au fil de ces pages. Il la fait découvrir par touches, en pointillé, à fleur des textes analysés. Il n’hésite pas à corriger ou nuancer, discrètement mais fermement – chez Albert Mockel, notamment – de nombreuses approximations, voire des affirmations théoriques qui ne résistent pas à l’analyse.
Toujours, sa pensée fixe des points de repère, trace des limites mais laisse également quelques points de fuite. La différence entre le symbole et l’allégorie, la métaphore et la comparaison sont au cœur de ses points d’insistance, on l’a vu. Christian Angelet ne cesse en outre de désigner la vanité des oppositions uniquement rhétoriques. Il s’attache enfin à ne pas couper trop abruptement, au niveau littéraire, la Belgique de la France. Sur ce point, sa pensée s’est toutefois nuancée au fil du temps. Ce fut également le cas chez Joseph Hanse dont il discute par ailleurs certaines analyses des poèmes de leur cher Maurice Maeterlinck18.
À chaque fois, les auteurs qu’il a le plus aimés et fréquentés ouvrent à des horizons théoriques. En premier lieu, Corbière et Gide, Rimbaud et Maeterlinck. Des auteurs qui ne correspondent pas aux goûts les plus personnels du critique n’en retiennent pas moins son attention. Son analyse de Les Villages illusoires d’Émile Verhaeren est un modèle de sagacité. Celle de Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach est tout aussi décisive à travers l’étude du carrefour intertextuel que constitue ce roman dont l’originalité tient, selon notre analyste érudit, au réaménagement subtil de divers textes19 antérieurs.
Le choix des articles n’a pas été facile. Christian Angelet a consacré par exemple plusieurs textes à Serres chaudes, à Bruges-la-Morte ou au théâtre de Paul Willems. Il nous a donc fallu choisir, étant entendu que la bibliographie de fin de volume permettra aux lecteurs et aux chercheurs d’approfondir tel ou tel chapitre qui aurait particulièrement retenu leur attention. Tel que nous le proposons, ce volume permet la découverte d’un travail critique précis et cohérent. Celui-ci offre le loisir de reprendre, à frais nouveaux, la lecture du corpus littéraire belge francophone, et notamment du plus commenté depuis des lustres, celui de la grande génération léopoldienne.
On y découvrira un critique directement enté, comme nous l’avons dit, sur la littérarité mais qui la fait comprendre dans la singularité d’une époque. Gide, Mockel, Rimbaud, de Gourmont, Huysmans, Verlaine, Claudel, Maeterlinck, Rodenbach ou Verhaeren rendent loisible le dépliement de l’univers, des imaginaires et des spécificités formelles des Fins de siècle dont l’ontologie n’était pas celle de Stéphane Mallarmé, leur figure de proue. C’est en Maurice Blanchot et Roger Dragonetti que Christian Angelet voit ses héritiers les plus cohérents. Le lien tissé par notre auteur entre Arthur Rimbaud et le premier Maeterlinck est un autre morceau de bravoure de ce livre, qui ne manque pas de mettre par ailleurs en lumière les causes de l’ambiguïté croissante des rapports du Gantois avec André Gide comme les raisons de la stabilité des rapports avec Émile Verhaeren.
Nous avons respecté les usages écrits de l’analyste. Ainsi, son emploi de la virgule suivie du tiret long mais aussi les formes d’interpellation de ses auditeurs qu’il conserva pour la publication en revue de ses études. Son style reproduit donc partiellement sa voix et la laisse entendre. Ce langage d’interpellation constitue un des charmes de son écriture. Il témoigne de son souci de n’être jamais en position de surplomb de l’autre ou d’accaparateur de l’auteur. C’est sa voix qu’il s’agit de faire entendre.
Bien évidemment, et du fait même de notre situation d’éditeurs posthumes, nous avons conservé les passages qui, de chapitre en chapitre, reviennent – parfois dans des termes presque identiques – sur les axes centraux de ses analyses, le symbole et l’allégorie, entre autres. Cela permettra au lecteur de mieux s’imprégner des idées-phare de la lecture angelettienne des œuvres littéraires.
Tout au long de ce travail, nous avons bénéficié de l’attention chaleureuse et de l’aide efficace de madame Jacqueline Angelet, elle aussi romaniste gantoise, ainsi que de ses enfants. Nous les en remercions. Elle nous a permis de nous rapprocher plus encore d’un homme élégant et subtil, rigoureux mais ouvert, dont la malice cachait son immense passion pour la littérature. Sa demeure familiale, au nom bien symbolique (Godshuizenlaan / Boulevard des hospices, littéralement ‘des maisons de Dieu’) reflétait parfaitement la sagesse de l’amoureux du monde et du savant aimable qu’était et que demeure en nos mémoires Christian Angelet.
L’homme d’une identité idéale, décidément.
Marc Quaghebeur
Jean Robaey
1 Cfr Le topos du manuscrit trouvé. Hommages à Christian Angelet, Études réunies et présentées par Jan Herman et Fernand Hallyn avec la collaboration de Kris Peeters, Louvain / Paris, Peeters, 1999.
2 Cfr Christian Angelet, Le thème primitiviste de l’existence en confusion : du philosophique au rhétorique, repris dans ce volume.
3 Christian Angelet, « Louis Bolle revisited », in Les Lettres romanes, Tome XXXIX, 1985, n°1-2, p. 17-26.
4 Ibidem, p. 19.
5 Rappelons son livre sur La poétique de Tristan Corbière, Bruxelles, Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises, 1961 (19752), ainsi que son édition des Amours jaunes, dans la collection Classiques de poche en 2003.
6 Christian Angelet, Préface à Tristan Corbière, Les Amours jaunes, op. cit., p. 14.
Details
- Pages
- 348
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034352499
- ISBN (ePUB)
- 9783034352505
- ISBN (Softcover)
- 9783034352482
- DOI
- 10.3726/b22226
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Christian Angelet Maeterlinck Symbolisme Littérature belge francophonie Wallonie Flandre
- Published
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 348 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG