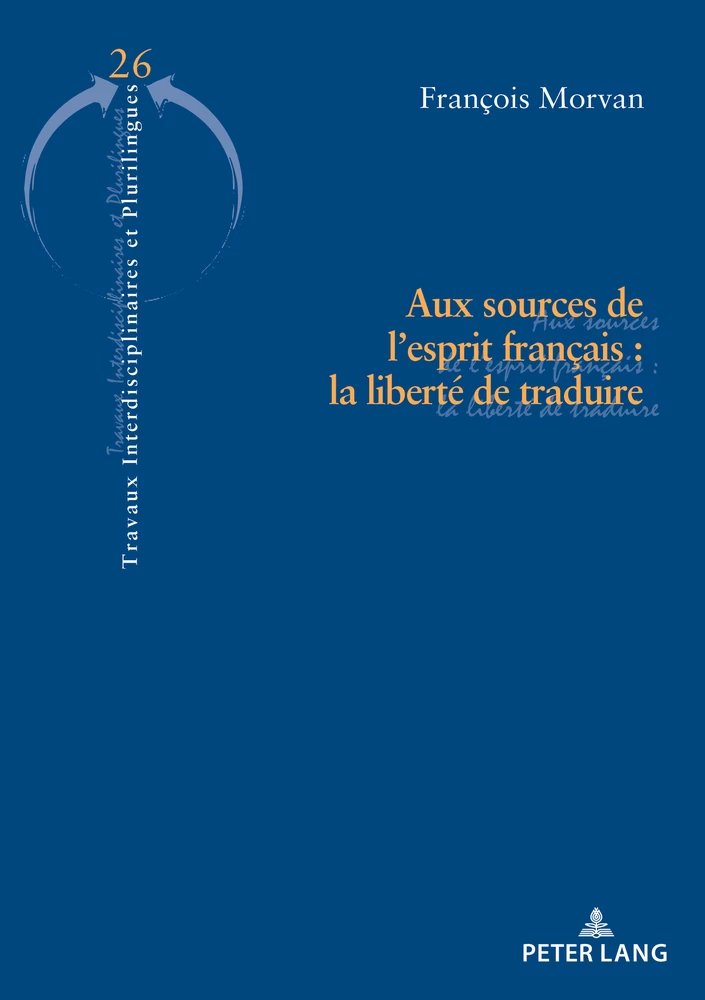Aux sources de l’esprit français : la liberté de traduire
Résumé
Partant de là, l'histoire se divise en quatre grandes périodes : la fondation latine et grecque ; la politique d'État de l'imperium français ; l'apogée de la littérature au XIXe siècle ; l'intégration dans une république mondiale des Lettres. La traduction sert tour à tour de ciment politique, d’outil de conquête et de terreau fertile d’un développement esthétique ou scientifique de la langue. Elle manifeste à chacune de ces époques l'essence même de « l'esprit français » : la quête d'universalisme.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction
- Chapitre I. La traduction d’État aux sources du royaume de France
- 1.1. L’ambition des rois de France pour dépasser le modèle latin (XIIe- XIVe siècle)
- 1.1.1. Sous Charles V (1364-1380), une culture en français issue de la traduction du latin
- 1.1.2. Après Charles V, au-delà de l’Empire romain
- 1.1.3. Un État libéré du latin sous la Renaissance
- 1.1.4. L’appropriation des sciences
- 1.2. La naissance d’un projet universaliste français
- 1.2.1. Une distance respectueuse entre la culture française et la Bible
- 1.2.2. Le dépassement du modèle italien (XIV e-XVIIe siècle)
- 1.2.3. Le modèle athénien
- Chapitre II. La construction de l’esprit français (XVe-XVIIIe siècle)
- 2.1. Un État dominateur à prétention universelle
- 2.1.1. La traduction, sommet d’une culture d’État
- 2.1.2. La traduction, résolution personnelle du monarque
- 2.1.3. État, littérature, langue et rayonnement français
- 2.1.4. Réaction et opposition
- 2.1.5. L’éducation des rois
- 2.1.6. La traduction comme exercice spirituel
- 2.1.7. De la détermination des rois à celle des États
- 2.1.8. Le passage de la théologie à la science
- 2.1.9. Le rôle d’Amyot dans la politique d’État
- 2.1.10. L’autonomie du français consacrée par la traduction des « belles infidèles »
- 2.1.11. Tacite et les racines de la critique des pouvoirs
- 2.1.12. La continuité de l’Ancien Régime sous la Révolution
- 2.2. La traduction vecteur d’une réappropriation des origines
- 2.2.1. La Pléiade et les racines
- 2.2.2. La traduction au service des racines gauloises et celtiques
- 2.2.3. Les racines virgiliennes de la France
- 2.2.4. L’identification au génie grec
- 2.2.5. Les racines homériques d’un héroïsme royal
- 2.3. Naissance de l’universalisme
- 2.3.1. La « conquête » de nouveaux mondes par le traducteur
- 2.3.2. Les origines nordiques de l’universalisme français
- 2.3.3. L’universalisme français nourri par le despotisme éclairé russe
- 2.3.4. La Pologne et les idéaux politiques français
- 2.3.5. L’Espagne flamboyante et le classicisme français
- 2.3.6. Résistance et réception de la mystique espagnole
- 2.3.7. L’enrichissement de l’imaginaire français par la saudade
- 2.3.8. À la conquête de l’Orient
- 2.4. La traduction comme moyen de contenir les puissances rivales
- 2.4.1. Un foisonnement de dissidences dans et autour de l’Église
- Chapitre III. La traduction, essence et vecteur de l’universalisme
- 3.1. Les racines de l’universalisme républicain
- 3.1.1. La formation des « élites »
- 3.1.2. Quatre dirigeants politiques contemporains
- 3.1.3. L’éloignement progressif du latin et du grec
- 3.2. D’autres sources de la culture française
- 3.2.1. La liberté de l’esprit italien
- 3.2.2. L’apport de la mystique et de la passion russe
- 3.2.3. L’universalisme de la France et des républicains éclairé par les Polonais
- 3.2.4. L’universalisme français de la IIIe République et l’esthétique japonaise
- 3.2.5. L’influence d’un Orient rêvé sur la France
- 3.3. Une place disputée : le « roman » de la nation française au XIXe siècle
- 3.3.1. La victoire contre la réaction religieuse
- 3.3.2. La traduction face aux velléités décentralisatrices
- 3.3.3. La rivalité allemande
- 3.3.4. Résistance à l’hégémonie anglaise et appropriation des savoirs
- Chapitre IV. Au XXe siècle, la fin d’une hégémonie et les échanges entre cultures
- 4.1. L’affirmation des civilisations et cultures
- 4.1.1. La présence de la littérature anglo-saxonne
- 4.1.2. La force de la pensée anglaise
- 4.1.3. L’apport religieux de la mystique espagnole renouvelé par la science
- 4.1.4. La continuité de la présence italienne
- 4.1.5. L’émergence de l’Europe centrale
- 4.1.6. La traduction politique du russe
- 4.1.7. L’universalisme portugais
- 4.1.8. L’émergence latino-américaine
- 4.1.9. La mélancolie et l’angoisse existentielles de Scandinavie
- 4.2. La culture classique mise à l’épreuve
- 4.2.1. Latin, la fin de la tradition
- 4.2.2. Mais une résistance par l’attachement militant à la culture classique
- 4.2.3. Une volonté de rapprocher la pensée grecque du présent
- 4.3. La culture religieuse bouleversée
- 4.3.1. Traduire la Bible sans le culte de la tradition
- 4.3.2. Les libertés prises avec la traduction de la Bible
- 4.3.3. La crise moderniste catholique, une chance pour la traduction
- 4.4. La pensée française face à l’Allemagne
- 4.4.1. Une fascination linguistique
- 4.4.2. La domination des grands philosophes allemands au XXe siècle
- 4.4.3. L’influence de la psychologie allemande
- 4.4.4. Assimiler la culture allemande
- 4.5. La France, relais des exotismes
- 4.5.1. La recherche des langues rares au XXe siècle
- 4.5.2. Une autre conquête des mondes arabes et musulmans
- 4.5.3. La culture savante à la conquête de l’Orient
- 4.5.4. L’intégration des mythologies et imaginaires d’Extrême-Orient
- 4.5.5. L’adoption de la poésie et la sensibilité perse
- 4.5.6. L’ailleurs et l’absolu indiens
- 4.5.7. L’indianisme, voie de l’antichristianisme au XXe siècle
- Conclusion
- Bibliographie
- Remerciements
- Titres de la collection
François Morvan
Aux sources de l’esprit français :
la liberté de traduire
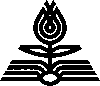
P.I.E. PETER LANG
Bern • Berlin • Bruxelles • New York • Oxford • Wien
Information bibliographique publiée par «Die Deutsche Nationalbibliothek»
«Die Deutsche Nationalbibliothek» répertorie cette publication dans la «Deutsche Nationalbibliografie»; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur Internet sous ‹http://dnb.d-nb.de›.
|
ISBN 978-2-8076-0544-2 br. |
ePUB 978-2-8076-0546-6 |
© P.I.E. PETER LANG s.a.
Éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2018
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com; brussels@peterlang.com
Cette publication a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
À propos du livre
Peut-on aller jusqu’à faire de la traduction vers la langue française la clé de voûte de l’émergence politique et culturelle de la civilisation française ? C’est ce que tente de démontrer cet ouvrage, qui part de l’hypothèse que le traducteur est un créateur à part entière, construisant son époque en empruntant à l’œuvre-source, sans se placer sous son joug.
Partant de là, l’histoire se divise en quatre grandes périodes : la fondation latine et grecque ; la politique d’État de l’imperium français ; l’apogée de la littérature au XIXe siècle ; l’intégration dans une république mondiale des Lettres. La traduction sert tour à tour de ciment politique, d’outil de conquête et de terreau fertile d’un développement esthétique ou scientifique de la langue. Elle manifeste à chacune de ces époques l’essence même de « l’esprit français » : la quête d’universalisme.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Table des matières
Chapitre I. La traduction d’État aux sources du royaume de France
1.1. L’ambition des rois de France pour dépasser le modèle latin (XIIe- XIVe siècle)
1.1.1. Sous Charles V (1364-1380), une culture en français issue de la traduction du latin
1.1.2. Après Charles V, au-delà de l’Empire romain
1.1.3. Un État libéré du latin sous la Renaissance
1.1.4. L’appropriation des sciences
1.2. La naissance d’un projet universaliste français
1.2.1. Une distance respectueuse entre la culture française et la Bible
1.2.2. Le dépassement du modèle italien (XIV e-XVIIe siècle)
Chapitre II. La construction de l’esprit français (XVe-XVIIIe siècle)
2.1. Un État dominateur à prétention universelle
2.1.1. La traduction, sommet d’une culture d’État
2.1.2. La traduction, résolution personnelle du monarque
2.1.3. État, littérature, langue et rayonnement français
2.1.6. La traduction comme exercice spirituel
2.1.7. De la détermination des rois à celle des États
2.1.8. Le passage de la théologie à la science
2.1.9. Le rôle d’Amyot dans la politique d’État
2.1.10. L’autonomie du français consacrée par la traduction des « belles infidèles »
2.1.11. Tacite et les racines de la critique des pouvoirs ←7 | 8→
2.1.12. La continuité de l’Ancien Régime sous la Révolution
2.2. La traduction vecteur d’une réappropriation des origines
2.2.1. La Pléiade et les racines
2.2.2. La traduction au service des racines gauloises et celtiques
2.2.3. Les racines virgiliennes de la France
2.2.4. L’identification au génie grec
2.2.5. Les racines homériques d’un héroïsme royal
2.3. Naissance de l’universalisme
2.3.1. La « conquête » de nouveaux mondes par le traducteur
2.3.2. Les origines nordiques de l’universalisme français
2.3.3. L’universalisme français nourri par le despotisme éclairé russe
2.3.4. La Pologne et les idéaux politiques français
2.3.5. L’Espagne flamboyante et le classicisme français
2.3.6. Résistance et réception de la mystique espagnole
2.3.7. L’enrichissement de l’imaginaire français par la saudade
2.3.8. À la conquête de l’Orient
2.4. La traduction comme moyen de contenir les puissances rivales
2.4.1. Un foisonnement de dissidences dans et autour de l’Église
Chapitre III. La traduction, essence et vecteur de l’universalisme
3.1. Les racines de l’universalisme républicain
3.1.1. La formation des « élites »
3.1.2. Quatre dirigeants politiques contemporains
3.1.3. L’éloignement progressif du latin et du grec
3.2. D’autres sources de la culture française
3.2.1. La liberté de l’esprit italien
3.2.2. L’apport de la mystique et de la passion russe
3.2.3. L’universalisme de la France et des républicains éclairé par les Polonais ←8 | 9→
3.2.4. L’universalisme français de la IIIe République et l’esthétique japonaise
Résumé des informations
- Pages
- 270
- Année de publication
- 2018
- ISBN (Broché)
- 9782807605442
- ISBN (PDF)
- 9782807605459
- ISBN (ePUB)
- 9782807605466
- ISBN (MOBI)
- 9782807605473
- DOI
- 10.3726/b13013
- Langue
- français
- Date de parution
- 2017 (Décembre)
- Mots Clés (Keywords)
- français culture traduction histoire universalisme identité
- Publié
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2018. 270 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG