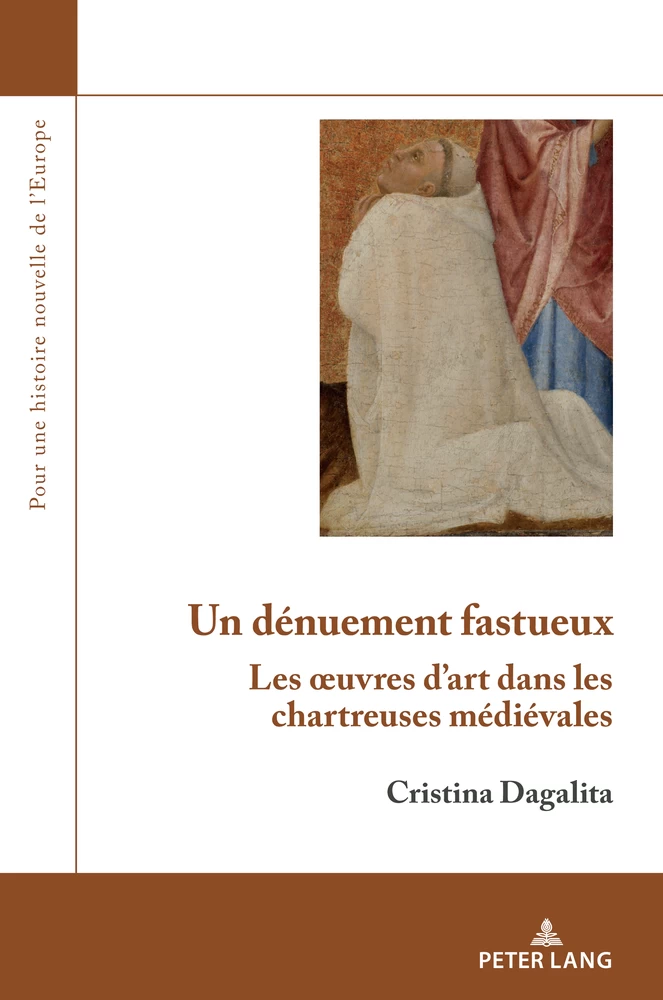Un dénuement fastueux
Les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Avant-propos
- Préface
- Introduction
- Première partie : Art et image dans la législation et dans les écrits de spiritualité des chartreux
- Chapitre 1. Les références aux œuvres d’art dans les textes normatifs des chartreux
- Les Coutumes de Chartreuse, écrit fondateur de la législation de l’ordre
- De la mise en place du chapitre général aux Antiqua statuta, 1140-1259
- Les Nouveaux statuts rassemblés par Guillaume Raynaud, en 1368
- L’organisation de l’ordre au cours du Grand Schisme
- Les décrets du XVe siècle
- La Tertia compilatio, réunie en 1509
- Le rôle de la visitation
- Conclusion
- Chapitre 2. L’image dans les écrits de spiritualité des chartreux
- Bruno de Cologne et Guigues Ier : l’expérience mystique des premiers pères chartreux
- La connaissance de soi-même à travers l’observation des réalités visibles
- L’attitude de Guigues Ier envers les œuvres d’art
- L’homme divin : vers une philosophie de l’image
- L’union contemplative d’après Guigues II
- L’Échelle de la contemplation, vers 1160
- Les méditations : une théologie affective autour de la figure de Marie
- Hugues de Balma et Guigues du Pont, les théoriciens de la vision
- Les voies qui mènent à la perfection, pour Hugues de Balma
- La contemplation active selon les écrits de Guigues du Pont
- Les écrits de Marguerite d’Oingt et la pratique de la dévotion affective chez les moniales chartreuses
- Le livre « comme un beau miroir »
- L’image peinte qui transporte
- L’interaction avec les personnes saintes
- La Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, vers 1350
- Un discours imagé
- Références à l’art dans la Vita Christi
- La philosophie de l’image pour Denys le Chartreux
- « L’attrait du monde et la beauté de Dieu »
- L’image de Marie et la célébration de la Trinité
- Conclusion
- Conclusion de la première partie
- Deuxième partie : Les œuvres d’art de trois chartreuses royales et princières
- Chapitre 3. Le monastère de Vauvert, près de Paris, un modèle pour l’ordre des chartreux
- La fondation royale de 1259
- Le monastère comme « palais céleste », d’après l’acte de fondation de messes par Charles V, en 1367
- Une construction favorisée par les proches des rois
- La mise en scène des donateurs dans les images de fondation
- Les dernières volontés des bienfaiteurs de Vauvert
- Conclusion
- Chapitre 4. Le monastère de Champmol, près de Dijon, et l’entraînement à la vie contemplative
- Chartreuse princière et demeure éternelle
- Par la manière que je l’ay commencé et devisié : l’organisation du chantier selon la volonté de Philippe le Hardi
- Des œuvres réalisées pour les chartreux de Champmol ?
- Le quadriptyque conservé à Anvers et à Baltimore
- Le Retable de la Vierge et l’Enfant du musée Mayer van den Bergh
- Les retables de Melchior Broederlam et de Jacques de Baerze
- Claus Sluter et le traitement pictural de la sculpture : le portail de l’église
- Le Puits de Moïse
- Les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
- Conclusion
- Illustrations
- Chapitre 5. Le monastère royal de Miraflores, près de Burgos
- Les chartreux en Aragon et en Castille
- La construction et l’aménagement de la chartreuse de Miraflores
- Le Triptyque de Miraflores, peint par Rogier van der Weyden, un don du roi Jean II de Castille
- Tableaux commandés lors du règne d’Isabelle de Castille
- Les œuvres d’art et la vision d’ensemble de l’intérieur de l’église
- La commande de verrières à Niclaes Rombouts
- Les œuvres sculptées par Gil de Siloé
- Conclusion
- Conclusion de la deuxième partie
- Troisième partie : Y a-t-il un art chartreux ?
- Chapitre 6. Les œuvres d’art reçues de divers donateurs et des peintres bienfaiteurs
- Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction, la chartreuse pontificale
- Le Couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton en relation avec les écrits de spiritualité des chartreux
- Le Retable de la Chute des anges rebelles, commande des chartreux à Raymond Boterie
- Des bienfaiteurs à part : les peintres et les chartreux
- Girard d’Orléans, ami des chartreux de Vauvert au temps de la mise par écrit du récit de fondation de l’ordre
- Rogier van der Weyden et les chartreux des Pays-Bas bourguignons
- Le monastère de Cologne, ville du fondateur de la première chartreuse
- Des peintres proches des moines : le Maître Wilhelm et le Maître de la Sainte Véronique
- Patriciens, marchands, érudits : les bienfaiteurs du monastère de Sainte-Barbe
- Le couronnement de Maximilien Ier et le cycle de la fondation de l’ordre
- D’autres commandes artistiques des chartreux de Cologne
- Conclusion
- Chapitre 7. Les œuvres d’art commandées par les chartreux
- Niccolò Albergati à Arras, tamquam pacis angelum destinamus
- Le portrait peint par Van Eyck
- Le cardinal Albergati, une figure de référence pour les chartreux
- Les humanistes et les moines : la commande de gravures pour les Statuts de l’ordre des chartreux à Urs Graf
- Les verrières des chartreuses de Fribourg-en-Brisgau et de Bâle
- Les portraits de chartreux et la dévotion à Marie, reine du ciel
- Les œuvres commandées par Jan Vos à Van Eyck et à Petrus Christus
- Le Portrait d’un chartreux par Petrus Christus
- Le diptyque de Willem van Bibaut
- Les représentations de la Vierge du rosaire chez Jan Provost et le Bergognone
- Les images privilégiées de la vie et de la Passion du Christ
- Le retable du maître-autel de l’église des chartreux de Strasbourg : trois épisodes de l’enfance du Christ
- Le retable de Thuison-lès-Abbeville
- Le retable de Boniface Ferrer pour la chartreuse de Porta Coeli
- La Lamentation sur le corps du Christ et l’Homme de douleurs
- Le Retable du Liget ou une vision de la rédemption
- Conclusion
- Conclusion de la troisième partie
- Conclusion générale
- Annexes
- Abréviations
- Sources et bibliographie
- Index et lexique
- Titres de la collection
Cristina Dagalita
Un dénuement fastueux
Les œuvres d’art dans
les chartreuses médiévales
Pour une histoire nouvelle de l’Europe
Vol. 9
Illustration de couverture : Jean de Beaumetz, Le Calvaire avec un moine chartreux (détail), entre 1389 et 1395, Paris, musée du Louvre, R.F. 1967-3.
© Musée du Louvre/Rmn Grand Palais.
Aides à la publication : avec le soutien du LabEx EHNE, de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, le Centre André Chastel, l’école doctorale 124 Histoire de l’art et archéologie.
Cette publication a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. Peter Lang s.a.
Éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2019
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com ; brussels@peterlang.com
ISSN 2466-8893
ISBN 978-2-8076-1146-7
ePDF 978-2-8076-1147-4
ePUB 978-2-8076-1148-1
MOBI 978-2-8076-1149-8
DOI 10.3726/b15669
D/2019/5678/16
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Bibliothek »
« Die Deutsche Bibliothek » répertorie cette publication dans la « Deutsche National-bibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site <http://dnb.ddb.de>.
Cristina Dagalita, chercheur associé au Centre André Chastel (UMR 8150), a soutenu sa thèse de doctorat sur les oeuvres d’art des chartreuses médiévales à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). Depuis 2010, elle a enseigné l’histoire et l’histoire de l’art du Moyen Âge, tout en participant à plusieurs projets de recherche sur la restauration et la numérisation de manuscrits et de vitraux médiévaux.
À propos du livre
En 1385, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi fonde la chartreuse de Champmol, près de Dijon. Les oeuvres somptueuses réalisées pour ce monastère reflètent-elles la spiritualité des chartreux ? Cet ouvrage propose un regard transversal sur l’art produit pour les moines chartreux au cours du Moyen Âge. Il analyse la manière dont les chartreux envisageaient la création artistique, d’après le témoignage de leurs textes normatifs ou mystiques. Peut-on dire qu’il y a eu un « art chartreux » ? Le présent livre explore les mécanismes de la commande artistique en se plaçant du point de vue d’un ordre renommé pour son austérité, mais destinataire de nombreuses oeuvres d’art.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Table des matières
Première partie : Art et image dans la législation et dans les écrits de spiritualité des chartreux
Chapitre 1. Les références aux œuvres d’art dans les textes normatifs des chartreux
Les Coutumes de Chartreuse, écrit fondateur de la législation de l’ordre
De la mise en place du chapitre général aux Antiqua statuta, 1140-1259
Les Nouveaux statuts rassemblés par Guillaume Raynaud, en 1368
L’organisation de l’ordre au cours du Grand Schisme
La Tertia compilatio, réunie en 1509
Chapitre 2. L’image dans les écrits de spiritualité des chartreux
Bruno de Cologne et Guigues Ier : l’expérience mystique des premiers pères chartreux
La connaissance de soi-même à travers l’observation des réalités visibles
L’attitude de Guigues Ier envers les œuvres d’art
L’homme divin : vers une philosophie de l’image
L’union contemplative d’après Guigues II
L’Échelle de la contemplation, vers 1160
Les méditations : une théologie affective autour de la figure de Marie←7 | 8→
Hugues de Balma et Guigues du Pont, les théoriciens de la vision
Les voies qui mènent à la perfection, pour Hugues de Balma
La contemplation active selon les écrits de Guigues du Pont
Les écrits de Marguerite d’Oingt et la pratique de la dévotion affective chez les moniales chartreuses
Le livre « comme un beau miroir »
L’interaction avec les personnes saintes
La Vita Christi de Ludolphe le Chartreux, vers 1350
Références à l’art dans la Vita Christi
La philosophie de l’image pour Denys le Chartreux
« L’attrait du monde et la beauté de Dieu »
L’image de Marie et la célébration de la Trinité
Conclusion de la première partie
Deuxième partie : Les œuvres d’art de trois chartreuses royales et princières
Chapitre 3. Le monastère de Vauvert, près de Paris, un modèle pour l’ordre des chartreux
Le monastère comme « palais céleste », d’après l’acte de fondation de messes par Charles V, en 1367
Une construction favorisée par les proches des rois
La mise en scène des donateurs dans les images de fondation
Les dernières volontés des bienfaiteurs de Vauvert
Chapitre 4. Le monastère de Champmol, près de Dijon, et l’entraînement à la vie contemplative
Chartreuse princière et demeure éternelle
Par la manière que je l’ay commencé et devisié : l’organisation du chantier selon la volonté de Philippe le Hardi
Des œuvres réalisées pour les chartreux de Champmol ?
Le quadriptyque conservé à Anvers et à Baltimore
Le Retable de la Vierge et l’Enfant du musée Mayer van den Bergh←8 | 9→
Les retables de Melchior Broederlam et de Jacques de Baerze
Claus Sluter et le traitement pictural de la sculpture : le portail de l’église
Les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
Chapitre 5. Le monastère royal de Miraflores, près de Burgos
Les chartreux en Aragon et en Castille
La construction et l’aménagement de la chartreuse de Miraflores
Le Triptyque de Miraflores, peint par Rogier van der Weyden, un don du roi Jean II de Castille
Tableaux commandés lors du règne d’Isabelle de Castille
Les œuvres d’art et la vision d’ensemble de l’intérieur de l’église
La commande de verrières à Niclaes Rombouts
Les œuvres sculptées par Gil de Siloé
Conclusion de la deuxième partie
Troisième partie : Y a-t-il un art chartreux ?
Chapitre 6. Les œuvres d’art reçues de divers donateurs et des peintres bienfaiteurs
Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction, la chartreuse pontificale
Le Couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton en relation avec les écrits de spiritualité des chartreux
Le Retable de la Chute des anges rebelles, commande des chartreux à Raymond Boterie
Des bienfaiteurs à part : les peintres et les chartreux
Girard d’Orléans, ami des chartreux de Vauvert au temps de la mise par écrit du récit de fondation de l’ordre
Rogier van der Weyden et les chartreux des Pays-Bas bourguignons
Le monastère de Cologne, ville du fondateur de la première chartreuse
Des peintres proches des moines : le Maître Wilhelm et le Maître de la Sainte Véronique←9 | 10→
Patriciens, marchands, érudits : les bienfaiteurs du monastère de Sainte-Barbe
Le couronnement de Maximilien Ier et le cycle de la fondation de l’ordre
D’autres commandes artistiques des chartreux de Cologne
Chapitre 7. Les œuvres d’art commandées par les chartreux
Niccolò Albergati à Arras, tamquam pacis angelum destinamus
Le portrait peint par Van Eyck
Le cardinal Albergati, une figure de référence pour les chartreux
Les humanistes et les moines : la commande de gravures pour les Statuts de l’ordre des chartreux à Urs Graf
Les verrières des chartreuses de Fribourg-en-Brisgau et de Bâle
Les portraits de chartreux et la dévotion à Marie, reine du ciel
Les œuvres commandées par Jan Vos à Van Eyck et à Petrus Christus
Le Portrait d’un chartreux par Petrus Christus
Le diptyque de Willem van Bibaut
Les représentations de la Vierge du rosaire chez Jan Provost et le Bergognone
Les images privilégiées de la vie et de la Passion du Christ
Le retable du maître-autel de l’église des chartreux de Strasbourg : trois épisodes de l’enfance du Christ
Le retable de Thuison-lès-Abbeville
Le retable de Boniface Ferrer pour la chartreuse de Porta Coeli
La Lamentation sur le corps du Christ et l’Homme de douleurs
Le Retable du Liget ou une vision de la rédemption
Conclusion de la troisième partie
Index et lexique←10 | 11→
Ce livre est issu de ma thèse de doctorat, intitulée « En .I. lieu desert, plain de montaignes ». Les images et la commande d’œuvres d’art pour les chartreuses médiévales (fin du XIe siècle-début du XVIe siècle). Le résultat de cette recherche, menée sous la direction du Professeur Philippe Lorentz, a été soutenu le 26 novembre 2015, à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Cet ouvrage doit son existence au directeur de ma thèse de doctorat, M. Philippe Lorentz, qui a eu l’idée d’une telle étude thématique et n’a cessé de l’encourager. Au cours des cinq années de l’élaboration de ma thèse, nos discussions, allant parfois dans les moindres détails de mes découvertes, ont façonné le chemin suivi et l’écrit qui en résulte.
Depuis 2016, le texte de ma thèse a bénéficié de l’apport des échanges avec les professeurs de mon jury de soutenance. Pour la publication de ce livre, je me suis efforcée de prendre en compte leurs remarques, afin de clarifier ou d’améliorer certains points. Le texte de ma thèse de doctorat a été légèrement réduit en vue de la publication. Certaines parties, jugées trop hypothétiques ou insuffisamment fondées, ont été écartées. Les notes en bas de page ont été allégées. Ce qui paraissait important a été inclus dans le corps du texte, tandis que de nombreuses informations secondaires ou descriptives ont été supprimées. Par ailleurs, le texte de ma thèse a été mis à jour, autant que possible, par l’ajout de nouvelles références bibliographiques.
Mon travail de recherche s’est déroulé dans des conditions privilégiées. Pour commencer, je remercie les enseignants de l’équipe d’accueil EA 3400 de l’Université de Strasbourg, dirigée alors par M. Benoît-Michel Tock, qui, en 2010, m’ont accordé un contrat doctoral, avec la possibilité d’être chargée de travaux dirigés en histoire et en histoire de l’art du Moyen Âge. Après ces trois premières années de recherche, j’ai été accueillie au Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Je remercie l’équipe de la mission pour la numérisation, ainsi que toutes les personnes auprès desquelles j’ai travaillé et qui m’ont tant appris sur les manuscrits et sur leur conservation. Je tiens à exprimer ma gratitude envers ceux qui m’ont facilité l’accès à des manuscrits précieux, à la Bibliothèque nationale de France ou au musée Condé, à Chantilly.
J’adresse mes remerciements à Mme Patricia Stirnemann pour son soutien et pour m’avoir mise en relation avec le Département des Manuscrits. La fin de mes recherches a été financée par un contrat temporaire dans le cadre de la restauration de la rose occidentale de la Sainte-Chapelle. Je remercie tout particulièrement Mme Karine Boulanger et M. Michel←11 | 12→ Hérold, qui m’ont formée à l’étude du vitrail médiéval. De plus, je tiens à remercier les enseignants de l’UMR 8150 du Centre André Chastel pour leur accueil chaleureux parmi eux, ainsi que Mme Marianne Grivel, alors directrice de l’UFR d’Histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Paris-Sorbonne, pour m’avoir permis d’effectuer des heures d’enseignement en histoire de l’art médiéval. Par ailleurs, je remercie les étudiants avec lesquels j’ai travaillé pour leur intérêt et leur enthousiasme qui ont fait grandir les miens.
Cet ouvrage n’aurait pas été tel sans ces rencontres et sans les personnes qui m’ont soutenue pendant tout ce temps. J’adresse un grand merci à ma famille et à mes amis, pour m’avoir accompagnée de diverses manières lors de la rédaction de ma thèse. Par ailleurs, j’adresse des remerciements cordiaux aux professeurs de mon jury de soutenance, Mme Laurence Ciavaldini Rivière, M. Daniel Le Blévec, M. Dany Sandron et M. Philippe Lorentz, qui ont accepté de lire ce travail et de le critiquer. Enfin, ma reconnaissance va à tous ceux qui ont facilité la publication de mon livre, grâce, entre autres, à une aide financière : les équipes du Centre André Chastel, du LabEx EHNE, de l’école doctorale 124 Histoire de l’art et archéologie et de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Que tous mes interlocuteurs des musées et des bibliothèques m’ayant donné les images et les autorisations pour leur parution dans ce livre soient assurés de ma vive gratitude.←12 | 13→
Details
- Pages
- 396
- Publication Year
- 2019
- ISBN (Softcover)
- 9782807611467
- ISBN (PDF)
- 9782807611474
- ISBN (ePUB)
- 9782807611481
- ISBN (MOBI)
- 9782807611498
- DOI
- 10.3726/b15669
- Language
- French
- Publication date
- 2019 (June)
- Published
- Bruxelles, Bern, Berlin, New York, Oxford, Wien, 2019. 396 p., 46 ill. coul.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG