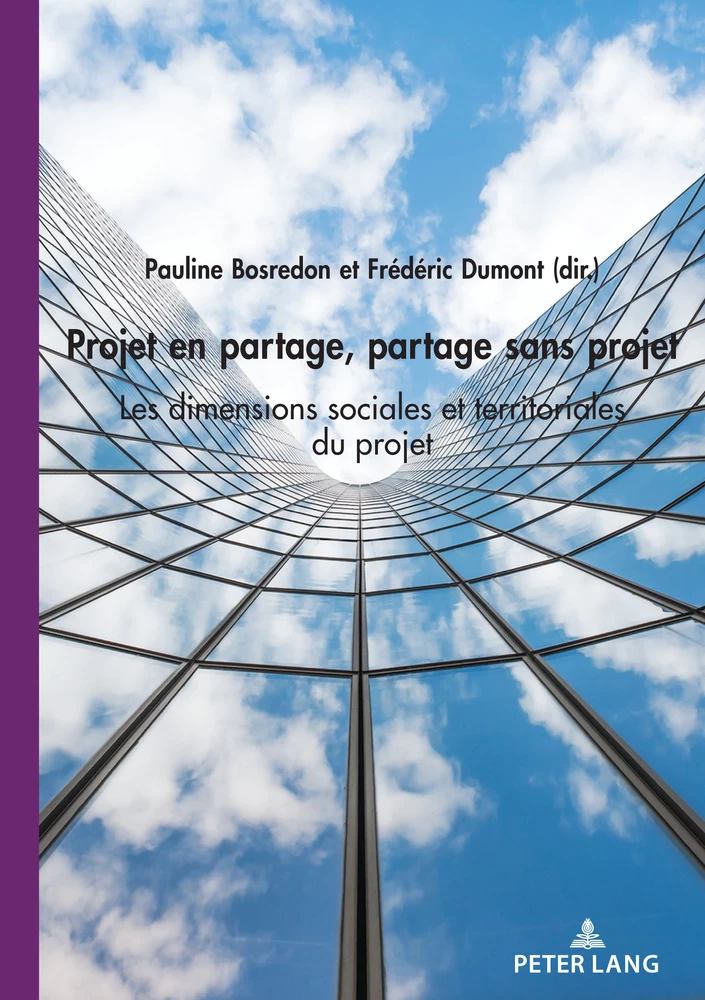Projet en partage, partage sans projet
Les dimensions sociales et territoriales du projet
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Tables des matières
- Liste des contributeurs
- Introduction (Pauline BOSREDON et Frédéric DUMONT)
- Chapitre 1 – Opposition et partage autour d’un projet pour l’émergence d’un espace public (Alexandra BIEHLER)
- Chapitre 2 – Projet urbain, action culturelle et mixité sociale à partir de la comparaison de deux places : la Praça da Estação à Belo Horizonte et la place du marché de Wazemmes à Lille (Pauline BOSREDON, Frédéric DUMONT, Flavio CARSALADE, Annick DURAND-DELVIGNE, Diomira Maria Cicci PINTO FARIA, Abdelhafid HAMMOUCHE et Frederico COUTO MARINHO)
- Chapitre 3 – Une expérience de planification et de projet métropolitain et local au Brésil : possibilités de convergence et de contrôle social (Heloisa COSTA, Geraldo COSTA et Roberto Luís MONTE-MÓR)
- Chapitre 4 – L’intégration du projet urbain dans un tissu ancien en déclin : le cas du quartier du Pile à Roubaix (Pauline CHAVASSIEUX)
- Chapitre 5 – Gentrification et conflits autour de la préservation d’un quartier historique (Luciana TEIXEIRA DE ANDRADE et Jupira GOMES DE MENDONÇA)
- Chapitre 6 – L’analyse des projets d’urbanisation au Complexo do Alemão à Rio de Janeiro : entre propositions prometteuses et résultats frustrés (Jean LEGROUX, Ana Lucia BRITTO et Luciana CARDOSO)
- Chapitre 7 – Construire du commun et de la différence : un usage ambigu de la projection des usagers en mode projet (Émilie GARCIA GUILLEN)
Liste des contributeurs
Alexandra BIEHLER
Alexandra Biehler, docteure en géographie et paysagiste DPLG, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille (ENSA-M), Laboratoire Project[s].
Pauline BOSREDON
Pauline Bosredon, Maîtresse de conférences en Urbanisme et Aménagement. Univ. Lille, Univ. Littoral Côte d’Opale, ULR 4477 – TVES – Territoires Villes Environnement & Société, F-59000 Lille, France.
Ana Lucia BRITTO
Ana Lucia Britto, Professeure au PROURB – Programa de Pós Graduação em Urbanismo, Université fédérale de Rio de Janeiro, LEAU – Laboratoire d’Étude des Eaux Urbaines.
Luciana CARDOSO
Luciana Cardoso, Étudiante en Master, Institut d’Études Politiques de Paris, Stage au PROURB Programa de Pós Graduação em Urbanismo, Université fédérale de Rio de Janeiro, LEAU – Laboratoire d’Étude des Eaux Urbaines.
Flavio CARSALADE
Flavio Carsalade, Professeur d’architecture. Escola de Arquitetura, Université fédérale du Minas Gerais, UFMG.
←9 | 10→Pauline CHAVASSIEUX
Pauline Chavassieux, Architecte, Université Jean Monnet (Saint-Étienne) – EVS-ISTHME, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble – MHAevt.
Frederico COUTO MARINHO
Frederico Couto Marinho, Professeur de géographie. Département de Géographie, Université fédérale du Minas Gerais, UFMG.
Heloisa COSTA
Heloisa Costa, Professeure. Département de Géographie, Université Fédérale du Minas Gerais, UFMG, CNPq.
Geraldo COSTA
Geraldo Costa, Professeur. Département de Géographie, Université Fédérale du Minas Gerais, UFMG, CNPq.
Frédéric DUMONT
Frédéric Dumont, Maître de conférences en Géographie. Univ. Lille, Univ. Littoral Côté d’Opale, ULR 4477 – TVES – Territoires Villes Environnement & Société, F-59000 Lille, France.
Annick DURAND-DELVIGNE
Annick Durand-Delvigne, Professeure émérite en psychologie. Univ. Lille, ULR Psitec.
Émilie GARCIA GUILLEN
Émilie Garcia Guillen, Doctorante, Université libre de Bruxelles, Centre de recherche Mondes modernes et contemporains.
Jupira GOMES DE MENDONÇA
Jupira Gomes de Mendonça, Chercheuse de l’Observatoire des Métropoles, Université fédérale du Minas Gerais. Departamento de ←10 | 11→Urbanismo e Núcleo de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura.
Abdelhafid HAMMOUCHE
Abdelhafid Hammouche, Professeur en sociologie. Univ. Lille, UMR 8019 Clersé – Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques.
Jean LEGROUX
Jean Legroux, Post doctorant au PROURB – Programa de Pós Graduação em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, LEAU – Laboratoire d’Étude des Eaux Urbaines.
Roberto Luís MONTE-MÓR
Roberto Luís Monte-Mór, Professeur. Département d’Économie, Université Fédérale du Minas Gerais, UFMG, CNPq.
Diomira Maria Cicci PINTO FARIA
Diomira Pinto Faria, Professeure en Géographie. Département de Géographie, Université fédérale du Minas Gerais, UFMG.
Luciana TEIXEIRA DE ANDRADE
Luciana Teixeira de Andrade, Chercheuse à l’Observatoire des Métropoles, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Departamento de Ciências Sociais e Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais.
Introduction
Cet ouvrage est issu d’une partie des 20es Rencontres internationales en urbanisme de l’APERAU qui se sont déroulées à Lille du 18 au 22 juin 2018 sur le thème « Que reste-t-il du projet ? Approches, méthodes et enjeux communs », suivant cinq axes qui font l’objet de plusieurs publications : « Cadres, pratiques et processus » ; « Enseigner le projet ou par projet » ; « Numérique : quelles intelligences du projet ? » ; « Adaptation, résilience, réversibilité, transition : de nouveaux enjeux pour le projet ? » ; et enfin, « Projet en partage, partage sans projet : dimension sociale et territoriale du projet », dont cet ouvrage est l’objet.
Le colloque proposait de questionner le projet, notion multi-échelle omniprésente de l’urbanisme contemporain. Pensé comme étape obligatoire et concept opérationnel permettant l’action collective, le projet présente souvent une distance entre les intentions affichées au départ et ce qu’il devient finalement, manipulé comme instrument de leurre ou disparaissant totalement. Derrière l’apparence de la précision et de la technicité, le projet peut prendre tant de sens différents, sa plasticité est telle qu’il peut finalement servir n’importe quelle cause au gré des intérêts de ses promoteurs. « Projeter, c’est avoir la prétention d’organiser le territoire, à travers des outils de planification, normatifs et réglementaires, mais aussi prospectifs et projectuels, supports du débat local et qui donnent aussi à voir ce territoire. Le projet de territoire devient alors en soit un support de mobilisation pour ses acteurs, où le processus devient au moins aussi important que les représentations1. »
Dans l’axe consacré à la dimension sociale et territoriale du projet qui nous intéresse ici, on traite particulièrement de projets urbains, de ←13 | 14→catégories d’acteurs, d’implications participatives et d’effets sociaux localisés. « Projet en partage, partage comme projet, partage sans projet : quelle est la dimension sociale du projet ? Comment pense-t-on le partage avant le projet, quels acteurs sociaux y participent, quand en sont-ils absents ? Ces éléments peuvent indiquer la direction que prendra le projet et augurer de ses effets. Et quels effets ? Effets de sens, effets de pouvoir, effets sociaux et décalages effectifs entre objectifs affichés et réalités sociales parfois tenaces. Au nord comme au sud, pour mettre en œuvre le projet les moyens sont variés, les outils sont divers, de la suggestion à la contrainte, des “bonnes pratiques” aux processus autoritaires2. »
Le projet de transformation urbaine marque l’appropriation ou la réappropriation d’un territoire, qu’il s’agisse d’une appropriation matérielle (foncière, immobilière, des espaces publics, des espaces communs, commerciale, etc.) et/ou d’une appropriation symbolique pour des activités diverses, par la fabrication et la diffusion d’une image de quartier ou par le jeu de la dénomination des espaces. Cette image peut aussi correspondre à la projection futuriste d’un promoteur immobilier ou encore être dessinée par la mémoire sélective, le choix et la restitution des récits des habitants par les associations ou les pouvoirs locaux qui les utilisent pour argumenter et légitimer leur projet. L’image peut aussi être construite par la mise en scène d’événements émouvants et structurants (manifestations, occupations, fêtes…) qui deviennent alors constitutifs d’une mémoire de demain.
Le partage peut s’incarner dans la participation à la construction du projet. Le stade de la conception peut être basé par exemple sur le partage d’un patrimoine symbolique qui peut être construit ou conforté à cette occasion et donne alors son sens au projet. On observe par ailleurs un processus similaire dans le cas des contre-projets, des projets qui se construisent en opposition au projet initial, ou de façon parallèle. Ces contre-projets génèrent de la participation, de l’action collective et donc du partage.
Mais le partage peut aussi résider dans la recherche de la dimension sociale finalement projetée. Le résultat escompté du projet est alors le partage social de l’espace, l’utopie d’une véritable mixité sociale.←14 | 15→
Details
- Pages
- 188
- Publication Year
- 2021
- ISBN (Softcover)
- 9782807618282
- ISBN (PDF)
- 9782807618299
- ISBN (ePUB)
- 9782807618305
- ISBN (MOBI)
- 9782807618312
- DOI
- 10.3726/b18154
- Open Access
- CC-BY-NC-ND
- Language
- French
- Publication date
- 2021 (July)
- Keywords
- dimension sociale du projet projets urbains dimensions sociales et territoriales
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 188 p., 6 ill. en couleurs, 9 ill. n/b, 3 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG