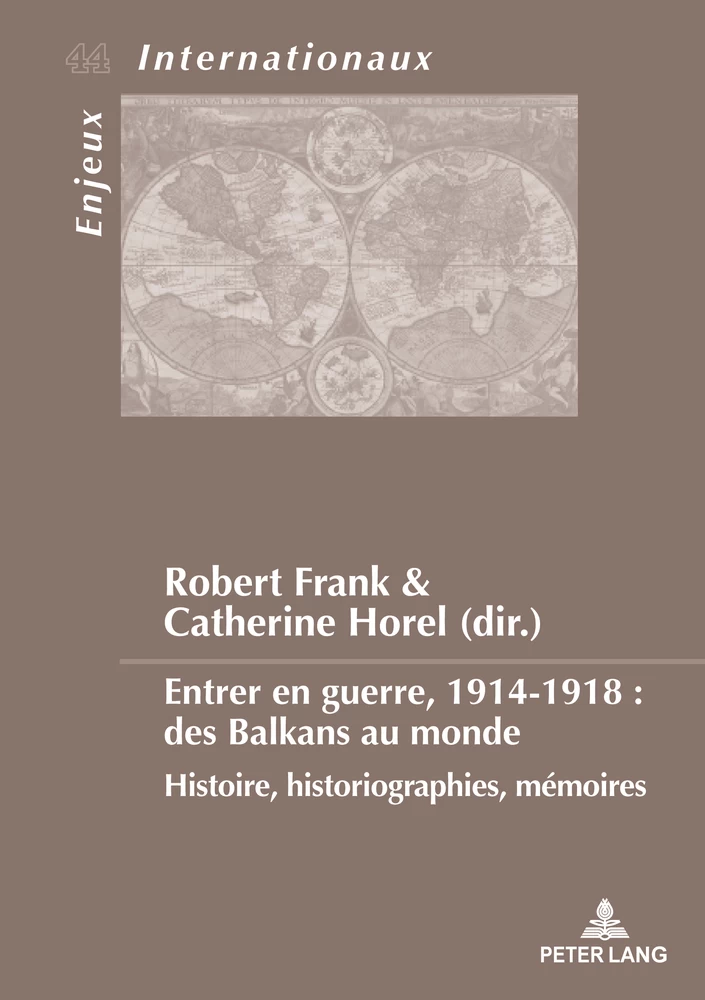Entrer en guerre, 1914-1918 : des Balkans au monde
Histoire, historiographies, mémoires
Summary
Il s’agit de montrer les Balkans au cœur du premier conflit mondial à travers les enjeux territoriaux, les identités collectives et les traces de guerre. La problématique centrale est celle des « entrées en guerre » afin de mieux définir la notion d’« état de guerre ». Le jeu d’échelles est pris en compte tant au niveau des espaces, entre le local et le global, qu’à celui des temporalités, entre le court et le long terme.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos des directeurs de la publication
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Les entrées en Grande Guerre, 1914-2014. D’un engrenage d’émotions aux brûlures de mémoires (Robert Frank / Catherine Horel)
- Les entrées en guerre : le processus de décision
- L’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre, 28 août 1916 (Gabriel Leanca)
- La mobilisation en Autriche-Hongrie (Catherine Horel)
- Risky Neutrality: Spain and the Great War (Javier Moreno-Luzón)
- La longue entrée en guerre de l’Italie dans les Balkans. Le théâtre albanais de mai à décembre 1915 (Fabrice Jesné)
- L’entrée en guerre des États-Unis en 1917 : chronique d’une guerre annoncée ? (Nicolas Vaicbourdt)
- La fin d’un monde ? Les premiers mois de la Grande Guerre dans l’Europe baltique (Maurice Carrez)
- Entrer ou ne pas entrer en guerre. Batailles médiatiques et politiques dans la presse grecque, 1914-1917 (Nicolas Pitsos)
- Between Entente and Central Powers. The Ottoman Empire on Its Way to War (Claudia Reichl-Ham)
- Ideology of the “Second Patriotic War” and Russian Realpolitik Aims in the Global Conflict of 1914-1918 (Victor Avdeev)
- Brazil Goes to War Thinking About Peace (José Flávio Sombra Saraiva / Natália Coelho)
- États et sociétés dans la guerre
- Japan Wages World War to Become a World Power (Hirotaka Watanabe)
- From Portugal to the World… Portuguese Participation in the First World War (Maria Fernanda Rollo / Ana Paula Pires)
- South Africa in the First World War. The Buildup of the Union Defence Force (Reiner Pommerin)
- De l’entrée en guerre à l’occupation : le cas de Bruxelles (Chantal Kesteloot)
- La presse italienne et la guerre (Alfredo Canavero)
- Entrer dans la guerre : l’île de La Réunion dans l’océan Indien occidental (Yvan Combeau)
- How the International Women’s Organizations and their Allied Affiliates “Entered” the War, 1914-1915 (Karen Offen)
- Historiographies et mémoires
- Contrasting Historical Interpretations. The Image of the Sarajevo Assassination and the Interpretation of the Great War in Serbian and Bosnian Muslim Historiography from the Early 1990s to the Present (Angeliki Mouzakiti)
- Gerhard Ritter, German Militarism, and the Coming of the First World War. The Witness, the Historian, and the Fischer Controversy (Klaus Schwabe)
- L’historiographie polonaise de la Grande Guerre (Tomasz Schramm)
- Transitions générationnelles. La Grande Guerre dans l’historiographie de l’Italie républicaine (Marco Mondini)
- De la rancœur à l’indifférence. La mémoire allemande de la Grande Guerre, une mémoire de vaincus, 1914-2014 ? (Guillaume Payen)
- “National Memory, National Amnesia”. First World War and the Greek Asia Minor Expedition in Greece’s Memory Wars (Erik Sjöberg)
- Naissance d’un projet national. Les tirailleurs lettons ou l’initiation au sacrifice, 1915-1917 (Julien Gueslin)
- Les images de Gavrilo Princip dans l’espace des Slaves du Sud, 1914-2014 (Stanislav Sretenovic)
- Bosnie, 1914-2014 : pour une histoire croisée des mémoires (Élise Julien)
- Les auteurs
- Index des noms de personnes
- Titres de la collection
Robert FRANK & Catherine HOREL (dir.)
Entrer en guerre, 1914-1918 :
des Balkans au monde
Histoire, historiographies, mémoires
Enjeux internationaux
Vol. 44
Cette publication a fait l’objet d’une évaluation par les pairs.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit, est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. Peter Lang s.a.
Éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 2018
1 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgique
www.peterlang.com ; brussels@peterlang.com
ISSN 2030-3688
ISBN 978-2-8076-0758-3
ePDF 978-2-8076-0759-0
ePUB 978-2-8076-0760-6
MOBI 978-2-8076-0761-3
DOI 10.3726/b14327
D/2018/5678/56
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Bibliothek »
« Die Deutsche Bibliothek » répertorie cette publication dans la « Deutsche National-bibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site <http://dnb.ddb.de>.
Robert Frank est professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d’histoire des relations internationales.
Catherine Horel est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l’Europe centrale contemporaine.
À propos du livre
Cet ouvrage propose une histoire globale de la Grande Guerre, en réglant la focale sur deux échelles distinctes : celle du monde d’un côté, celle des Balkans de l’autre, où, à partir de l’attentat de Sarajevo, l’histoire régionale croise l’histoire mondiale de la guerre. Nous mesurons ici le degré et le rythme de la mondialisation de ce conflit, et donc le degré et les formes d’engagement et de mobilisation des différents pays comme à l’échelle des continents. Les auteurs analysent et comparent la façon dont cette guerre change les visions du monde, chez les belligérants, chez les neutres, en Europe et hors d’Europe. Comment les systèmes de représentations ou les imaginaires ont-ils été transformés et ont modifié la perception et l’image des grandes puissances en guerre ? Comment les mémoires en ont-elles été affectées dans la durée ?
Il s’agit de montrer les Balkans au coeur du premier conflit mondial à travers les enjeux territoriaux, les identités collectives et les traces de guerre. La problématique centrale est celle des « entrées en guerre » afin de mieux définir la notion d’« état de guerre ». Le jeu d’échelles est pris en compte tant au niveau des espaces, entre le local et le global, qu’à celui des temporalités, entre le court et le long terme.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Sommaire
Les entrées en Grande Guerre, 1914-2014. D’un engrenage d’émotions aux brûlures de mémoires
Robert Frank & Catherine Horel
Les entrées en guerre : le processus de décision
L’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre, 28 août 1916
La mobilisation en Autriche-Hongrie
Risky Neutrality: Spain and the Great War
La longue entrée en guerre de l’Italie dans les Balkans.
Le théâtre albanais de mai à décembre 1915
L’entrée en guerre des États-Unis en 1917 : chronique d’une guerre annoncée ?
La fin d’un monde ? Les premiers mois de la Grande Guerre dans l’Europe baltique
Entrer ou ne pas entrer en guerre. Batailles médiatiques et politiques dans la presse grecque, 1914-1917
Nicolas Pitsos←7 | 8→
Between Entente and Central Powers. The Ottoman Empire on Its Way to War
Ideology of the “Second Patriotic War” and Russian Realpolitik Aims in the Global Conflict of 1914-1918
Brazil Goes to War Thinking About Peace
José Flávio Sombra Saraiva & Natália Coelho
États et sociétés dans la guerre
Japan Wages World War to Become a World Power
From Portugal to the World… Portuguese Participation in the First World War
Maria Fernanda Rollo & Ana Paula Pires
South Africa in the First World War. The Buildup of the Union Defence Force
De l’entrée en guerre à l’occupation : le cas de Bruxelles
La presse italienne et la guerre
Entrer dans la guerre : l’île de La Réunion dans l’océan Indien occidental
How the International Women’s Organizations and their Allied Affiliates “Entered” the War, 1914-1915
Karen Offen←8 | 9→
Contrasting Historical Interpretations. The Image of the Sarajevo Assassination and the Interpretation of the Great War in Serbian and Bosnian Muslim Historiography from the Early 1990s to the Present
Gerhard Ritter, German Militarism, and the Coming of the First World War. The Witness, the Historian, and the Fischer Controversy
L’historiographie polonaise de la Grande Guerre
Transitions générationnelles. La Grande Guerre dans l’historiographie de l’Italie républicaine
De la rancœur à l’indifférence. La mémoire allemande de la Grande Guerre, une mémoire de vaincus, 1914-2014 ?
“National Memory, National Amnesia”. First World War and the Greek Asia Minor Expedition in Greece’s Memory Wars
Naissance d’un projet national. Les tirailleurs lettons ou l’initiation au sacrifice, 1915-1917
Les images de Gavrilo Princip dans l’espace des Slaves du Sud, 1914-2014
Bosnie, 1914-2014 : pour une histoire croisée des mémoires
Index des noms de personnes ←9 | 10→ ←10 | 11→
Les entrées en Grande Guerre, 1914-2014
D’un engrenage d’émotions aux brûlures de mémoires
Robert Frank & Catherine Horel
UMR Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe
Depuis quelques années, la problématique des « sorties de guerre » a été développée d’une façon fructueuse dans de nombreux colloques et de non moins nombreux ouvrages. Elle ne se réduit pas à l’ancienne question des « après-guerre » ou à celle des « conséquences de la guerre », notions classiques qui renvoient à une approche statique des « suites de conflits » sur le plan démographique, économique, social, politique et géopolitique. D’une façon plus dynamique, il s’agit de « comprendre les processus de démobilisation des sociétés, des armées, des États et des économies », d’analyser la façon dont est vécu concrètement le passage de l’état de guerre à l’état de paix par les populations civiles et militaires, de décrire la façon dont sont perçus par les sociétés les changements sociaux, culturels, économiques, politiques, internationaux, induits par la guerre1.
Il est pertinent maintenant de s’intéresser aux « entrées en guerre », non point au prisme de la question des « origines » et des « causes » du conflit, même s’il convient de continuer à s’interroger sur elles, mais à travers un questionnement plus large : comment les États, les sociétés, les opinions, « les gens » sont-ils passés de l’état de paix à l’état de guerre ? Que signifie concrètement ce passage ? Et comment a-t-il été « vécu » ? Ces interrogations favorisent une réflexion sur la nature même de la guerre, dans sa dimension anthropologique : entrer en guerre, c’est mettre brusquement la mort collective à l’ordre du jour, placer les sociétés dans la perspective de la violence à subir et à infliger. Entrer en guerre, c’est sortir←11 | 12→ de l’ordinaire de la vie individuelle et entrer dans l’ordre extraordinaire de la brutalité de masse plus ou moins bien assumée. Il s’agit donc de mieux comprendre la façon dont, ici et là, s’opère ce grand saut : dans les faits, dans les consciences, dans les comportements ; de prendre en compte à la fois le « choc » à court terme que produit l’entrée en guerre et la profondeur temporelle dans laquelle elle s’inscrit comme processus, plus ou moins lent, avec des temporalités qui sont variables d’un pays à l’autre, d’un groupe social à l’autre.
L’intérêt des entrées en Grande Guerre est qu’elles sont multiples, étagées entre 1914 et 1917, avec souvent les Balkans comme enjeu déclencheur. De fait, cette région est inscrite dans un processus plus long que celui de la Première Guerre mondiale : des guerres balkaniques au règlement de la paix avec le traité de Lausanne de 1923, la chronologie s’y déploie différemment. L’étincelle de Sarajevo couvait depuis 1908. Dans un processus guerrier élargi et de plus en plus mondialisé, les Balkans déterminent également des entrées en guerre décalées selon les belligérants dont certains, épuisés par le conflit précédent, ne sont pas en état dans un premier temps de participer. C’est pourquoi il est particulièrement utile de s’arrêter sur ces temporalités qui se déploient de 1914 à 1917 sur l’ensemble du globe.
Le présent volume, qui prend ces questions à bras le corps, est le produit du colloque international « Des Balkans au monde. Entrer en guerre (1914-1918). Échelle globale et échelles locales » tenu à l’Unesco, à Paris, les 13-15 novembre 2014. Cette grande manifestation scientifique, organisée par le Comité international des Sciences historiques (CISH) et par l’Unité mixte de recherche Sirice (Sorbonne-Identités, Relations internationales et Civilisations de l’Europe), a reçu un fort soutien de la Mission du Centenaire 14-18, dirigée par Joseph Zimet. Que celui-ci et toute son équipe soient ici chaleureusement remerciés, ainsi qu’Antoine Prost, président du comité scientifique de cette Mission, qui a ouvert le colloque, et les historiens qui ont introduit chacune des séances : Olivier Forcade, Stefanie Prezioso, John Horne, Nicola Labanca et Élise Julien.
Cette rencontre de Paris est d’abord l’aboutissement d’un long parcours qui a lui-même une histoire, mouvementée, qui vaut la peine d’être brièvement racontée, car elle montre que la guerre de 1914 déchaîne encore les passions dans les Balkans, au point qu’elles ont failli faire sombrer le projet scientifique.←12 | 13→
Un projet au long cours, confronté à l’éruption des passions balkaniques, 2008-2014
Le point de départ se situe en 2006 lorsque l’équipe de l’UMR Irice (aujourd’hui Sirice) décide de lancer un programme de recherche ambitieux, intitulé « De Sarajevo à Sarajevo, 1908/1914/2014 ». L’idée était de profiter des centenaires de la crise de Bosnie de 1908, des guerres balkaniques de 1912-1913 et du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 pour organiser une série de rencontres scientifiques sur les crises qui commencent dans les Balkans puis gagnent le monde, ainsi que leur place dans les mémoires jusqu’au colloque final de 2014. L’objectif était en effet double, historique et mémoriel. En premier lieu, dans cette étude des années 1908-1914, la problématique historique était centrée sur la façon dont les tensions locales pouvaient dégénérer en tensions internationales, voire se mondialiser. La démarche ne se voulait en rien téléologique et ne visait pas à dire que la chaîne des crises balkaniques conduisait inexorablement au cataclysme de 1914. Il s’agissait au contraire de « défataliser » l’histoire, tout en repérant les engrenages s’il y en avait, mais aussi de mettre en valeur les facteurs qui, échappant à ces mécanismes, pouvaient les contrecarrer. En second lieu, le projet « De Sarajevo à Sarajevo » entendait écrire l’histoire de la mémoire de ces événements « déclencheurs » pendant tout le siècle qui a suivi : il s’agissait en particulier d’analyser les répercussions des guerres de Yougoslavie des années 1990 sur les mémoires de 1914 et de la Grande Guerre.
Il était en outre permis d’espérer, même assez naïvement, qu’une nouvelle phase d’élargissement de l’Union européenne concernât l’ex-Yougoslavie, intégrant ainsi des pays anciennement adversaires, dans les années 1990 tout comme en 1914. Or, comme on le sait, seules la Bulgarie et la Roumanie en 2007, puis la Croatie en 2013 ont rejoint la Slovénie entrée en 2004. Le centenaire de l’attentat du 28 juin 1914 aurait pu devenir l’heureuse occasion pour l’Europe de clore un siècle commencé dans la brutalité à Sarajevo même.
Details
- Pages
- 428
- ISBN (Softcover)
- 9782807607583
- ISBN (PDF)
- 9782807607590
- ISBN (ePUB)
- 9782807607606
- ISBN (MOBI)
- 9782807607613
- DOI
- 10.3726/b14327
- Language
- English
- Publication date
- 2018 (July)
- Keywords
- Grande Guerre mobilisation Balkans Europe conflit
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2018. 423 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG