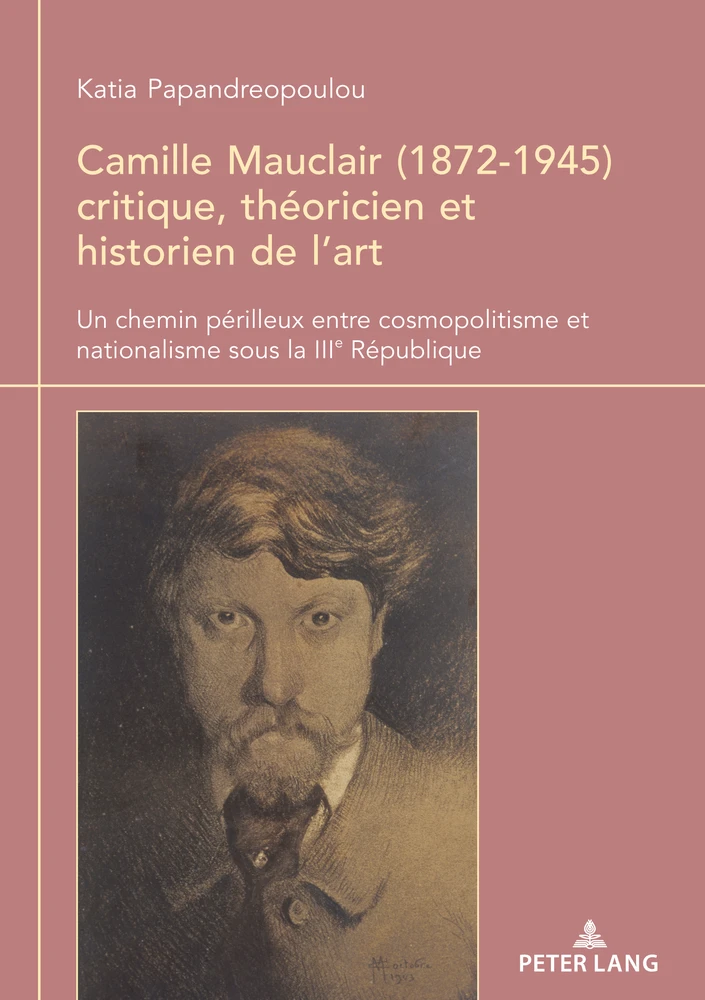Camille Mauclair (1872-1945), critique, théoricien et historien de l’art
Un chemin périlleux entre cosmopolitisme et nationalisme sous la IIIe République
Résumé
Figure majeure, quoique controversée, de la presse artistique et des arts plastiques de la IIIe République, Camille Mauclair (1872-1945), critique d’art, théoricien et historien de l'art, n'est pas traité ici comme un cas isolé. Ce livre, issu d’une thèse de doctorat, cherche à resituer l’auteur dans son époque troublée et à mettre en lumière les réseaux – artistiques, littéraires ou politiques – qui le soutiennent et le révèlent. Comment un auteur internationaliste a-t-il placé la question nationale au cœur des débats, devenant ainsi progressivement un porte-parole des bastions de conservatisme et de réaction ; tel est l’un des principaux questionnements de l’autrice. En retraçant le parcours intime, professionnel et intellectuel de Mauclair, ce livre aborde des sujets sensibles, tels que le nationalisme, le racisme ou l’antisémitisme, en puisant dans un large corpus de textes inédits de l’époque.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Abréviations et avertissements
- Préface de Neil McWilliam
- Introduction
- Éléments biographiques
- Première Partie De l’apprentissage à l’engagement
- Au cœur de la mêlée symboliste et internationaliste
- Réseaux
- Les premiers réseaux artistiques transnationaux
- Un exemple de reconnaissance précoce : « Les portraits du prochain siècle »
- Deux maîtres : Mallarmé et Barrès
- En quête de statut professionnel : poète, romancier, critique, dessinateur ?
- Les débuts dans le monde des revues : l’esprit international et les stratégies transnationales
- Mercure de France
- De la nécessité d’admirer la peinture anglaise
- Le cas de « la peinture du Nord », un esprit germanophile
- L’occulte et la raison : les décalages esthétiques fin-de-siècle
- Entre idéalisme et romantisme
- Au temps de l’éclatement des théories artistiques
- Rivalités et méfiance à l’égard des modernes
- Le cas Gauguin, Bernard
- Contre l’occultisme
- Peinture « littéraire » et peinture de « morceaux »
- Polémiques communicatives
- Dreyfusard oui, mais socialiste ? L’Affaire Dreyfus et la question de l’art social
- Entre littérature et société
- Une transition douloureuse
- De l’individuel au collectif
- Mauclair dreyfusard
- La tentation socialiste et la question de l’art social
- Art décoratif et identité nationale
- Réinterpréter les artistes selon leur valeur sociale
- L’artiste moderne et la question sociale
- Rodin social
- « Partout où le socialisme arrive, l’art est malmené »
- Le bourgeois et le juif : première affirmation du mal
- Socialisme et élitisme
- La fin de la question sociale
- DEUXIÈME PARTIE Nationalismes et histoire de l’art
- Nationalisme et narrations nationales au début du xxe siècle
- « La réaction nationaliste en art »
- Des guides spirituels : Maurice Barrès, Louis Courajod et ses héritiers
- Des idéaux réfutés
- Académisme vs classicisme français
- Le culte pour Ingres
- Des classicismes sur mesure
- La latinité et l’Italie contre Rome
- Vers une relecture de l’art français : entre critique et histoire de l’art
- Premières tentatives d’historien d’art
- Le problème de la Renaissance et l’erreur de Fontainebleau
- Les peintres « primitifs »
- Le XVIIIe siècle : un art français
- Dans les pas des Goncourt et de Mantz
- Un projet d’exposition inabouti
- Fragonard et Greuze, les maîtres du xviiie siècle
- Le XIXe siècle français
- La hantise des filiations
- La francité du mouvement impressionniste (et sa diffusion transnationale)
- Construire le caractère bohème et national du mouvement
- TROISIÈME PARTIE Théorie et crises de la critique
- Mauclair théoricien de la critique d’art
- Idéaux et taxinomies
- Entre critique philosophique et critique institutionnalisée : Hippolyte Taine et André Fontaine
- La critique d’art unitaire et la fusion des arts
- « La question de la critique est avant tout une question morale »
- Fonctions et rôles de la critique
- « La critique est une vocation idéologique à part, et un art, elle aussi, mais surtout un apostolat »
- Les catégories du critique : philosophe, prêtre et alchimiste
- Le Salon d’Automne et les crises du moderne
- Un Salon attendu mais décevant
- Gauguin et l’approche orientalisante
- La crise de la laideur
- La leçon de Ruskin : « Jeter un pot de peinture à la figure du public »
- Trois crises de l’art actuel
- Des responsabilités dans le système marchand-critique
- La dénonciation de la « nouveauté »
- Le critique « d’avant-garde »
- La récompense désintéressée contre la décadence de la réclame
- Le marchand d’art ou la personnification du mal
- De l’art de dénoncer les avant-gardes
- Un trop grand nombre d’exposants
- La démocratisation des moyens
- Modernismes nuancés : Maurice Denis et Marinetti
- Modernisme conservateur
- Maurice Denis, l’inclassable
- Modernisme réactionnaire : le cas du mouvement futuriste
- Marinetti et Mauclair : une admiration mutuelle
- Un appui inconditionnel
- QUATRIÈME PARTIE Le devenir d’un réactionnaire
- Autour de la Grande Guerre
- L’éveil de la conscience patriotique et catholique
- Les deux pôles d’une identité : patriotisme et religion
- Kultur contre Civilisation
- Écrits et manifestes
- Un réseau de périodiques en périphérie
- Écrire du centre : Mauclair impliqué
- Mauclair et le milieu royaliste : des liaisons dangereuses
- Les rapports avec Maurras et l’Action française
- Chapitre 10. Réseaux et stratégies de reconnaissance d’entre-deux-guerres
- Célébrité et prix littéraires
- Tentations et échecs
- L’avènement de la reconnaissance
- Réputation et polémiques
- Monticelli et Gide
- Les enquêtes littéraires
- Dans l’ombre de François Coty : privilèges et distinctions
- Chapitre 11. Mauclair et la presse dans l’entre-deux-guerres
- Des thématiques renouvelées en histoire de l’art
- Des approches pseudo-médicales
- La généalogie de l’art français réactivée
- La presse d’extrême droite : (Le) Figaro (1927–1933) et L’Ami du Peuple (1928–1933)
- « Une barbarie ‘made in Germany’ »
- L’expressionnisme, une maladie physique
- L’affaire Ramond, diaboliser l’argent
- Déformation, abstraction, poison
- L’École de Paris et l’École de France
- L’École de Paris ou la personnification du monstre
- Une attaque latérale contre l’École de Paris : Waldemar-George
- Picasso, avant et après l’exposition 1932
- Les Expositions de Figaro, ou Mauclair commissaire
- Tenter de nouveaux genres
- Les pamphlets contre l’art moderne
- La littérature de voyage, une vulgarisation de la culture
- Chapitre 12. Collaborer, un choix délibéré
- Conclusion
- Pourquoi Camille Mauclair aujourd’hui ?
- Bibliographie
- BIBLIOGRAPHIE DE CAMILLE MAUCLAIR
- BIBLIOGRAPHIE SUR CAMILLE MAUCLAIR
- BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
- Cahier d’images
- Liste des illustrations
- Index des noms
Abréviations et avertissements
Certaines sources archivistiques ont été citées en abrégé afin de faciliter la lecture des notes de bas de pages :
Autres abréviations d’usage utilisées :
Préface
Un lundi de septembre 1921, le peintre Émile Bernard rend visite à Camille Mauclair dans sa maison de Saint-Leu-Taverny, en bordure de la forêt domaniale de Montmorency. Bernard avait annoncé sa visite dans une lettre remerciant Mauclair pour ses commentaires favorables sur l’une de ses publications récentes et décrivant le critique comme « un homme de haute valeur artistique et morale » qui appartenait à « l’Olympe de l’élite et de ceux qui survivront1. » Leur rencontre confirma l’impression favorable de Bernard. Ce dernier écrivit à sa compagne Andrée Fort : « Mauclair m’a beaucoup plu ». Un « homme vraiment supérieur, qui voit du haut de l’éternité du Beau », l’écrivain « a physiquement toutes les lignes de l’aristocratie » et une « conversation aisée, assise et très familière ». Néanmoins, Bernard exprime des soupçons persistants : « il y a sans doute en lui, comme en la plupart des gens de ce temps-ci, des inquiétudes, des doutes, des influences du siècle qui infligent une diminution à sa personnalité2 ». Les réserves de Bernard n’étaient pas récentes. Les deux hommes sont entrés en contact pour la première fois en 1895, au cours d’un échange acrimonieux à propos de la discussion du critique sur la dette supposée de l’artiste envers Gauguin. Après une première escarmouche dans les pages du Mercure de France, ils en viennent rapidement à une tentative de réconciliation, même si Bernard considère alors Mauclair comme « un esprit compliqué », « trop parisien », avouant à sa mère en septembre 1895 : « voilà bien des causes pour qu’en nous estimant nous ne nous comprenions pas absolument3 ». L’admiration exprimée un quart de siècle plus tard (avec l’ambivalence caractéristique de Bernard) est clairement réciproque. En effet, Mauclair rejoint le comité d’honneur de la Société des amis d’Émile Bernard à la suite du décès de l’artiste en 1941.
Mauclair et Bernard avaient beaucoup en commun : ils se considéraient tous deux comme des hommes universels, accomplis dans de nombreux genres artistiques. Tous deux étaient prodigieusement productifs et très opiniâtres. L’un comme l’autre détestaient la démocratie, les valeurs bourgeoises et le monde moderne, et se considéraient à la fois comme injustement ignorés et comme membre d’une élite spirituelle et intellectuelle. Après leur mort, les deux hommes ont quasiment disparu de l’historiographie, même si la réputation de Bernard s’est perpétuée grâce à son association précoce avec l’école de Pont-Aven. Au cours des dernières décennies, cependant, l’art de Bernard a été plus largement réévalué et les activités de Camille Mauclair en tant que poète, romancier, critique et mémorialiste du Symbolisme ont suscité un intérêt scientifique croissant. Jusqu’à présent, cependant, cette attention avait été entravée par l’absence de précisions sur la vie personnelle de Mauclair et par la tendance des chercheurs à évoquer seulement des moments isolés, dans sa longue carrière prodigieusement productive. On sait depuis longtemps que Mauclair a joué un rôle important dans la vie culturelle française, de la Belle Époque à la Libération. Cependant, du fait de la rareté des sources biographiques, de la diversité et du nombre impressionnant de ses textes (poèmes, romans, critique journalistique, théorie esthétique, monographies populaires d’histoire de l’art, études de compositeurs, récits de voyage…), sa production a été traitée comme un immense puzzle, dont seules certaines pièces pouvaient être assemblées.
Grâce à l’ouvrage de Katia Papandreopoulou, nous avons aujourd’hui une meilleure compréhension des complexités, des constantes et des contradictions de la carrière de Mauclair ainsi que de sa volumineuse production de critique et d’historien de l’art. Des parties de l’œuvre de Mauclair qui retenaient l’attention des chercheurs précédents, telles que les études sur son antisémitisme réalisées par Romy Golan en 1995 ou par Pierre Vaisse en 2009, peuvent désormais être situées dans le cadre d’une analyse minutieusement documentée de l’esthétique du critique, de son évaluation de l’art ancien et contemporain, de ses sympathies idéologiques et des détails de sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, la frustration exprimée par Pierre Vaisse selon laquelle “aucun ouvrage d’ensemble ne permet encore de bien cerner le personnage4” a finalement été dépassée, même si son observation selon laquelle un compte rendu complet du large éventail d’activités de Mauclair défie les limites raisonnables d’une étude synthétique reste toujours vraie. Pour les historiens de l’art, l’avancée représentée par l’œuvre de Papandreopoulou est claire, notamment parce qu’elle comble d’importantes lacunes dans le développement intellectuel et idéologique de Mauclair d’une manière qui offre une compréhension historiquement plus complexe de sa trajectoire du cosmopolitisme au nationalisme et affine l’analyse de son aversion souvent violente à l’égard de l’art contemporain.
De même qu’Émile Bernard, qui demandait en 1918 « Qu’ai-je […] fait au monde qu’il me repousse ainsi ?5 », Camille Mauclair nourrissait un ressentiment amer envers ce qu’il considérait comme les injustices qu’il subissait par rapport à ses pairs riches et choyés, « ces bourgeois-artistes, bien nés » : « Tu n’as rien, tu es seul. […] efforce-toi d’aimer le second rang où la vie t’a placée6 ». Pendant une grande partie de sa carrière, Mauclair s’est bridé contre sa dépendance à l’égard de la production incessante d’articles et d’ouvrages de vulgarisation comme moyen nécessaire de survie financière dans un monde dont il méprisait les valeurs ostensiblement matérialistes. Ainsi que le démontre Papandreopoulou, le sentiment anti-bourgeois a soutenu les premières sympathies anarchistes de Mauclair et sa brève incursion dans le socialisme. Cet intermède s’est terminé par sa conviction que le mouvement était irrémédiablement utilitaire et que la classe ouvrière était incapable de répondre à la beauté. La démocratie et la marchandisation de la culture dans une société de consommation – les tares de la société bourgeoise – répugnaient à Mauclair, comme étant des signes du « flot montant du progrès, cette barbarie sans innocence7 ». De même que Bernard, pour qui « l’art est notre unique réalité8 », Mauclair considérait l’art comme un « silencieux apostolat9 », le dernier bastion de valeur dans un monde qui succombe à la sensualité et à l’attrait de la nouveauté. Pour Mauclair – dans un entretien au journal raciste Revivre, publié en 1944, un an avant sa mort – « l’art est la seule religion qui nous reste10 ».
Et c’est là la pierre d’achoppement. Comme l’ont depuis longtemps reconnu les historiens, le culte de la beauté chez Mauclair a nourri – et renforcé – un mélange pernicieux de haine et de préjugés, qui l’ont propulsé du nationalisme culturel avant la Première Guerre mondiale vers un antisémitisme hystérisé au cours des années 1930 qui ont culminé dans son admiration pour Hitler et sa collaboration dans la presse de Vichy après la défaite de la France en 1940. Le travail de Katia Papandreopoulou nous permet de voir comment l’idéalisme esthétique de Mauclair soutient la réaction politique qu’il embrassa avec une véhémence croissante dans l’entre-deux-guerres. Les fondements esthétiques de la politique réactionnaire de Mauclair ne sont pas inhabituels pour sa génération : le chef royaliste Charles Maurras, par exemple, déclare en 1916 : « Notre nationalisme a commencé par être esthétique11 », et l’association entre esthétique et ordre social est un thème récurrent dans le discours conservateur de l’époque. À l’instar de Mauclair, des personnalités comme Maurras ont élaboré des généalogies culturelles qui ont nourri leurs prédilections idéologiques. La généalogie exclusive de l’art français de Mauclair diffère, par exemple, de celle de Maurras et de ses disciples, qui postulaient la dette de la nation envers la Renaissance italienne, ce que Mauclair contestait vivement, alors qu’Émile Bernard soutenait que la beauté était une valeur absolue qui transcendait les frontières nationales contingentes. Toutefois, le dégoût prononcé de Mauclair pour l’avant-garde moderniste d’avant 1914 et sa campagne de plus en plus violente contre les artistes étrangers – et en particulier juifs – actifs dans le Paris de l’entre-deux-guerres, ont trouvé de nombreux échos dans le climat culturel polarisé des années 1920 et 193012.
Les contours de ces débats, et notamment leur articulation par Mauclair lui-même, ont été esquissés dans plusieurs études récentes. Ce qui ressort aujourd’hui avec plus de force, grâce aux recherches de Katia Papandreopoulou, c’est à quel point l’incursion de Mauclair dans le nationalisme et la xénophobie, loin d’être une diversion, peut être comprise comme l’aboutissement logique d’un idéalisme esthétique déjà au cœur de son émergence en tant que défenseur du Symbolisme dans les années 1890. Pour Mauclair, comme d’ailleurs pour Bernard, la beauté sert de justification à une idéologie enracinée dans des normes – esthétiques, sociales, raciales, historiques – intolérantes à toute dérive et défendues par une élite assiégée, dont Mauclair et Bernard se considèrent membres. En même temps, cependant, Mauclair était nécessairement complice de la culture qu’il prétendait mépriser : indigné par le mercantilisme prétendument cynique des artistes, marchands et critiques contemporains, il était lui-même un travailleur infatigable dont les livres, articles, conférences et activités curatoriales alimentaient le marché de l’art et des idées qu’il prétendait critiquer depuis sa forteresse spirituelle. Écrivant en 1921, Bernard félicite Mauclair (et par implication lui-même) pour sa lutte implacable contre les « nombreux industriels portant des titres trompeurs d’artistes ou de marchands », promettant que « par la seule évidence du Beau et du Juste, nous vaincrons tôt ou tard, morts ou vivants13 ». Ce rêve de justification s’est heureusement avéré illusoire, car Mauclair continue d’incarner certains aspects des plus sinistres de la politique culturelle française du vingtième siècle. Toutefois, l’exemple de Mauclair reste pertinent dans le contexte actuel d’intensification des guerres culturelles et constitue un puissant rappel du pouvoir de division des appels à l’art en tant qu’expression d’un esprit national d’exclusion.
Neil McWilliam, Duke University
1 Émile Bernard à Camille Mauclair, brouillon d’une lettre (non retrouvée) datée 1921 (par une main plus tardive), achetée en 2021 pour la collection du Centre des ressources du musée de Pont-Aven. Il s’agit probablement du livre Tintoret, Greco, Magnasco, Manet, publié par Bernard en 1920.
2 Émile Bernard à Andrée Fort, l.a.s. datée ‘mardi’ [septembre 1921], dans Neil McWilliam (ed.), Émile Bernard. Les lettres d’un artiste, Dijon, Les Presses du réel, 2012, p. 867–68. Bernard fait remarquer dans sa lettre à Mauclair en 1921 : « Vous m’avez fait beaucoup de bien lorsque j’étais très jeune en apportant votre contradiction à mes idées. Vous m’avez fait réfléchir plus sérieusement et plus profondément. Votre talent vous donnait une autorité qu’on ne pouvait pas négliger. À force de voyages, d’efforts, de vérités éprouvées, je suis arrivé à vous donner raison. Pleinement raison, et j’ai brûlé quelques idoles de ma jeunesse ; non que j’eusse pour elles aucun mépris, mais parce que l’art que je voyais de plus haut me montrait leur néant. »
3 Voir ibid., p. 416, note 1.
4 Pierre Vaisse, « Le Cas Mauclair », Lendemains, no 133, 2009, p. 200.
5 Lettres d’un artiste, p. 5.
6 Camille Mauclair, Servitude et grandeur littéraires, Paris, Ollendorff, 1922, p. vi-vii.
7 Mauclair, « Les villes bien-aimées », Le Figaro, 18 mars 1928, p. 1.
8 Émile Bernard à Andrée Fort, l.a.s. non datée [1909], Fondation Custodia, Inv. 2002 A 409.
9 Mauclair, Princes de l’esprit, Paris, Ollendorff, 1920, p. 315.
10 Stéphane Galanon, « Les mystères de l’art vivant », Revivre : le grand magazine illustré de la race, 5 mai 1944.
11 Charles Maurras, Quand les Français ne s’aimaient pas. Chronique d’une renaissance 1895–1905, Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1916, p. xv.
12 Voir Alessandro Gallicchio, Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l’art juif. De quelques critiques d’art au temps de l’École de Paris (1925–1933), Paris, Deutsches Forum für Kunstgeschichte et Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023.
13 Voir note 1.
Introduction
« Si je veux louer à leur valeur les artistes de talent, je veux aussi éreinter sans merci les équilibristes et les jongleurs. Que l’article leur parvienne ou non, je le travaillerai avec soin, car certaines choses mettent depuis trop longtemps ma patience à l’épreuve, et j’ai toujours été l’ennemi convaincu des charlatans, dont un si grand nombre bat aujourd’hui la caisse14. »
Loin de constituer l’une des célèbres polémiques de Mauclair critique d’art établi, cet extrait provient de sa toute première lettre adressée à l’âge de 17 ans au collaborateur de La Revue Indépendante Abel Pelletier et témoigne de son souhait de s’exprimer en tant que critique d’art professionnel à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889. Cette lettre est révélatrice d’un tempérament insatiable et emporté, d’un travailleur acharné, qui deviendra un critique influent au cours des décennies suivantes (voir cahier d’images en fin d’ouvrage, Fig. 1).
Opportuniste mais opportun, persévérant mais aussi opiniâtre, idéologue avant tout, Camille Mauclair entretient avec succès de longues collaborations dans les revues de renom qui lui assurent une solide carrière d’écrivain d’art. Homme de réseau depuis son plus jeune âge, il exerce une fascination sur les personnes qu’il rencontre sur son chemin, fascination qui n’est pas seulement positive : « Il m’a quelque peu effarouché avec un air de vouloir happer les monades des gens. Il a l’âme, je crois, bruyante et raboteuse. Au reste, je puis me tromper15 », déclare André Gide à Paul Valéry quelques jours après leur première rencontre. « Observons avec intérêt l’astre Mauclair s’élever16… », lui répond prudemment Valéry. Lugné-Poë, son collaborateur au Théâtre de l’Œuvre, écrira dans ses confessions: « Ce jeune Mauclair donnait à nos esprits assez ingénus l’impression de posséder un cran étonnant, nous croyions deviner en lui un conducteur pratique qui deviendrait précieux ; il gardait en mains des fils avec toutes les maisons, tous les salons, chez Stéphane Mallarmé, chez Paul Hervieu, chez de Régnier, chez Barrès, et jusque chez les snobs. Agressif ou simplement audacieux, ces yeux vous gagnaient par leur acuité ; plus que quiconque il devait avoir un but17» (ill. 1)

Ill.1.Camille Mauclair, Tête au crayon lithographique, 1900
L’œuvre de Camille Mauclair ne se limite pas au champ de l’histoire de l’art. Elle compte plus de 150 ouvrages et des milliers d’articles publiés dans la presse francophone et étrangère18. Bien des domaines de l’espace intellectuel et social s’entrecroisent dans ses publications : la littérature, la musique, le théâtre, les arts plastiques, l’esthétique, la morale, la politique culturelle. Mauclair était un touche-à-tout, dont l’œuvre, de vaste étendue, permet inévitablement, comme on le découvrira, un large éventail d’approches et d’interprétations. Nous nous consacrerons principalement à sa production concernant, d’une part, les arts plastiques et la théorie et, d’autre part, l’évolution du marché de l’art sans pour autant sous-estimer son rapport constant aux différentes disciplines. Ce rapport, souvent lié à ses opinions fluctuantes sur l’art, s’exprime avant tout dans son effort pour élaborer une théorie unitaire des arts, mêlant la musique, la philosophie de l’art et les arts plastiques. Toutefois, lorsque les développements dans le marché de l’art et les importations étrangères décevront Mauclair, il en résultera une fragmentation de cette unité utopique.
Mais quelle est vraiment cette personnalité qui se déclare anarchiste et internationaliste dans sa jeunesse puis se rapproche du socialisme avant d’affirmer sa foi dans le catholicisme et s’impliquer dans le nationalisme ? Pourquoi cette figure des lettres françaises a-t-elle tant préoccupé les historiens (notamment les historiens de l’art) et les littéraires ? Et pourquoi a-t-elle si longtemps et si largement été un paradigme pour représenter tous les maux d’avant-guerre ? Patrick McGuinness voit en Mauclair un cas « d’ extrémisme transférable », de gauche à droite19. Quelques années plus tôt, l’historien Simon Epstein le considérait comme le type même du dreyfusard qui s’était plongé, au fil des ans, dans les eaux profondes de la réaction en France, alors que la sociologue Gisèle Sapiro le situe dans la lignée des professionnels par excellence qui avaient le profil de collaborateurs20. Ces études ont le mérite de montrer non pas un parcours erratique, mais plutôt le parcours d’une génération possédant les caractéristiques de la classe moyenne, des goûts bourgeois et une professionnalisation qui lui permet de manœuvrer au sein des réseaux intellectuels de la Troisième République.
Camille Laurent Célestin Faust, dit Camille Mauclair (1872–1945), est l’un des auteurs qui compte non seulement parmi les plus prolifiques mais aussi parmi les plus lus de son temps. Il a su saisir toutes les occasions que lui offrait la République des lettres et investir sa curiosité des débuts dans différents genres : la poésie, le roman, l’essai et la critique. Son véritable souhait était cependant de s’affirmer dans la critique d’art, qui le fascinait. Sa collaboration au Mercure de France donnera à sa signature sa légitimité, alors que son activité de conférencier, notamment en Belgique et en Angleterre à ses débuts, mais aussi en Bohême et plus tard en Italie, lui conférera très vite une réputation transnationale. De ce fait, il est considéré en son temps comme l’un des critiques français les plus pertinents, ce qui contraste avec l’historiographie récente dans laquelle il est plutôt connu pour ses positions antisémites et réactionnaires des années trente. En effet, la carrière et le parcours de ce critique pointu entreront dans une nébuleuse que les interprétations d’une histoire de l’art forgée par des critères absolutistes entre bon et mauvais critique, entre critique progressiste et critique conservatrice, ne suffisent plus à interpréter21.
En France, le lecteur devra attendre les années 1990 pour retrouver le nom de Mauclair parmi les critiques qui ont marqué l’historiographie de l’art, notamment dans La Promenade du critique influent et la notice rédigée par Constance Naubert-Riser22. Cité en 2005 parmi les écrivains symbolistes dans l’ouvrage de Françoise Lucbert Entre le voir et le dire23, le nom de Camille Mauclair commence alors à apparaître timidement dans le champ de l’histoire de l’art en France, mais seulement en tant que critique du symbolisme. En 2009, deux études qui se situent dans une perspective plus large lui sont consacrées : Dominique Jarassé rédige une notice analytique du critique dans le Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale24, alors que Pierre Vaisse signe un article célèbre dans lequel les questionnements portent sur les liens des écrits de Mauclair avec l’antisémitisme et l’Occupation25. Parallèlement, l’émergence des études sur la critique d’art en France depuis la fin des années 1990, à travers des thèses ou, plus récemment, à travers la recherche dans le numérique intégrée aux programmes universitaires26, a précisément favorisé non seulement le réexamen de ce champ d’étude par de jeunes chercheurs mais aussi la révélation d’un terrain épistémologique examiné jusqu’alors d’un point de vue plutôt stylistique. Ainsi, l’ergographie complète de l’auteur fait également partie de la Bibliographie des critiques d’art francophones de Marie Gispert et Catherine Méneux27.
Dans un registre global, avant que les œuvres du critique ne deviennent un objet d’études convoité en France, le nom de Mauclair apparaît dans les études anglo-saxonnes des années soixante-dix portant sur le mouvement symboliste et le culte des « French studies ». Une histoire biographique, caractérisée par des découpages bruts et inexplicables, est alors forgée : à la lecture des quatre thèses de doctorat de troisième cycle consacrées à Mauclair de 1973 à 199328, deux constats apparaissent surprenants : d’une part, le choix d’étudier et d’approfondir seulement la partie précoce de sa vie et de son œuvre, quel que soit le point de vue épistémologique ; d’autre part, pour ce qui concerne le contenu des travaux, le choix de garder ses distances par rapport aux idées politiques de l’auteur, inextricablement liées à son œuvre.
Bien qu’il ait le mérite d’intégrer la critique d’art dans le grand récit de l’histoire de l’art, l’historien de l’art John Rewald n’échappe pas aux découpages que le modernisme avait survalorisés. Sa position sur les artistes qui ont, selon lui, forgé l’art moderne suffit à donner durablement une vision dualiste de l’art et de la critique issue de cette période. Ses commentaires voyaient en Gauguin, Pissarro et Toulouse-Lautrec des artistes majeurs, alors que « des artistes mineurs, tels Carrière, de Groux et Hodler », étaient « inexplicablement admirés29 » par Camille Mauclair. Même si l’on sait aujourd’hui que ces derniers comptaient parmi les véritables protagonistes de leur temps, le commentaire de Rewald suffit pour placer Mauclair parmi les « conservateurs » de l’art moderne. De plus, l’historien de l’art américain regrettait la disparition prématurée du Mercure de France du critique Albert Aurier, qui avait fait place au conservatisme et à « l’hostilité » de Mauclair. Durant une période où les héros du modernisme, généralement masculins, ne descendaient pas de leur piédestal, toute voix de contestation était perçue comme mauvaise, même si elle provenait de leur propre temps historique. Dans Histoire des Droites, Pierre Vaisse analyse cette approche qui régnait depuis longtemps dans certains courants historiographiques, selon laquelle l’art moderne est « de gauche par nature ». Il mentionne la célèbre citation d’Apollinaire sur « l’opposition entre l’immobilisme et le mouvement, l’attachement au passé et la modernité, l’ordre et l’aventure30».
Comme le rappellent Charle et JeanPierre en ce qui concerne la vie intellectuelle en France, il ne faudrait plus se limiter à « des logiques classificatoires ou des oppositions binaires commodes pour l’ordonnancement des phases de l’histoire transformées en rubriques de manuel ou en articles d’encyclopédie »31. Réduite pour longtemps à des récits absolutistes qui valorisaient les analyses formalistes de style ou les approches manichéennes entre écrivains majeurs et écrivains mineurs, la critique d’art en est venue à introduire des questionnements plus pertinents et à réconcilier les idées sociales, afin de produire une histoire des cultures et de ses producteurs. En 1995, l’historienne américaine Romy Golan ouvre de nouvelles voies interprétatives à la critique d’art de Mauclair en étudiant la contribution de ce dernier au discours nationaliste et antisémite de son époque32, même si elle fait du critique, à son insu, un bouc émissaire de la culture française d’avant-guerre. Mais comment lire – ou plutôt relire – aujourd’hui les écrits d’un homme de lettres qui a sans aucun doute largement contribué à la décrépitude de la critique par ses thèses extrêmes, que ce soit l’antisémitisme, le racisme ou, bien évidemment, le nationalisme ? En France, la réédition des écrits de certains auteurs controversés a récemment suscité des débats houleux dans la presse. Le plus connu porte sur l’éventuelle réédition des pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline chez Gallimard. L’annonce de cette publication en pleine période d’intensification de la haine contre les Juifs en France, peu de temps après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher en 2015, a renforcé la méfiance que même le nom de l’historien Pierre Assouline dans l’introduction n’avait pas réussi à apaiser. Une lettre ouverte adressée par le délégué interministériel au président des Éditions Gallimard fera part de cette inquiétude, reportant ainsi la réédition de l’ouvrage à une date indéterminée33.
L’aspect réactionnaire et raciste des écrits tardifs de Mauclair a suscité, au fil du temps, une gêne chez les chercheurs, qui optent pour le silence plutôt que l’historicisation, la contextualisation et la révision critique. Tel est le cas de deux monographies sur Mauclair, l’une de Simonetta Valenti en 200334, l’autre de Rosemary Yeoland en 200835. Cette dernière fait notamment référence, dans l’introduction de son étude musicale consacrée à l’auteur, au « soupçon de collaboration » qui pesait sur Mauclair. Dans l’avant-propos de l’ouvrage, même s’il souligne la spécificité d’une telle position, Guy Ducrey soutient l’auteur dans sa démarche36. Faudrait-il alors dissocier la production antérieure de l’écrivain, opérer un tri et occulter les aspects politiques, afin de ne pas aborder les sujets sensibles ? C’est là bien sûr une question rhétorique, car Mauclair, qui n’est qu’un maillon dans la chaîne d’un réseau de penseurs et de professionnels de la Troisième République troublée à la suite de l’affaire Dreyfus, offre précisément la possibilité de plonger au cœur d’une période à multiples facettes. De gauche ou de droite, dreyfusards ou antidreyfusards, la grande majorité des acteurs de l’époque prennent position, directement ou non, par leurs publications, leurs jugements, leurs choix ou leurs refus, leurs préférences, ou encore leurs silences. Il est donc impossible et anhistorique de dissocier les idées sous-jacentes derrière la critique d’art de la critique d’art elle-même. Le « cas » Mauclair appartient à ceux dont l’histoire d’après-guerre a fait des boucs émissaires, sans se rendre compte qu’il ne s’agissait pas d’exceptions, mais plutôt de l’ordre canonique d’un entre-deux-guerres complexe qui a abouti à des idées racistes et à des actes de violence.
Dans cette lignée, le qualificatif d’antimoderne, d’abord introduit pour la littérature par Antoine Compagnon puis pour l’histoire de l’art par Neil McWilliam, nous paraît davantage ancré dans son époque. Malgré la nébuleuse du terme pour Compagnon, qui y fait entrer un vaste éventail d’hommes de lettres et de critiques du xixe siècle jusqu’alors considérés comme modernes, l’auteur parvient à révéler un aspect caché de l’histoire de l’époque, à savoir la méfiance à l’égard de la nouveauté, le rejet des Lumières et le pessimisme37. Pour McWilliam, la figure antimoderne fonctionne non pas en contradiction mais avec les conservateurs et les réactionnaires. Ce sont des hommes de plume qui ont porté les idéaux de la nation et de la catholicité alors que « le triple coup infligé à l’ordre traditionnel – par la laïcité, la démocratie et le capitalisme industriel – est censé remettre en cause la cohésion sociale »38.
Plus qu’aucun autre critique de son temps, Mauclair a su placer la question de l’art national au centre de ses recherches. Mais loin de lui appartenir exclusivement, ce repli sur l’inquiétude de redécouvrir les véritables racines de l’art « français » semble transposer dans le domaine des arts un débat engagé deux décennies plus tôt, avec le célèbre « Qu’est-ce qu’une nation ? » d’Ernest Renan (1882). C’est la question « Qu’est-ce qu’un art national ? » qui semblait à présent émerger. C’est pourquoi il est, selon nous, essentiel que l’étude de Camille Mauclair critique et historien de l’art dépasse une approche esthétique et formaliste de ses critiques d’art, approche qui l’intégrerait automatiquement dans ce que Jean-Paul Bouillon a appelé le culte du « bon » critique issu du « grand » écrivain39. Par ailleurs, il nous paraît important de montrer comment émergent les questions sur l’identité nationale et les tendances antirépublicaines ou nationalistes, non seulement dans sa critique d’art, mais aussi dans son discours au cours de ses différentes fonctions administratives, à savoir les fonctions de lauréat de l’Académie Française (1925) et de Président des Critiques d’art français (1929).
En ce qui concerne les représentations, le réalisme et la question de la figure ou de l’art figuratif sont des constantes dans le système de taxinomie des mouvements par Mauclair, taxinomie souvent floue mais enracinée dans des critères ethniques. Le réalisme est pour l’auteur une valeur nationale en l’honneur de laquelle il lance de longs débats ou des querelles dans la presse afin de le préserver. Sous l’impulsion de la révision des importations étrangères depuis la fin de 1890, le réalisme est chez lui un acte de défense d’une certaine tradition française et de préservation d’un système des arts en voie de disparition sous la pression des secousses engendrées par le capitalisme et le marché de l’art. La question du classicisme émerge ainsi dans la première décennie du xxe siècle comme une importante variante française de la nébuleuse réaliste des mouvements modernistes. Des éléments royalistes, catholiques, nationalistes et conservateurs souvent liés à l’Action française parviennent à infiltrer ce classicisme réinventé, dont Mauclair se servira pour élaborer sa propre version de la droite radicale qui était déjà d’une ampleur considérable40.
Résumé des informations
- Pages
- 474
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9782875748478
- ISBN (ePUB)
- 9782875748485
- ISBN (Broché)
- 9782875748461
- DOI
- 10.3726/b21324
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Juin)
- Mots Clés (Keywords)
- Mauclair critique critique d’art nationalisme art moderne antimodernisme Barrès revues d’art antisémitisme réactionnaire marchand XIXe siècle
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford 2024. 474 pp., 18 ill. a colori, 36 ill. b/n.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG