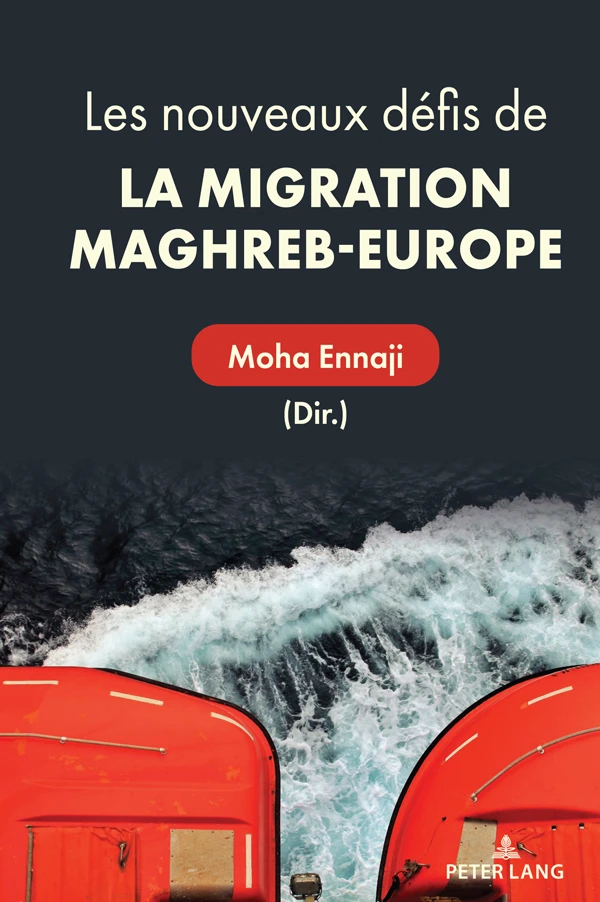Les nouveaux défis de la migration Maghreb-Europe
Résumé
L’ouvrage invite au dialogue entre les gouvernements, la société civile et le monde académique en vue de parvenir à une meilleure compréhension de la relation entre les migrations, le développement et la diversité culturelle. Il appelle tous les acteurs à adopter de nouvelles stratégies et mesures à même de garantir les droits des migrants. Enfin le livre préconise le renforcement et l’élargissement des échanges entre les pays du pourtour méditerranéen dans les domaines de la migration et du développement afin de promouvoir la coopération et le partage.
Extrait
Table des matières
- Cover
- Title
- Copyright
- A propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Dedication
- TABLE DES MATIÈRES
- Introduction
- PREMIÈRE PARTIE ètudes comparatives sur les nouveaux flux migratoires
- Chapitre 1 Le nouveau Pacte Européen sur la migration, l’asile et le drainage des compétences et des talents marocains par l’UE : quels enseignements ?
- Chapitre 2 Le défi de la migration irrégulière dans l’espace euro-méditerranéen : pour une gestion concertée des flux migratoires
- Chapitre 3 La lutte contre l’immigration irrégulière et les impératifs des droits humains : le cas du Maroc et de l’Espagne
- Chapitre 4 La lutte contre la traite des femmes subsahariennes migrantes : un nouveau défi de la migration en Tunisie
- Chapitre 5 Le Pacte mondial de Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et régulière : une réponse crédible aux défis migratoires ?
- Chapitre 6 L’émigration vue sous le double angle du développement local et/ou de la catastrophe humanitaire
- Chapitre 7 Les Maghrébins en Europe : entre identité et modernité
- Chapitre 8 Immigration et religion : faut-il avoir peur de l’Islam ?
- Chapitre 9 L’amazighité et l’immigration en France : transformation des liens sociaux et productions d’identités
- Chapitre 10 Le devenir du dialogue interculturel comme antidote au « choc des civilisations » et au terrorisme globalisé d’inspiration islamiste
- DEUXIÈME PARTIE L’apport de la littérature : récits et témoignages
- Chapitre 11 Le rêve d’un lieu démocratique dans Partir de Tahar Ben Jelloun
- Chapitre 12 Le « voyage » de Kenza à la recherche d’elle-même
- Chapitre 13 Abdellatif Laâbi : une seule langue ne suffit pas pour écrire
- Khadija et Roland : circonstances, évolution d’un mariage mixte
- Chapitre 15 Hommage au grand écrivain Tahar Ben Jelloun
- Chapitre 16 Entretien avec Tahar Ben Jelloun
- Biographie des auteurs
- Index
Introduction
Moha Ennaji
Ce collectif, auquel participe des experts nationaux et internationaux dans le domaine de la migration, vise d’une part, à mettre en évidence les causes et les conséquences des flux migratoires dans la région méditerranéenne et nord- africaine et leur impact aux niveaux culturel, social et économique, et d’autre part, à identifier les meilleurs moyens de consolider le co-développement durable et le dialogue interculturel. Il a également pour objectif de cerner les nouveaux défis de la migration qui se posent dans cette région du monde et à proposer une meilleure approche afin de développer et d’approfondir les échanges et la communication entre les pays d’origine et d’accueil.
Les différents chapitres du livre traitent des défis de l’intégration et proposent un dialogue fructueux comme antidote à tous les extrémismes. Il est abordé dans cet ouvrage collectif les sujets suivants : 1.) le nouveau pacte européen sur la migration, l’asile et la fuite des cerveaux ; 2.) le défi de la migration irrégulière dans l’espace euro-méditérranéen ; 3.) la situation des migrants sub-sahariens ; 4.) les droits des migrants et la lutte contre la traite des femmes sub-sahariennes ; 5.) le contexte méditerranéen et la diversité culturelle ; 6.) l’Islam, l’islamophobie, l’identité et l’éducation en Europe ; 7.) le rôle de l’échange culturel dans la communication et le développement ; 8) l’écriture et les écrivains de la diaspora ; 9.) la migration, la jeunesse et la réforme sociale.
Le point fort de ce livre est l’accent qui est mis sur la problématique des nouveaux flux migratoires externes, et leur impact sur la société et le développement humain. Il s’agit ici de proposer des stratégies cohérentes, permettant de promouvoir le développement durable et le dialogue entre les pays du Sud et ceux du Nord. Aussi, il plaide en faveur de la mise en œuvre du Pacte mondial de Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et régulière.
L’ouvrage invite au dialogue entre les gouvernements, la société civile et le monde académique en vue de parvenir à une meilleure compréhension de la relation entre les migrations, le développement et la diversité culturelle. Il appelle à l’adoption de nouvelles stratégies et mesures migratoires qui soient adéquates et qui puissent garantir les droits des migrants. Il préconise aussi le renforcement et l’élargissement des échanges entre les pays du pourtour méditerranéen dans les domaines de la migration et du développement afin de promouvoir la coopération et le partage.
La problématique de la migration et de la diversité culturelle s’impose d’autant plus que les particularismes et les irrédentismes identitaires et religieux sont encore souvent source de plusieurs conflits de par le monde. Il paraît donc utile voire impératif de favoriser un dialogue soutenu et fort entre les cultures et les religions, d’où le souci d’opérer une jonction entre le religieux et le culturel dans cette approche.
Les conflits et la violence dont souffrent plusieurs pays confortent la nécessité de ce dialogue. C’est précisément parce que le climat est tendu, que l’excès de langage est devenu la règle et que la confusion entre concepts et notions à connotation religieuse est entretenue, qu’il faut approfondir le débat, par des discussions et la confrontation d’idées sur les cultures, les civilisations et les religions.
Si l’acceptation de l’idée du dialogue peut paraître théoriquement facile à faire admettre pour les élites et les décideurs, elle reste, en revanche, difficile à faire partager auprès des masses. Ainsi, un travail en profondeur sur le plan pédagogique devrait être réalisé par les Etats, les associations, les médias et tous ceux et celles qui aspirent à vivre en paix et en harmonie malgré leurs différences culturelles et identitaires respectives.
Ce volume souhaite enfin faire la promotion d’une stratégie culturelle à même de remédier aux lacunes des systèmes d’éducation et de formation en vigueur. L’un de ses objectifs principaux est de réfléchir à des mécanismes communs qui prennent en compte les intérêts de toutes les parties concernées pour gérer en toute sérénité les flux migratoires. Il discute des moyens à mettre en place afin de promouvoir une gestion efficiente par ces derniers dans le cadre d’une étroite concertation entre les pays des deux rives de la Méditerranée occidentale.
Les auteurs adoptent une approche multidisciplinaire, globale et intégrée de la
question migratoire. Aussi, une approche qui privilégie la dimension humaine et socioéconomique, et qui opère une corrélation étroite entre la lutte contre la migration clandestine et la préservation des droits et des acquis des individus qui sont légalement établis dans les pays d’accueil. Au cœur de la question de la migration se trouve une dimension humaine et culturelle de même que de développement socio-économique.
L’ouvrage se décline en deux parties et dix-sept chapitres. La première partie présente des études comparatives sur les nouveaux flux migratoires alors que la deuxième réunit des textes sur l’apport de la littérature illustrée de récits et de témoignages de la part d’éminents écrivains. Le premier chapitre est réalisé par Abdelkrim Belguendouz et porte sur « Le nouveau pacte européen sur la migration, l’asile et le drainage des compétences et des talents marocains sur l’UE ». L’auteur tire les enseignements nécessaires de cette expérience et appelle chaque pays à élaborer un programme national de la recherche en la matière, fournissant des réponses articulées aux défis et enjeux migratoires propres à la région euro-méditerranéenne.
Le deuxième chapitre est écrit par Mohamed Khachani et discute du défi de la migration irrégulière dans l’espace euro-méditérranéen. L’auteur défend une gestion concertée des flux migratoires et appelle tous les partenaires à « donner un sens plus concret au 3ème volet de la déclaration de Barcelone, le volet social, humain et culturel. » Aussi, il défend la création, dans le cadre du partenariat euro-marocain, d’«un cadre contractuel pour une immigration réglementaire ». Pour le chercheur, la question migratoire dans l’espace euro-méditerranéen ne saurait se résoudre unilatéralement. Le Maghreb comme l’Union Européenne (UE) doivent collaborer, en tant que partenaires, et « œuvrer pour une gestion concerté des flux migratoires à travers le dialogue. »
Le chapitre de Diachari Poudiougo met l’accent sur l’immigration subsaharienne au Maroc et en Espagne et discute de la nécessité de protéger les droits des immigrés. Pour l’auteur, cette immigration est le résultat des crises socio-économiques, des conflits armés et des inégalités sociales de plus en plus croissantes entre le Nord et le Sud « comme conséquence de la mondialisation et l’échec de l’intégration africaine. » Il plaide en faveur d’une humanisation de la gestion des flux migratoires irréguliers et de l’implication des associations de défense des droits humains et de la société civile dans la protection des droits des migrants.
Bouthaina Ben Kridis se penche sur la traite humaine des femmes sub- sahariennes en Tunisie. Selon l’auteure, pour l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des femmes migrantes subsahariennes en Tunisie, une collaboration est indispensable entre le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, les départements ministériels, les médias, la société civile et les organisations internationales. En outre, l’application de la loi anti-traite de 2016 nécessite un engagement à travers des activités de sensibilisation et de prise de conscience pour aider le public et les parties prenantes à lutter contre ce phénomène et ses différents aspects.
Alberto Tonini revient sur la conférence intergouvernementale qui a porté sur les migrations et qui s’est tenue sous les auspices des Nations Unies à Marrakech, au Maroc, le 10 décembre 2018. L’auteur défend une migration sure, ordonnée et régulière pour parer aux dangers de l’immigration clandestine. Il propose l’implémentation du Pacte mondial en établissant des plans de mise en œuvre des lois organiques efficientes, en particulier en ce qui a trait à la conception et au financement. A défaut de cette mesure, l’application du « mécanisme de renforcement des capacités » mentionné dans le Pacte restera lettre morte.
Le chapitre de Madina Bourana Touré soulève la question de l’émigration vue sous le double angle du développement local et/ou de catastrophe humanitaire. L’auteure y recommande de renforcer la lutte contre la migration irrégulière qui fait chaque année de nombreuses victimes. Selon elle, une politique de coopération économique Nord-Sud adaptée aux réalités du terrain pourrait aboutir à des résultats plus bénéfiques pour tous les partenaires qu’une politique sécuritaire répressive. Elle souligne que les échanges interculturels engendrent également des gains multilatéraux, sociaux, économiques et humains.
Le chapitre de Moha Ennaji, intitulé « Les Maghrébins en Europe : entre identité et modernité », préconise une approche globale et intégrée de la question migratoire, une approche qui privilégie le respect de la diversité culturelle et de la dimension humaine et socio-économique et qui opère une corrélation étroite entre la lutte contre la migration clandestine et la préservation des droits et des acquis des immigrés réguliers. Par ailleurs, il soutient qu’il est essentiel de se pencher sur les conditions socioculturelles, linguistiques et éducatives des jeunes issus de l’immigration maghrébine en Europe, et de garantir la transmission culturelle à travers la langue maternelle.
Abderrahman Tenkoul aborde la problématique de la religion et de l’islamophobie en Europe. Tout en critiquant certains médias et milieux politiques qui instrumentalisent la religion des immigrés maghrébins à des fins électorales, l’auteur plaide pour une immigration ordonnée, pleinement assumée et élevée au rang de valeur ajoutée, car elle représente « une chance inouïe pour échapper à l’uniformisation et au repli identitaire ». Il encourage fortement à bâtir des sociétés tolérantes et ouvertes sur le monde.
Le chapitre de Didier Le Saout, sur l’affirmation identitaire amazighe et l’engagement associatif en France, nous informe du fait que les migrants maghrébins qui agissent dans l’espace public expriment un désir de reconnaissance en construisant des symbolisations qui leur permettent de s’inscrire dans des logiques d’intégration à la fois, dans la société française et dans les sociétés marocaine et algérienne.
Le chapitre rédigé par Jilali Saib et intitulé « Le devenir du dialogue interculturel comme antidote au « choc des civilisations » et au terrorisme globalisé d’inspiration islamiste » plaide pour que toute réforme et tout changement incluent « le rejet de toutes les formes de discrimination et d’exclusion », de même que pour une adhésion franche aux principes du discours interculturel. De la même manière, il exhorte au respect des principes consacrés dans la charte et dans les autres conventions universelles de l’ONU relatifs aux droits humains, à la paix mondiale et au respect des cultures et civilisations du monde.
Juliane Tauchnitz traite du projet migratoire et du rêve d’un lieu démocratique dans le roman Partir de Tahar Ben Jelloun. Le dernier chapitre du roman met en lumière le fait que c’est la littérature qui engendre la souffrance des personnages migrants car l’écriture rend durable une situation qui est fugitive. Ainsi, le rêve de quitter le pays d’origine se butte à de nombreux obstacles et le retour des personnages vers un lieu qui soit réellement démocratique ne reste (encore) qu’une fiction.
Le chapitre d’Enza Palamara concerne le sujet de la migration et du voyage en quête de l’identité et du bien-être. Il aborde le roman de Cécile Oumhani intitulé Une odeur de henné dont l’héroïne Kenza, est une jeune médecin qui vit dans un village tunisien. Le roman dresse l’itinéraire de Kenza qui a immigré en France et qui a lutté afin de s’affirmer au-delà des contraintes sociales et des circonstances socio-culturelles. Ce parcours se révèle comme « un vrai combat d’ordre culturel, mais aussi existentiel, spirituel même. »
Arturo Dávila Sanchez nous parle de la poésie de l’écrivain franco-marocain, Abdellatif Laâbi installé en France, et notamment de son œuvre, « Une Seule Langue ne Suffit pas pour Ecrire ». D’après l’auteur, « malgré l’exil, Laâbi reste attaché à son pays natal. Et dans les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse au Maroc on retrouve les sources de son inspiration poétique ». On pourrait même dire qu’à travers sa poésie, ce poète n’a jamais quitté le Maroc.
Jean-Marie Simon relate l’histoire d’un mariage mixte, celui de Khadija et de Roland, auquel il a assisté en personne. Le couple, qui est installé en France où il vit en parfaite harmonie, est pour l’auteur un bon exemple du vivre ensemble et des liens tissés entre le Maroc et la France.
Le texte de Nouzha Skalli est un hommage à l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun et à son œuvre littéraire. Il met en exergue la lutte que mène l’écrivain pour les droits des migrants, l’égalité des sexes et le respect de la diversité linguistique et culturelle.
Enfin, Moha Ennaji nous fait part d’un entretien récent qu’il a eu avec l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun et au cours duquel ont été abordés tour à tour, les sujets relatifs à la migration, l’identité culturelle et le problème de l’écriture. Le but étant de cerner les idées de l’écrivain sur le phénomène migratoire et l’impact de celui-ci sur les sociétés d’origine et les sociétés d’accueil.
· 1 · LE NOUVEAU PACTE Européen sur la migration, l’asile et le drainage des compétences et des talents marocains par l’UE : quels enseignements ?
Abdelkrim Belguendouz
Ambitionnant de réformer la politique migratoire de l’Union européenne (UE) en l’harmonisant et en la rationalisant, après plusieurs années d’atermoiements européens, la Commission européenne a finalement rendu publique le 23 septembre 2020, le projet très attendu d’un nouveau Pacte européen sur l’immigration et l’asile, sous la forme d’un «paquet » de quelques 500 pages comprenant une communication, cinq propositions de règlements, trois recommandations et différents textes contenant des lignes directrices. Ce document est adressé aux autres institutions de l’UE (Parlement européen, Conseil européen, Comité économique et social européen et Comité des régions) pour adoption. Constituant en quelque sorte une synthèse de celui-ci, nous nous focaliserons ici davantage sur la « communication de la Commission européenne relative à un nouveau Pacte de l’UE sur la migration et l’asile » (COM-2020-609 final), avec fournissant en annexe, la feuille de route relative à sa mise en œuvre. Notre lecture critique tiendra compte aussi du débat mené jusqu’ici sur ce pacte, et reflété par une partie de la bibliographie jointe à la présente contribution.
Résumé des informations
- Pages
- XII, 278
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9781636677118
- ISBN (ePUB)
- 9781636677125
- ISBN (Relié)
- 9781636677101
- DOI
- 10.3726/b21311
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Novembre)
- Mots Clés (Keywords)
- Migration Maghreb Europe Sahel Afrique Méditerranée défis
- Publié
- New York, Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, Oxford, 2024. XII, 278 pp., 1 b/w ill., 1 b/w table.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG