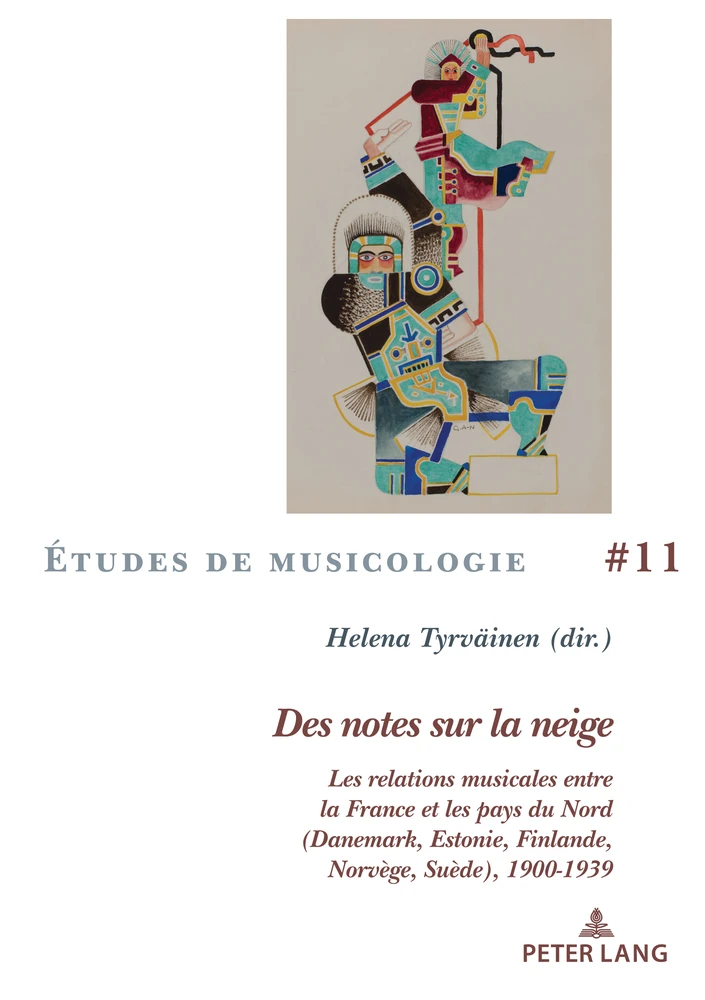Des notes sur la neige
Les relations musicales entre la France et les pays du Nord (Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Suède), 1900-1939
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Préface (Myriam Chimènes)
- Introduction (Helena Tyrväinen)
- Conceptions françaises et réseaux transnationaux à Paris
- Les Nordiques vus par les Français au tournant du xxe siècle (Régis Boyer)
- Les relations nordiques de Vincent d’Indy : musiciens, littérateurs, élèves (Manuela Schwartz & Gilles Saint Arroman)
- Magnus Synnestvedt : du politique à l’esthétique chez un intermédiaire norvégien et ami de l’avant-garde parisienne, 1902-1908 (Jann Pasler)
- Séjours à Paris
- « C’est ici que ça se passe ! » Quatre jeunes compositeurs suédois à Paris en 1920 (Anders Edling)
- La pâle absinthe de Montparnasse ? Le jeune Knudåge Riisager et la France (Claus Røllum-Larsen)
- Carl Nielsen et Paris (Knud Ketting)
- Inspiration française
- « Une œuvre religieuse dans le vrai sens du mot ». Le rôle du plain-chant dans la musique d’orgue symphonique de Charles-Marie Widor et d’Otto Olsson (Sverker Jullander)
- Sibelius et la musique orchestrale française dans le contexte de la tradition symphonique germanique (Veijo Murtomäki)
- La musique française dans la vie musicale estonienne des années 1920 et 1930 (Urve Lippus)
- Les origines d’un style : le compositeur finlandais Uuno Klami (1900-1961) et la France (Helena Tyrväinen)
- Les auteur.e.s
- In dex des noms
- Annexe. Discours d’ouverture d’Henri Dutilleux le 5 mai 1999 au colloque « La France dans la musique nordique – Relations musicales franco-nordiques de 1900 à 1939 », l’Institut finlandais, Paris.
- Titres de la collection
Helena Tyrväinen (dir.)
avec la collaboration de Jean Gribenski et Daniel Grimley
Des notes sur la neige Les relations musicales entre la France et les pays du Nord (Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Suède), 1900-1939

Bruxelles - Berlin - Chennai - Lausanne - New York - Oxford
Illustration de la couverture:
GAN (Gösta Adrian Nilsson), « Un homme et une femme dansants » (Dansande man och kvinna). Esquisse pour les costumes du ballet inachevé La Mer glaciale (Ishavet) de Gösta Nystoem. Nationalmuseum, Stockholm. @Kuvasto 2024.
Tous droits réservés.
Cette publication, toutes parties incluses, est protégée par le droit d’auteur. Toute utilisation sans l’autorisation de la maison d’édition, en dehors des limites strictes de la loi sur le droit d’auteur, est passible de poursuites. Ceci s’applique en particulier aux reproductions, traductions, microfilms, ainsi qu’au stockage et au traitement dans des systèmes d’extraction électroniques.
© 2024 Peter Lang Group AG, Lausanne
Peter Lang Éditions
Scientifiques Internationales -
P.I.E., Bruxelles, Belgique
info@peterlang.com http://www.peterlang.com/
ISSN 2031-2431
ISBN 978-3-0343-4918-5
ePDF 978-3-0343-4919-2
ePub 978-3-0343-4920-8
DOI 10.3726/b22200
D/2024/5678/43
Information bibliographique publiée par Die Deutsche Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek répertorie cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site http://dnb.d-nb.de.
À propos de l’auteur
Helena Tyrväinen est musicologue et chercheure à l’Université de Helsinki où elle a soutenu sa thèse de doctorat sur l’influence française dans la musique du compositeur finlandais Uuno Klami. Elle a pratiqué des études à Columbia University et à l’École Pratique des Hautes Études. Ses travaux portent sur les relations musicales franco-nordiques lors de la Troisième République française.
À propos du livre
Les productions artistiques d’Europe du Nord – littérature, peinture, mais aussi musique – sont une grande source d’inspiration et d’innovation dans la France de la fin du XIXe siècle. Dans le Nord, la France incarne, pendant quelques temps, un contrepoint à l’hégémonie germanique. Cet ouvrage traite de l’évolution jusqu’ici mal connue des relations musicales franconordiques et ses implications artistiques au cours des premières décennies du XXe siècle, une période marquée par de grands changements historicopolitiques et artistiques. Les dix essais traitent de l’art musical en France, Norvège, Suède, Danemark, Finlande et en Estonie, des réseaux transfrontaliers, de la mobilité entre la France et le Nord de l’Europe, de l’émergence des styles musicaux, et de l’accueil des oeuvres et des musiciens par la presse. Des personnages célèbres, comme Grieg, Sibelius, Nielsen, d’Indy, Widor, Debussy, Ravel, Schmitt, Stravinsky et beaucoup d’autres, sont évoqués.
« Cet ouvrage réunit dix études sur les échanges culturels musicaux entre la France et les pays nordiques pendant la première moitié du XXe siècle. L’introduction d’un contenu exceptionnellement complet et très riche définit parfaitement l’état de la recherche sur ces questions. En adoptant l’angle des parcours individuels de compositeurs majeurs (Grieg, Sibelius, Nielsen) ou moins connus actuellement, l’ouvrage apporte un ensemble d’informations et de mises en perspective tout à fait neuves. En outre, l’ouvrage apporte une documentation importante et originale sur la réception de la musique scandinave à Paris. »
Catherine Massip
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Préface
Myriam Chimènes
Depuis une trentaine d’années, les musicologues sont progressivement sortis de leur isolement et ont commencé à apporter leur tribut à l’histoire culturelle, dont le décloisonnement avec l’histoire politique est alors manifeste, et à l’histoire des relations internationales. Les collaborations entre historiens et musicologues en particulier se sont développées de manière concomitante, les premiers prenant enfin la musique comme objet de leurs recherches, les seconds élargissant pour leur part leur réflexion aux aspects sociaux et politiques. Désenclavée, la musicologie trouve ainsi pleinement sa place dans les sciences humaines. Intitulées « Musique et relations internationales », deux livraisons de la revue Relations internationales témoignent de cette remarquable évolution1. La circulation et la réception de la musique et des musiciens, compositeurs et interprètes, le nationalisme et le cosmopolitisme, les réseaux transnationaux de musiciens, les sociabilités artistiques, l’inspiration suscitée par les échanges et transferts culturels, les influences croisées, l’analyse des phénomènes d’appropriation, d’hybridation, de métissage ou d’imitation sont autant de notions qui nourrissent désormais les problématiques des musicologues. Consacré à un sujet inédit, ce livre en est une magnifique illustration. Il s’inscrit dans la lignée de travaux concernant notamment la diffusion en Europe du jazz ou des musiques latino-américaines ou encore le rôle des élèves musiciens étrangers dans la propagation de la culture française2.
Musicologue finlandaise, Helena Tyrväinen a séjourné au début des années 1990 à Paris où elle a suivi le séminaire de François Lesure à l’École Pratique des Hautes Études. Adoptant une démarche pionnière, ce dernier, fondateur et rédacteur en chef des Cahiers Debussy, avait initié des recherches sur la réception de l’œuvre de Debussy à l’étranger. C’est lui qui l’incita à s’intéresser à la réception de la musique de Debussy en Finlande, puis à entraîner dans son sillage trois de ses collègues (dont deux, Anders Edling et Claus Røllum-Larsen, contribuent au présent ouvrage) afin d’étendre le sujet à d’autres pays nordiques. Il lui offrit ainsi l’opportunité de publier dans les Cahiers Debussy, au sein d’un dossier intitulé « La réception de Debussy dans les pays nordiques », un article sur « Les origines de la réception de Debussy en Finlande (1901-1933) », paru en 20003. Entre-temps Helena Tyrväinen avait participé au projet « France in Nordic Music, 1900-1939 » et assumé la responsabilité scientifique du colloque « La France dans la musique nordique. Relations musicales franco-nordiques, 1900-1939 », organisé à Paris en 1999 et dont le contenu a jeté les bases du présent ouvrage. Mes liens avec elle se sont noués à cette époque, à la fois comme membre du comité de rédaction des Cahiers Debussy et comme présidente de la séance d’ouverture de ce colloque réuni à l’Institut finlandais. Je ne peux que rendre hommage à la persévérance et à la patience d’Helena Tyrväinen, qui a d’ailleurs déjà à son actif de nombreuses autres publications sur ce sujet. Maître d’œuvre de ce livre qui, outre la musique, touche aussi à la littérature et au théâtre, entourée de chercheurs d’horizons et de nationalités diverses, elle offre une introduction copieuse, panoramique et analytique, qui dispense à l’évidence d’en donner un résumé ici.
Conjugué à celui des bornes chronologiques de cette étude centrée sur la période charnière qui s’étend de la Belle Époque à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le choix des pays concernés est clairement explicité. On notera qu’à une exception près, la Norvège, ces « pays du Nord », Danemark, Estonie, Finlande, et Suède, font aujourd’hui tous partie de l’Union européenne. Plusieurs lignes de force se dégagent de cet ouvrage collectif, qui compte des chapitres thématiques et une majorité de chapitres monographiques, tous centrés sur les relations avec la France, plus précisément Paris. Au tournant du xxe siècle, capitale de la France, Paris est aussi considérée comme celle du monde de la culture, « la Mecque des créateurs », selon Pablo Casals, qui s’y installe en 1900 après s’être laissé dire que le centre de la musique était alors Paris. Cette attirance pour Paris n’est pas exclusivement réservée à la Belle Époque et, comme Casals, de nombreux musiciens étrangers, compositeurs ou interprètes, y élisent domicile pour des séjours plus ou moins longs : Ricardo Viñes, Georges Enesco, Manuel de Falla, Igor Stravinsky, Serge Prokofiev, entre autres, vécurent ou séjournèrent à Paris entre 1870 et 1940. Cette étude nous révèle que les musiciens venus du Nord ne dérogent pas, le séjour à Paris étant considéré comme un « rite de passage » pour tout jeune talent nordique. Le témoignage de Carl Nielsen, venu fréquemment à Paris, corrobore celui de Casals : « Le centre nerveux du monde pour la science, la littérature et l’art vibre dans cette ville, dans ce pays, dans ce peuple4 ».
Lorsque, sous l’impulsion de Vincent d’Indy, les compositeurs français sortent du protectionnisme provoqué par la défaite de 1870 et marqué par la création de la Société nationale de musique, des compositeurs nordiques sont parmi les premiers étrangers à en bénéficier : leurs œuvres sont programmées dans ces concerts à partir de 1887. Après la Première Guerre mondiale, le Conservatoire de Paris accueille, outre des Suédois et des Danois déjà présents, des élèves estoniens, norvégiens et finlandais5. Si les compositeurs les plus connus en France restent Grieg et Sibelius, on découvre avec intérêt les parcours des Danois Knudåge Riisager et Carl Nielsen, des Suédois Hilding Rosenberg, Gösta Nystroem, Moses Pergament, Viking Dahl et Otto Olsson, des Estoniens Heino Eller, Cyrillus Kreek et Mart Saar et du Finlandais Uuno Klami, autant de noms pour la plupart peu familiers voire ignorés des oreilles françaises et mis en lumière ici au prisme de leurs relations avec la France. On note d’autre part le rôle de médiateur que jouent des personnalités comme le diplomate et journaliste norvégien Magnus Synnestvedt, membre du groupe des Apaches et promoteur notamment de la musique de Debussy en Norvège, ou comme le Suédois Melcher Melchers, élève de Caussade, lié à Satie et au Groupe des Six par sa participation, pendant la Première Guerre mondiale, à l’organisation des concerts Lyre et Palette dans un atelier de Montparnasse – sans compter également le pouvoir de transmission de pédagogues comme d’Indy ou Roussel. Pour compléter l’histoire de la vitalité de ces échanges, on peut citer Jean Cathala, professeur de français installé en 1929 à Tallin où il crée un comité local de l’Alliance française, dont il développe les activités musicales, et favorise l’obtention par les étudiants estoniens de bourses accordées par l’Association française d’action artistique (AFAA)6. Par ailleurs, quelques honneurs croisés attestent de bons échanges artistiques et diplomatiques : Sibelius est décoré chevalier de la Légion d’honneur en 1900 et Nielsen promu officier du même ordre en 1926, Grieg est élu correspondant étranger à l’Académie des Beaux-arts en 1891, tandis que d’Indy, Widor et Debussy le seront à l’Académie royale de Suède en 1910.
Un fil rouge traverse ce volume : à la fin du xixe siècle, un mouvement de bascule s’opère qui conduit les musiciens du nord à échapper à l’influence austro-allemande au profit de celle de la France qui leur propose une alternative. Ce choix va de pair avec les conséquences esthétiques qui en découlent. La réflexion de Ravel, issue d’un article entretien publié en suédois à l’occasion de sa venue à Stockholm en 1926, mérite d’être soulignée. À la question : « La musique scandinave a-t-elle rencontré un écho favorable en France ? », il répond : « Je suis désolé de devoir le dire – parmi le grand public – pas vraiment. Mais ce qui m’intéresse c’est que Grieg et Svendsen semblent avoir exercé une bien plus grande influence sur la composition française que sur la simple musique scandinave7 ».
En comblant une lacune, cet ouvrage enrichit de manière substantielle et originale la bibliographie des relations culturelles internationales.
1 Voir Relations internationales 155 et 156 (2013/3 et 4) : « Musique et Relations internationales ».
2 Voir notamment Ludovic Tournès, New Orleans sur Seine. Histoire du jazz en France, Paris : Fayard, 1999 ; Anaïs Fléchet, Si tu vas à Rio. La musique populaire brésilienne en France au xxe siècle, Paris : Armand Colin, 2013 ; Marie Duchêne-Thégarid, « Les plus utiles propagateurs de la culture française ? » Les élèves musiciens étrangers à Paris pendant l’entre-deux-guerres, thèse de doctorat en musique et musicologie, Université François-Rabelais de Tours, 2015. Pour plus de détails à ce sujet, voir l’introduction d’Anaïs Fléchet et Antoine Marès à « Musique et Relations internationales I », Relations internationales 155 (2013/3), p. 3-9.
3 Voir Cahiers Debussy 24 (2000), p. 3-55.
4 Voir le chapitre « Carl Nielsen et Paris » dans le présent ouvrage.
5 Voir Duchêne-Thégarid, « Les plus utiles propagateurs de la culture française ? » Les élèves musiciens étrangers à Paris pendant l’entre-deux-guerres, p. 302.
6 Voir même référence, p. 222.
Details
- Pages
- 328
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034349192
- ISBN (ePUB)
- 9783034349208
- ISBN (Softcover)
- 9783034349185
- DOI
- 10.3726/b22200
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (January)
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 328 ., 47 ill. n/b.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG