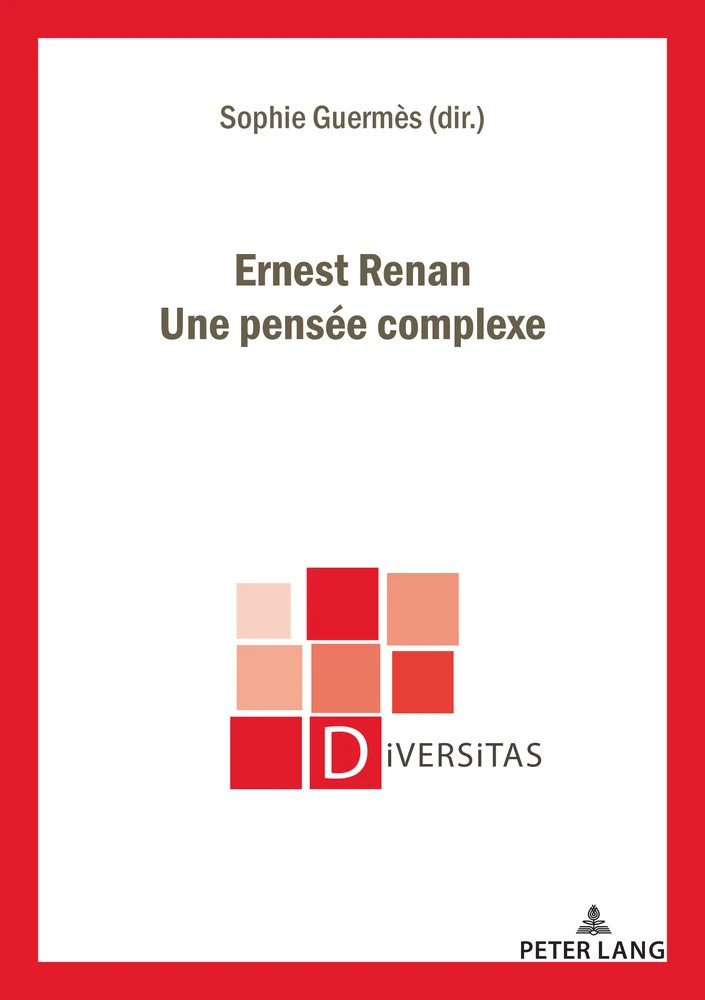Summary
prononcées lors du bicentenaire de la naissance d’Ernest
Renan à Tréguier, du 28 février 2023 (François Hartog) au
colloque des 30 juin et 1er juillet (contributions de Sophie
Guermès, André Stanguennec, Brigitte Krulic, Maya
Boutaghou, Carole Reynaud-Paligot, Tomasz Szymański,
Peter Lang Group/Publicity Form 2
Henri Le Bellec, Jean Balcou). Qu’il s’agisse de religion,
de philosophie, de littérature ou de réflexion sur la
nation, ils mettent en lumière les ambiguïtés d’un
homme non seulement « double », comme il l’avouait
lui-même, mais insaisissable, dont la personnalité et la
pensée sont loin d’être réductibles à l’image que la
postérité en a léguée.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction (Sophie Guermès)
- Ernest Renan, 28 février 2023 (François Hartog)
- « Quant à l’avenir, je n’en dis rien ». Renan, 1848 (Sophie Guermès)
- La place de Cousin et de Hegel dans la culture philosophique de Renan et dans l’évolution de ce dernier (André Stanguennec)
- Les Allemagnes d’Ernest Renan : du temple de l’idéal au Reich bismarckien (Brigitte Krulic)
- Questions et méthodes appliquées à Qu’est-ce qu’une nation ? (1882) d’Ernest Renan (Maya Boutaghou)
- Renan entre race et nation (Carole Reynaud-Paligot)
- Histoire d’une demeurée : anthropologie, théologie, mystique (Sophie Guermès)
- Ernest Renan et l’Évangile éternel (Tomasz Szymański)
- Renan et le tropisme de la mer (Henri Le Bellec)
- L’Acropole en mal de larmes. L’Acropole sans Prière (1865) (Jean Balcou)
- Bibliographie
Introduction
Université de Brest (CECJI)-Comité Renan
Le bicentenaire de la naissance d’Ernest Renan, né le 28 février 1823 à Tréguier, a été l’occasion de le relire attentivement, et aussi de le « dé-lire », pour réemployer l’expression d’Henri Mitterand commémorant en 2002 le centenaire de la mort d’Émile Zola1. Il y a une image de Renan passée à la postérité, et qui correspond à la réalité : un homme de très vaste culture, grand universitaire, sage qu’on venait solliciter au Collège de France dont il fut non seulement l’un des professeurs les plus célèbres, mais aussi l’administrateur pendant de longues années. Pilier de cette institution où il souhaita mourir, représentant de la IIIe République, chantre de la laïcité, Renan, à l’instar d’Edgar Quinet, son prédécesseur à bien des égards, a laissé une œuvre dont on retient surtout Vie de Jésus, Qu’est-ce qu’une nation ? et Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Statufié au propre (il a été sculpté dans la pierre, auprès d’Athéna, sur la place de la cathédrale de Tréguier) comme au figuré, « immortel », puisqu’il siégea à l’Académie française, il semble un bloc de granit, aisément identifiable.
Pourtant, Ernest Renan fut en perpétuel décalage, et cela correspond aussi à la réalité : séminariste qui abandonna les ordres avant de prononcer ses vœux définitifs et devint la bête noire du clergé et du monde catholique, tout en ne cessant de proclamer son amour de Jésus2 ; agrégé de philosophie mais professeur de langues sémitiques qu’il mit au service d’une enquête historique sur les origines de ce christianisme n’ayant pas suffi à donner un sens à sa vie ; Breton attaché à ses racines tout en ayant vécu la majeure partie de sa vie à Paris et revenu tard, pour quelques vacances, dans sa région natale ; auteur d’une œuvre monumentale, mais décentrée, à la fois historique, philologique et littéraire ; voulant qu’on grave sur sa tombe, qu’il aurait souhaitée dans le cloître de la cathédrale de Tréguier, « veritatem dilexi » (« j’ai aimé la vérité ») mais affirmant dans son dernier livre, Feuilles détachées : « La vérité est sourde et froide ; nos ardeurs ne la touchent pas »3 et revenant sans cesse à la fiction et à l’imagination (de Patrice à L’Abbesse de Jouarre en passant par Ernest et Béatrix et L’Eau de jouvence), en marge de ses travaux scientifiques ; se félicitant d’avoir eu une vie calme et heureuse, alors que ses lettres de jeunesse nous le montrent profondément tourmenté4. C’est sur cet aspect complexe, contradictoire, et finalement insaisissable, que les auteurs des travaux rassemblés dans ce volume ont insisté. Car l’évolution personnelle de Renan puis ses choix intellectuels impliquaient, d’une part une liberté intérieure, d’autre part un décloisonnement disciplinaire5 rendant caduque toute simplicité.
« Je suis double »6, a-t-il avoué dans Souvenirs d’enfance et de jeunesse, attirant l’attention sur sa « complexité d’origine »7. Et, dans des Fragments non publiés il affirmait : « je veux liberté de me placer successivement aux différents points de vue opposés, m’y délecter… »8. Ayant réussi à s’extraire des mailles du filet théologique où il avait été pris à son insu, il n’aimait pas les certitudes ; favorable au dialogue, il se montrait souple avec autrui. Il l’était aussi avec lui-même, jusque dans ses travaux, bien que la science ait pris en lui la place que Dieu y avait tenue pendant plusieurs années. Ainsi, dans Vie de Jésus, dont on a célébré en 2023 le cent-soixantième anniversaire9 (une parution qui en son temps fit scandale10, et un best-seller qui surpassa en ventes Les Misérables, roman paru un an plus tôt), son entreprise de reconstitution passe par de nombreuses hypothèses, des « probablement », « sans doute », des modalisations variées, qu’il a justifiées : « Si l’on s’astreignait, en écrivant la vie de Jésus, à n’avancer que des choses certaines, il faudrait se borner à quelques lignes. » Renan s’autorise donc à « faire des conjectures, à condition de les proposer pour ce qu’elles sont. […] Il n’y a guère de détails certains en histoire ; les détails cependant ont toujours quelque signification. Le talent de l’historien consiste à faire un ensemble vrai avec des traits qui ne sont vrais qu’à demi. »11 Renan se contredit donc quelque peu : il prend conscience qu’il ne peut faire œuvre absolument scientifique. En fait, il se trouve confronté aux mêmes problèmes que ceux qui, à cette époque, se posent aux romanciers réalistes. Voulant faire du vrai, il doit composer avec le vraisemblable, qui est la vérité littéraire. Il s’abandonne également à son penchant romantique, au rêve, lorsqu’il imagine Jésus : « Ce fut un charmeur. […] Il fallait faire mon héros beau et charmant, car sans contredit il le fut. »12 La fin aussi est ambiguë : après avoir farouchement nié tout ce qui ne relevait pas de la rationalité, il écrit dans le dernier paragraphe de la préface : « Malheur aussi à la raison, le jour où elle étoufferait la religion ! […] Est Deus in nobis. […] Le dernier des simples, pourvu qu’il pratique le culte du cœur, est plus éclairé sur la réalité des choses que le matérialiste qui croit tout expliquer par le hasard et le fini. »13 Cette ambiguïté se trouvait déjà à la fin de L’Avenir de la science, qui s’achevait sur ces paroles adressées à Dieu : « quoique tu m’aies trompé, je t’aime encore ! »14, puis, un an plus tard, à la fin de Patrice. On la retrouvera dans le revirement final de la préface à Feuilles détachées : « ‘Nous ne savons pas’, voilà tout ce qu’on peut dire de clair sur ce qui est au-delà du fini. Ne nions rien, n’affirmons rien, espérons. Gardons une place, dans les funérailles, pour la musique et l’encens. »15 Et : « Ne renonçons pas à Dieu le Père ; ne nions pas la possibilité d’un jour final de justice. »16 À la fin, il s’adresse encore à Dieu : « J’ai désiré ton jour et j’y crois encore. »17
« Renan ne prisait guère l’univocité », remarque François Hartog qui qualifie la Prière sur l’Acropole de « chef-d’œuvre d’ambiguïté » et insiste sur le fait qu’il y a « plusieurs niveaux d’écriture et de lecture ». Jean Balcou, analysant dans une note des feuillets écrits au moment de la découverte de l’Acropole, constate « un retournement comparable à celui concernant saint Paul ». Tomasz Szymański a relevé que, tout en prenant ses distances avec Joachim de Flore, Renan s’en rapprochait dans la préface des Souvenirs d’enfance et de jeunesse. En outre, tout en niant les miracles, dans Vie de Jésus, Renan évoque avec attendrissement, dans Feuilles détachées, le « plus touchant miracle du moyen âge ». Maya Boutaghou, établissant l’édition critique et le commentaire de Qu’est-ce qu’une nation ?, a découvert que la pensée de Renan sur la nation, « ouverte et souple », était « clairement voilée par les idées portées par La Réforme intellectuelle et morale » ; de son côté, Carole Reynaud-Paligot démontre que s’appuyer seulement sur Qu’est-ce qu’une nation ?, sans se référer à ses écrits antérieurs, « amène à la vision d’un Renan ‘anti-raciste’ peu conforme à la réalité » puisqu’il a constaté « ‘l’inégalité des races’ et par conséquent des hommes »18. André Stanguennec prouve qu’après la prise de distance avec Victor Cousin, « plusieurs points non négligeables de l’éclectisme cousinien » ont été « conservés dans la pensée de Renan » et définit celui-ci comme « un sceptique, non doctrinal mais méthodique ». On voit aussi Renan évoluer radicalement, en peu de temps, à propos de Quinet et de Michelet, considérés chacun, en 1845, comme l’antéchrist, alors que quelques mois plus tard ils suscitent de sa part la plus vive admiration. Une évolution en sens inverse l’a fait passer de la vision d’une Allemagne idéale, temple du savoir, à celle d’un « Reich bismarckien qui menace l’idée même de civilisation », selon Brigitte Krulic qui a montré que « paradoxalement, cet antidémocrate a[vait] eu recours à une argumentation profondément ‘démocratique’ – la légitimité d’une nation se fonde sur le libre-choix des populations » quand il avait dû « répondre au défi intellectuel et politique que constituait l’annexion de l’Alsace- Lorraine ». Quant aux Souvenirs d’enfance et de jeunesse, ils ont donné lieu à trop d’interprétations qui en niaient la complexité. Jean Gaulmier les qualifiait de « livre charmant » ou encore « exquis », et Le Broyeur de lin, qui ouvre le volume, de « nouvelle parfaite », n’ayant « pas de rapport direct avec la personne de Renan »19. Une étude inédite et approfondie de cette nouvelle démontre tout le contraire et invite, en conséquence, à relire l’ensemble du volume à nouveaux frais.
La proximité de la mer, connue dès la naissance, source d’un traumatisme (la noyade probablement volontaire de son père) dont il a gardé mémoire, mais aussi d’émerveillements (en Grèce ; à Ischia…), a peut-être influé sur Renan. « Toujours, où qu’elle soit, elle se dédouble » note Henri Le Bellec. « Il y a celle qu’il a sous les yeux le plus souvent en arrière-plan, à Amschit, Sour, Byblos, Antioche où il s’est assis sur le môle du port, et qu’il met en balance avec l’autre, celle de toujours qui s’est installé durablement dans son esprit, fidèle entre toutes et facilement identifiable avec ‘ses côtes hérissées de rochers, toujours battue par les orages’ ». Et « au pied de l’Acropole, à l’heure de l’hommage à la raison, c’est l’alliance de la mer et de la Bretagne que Renan, au faîte de sa gloire, célèbre d’abord ». Par contagion, l’image de Renan a aussi été tributaire de ses propres fluctuations. Dans un article paru en 1973, « Renan et Péguy », Simone Fraisse notait « une impression d’ambiguïté. On ne sait jamais où en est Péguy. On croit qu’il accable Renan et soudain il le relève. Et inversement. »20
« Qu’adviendra-t-il du conflit des nationalités européennes ? », se demandait Renan dans la préface de son dernier livre, à bien des égards testamentaire. « Quel tour prendront les questions sociales ? Sortira-t-il quelque chose du mouvement socialiste proprement dit ? Quel sera le sort prochain de la papauté ? Hélas ! je mourrai avant d’avoir rien vu de tout cela si ce n’est par conjecture, et vous, vous contemplerez ces énigmes comme des faits accomplis ! »21 Cet homme qui voulait au sortir du séminaire « organiser scientifiquement l’humanité »22 demeurait plein d’incertitudes, car la science, contrairement au Dieu de sa jeunesse, évolue, et les consciences changent, elles aussi. Les questions qu’il posait avant sa mort n’ont pas été réglées une fois pour toutes ; elles demeurent d’actualité, conservant leur part d’énigme.
1 Henri Mitterand (dir., avec la collaboration de Jean-Pierre Leduc-Adine), Lire/Dé-lire Zola, Paris, Nouveau monde éditions, 2004.
2 « L’idée qu’en abandonnant l’Église, je resterais fidèle à Jésus, s’empara de moi, et, si j’avais été capable de croire aux apparitions, j’aurais certainement vu Jésus me disant : « Abandonne-moi pour être mon disciple ». Cette pensée-là me soutenait, m’enhardissait. Je peux dire que, dès lors, la Vie de Jésus était écrite dans mon esprit. La croyance à l’éminente personnalité de Jésus, qui est l’âme de ce livre, avait été ma force dans ma lutte contre la théologie. Jésus a bien réellement toujours été mon maître. » (Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, introduction et dossier de Jean Balcou, Paris, Anagrammes, 2006, p. 180-181).
3 Ernest Renan, Feuilles détachées, Paris, Calmann-Lévy, 1892, p. X (préface).
4 Il en fait la synthèse dans ce passage des Souvenirs d’enfance et de jeunesse : « Telles furent ces deux années de travail intérieur, que je ne peux comparer qu’à une violente encéphalite, durant laquelle toutes les autres fonctions de la vie furent suspendues en moi. Par une petite pédanterie d’hébraïsant, j’appelai cette crise de mon existence nephtali, et je me redisais souvent le dicton hébraïque : naphtoulé élohim niphtalti : « j’ai lutté des luttes de Dieu. » (op. cit., p. 177).
5 C’est ce décloisonnement qui inspira à Edgar Morin la notion de « pensée complexe », même s’il ne se référait pas à Renan : loin de chercher « un principe unitaire à toute connaissance », il a voulu « indiquer les émergences d’une pensée complexe, qui ne se réduit ni à la science, ni à la philosophie, mais qui permet leur intercommunication en opérant des boucles dialogiques. » (E. Morin, Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982, p. 15). Cf. Introduction à la pensée complexe (Paris, ESF, 1990).
6 Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, op. cit., p. 109. Cela fait écho à une affirmation de la préface (« Presque tous nous sommes doubles. »).
7 Ibid.
8 Ernest Renan, Fragment, Bibliothèque nationale de France, n.a.fr. 14200, f° 171.
Details
- Pages
- 174
- Publication Year
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783034352215
- ISBN (ePUB)
- 9783034352222
- ISBN (Softcover)
- 9783034352178
- DOI
- 10.3726/b22253
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- Ernest Renan Qu’est-ce qu’une nation Religion Souvenirs d’enfance et de jeunesse Allemagne Bretagne
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 174 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG