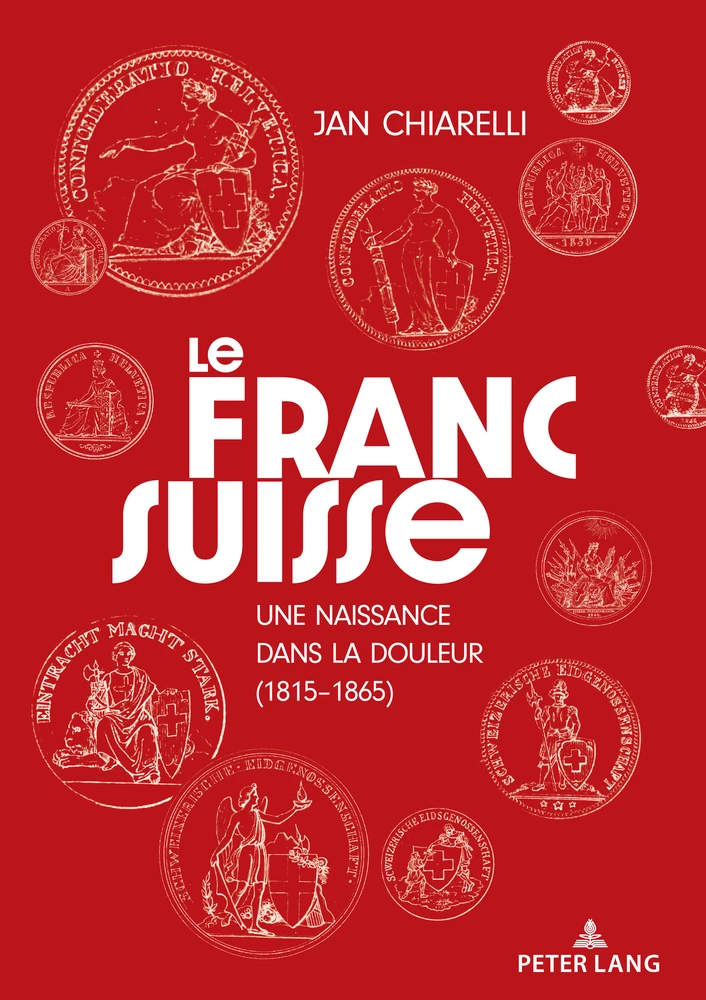Le franc suisse:
une naissance dans la douleur (1815-1865)
Summary
S’intéresser aujourd’hui aux origines du franc suisse offre l’occasion de constater qu’il n’a pas toujours eu la force et la stabilité qui font sa réputation actuelle, loin de là.
Open Access Annexes available at:
https://supplementaryresources.blob.core.windows.net/4335438-chiarelli/Annexes.pdf
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Remerciements
- Table des matières
- Liste des cartes
- Liste des graphiques
- Liste des schémas
- Liste des tableaux
- Liste des abréviations
- 1. Chapitre introductif
- 1.1. Introduction
- 1.2. Importance de la thématique et questionnements de recherche
- 1.3. Aperçu bibliographique et apports
- 1.4. Présentation des sources
- 1.5. Revendications des acteurs du débat monétaire et cadre d’analyse
- 1.6. Périodisation et structure de l’ouvrage
- Première partie: la longue marche vers l’unification monétaire (1815-1847)
- 2. L’impossible conciliation des intérêts monétaires régionaux à l’échelle fédérale (1815-1833)
- 2.1. L’Europe et la Suisse à la sortie des guerres napoléoniennes
- 2.1.1. La situation commerciale et monétaire à l’échelle européenne après 1815
- 2.1.2. Le mutisme du Pacte fédéral de 1815: la restauration de la régale monétaire cantonale
- 2.2. Intérêts et besoins monétaires divergents des cinq «mondes de production»
- 2.2.1. Les marchands-banquiers de Suisse occidentale: améliorer l’intégration au grand commerce international
- 2.2.2. Les milieux agricoles de Suisse occidentale: développer le marché intérieur
- 2.2.3. Les milieux agricoles de Suisse centrale et méridionale: partisans du statu quo
- 2.2.4. Les industriels de Suisse orientale: maintenir l’osmose économique avec les Etats allemands
- 2.2.5. Négociants et industriels de la région zurichoise: la recherche de compromis
- 2.3. Parcours des mesures d’uniformisation monétaire aux échelles fédérale et régionale (1816-1833)
- 2.3.1. Revendications multiformes et oppositions hétérogènes à la Diète fédérale (1816-1824)
- 2.3.2. L’échec du concordat monétaire de Suisse occidentale (1825-1830)
- 2.3.3. Le retrait du billon helvétique: une victoire d’endurance (1828-1833)
- 3. Pressions économiques à l’unification monétaire: luttes et désaccords sur le choix du pied monétaire (1833-1847)
- 3.1. Mutations du commerce international helvétique et revendications monétaires à l’échelle fédérale durant les années 1830
- 3.1.1. Déplacement du centre de gravité du commerce international helvétique en direction des ports de l’Atlantique
- 3.1.2. Echec de la révision du Pacte fédéral et polarisation des positions dans le débat monétaire
- 3.1.3. Le franc français pour renforcer l’intégration au commerce international contre le franc suisse pour sauvegarder le débouché allemand
- 3.2. Genève, le «Zollverein» et la Suisse: l’influence de deux réformes monétaires sur la situation fédérale
- 3.2.1. Faire face à la lenteur proverbiale des délibérations fédérales: la naissance du franc de Genève (1835-1839)
- 3.2.2. La réforme monétaire allemande (1837-1838): influences et renforcement des liens économiques en Suisse orientale
- 3.2.3. L’échec des conférences monétaires fédérales (1838-1840): l’abandon définitif des délibérations
- 3.3. Revendications croissantes et échecs persistants durant la crise économique des années 1840
- 3.3.1. Intensification des revendications, convergences et divergences sur la nécessité d’une réforme monétaire
- 3.3.2. Naissance et mort du projet de réforme monétaire zurichoise (1843-1846)
- 3.3.3. Vers la fondation de l’Etat fédéral
- Deuxième partie: la naissance du franc suisse (1848-1853)
- 4. La première étape de la réforme monétaire (1848-1849): intérêts, enjeux et stratégies des acteurs en présence
- 4.1. L’offensive des milieux marchands de Suisse occidentale: le choix du franc français comme outil d’intégration de la Suisse à l’économie mondiale
- 4.1.1. L’adoption de l’article constitutionnel sur les monnaies et la redéfinition des lieux de pouvoir à l’échelle fédérale
- 4.1.2. La nomination de Johann Jakob Speiser comme expert monétaire unique
- 4.1.3. Le rôle du rapport d’expertise de Speiser et le poids de la France dans les relations commerciales extérieures de la Suisse
- 4.1.4. La stratégie des partisans du franc: publier en masse et élargir les réseaux de soutien
- 4.2. Maintenir l’osmose économique avec les Etats du sud de l’Allemagne: la contre-offensive des milieux industriels de Suisse orientale
- 4.2.1. La défense du florin allemand entre compétitivité économique, approvisionnement en liquidités et nécessité de préserver le commerce frontalier
- 4.2.2. Réseaux d’acteurs et stratégie de défense du florin: l’alliance entre la banque, le grand négoce et les autorités politiques
- 4.2.3. Les acteurs de la banque et de l’industrie de la région zurichoise divisés sur le choix du pied monétaire
- 5. La deuxième étape de la réforme monétaire (1849-1850): les débats aux Chambres fédérales
- 5.1. Réactions divergentes des promoteurs du pied français et des défenseurs du pied allemand suite au vote au Conseil des Etats
- 5.1.1. La victoire du pied monétaire français au Conseil des Etats
- 5.1.2. La réorganisation de la stratégie de défense du florin allemand: le lancement d’une pétition
- 5.1.3. Les intérêts hétérogènes du commerce international et régional. Analyse des pétitions en faveur du pied monétaire allemand à Zurich et en Argovie
- 5.1.4. La réaction des milieux marchands de Suisse occidentale et l’intervention du consul suisse en Belgique dans les affaires helvétiques pour défendre l’adoption du franc français
- 5.2. Vers le débat au Conseil national
- 5.2.1. Les rapports des commissions et la position équivoque d’Alfred Escher
- 5.2.2. La victoire du pied monétaire français au Conseil national: la loi du 7 mai 1850 et la naissance du franc suisse
- 6. La mise en application de la réforme monétaire (1850-1853): causes et conséquences du «parasitisme monétaire» helvétique
- 6.1. Fabriquer les premiers francs suisses rapidement et à moindre coûts: direction les Hôtels des Monnaies étrangers
- 6.1.1. Le difficile équilibre entre réduction des frais et qualité des monnaies: les causes du «parasitisme monétaire» suisse
- 6.1.2. Les exigences helvétiques confrontées à la réalité du terrain: l’échec des négociations avec la Monnaie de Belgique
- 6.1.3. La frappe des premiers francs suisses en France: un processus efficace, mais insatisfaisant
- 6.1.4. Remédier à l’insuffisance du numéraire à disposition: augmentation des frappes, tarification des monnaies allemandes et cours légal aux monnaies étrangères
- 6.2. La mise en place du nouveau système monétaire suisse: le retrait des anciennes monnaies et leur remplacement par les nouveaux francs suisses
- 6.2.1. L’élaboration des tarifs de transition: noyau du passage au nouveau système
- 6.2.2. Le retrait rapide et efficace des anciennes monnaies
- 6.2.3. Valeur du retrait, livraison des nouvelles monnaies et bilan financier de la réforme
- 6.3. La naissance du franc suisse: éléments pour un bilan de la réforme monétaire
- 6.3.1. Une réforme monétaire bâloise ? Le rôle des acteurs bâlois dans le déroulement et le financement de la réforme
- 6.3.2. Les apports de l’unification monétaire à la construction de l’Etat fédéral et ses effets sur le développement économique de la Suisse
- Troisième partie: les quinze premières années d’existence du franc suisse (1853-1865)
- 7. La difficile mise en place d’une politique fédérale en matière monétaire (1853-1860)
- 7.1. Commerce, métaux et monnaies: le contexte des années 1850 et 1860
- 7.1.1. La Suisse dans l’orbite commerciale et financière française
- 7.1.2. Les bouleversements du contexte monétaire international: l’afflux de l’or sur le continent européen et la disparition de l’argent
- 7.1.3. La création de l’Hôtel suisse des Monnaies: un outil potentiel d’indépendance monétaire qui doit être rentable
- 7.2. Le changement de la législation de 1850 et le passage au bimétallisme en 1860. Exigences et besoins hétérogènes des acteurs économiques helvétiques
- 7.2.1. Assurer l’intégration de la Suisse aux marchés internationaux: des représentants du grand commerce et de la banque défendent le passage à l’étalon-or
- 7.2.2. Maintenir les activités sur le marché intérieur: union hétérogène d’acteurs de la banque, de l’artisanat et de l’horlogerie pour le maintien de l’étalon-argent
- 7.2.3. Les étapes du passage au bimétallisme en Suisse (1854-1860)
- 8. La fondation de l’Union monétaire latine (1860-1865)
- 8.1. L’unification des outils du commerce et de la communication durant les années 1860
- 8.1.1. La Suisse dans l’orbite commerciale française: la signature du traité de commerce franco-suisse de 1864
- 8.1.2. La France, fer de lance du processus d’unification des composantes du commerce international
- 8.2. L’adhésion de la Suisse à l’Union monétaire latine (1864-1865)
- 8.2.1. La situation monétaire de la Suisse au milieu des années 1860
- 8.2.2. Les exigences du Conseil fédéral: maintenir la législation monétaire de 1860 intacte
- 8.2.3. Divergences de vues entre le Conseil fédéral et les délégués helvétiques à Paris: les concessions nécessaires pour améliorer l’intégration monétaire de la Suisse aux marchés étrangers
- 8.2.4. Epilogue: la Suisse dans l’Union monétaire latine
- 9. Conclusion
- In dex des personnes
- Bibliographie
Jan Chiarelli
Le franc suisse : une naissance
dans la douleur (1815-1865)

Lausanne - Berlin - Bruxelles - Chennai - New York - Oxford
Information bibliographique publiée par Die Deutsche Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek répertorie cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site http://dnb.d-nb.de.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
A CIP catalog record for this book has been applied for at theLibrary of Congress.
Cet ouvrage est une version légèrement retravaillée d’une thèse de doctorat en histoire,soutenue en septembre 2023 à la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne.
La publication de ce travail a bénéficié du soutien financier du Fonds des publications de l’Université de Lausanne. Publié avec le soutien du Fonds national suisse de recherche scientifique.
Illustration de couverture :
Projets de dessins pour l’avers de la pièce de 5 francs suisses réalisés lors du concours pour les nouvelles pièces helvétiques en 1850-1851 (Archives fédérales, E12#1000/36#151* et E12#1000/36#152*).
ISBN 978-3-0343-4951-2 (Print)
E-ISBN 978-3-0343-4959-8 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-0343-4960-4 (EPUB)
DOI 10.3726/ b21867

Open Access : Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence internet CC-BY 4.0. Pour consulter une copie de cette licence, visitez le site https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
© 2024 Jan Chiarelli
Publié par Peter Lang AG, Lausanne, Suisse
À propos de l’auteur
Jan Chiarelli a réalisé une thèse de doctorat à l’Université de Lausanne traitant de la naissance du franc suisse en 1850. Ses recherches portent aussi sur les banquiers privés et notamment leur rôle dans le développement touristique de l’Arc lémanique durant la seconde moitié du 19e siècle
À propos du livre
Pourquoi la monnaie suisse est-elle le franc, unité monétaire bien connue de la France jusqu’en 2002 ? La réponse à cette question est plus complexe qu’il n’y paraît. Et pour cause : au milieu du 19e siècle, plus de 700 monnaies différentes circulent sur le territoire helvétique, représentant des milliers de variétés de pièces. Réussir à en choisir une seule qui satisfasse les intérêts de tout le monde est pour le moins délicat. En parcourant les nombreux débats monétaires qui ont lieu en Suisse entre 1815 et 1865, cet ouvrage analyse le long processus de centralisation et d’unification des monnaies. Il montre que le chemin pour y parvenir est semé d’embûches et que le franc suisse naît en 1850 dans la douleur. Ses premières années d’existence sont elles aussi tumultueuses.
S’intéresser aujourd’hui aux origines du franc suisse offre l’occasion de constater qu’il n’a pas toujours eu la force et la stabilité qui font sa réputation actuelle, loin de là.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Remerciements
Cette étude est le fruit d’un travail de longue haleine qui n’aurait pu aboutir sans le concours de nombreuses personnes. Je tiens ici à leur témoigner ma reconnaissance.
Mes premiers remerciements vont à Cédric Humair, Sébastien Guex, Luca Einaudi et Sacha Zala pour leur expertise et la finesse de leurs critiques.
Pour leur travail de relecture et leurs corrections, je suis très reconnaissant à Vivien Ballenegger, Nicolas Chachereau, Samuel Goy, Sylvain Praz et Fabio Rossinelli. J’adresse également mes sincères remerciements à Karine Crousaz pour m’avoir initié à la lecture de la Kurrentschrift ; cette aide a été inestimable lors de la consultation des documents d’archives. Ma gratitude va aussi à Jacqueline Frey et à Alexandre Hirzel du Centre informatique de l’Université de Lausanne pour le support informatique et l’élaboration des cartes.
J’adresse mes plus profonds remerciements à Olivier Chaponnière, Roger Durand, Antoine Clerc et Gilles Perret pour les nombreux moments de partage, leur regard affuté, leur soutien technique, ainsi que la pertinence de leur analyse. J’ai aussi une dette particulière envers Gilles Bourquin, soutien indéfectible depuis de nombreuses années.
Merci également aux membres des familles Chiarelli, Vuaridel, Buffat et Siffert pour leurs encouragements.
Je suis également redevable au personnel des différentes archives et bibliothèques pour leur collaboration durant toutes ces années de recherches. Leur disponibilité m’a été très précieuse. Merci en particulier aux collaborateurs des Archives fédérales, des Archives d’Etat de Bâle-Ville, des Archives d’Etat de Genève, ainsi que de la Bibliothèque nationale suisse. Je suis en particulier reconnaissant envers Mme Cosette Lagnel du Musée monétaire de Lausanne pour son accueil.
Pour la réalisation de ce livre, merci à Mme Viktoria von Wickede pour son accompagnement et sa confiance.
Enfin, parmi toutes ces personnes, il y en a une essentielle, l’ingrédient magique, dont la bonne humeur contagieuse et le soutien inconditionnel m’ont fourni la légèreté indispensable à traiter cette thématique complexe et à tenir bon sur le long terme: que Camille trouve dans les pages qui suivent la marque de ma plus profonde reconnaissance.
1. Chapitre introductif
1.1. Introduction
«L’histoire monétaire suisse n’a rien d’instructif ni d’édifiant»1. Écrite en 1849, une année avant la naissance du franc suisse (FS), cette phrase d’un fin connaisseur de la situation monétaire du pays a de quoi surprendre le lecteur du 21e siècle. Il est vrai que les travaux actuels ont plutôt tendance à présenter l’histoire monétaire suisse comme une histoire à succès. Le titre du dernier ouvrage en date paru sur le sujet en témoigne bien2. C’est que la situation a passablement changé depuis un siècle et demi. Les propos tenus par le Conseiller fédéral (Cf) Hans-Rudolf Merz en 2005 à l’occasion de la commémoration du décès du Soleurois Josef Munzinger, premier Cf en charge des Finances considéré comme le père du FS, sont à cet égard révélateurs du chemin parcouru depuis un siècle et demi:
«Die Einführung des Frankens vor 150 Jahren entpuppt sich also als eine Erfolgsgeschichte. Die Schweiz gehört denn auch zu den ganz wenigen europäischen Ländern, die ihre ursprüngliche Währung bis heute beibehalten haben. […] Zusammen mit der politischen Stabilität, der Sozialpartnerschaft, gesunden öffentlichen Finanzen, einem flexiblen Arbeitsmarkt und der Forschungsfreiheit bilden diese die Pfeiler unseres Wohlstands »3.
Présenté comme un élément constitutif de la prospérité helvétique actuelle, le FS n’a pas toujours rempli cette fonction, loin s’en faut. Depuis sa naissance en 1850, la monnaie suisse a d’abord passé par le statut de monnaie-satellite de la France peu recherchée sur les marchés étrangers durant toute la seconde moitié du 19e siècle. Elle a ensuite connu une histoire mouvementée au 20e siècle, avec les affres de la Première Guerre mondiale qui l’a hissée au rang de réserve de valeur internationale, position fortement renforcée par le Second conflit mondial, et la dévaluation de 1936. Aujourd’hui, elle affiche une stabilité qui fait bien des envieux. Cette histoire à succès, comme aime à le rappeler la littérature consacrée au FS, est en fait une construction relativement récente qui tend à occulter que le FS naît dans la douleur.
C’est justement l’objet de ce travail. La réalisation de l’unification monétaire, inscrite dans la Constitution de 1848, est un parcours semé d’embûches. Au cœur de ce processus figure le choix du pied monétaire, c’est-à-dire la base qui détermine l’unité de référence du nouveau système. Plusieurs possibilités s’offrent au législateur de 1848: adopter la monnaie française, introduire la monnaie des Etats du sud de l’Allemagne ou alors créer leur propre système monétaire. Si la première solution est finalement retenue, ce choix n’allait pas de soi. Le pays se déchire en effet autour de la question monétaire, comme on l’appelait alors. En 1850, un partisan de la monnaie allemande va jusqu’à considérer l’adoption du pied monétaire français comme une déclaration de guerre à la Suisse orientale. Au sortir de la guerre civile du Sonderbund, cette affirmation fait grand bruit et témoigne d’enjeux d’envergure qui pèsent sur le débat monétaire. Après la naissance du FS en 1850, ses premières années d’existence sont tout autant tumultueuses. A peine arrivées dans la circulation, les nouvelles pièces disparaissent sous les effets d’une modification du contexte international: la découverte de mines d’or dans des contrées lointaines contribue à redistribuer les cartes du jeu monétaire à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’au prix de la diminution du contenu métallique des pièces suisses en 1860, qui constitue une importante modification de la législation monétaire adoptée une décennie auparavant, que les milieux économiques suisses parviennent à maintenir des espèces helvétiques dans la circulation intérieure. Cette mesure n’est toutefois pas du goût de tout le monde: en 1864, la France interdit les pièces suisses puisqu’elles ne sont plus conformes aux siennes. Nous sommes donc loin d’un parcours constitué d’exploits et de réussites se succédant qui seraient les fondements de la prospérité actuelle.
Disons-le d’emblée, il ne s’agit pas ici d’écrire une énième histoire du FS dont le 20e siècle a été particulièrement friand. Le lecteur qui chercherait un travail mettant en scène les grandes étapes de l’histoire monétaire helvétique serait vraisemblablement déçu en se lançant dans la lecture des pages qui suivent. Il existe d’ailleurs bien assez d’ouvrages qui remplissent cette fonction. Notre objectif est bien différent: cette étude vise à étudier le long processus qui donne naissance au FS en 1850 et ses premières années d’existence. Point de bascule entre la première moitié du 19e siècle, durant laquelle plus de 700 monnaies différentes circulent sur le territoire helvétique, et la participation à l’Union monétaire latine (UML) fondée en 1865, la naissance du FS figure sans aucun doute parmi les événements les plus importants de l’histoire monétaire contemporaine. Dans ce travail, il s’agira de comprendre qui sont les acteurs qui ont défendu ou combattu l’adoption du pied monétaire français en Suisse et, surtout, pour quelles raisons. De cette manière, il sera possible de donner un peu de chaire à une histoire qui a souvent tendance à se limiter à sa stricte dimension technique.
1.2. Importance de la thématique et questionnements de recherche
Durant le demi-siècle qui sépare 1815 de 1865, la Suisse connaît de profonds bouleversements en matière économique, sociale et politique. Pays à large dominante agricole où près de deux tiers de la population active est employée dans l’agriculture au début du siècle4 et qui connaît des vagues d’émigration pour échapper aux disettes, il se transforme progressivement sous l’impulsion de l’industrialisation. En 1840, la Suisse figure ainsi en première position des pays dits “développés” en termes d’exportations par habitant5. Deux décennies plus tard, elle occupe la 3e place des pays “développés” en termes de volume de production industrielle par habitant, derrière la Grande-Bretagne et la Belgique6, alors que les secteurs secondaire et tertiaire réunis emploient un peu moins de la moitié de la population active7. Cette transformation en profondeur de la structure socio-économique helvétique s’accompagne d’une modification du statut et du rôle de la monnaie. Pour bien comprendre cette évolution, il est au préalable nécessaire de prendre en compte les trois fonctions de la monnaie déjà énoncées par Aristote: celles de paiement, de compte et de réserve de valeur8. A ces trois fonctions traditionnelles, nous en ajoutons deux supplémentaires, celle de matière première et celle de source de revenus. Arrêtons-nous un moment sur cet aspect9.

La fonction de paiement de la monnaie concerne et touche toutes les activités monétarisées de la société, puisqu’elle constitue le principal instrument des échanges dans les sociétés marchandes. Au contraire du troc, qui représente l’échange de deux biens ou services, la monnaie introduit une dimension supplémentaire dans le processus d’échange, car elle permet de différer le paiement. Lors du paiement au créancier, il ne s’agit plus d’acquérir un bien, puisque le débiteur est déjà en sa possession, mais d’éteindre une dette. A son tour, le créancier peut acquérir un bien avec cette somme ou honorer une dette qu’il posséderait. En raison de son rôle dans les échanges marchands, la monnaie intéresse tous les acteurs du commerce, des négociants actifs à l’échelle internationale aux détaillants pratiquant leurs activités sur les marchés de proximité en passant par tous les prestataires de services, qu’ils soient hôteliers, banquiers ou encore transporteurs. La monnaie concerne également les milieux industriels pour le paiement des salaires, qu’il s’agisse des grands industriels de l’industrie mécanisée qui sont de gros employeurs ou de plus petits industriels. Enfin, la monnaie devient au 19e siècle le principal outil pour payer les impôts.
Pour assurer cette fonction de paiement, il est décisif de pouvoir disposer de suffisamment de monnaies. Leur insuffisance peut en effet avoir comme conséquence de provoquer un ralentissement des échanges et peut mener à une paralysie de l’économie. C’est dans ce genre de cas que d’autres objets sont temporairement utilisés pour assurer les transactions, comme des timbres-poste ou de la porcelaine. Au contraire, l’inflation des moyens de paiement a pour conséquence une perte de valeur de la monnaie. En cas de surémission, les outils monétaires traditionnels sont en effet délaissés au profit d’autres instruments à la valeur jugée plus stable. Il est aussi nécessaire que la monnaie soit de bonne qualité et qu’elle soit reconnue comme telle par les partenaires économiques pour remplir son rôle d’intermédiaire des échanges. A défaut, elle peut constituer un frein à la fluidité des transactions, voire être refusée. En raison de cette fonction de paiement centrale dans les échanges, les coûts d’acquisition des moyens de paiements relèvent d’un facteur de compétitivité pour les acteurs économiques. Des variations sur le change des outils monétaires peuvent en effet fortement pénaliser ses utilisateurs par rapport à la concurrence. Au-delà du change, les coûts de transaction pour se procurer ces moyens de paiement jouent aussi un rôle et peuvent être déterminants pour demeurer compétitif.
La seconde fonction de la monnaie est son usage comme unité de compte, offrant ainsi la possibilité de mesurer la valeur de toute chose. Elle permet alors de simplifier la comparaison des prix et de fluidifier les échanges. Jusqu’au 19e siècle, la structure monétaire repose sur la circulation d’une multitude de pièces, dont la valeur des unes par rapport aux autres dépend de leur contenu métallique et de leur demande qui varie selon le type d’opérations à effectuer et en fonction du destinataire final. Afin de comparer et d’évaluer la valeur respective de ces espèces, une monnaie de compte – qui, comme son nom l’indique, sert à compter et n’est le plus souvent pas frappée – fournit une unité de mesure commune qui permet ensuite de transposer une valeur dans d’autres monnaies10. Avec ce système, il devient possible de faire cohabiter sur un territoire des espèces hétérogènes dans un ensemble relativement homogène. Ceci est d’autant plus nécessaire que les sociétés pré-marchandes connaissent de fréquents épisodes de pénurie monétaire, auxquels répondent la circulation d’une grande diversité de pièces locales et étrangères11. En somme, cette organisation fournit un repère commun auquel tout le monde peut se référer et qui sert de base au système d’échange. Le 19e siècle marque une rupture fondamentale dans cette structure. Les monnaies réelles et de compte fusionnent en une seule unité qui est à la fois l’une et l’autre: l’unité de compte est physiquement représentée par une espèce métallique. Changement majeur, car il implique que les pièces possèdent désormais une valeur monétaire et une teneur en métal toutes deux invariables12.
En raison de cette fonction, la monnaie intéresse tous les acteurs de l’économie qui échangent des biens et des services sur une base monétaire. Pour être utilisée comme unité de compte, la monnaie doit être adaptée aux besoins et aux usages courants des utilisateurs pour qu’ils s’en servent. C’est ce qui explique qu’une fois solidement ancrées, il est très difficile de changer les habitudes liées à la manière de compter des monnaies. Puisqu’il est fréquent que les utilisateurs aient recours à des pièces provenant de plusieurs systèmes, la fonction de compte est décisive car elle fournit le dénominateur nécessaire pour établir une comparaison entre elles. La lisibilité des changes doit donc être compréhensible pour que cette monnaie remplisse cette fonction. Enfin, en tant qu’unité de compte, la monnaie doit être suffisamment stable pour mesurer la valeur des biens et des services, sans pour autant la déterminer. La dévaluation, qui consiste en une baisse de la valeur légale de la monnaie, peut entrainer un abandon de cette monnaie, car elle ne présente plus la stabilité nécessaire à remplir son rôle d’unité de compte.
La troisième fonction de la monnaie est d’officier comme réserve de valeur dans le temps, bien que cette fonction ne soit pas propre à la monnaie. En effet, une monnaie peut perdre son statut de réserve de valeur en période d’instabilité économique, mais garder ceux de moyen de paiement et d’unité de compte. Quoi qu’il en soit, un détenteur de monnaies n’est pas tenu de les utiliser dans l’immédiat, car elles offrent la possibilité de différer le pouvoir d’achat qu’elles confèrent dans le temps. Dans cette perspective, le contenu métallique garantit la valeur nominale des monnaies et met en partie à l’abri ses détenteurs des risques de dévaluation ou d’inflation, car le métal précieux contenu dans une pièce a une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilisation monétaire. Le souverain émetteur, rôle qu’endosse l’Etat dans les sociétés contemporaines, joue également un rôle central en garantissant la valeur de la monnaie sur la durée. En plus d’assurer la qualité de la fabrication des pièces, il peut aussi intervenir afin de limiter les risques de change qui pourraient peser sur une monnaie.
En tant que réserve de valeur, la monnaie intéresse tous ses détenteurs, mais en particulier les épargnants et les investisseurs. Pour remplir cette fonction, sa valeur doit donc être stable dans le temps afin de constituer une sécurité pour ses détenteurs. Cela signifie que l’inflation doit être maîtrisée pour éviter une perte de pouvoir d’achat et que la dévaluation doit être évitée pour garantir ce rôle de réserve de valeur. En somme, il est nécessaire de tendre vers la plus grande stabilité pour assurer cette fonction.
Au-delà de ces trois fonctions traditionnelles, il faut encore ajouter que la monnaie peut aussi remplir une fonction industrielle. Pour certains secteurs qui travaillent les métaux précieux, comme les orfèvres, les bijoutiers ou encore les horlogers, la monnaie constitue une matière première pour leurs activités. Cet aspect n’est pas à négliger, car l’usage non monétaire de la monnaie peut en effet atteindre des sommes conséquentes et constituer un élément de compétitivité économique. Il est donc nécessaire de disposer de monnaies en quantité suffisante pour pouvoir s’approvisionner directement dans la circulation. Un ralentissement dans la vitesse de circulation des moyens de paiement métalliques aurait pour conséquence de réduire l’activité industrielle. La qualité des pièces joue également un rôle important, car ne pas pouvoir les utiliser nécessiterait de modifier le circuit d’approvisionnement en matière première, engendrant au passage des coûts supplémentaires. C’est en effet parce que cela leur revient moins cher que ces acteurs économiques puisent dans la circulation des monnaies le métal nécessaire à leurs activités.
La monnaie a une dernière fonction, celle de source de revenus pour le souverain émetteur. Jusqu’à l’émergence des Etats-nations dans le courant du 19e siècle, le droit de frapper monnaie est une prérogative endossée par une multitude de souverains, qu’il s’agisse de rois, de princes, de villes, de monastères ou encore de profanes qui affirment leur souveraineté par l’émission de monnaies. Mais la fabrication de pièces, surtout celles qui contiennent une faible proportion de métaux précieux, peut aussi constituer une source de revenus pour ces souverains. D’ailleurs, il est très fréquent que le contenu métallique des pièces soit abaissé afin d’accroître les profits réalisés. Il arrive aussi que des frappes en grande quantité aient lieu de manière ponctuelle pour financer, par exemple, l’effort de guerre. En raison de ce rôle, les souverains sont peu enclins à se défaire de leur régale monétaire et peuvent faire preuve d’une résistance parfois assez forte à transférer à l’Etat le droit de battre monnaie. Enfin, dans les sociétés contemporaines, la valeur de la monnaie en circulation est garantie par la législation des Etats et les quantités frappées sont régulées. Cela signifie qu’en principe, le contenu métallique des pièces est invariable et qu’il y a moins d’épisodes de surémission.
En raison des multiples fonctions qu’endosse la monnaie, il peut arriver qu’une fonction entre en contradiction avec une autre. Par exemple, l’émission de grosses quantités de pièces de faible valeur de la part d’un souverain pour des raisons financières peut entrer en conflit avec la fonction de réserve de valeur qui requière une stabilité dans les quantités de moyens de paiement à disposition. En cas de crise économique, la nécessité de disposer d’outils monétaires en suffisance peut entrer en opposition avec la fonction de réserve de valeur, puisque les détenteurs de monnaies ont tendance à les thésauriser. Ainsi, la monnaie endosse plusieurs rôles et fonctions qui en font un objet d’étude extrêmement complexe. Pour chaque acteur économique, la monnaie remplit une ou plusieurs fonctions qui requièrent certaines qualités, qui peuvent être incompatibles avec les qualités que d’autres acteurs recherchent pour remplir une autre fonction monétaire.
Details
- Pages
- 874
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034349598
- ISBN (ePUB)
- 9783034349604
- ISBN (Hardcover)
- 9783034349512
- DOI
- 10.3726/b21867
- Open Access
- CC-BY
- Language
- French
- Publication date
- 2025 (January)
- Keywords
- Monnaies bimétallisme Union monétaire latine naissance de l’Etat fédéral 1848 histoire économique histoire monétaire
- Published
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 874 p., 22 ill. n/b, 22 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG