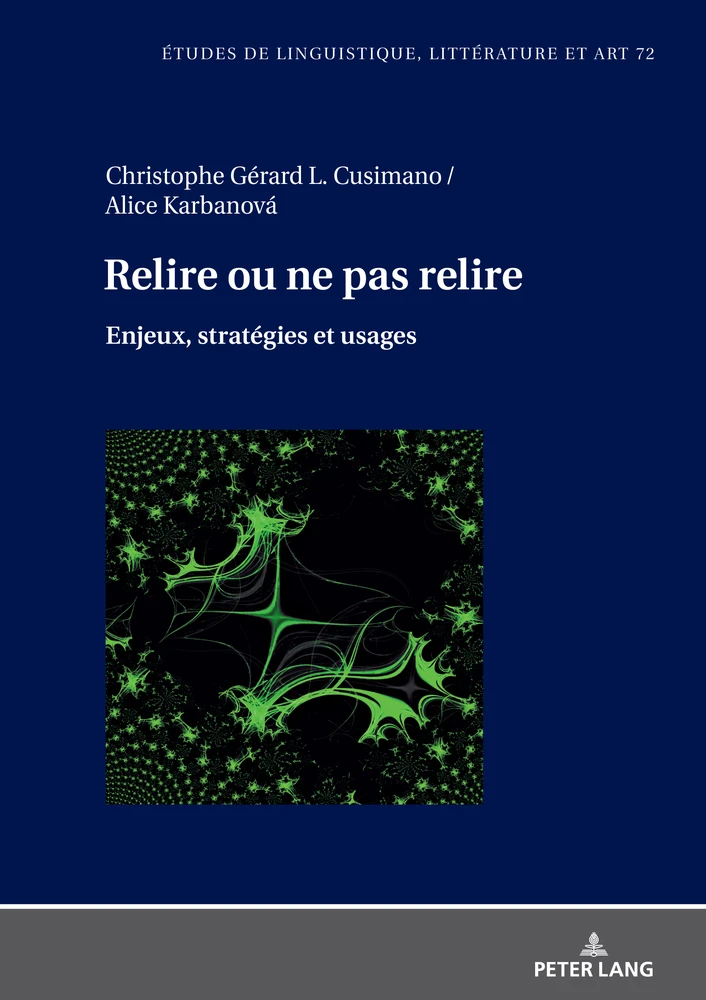Relire ou ne pas relire
Enjeux, stratégies et usages
Résumé
Extrait
Table des matières
- Cover
- Title
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Table des illustrations
- Réflexions liminaires
- Chapitre 1 : Relire selon les sciences cognitives
- 1. Comprendre selon les sciences cognitives (A. Karbanová et C. Cusimano)
- 1.1. La théorie dite « Construction-Integration Model »
- 1.2. La théorie « Structure Building Framework »
- 1.3. Comprendre selon le cognitivisme orthodoxe
- 2. Les variables évaluées en relecture (A. Karbanová et C. Cusimano)
- 2.1. L’effet de l’âge
- 2.2. L’intervalle de temps en question
- 2.3. Apport qualitatif vs. quantitatif
- 2.4. Des différences individuelles
- 2.5. Structure et complexité du texte
- 2.6. Des différences génériques
- 2.7. Relire : une activité profitable ?
- 3. La relecture : une mise en perspective (C. Cusimano)
- 3.1. Expériences sur la relecture vs. expérience de re-lecture
- 3.2. Dévaluation du genre et dilution de la valeur littéraire
- 4. Lire sans relire … et plus vite que ça ! Les tests de vitesse de lecture en neuropsychologie (C. Cusimano)
- 4.1. Une consigne contre-intuitive ?
- 4.2. Des histoires binaires
- 4.3. Rapports logiques et ruptures d’isotopies sémantiques
- 4.4. Problèmes généraux d’interprétation : voisinage avec d’autres genres, énoncés ironiques /humoristiques, vitesse exigée
- 4.5. Fascinante incongruité : retour sur l’onde N400
- Chapitre 2 : Relire en sémantique (C. Cusimano)
- 1. « Pas fidèle à 100 % » : relire Asimov et Tolkien à la lumière des séries cinématographiques
- 1.1. Une définition pour commencer
- 1.2. Parties de discours et tiroirs verbaux
- 1.3. Un but illocutoire varié
- 1.4. Co-occurrents et corrélats sémantiques
- 1.5. Pourquoi relire ou l’évoquer ?
- 2. Relire en didactique du FLE : une question de devoir ?
- 2.1. « Relire » et le CECRL
- 2.2. Relire en dictée
- 2.3. Quelques données quantitatives
- 2.4. Un difficile devoir
- 3. « Sans se relire » : ambivalence d’une expression phraséologique
- 3.1. Une expression phraséologique
- 3.2. Variabilité et collecte d’occurrences
- 3.3. Ne pas se relire en écriture automatique
- 3.4. Une absence de relecture coupable
- 3.5. Quelles intercalations ?
- 3.6. Récapitulatif
- 4. Quels concurrents paradigmatiques de « relire » et « relecture » ? les équivalents traductionnels en renfort
- 4.1. Cadrage verbal vs. satellitaire et forme synthétique vs. analytique
- 4.2. La notion d’équivalence en traductologie, lexicographie et terminologie
- 4.3. « Relecture » et « relire » : entre nouvelle lecture et activité de correction
- 4.4. Une activité biface rendue visible
- Remarques conclusives et limites
- Bibliographie
- Annexes
- Ind ex
Réflexions liminaires
« … je lis peu, mais je relis sans cesse, Flaubert et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et Queneau ; je relis les livres que j’aime et j’aime les livres que je relis, et chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt pages, trois chapitres ou le livre entier : celle d’une complicité, d’une connivence, ou plus encore, au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée ».
(G. Perec, W ou le souvenir d’enfance, 1975 : 195)
Alors que toutes les enquêtes récentes montrent un désintérêt de plus en plus marqué pour la lecture, notamment chez les plus jeunes, il peut sembler inop- portun de s’engager dans la conception d’un ouvrage, même modeste, sur la relecture. Si personne ne lit, qui relit donc encore à l’heure actuelle ? Or nous serions tenté de répondre : quiconque doit apprendre ou enseigner, publier des textes quels qu’ils soient, communiquer et envoyer des messages pour dénoncer, convaincre ou séduire. En un mot, tout le monde, ou presque, ce qui règle d’emblée la question de l’extension du domaine de la relecture.
Relire, dans la vie quotidienne, c’est plutôt l’histoire d’un verbe mal aimé, parce qu’il renvoie à une activité corrective rébarbative, et comporte souvent une part de culpabilité qui l’attire vers le tiroir du conditionnel passé. Quelque chose qu’on « aurait dû » faire mais qu’on n’a pas fait. On ne s’est pas relu avant d’envoyer le mail, c’est dommage, mais pas très grave, seulement négligent. On a laissé des fautes de frappe, on a écrit madame à monsieur, un adjectif inapproprié s’y est glissé, dévoilant trop le fond de sa pensée. Un article mal ficelé, rendu après la date limite, et la bibliographie avec des dates de publication fausses. « Une relecture aurait été bienvenue », a-t-on coutume de souligner.
Par ailleurs, si on ne prend pas assez la peine de lire, on prend encore moins le temps de relire - des œuvres s’entend et non des mails. Parcourir à nouveau les mêmes lignes, et perdre un temps de plus en plus précieux semble inapproprié à nos contemporains, hors des chercheurs des cercles académiques dont c’est justement le travail. Le sentiment de connaître déjà l’histoire (et même si l’on ne s’en souvient pas en détails, « ça nous reviendra » dès qu’on commencera) et la fatigue due à l’écume dense du quotidien conduisent invariablement à repousser le projet aussitôt formulé.
Le temps, pris dans sa dimension non plus contraignante mais plutôt sous l’angle de l’espacement entre lecture et relecture, est peut-être aussi une variable pertinente. Un peu comme, lorsqu’on déménage loin, nul ne sait s’il vaut mieux retourner tout de suite revisiter les anciens lieux ou vite revoir les vieux amis. Vaut-il mieux laisser passer un peu de temps, s’autoriser à oublier, laisser les photos pâlir ou, pour le dire à la manière de Virginia Woolf, « attendre que la poussière de la lecture se dépose »1 ? Puis, le moment venu, replonger et prendre toute la mesure de ce qu’on y a vécu et, peut-être, perdu. Par ailleurs, doit-on relire une œuvre quelques mois ou un an après l’avoir lue une première fois, ou beaucoup plus tard ? Dans ce dernier cas, il s’agit alors d’une entreprise à la fois plus séduisante mais aussi plus périlleuse : car en relisant on conçoit un espace unique, un trou de ver qui connecte deux moments de lecture, deux espace-temps d’une vie, plus ou moins heureux. Aucun re-lecteur n’y est vraiment préparé et la mélancolie guette. G. Perec, comme nous le voyons dans la citation placée en exergue, vivait à l’inverse la relecture comme une activité rassurante : n’écrit-il pas à propos des livres, juste avant que ne débute la citation, qu’il appréciait « la certitude qu’on avait de les retrouver ». La relecture confirme ainsi que tout est à sa place, que le bonheur reste accessible et à portée de main, et que sa famille littéraire l’entoure toujours. On retrouve cette idée de réconfort dès les premières lignes de l’essai de P. M. Spacks (2011). Celle-ci s’interroge sur la sécurité que nous procure la relecture d’une œuvre, alors même que l’œuvre en question est relue avec des yeux nécessairement différents, puisque le contexte a changé et que, plus simplement, nous avons changé :
« La question de savoir quel type de sécurité offre la relecture laisse place à une autre question : comment la relecture peut-elle apporter une quelconque sécurité ? Comment un relecteur qui reste « toujours un étranger » peut-il espérer être rassuré ? Si les livres changent constamment avec leurs lecteurs, ils ne possèdent aucune stabilité et ne semblent offrir aucune sécurité »2.
P. M. Spacks répond elle-même à ce paradoxe en affirmant que le relecture d’une œuvre nous permet ni plus ni moins de nous souvenir de notre propre passé, récent ou plus lointain comme notre enfance.
« La relecture nous met plus nettement en contact avec la façon dont nous-mêmes - comme les livres que nous relisons - avons à la fois changé et sommes restés les mêmes. Les livres contribuent à constituer notre identité. Ils permettent aussi, au fur et à mesure que nous les relisons, de mesurer les changements de notre identité au fil du temps »3.
Malgré sa vraisemblance et la beauté de sa formulation, cette hypothèse ne saurait être vérifiée empiriquement et ne prête le flanc à aucune expérimentation. C’est d’ailleurs le cas de la plupart des essais, souvent le fait d’universitaires littéraires, qui portent sur la relecture, soit en général soit centrés sur un écrivain en particulier.
En effet, d’un point de vue scientifique, la matière paraît rétive à toute approche. Comment cela pourrait-il ne pas être le cas puisque, comme nous l’ont enseigné des siècles d’activité interprétative, il n’existe aucun consensus sur les modes de réception et de compréhension des textes ? Des théories littéraires, linguistiques, d’obédience herméneutique ou pragmatique, et depuis moins longtemps des théories provenant des sciences cognitives, ont permis de mieux cerner cette activité humaine essentielle qu’est la lecture, mais sans jamais en saisir tous les aspects. Il n’est alors guère surprenant que son mode itératif, la relecture, n’ait pas été instruit en détails.
On ne trouve que peu d’ouvrages tout entiers dédiés sur la question. Ces rares sources sont cependant des études brillantes, en particulier la monographie de M. Călinescu sobrement intitulée Rereading (1993) : celle-ci, qui fait autorité, se présente comme un essai instruit et argumenté de la relecture sous tous les angles possibles. Son orientation est majoritairement d’ordre spéculatif et évaluatif – nous voulons dire par là sans ambition de démonstration par la preuve, même s’il comporte de nombreuses illustrations à l’appui. Cet ouvrage est précieux pour son approche multi-facettes, notamment diachronique et diatopique, générique aussi au sens de l’opposition lecture par l’homme ou la femme (105 sq.), et psychologique/psychiatrique (157 sq.). Nous retiendrons encore la richesse des recherches bibliographiques données à voir, à travers des extraits littéraires peu connus, bref son érudition. Il est constitué de quatre parties : « modèles de lecture », « histoire, psychologie et poétique », « jeu », et « relire pour le secret », chacune recelant quatre ou cinq études non-étanches. Plus proche des interrogations qui nous guideront dans cet ouvrage, on y trouve aussi une redéfinition de l’activité. M. Călinescu (1993 : 18) invite, sans récuser la distinction, à ne pas opposer frontalement lecture et relecture, en rappelant que toutes deux vont souvent ensemble, partagent des traits communs (attention fluctuante, fragmentation, retours en arrière, fluidité ponctuelle), même si l’attention à la structure du texte et aux détails précis est moindre dans la première :
Résumé des informations
- Pages
- 140
- Année de publication
- 2025
- ISBN (PDF)
- 9783631928882
- ISBN (ePUB)
- 9783631931035
- ISBN (Relié)
- 9783631914168
- DOI
- 10.3726/b22609
- Langue
- français
- Date de parution
- 2025 (Février)
- Mots Clés (Keywords)
- Relire relecture lecture compréhension sciences cognitives sciences du langage sciences humaines
- Publié
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2025. 140 pp., 7 fig. b/w
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG