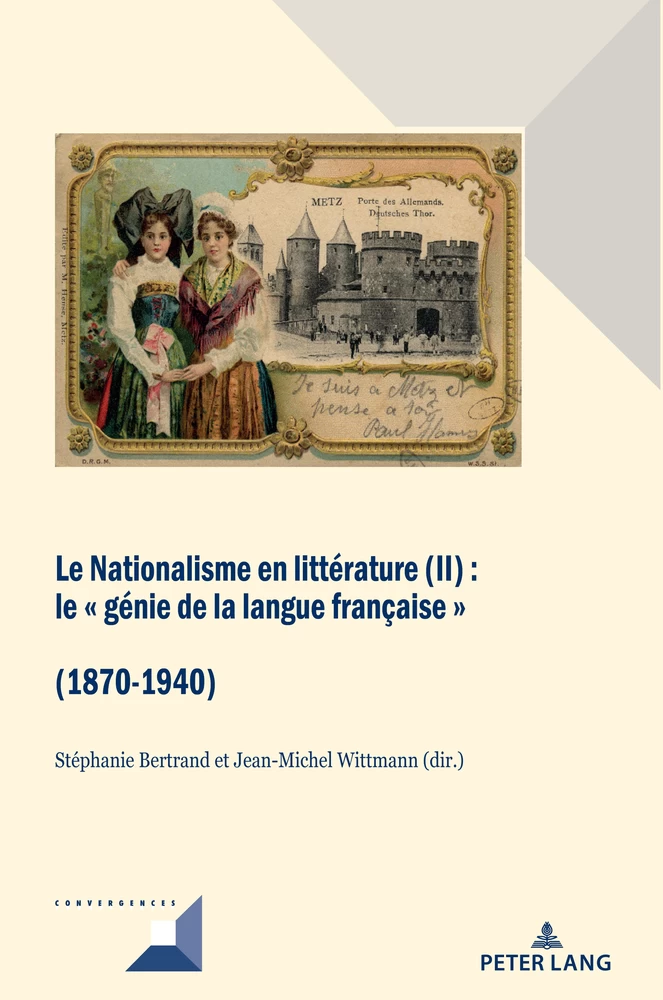Le Nationalisme en littérature (II)
Le « génie de la langue française » (1870-1940)
Summary
Les formes de l’analogie entre langue et nation, les valeurs linguistiques présentées comme « françaises », la nature des exigences linguistiques académiques et institutionnelles : ce sont les enjeux idéologiques de ces considérations sur la langue que les contributions ici rassemblées se proposent d’expliciter, à partir d’un corpus littéraire narratif, essayistique, voire poétique, composé des œuvres des chantres du nationalisme (Paul Bourget, Maurice Barrès, Charles Maurras), mais aussi d’œuvres reflétant (ou contestant) les idées et les valeurs du nationalisme (René Bazin, Léon Daudet, Paul Verlaine, Anatole France, Henri Barbusse, Jean Giraudoux, etc.).
Ce volume, qui réunit les communications prononcées lors du colloque organisé les 27 et 28 juin 2019 à l’Université de Lorraine, propose ainsi de réfléchir aux liens entre langue et idéologies nationalistes en littérature sous la IIIe République.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction (Stéphanie Bertrand et Jean-Michel Wittmann)
- La langue et la question de « l’identité nationale ». Contextes et historicités : le cas Ernest Renan (Jean-Louis Chiss)
- Première partie Les écrivains, la langue française et l’idée de nation
- La langue française sous l’œil du barbare, de Maurice Barrès à René Bazin (Jean-Michel Wittmann)
- Nation, hérédité et langue française selon Léon Daudet (Franck Javourez)
- Langue(s), nation(s) et vertu(s) : contradictions autour du « patriotisme froid » de la prose de Verlaine (Benoît Abert)
- La langue selon Anatole France, une patrie à quatre dimensions (Élodie Dufour)
- Identité(s) en discours : le cas de Siegfried et le Limousin de Jean Giraudoux (1922) (Paola Codazzi)
- Deuxième partie Formes et valeurs « françaises »
- Le monologue intérieur et la prose française dans les années 1920 (Stéphanie Smadja)
- « Un des traits les plus significatifs de l’esprit français » : l’aphorisme, forme « française » au tournant des XIXe–XXe siècles (Stéphanie Bertrand)
- Langue et esprit français dans les années 1910 (Antoine Piantoni)
- L’ordre et la clarté : « nos plus belles qualités nationales » selon Maurice Barrès (Vital Rambaud)
- Derrière la crise du français : nouveaux aspects du purisme dans l’entre-deux-guerres (Vincent Berthelier)
- Troisième partie De l’académisme aux contre-discours
- Les habits neufs de l’universalité L’Académie et la langue française en 1912 (Stéphane Zékian)
- La langue nationale d’Irène Némirovsky (Christelle Reggiani)
- Écrivains « francophones », nationalisme et langue littéraire. Un exemple de l’entre-deux-guerres belge (Paul Dirkx)
- « La France, notre bopéyi, s’apeulait ja10 l’Agaule » : le style surréaliste contre la nation (Raphaëlle Hérout)
- Quatrième partie Une nation, plusieurs langues ?
- Une nation, des régions : la langue française au singulier, ou le « patois » comme impensé (Cécile Gauthier)
- Les « petites patries » dans la production poétique en langue française et dialectale après la guerre de 1870 (Pamela Puntel)
- L’argot du Feu (1916) d’Henri Barbusse (Denis Pernot)
- L’espéranto : entre complot juif et menace sur la langue française. Remy de Gourmont et Ernest Gaubert (Vincent Gogibu)
- L’écrivain et l’horizon de la langue Entretien avec Jean Rouaud (Jean Rouaud et Sophie Milcent-Lawson)
- Bibliographie
- Notices
- Index
- Titres parus dans la collection
Introduction
Stéphanie Bertrand et Jean-Michel Wittmann
Université de Lorraine, ÉCRITURES
« Une littérature nationale signifie un ensemble d’ouvrages dont le style soit conforme au génie national, car la littérature, hors du style, n’est rien », écrit Charles Maurras en 1896, dans son Prologue d’un essai sur la critique1. Après 1870, ce type de remarque, qui explicite la portée idéologique du style littéraire et celle des considérations stylistiques, revient fréquemment sous la plume des écrivains nationalistes ou directement influencés par cette idéologie. Pour ces écrivains représentatifs de ce que Michel Winock définit comme le « nationalisme fermé2 », les choix stylistiques engagent la nation, en vertu de leur capacité à incarner symboliquement, voire concrètement, les caractéristiques – ou qualités – jugées représentatives de « l’esprit français » ou du « génie français ». Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la virilité, l’énergie, la fermeté apparaissent-elles comme des qualités proprement « françaises », s’agissant de la nation comme du style.
Les imaginaires stylistiques et le style de ces écrivains marqués par l’idéologie nationaliste – qu’ils y aient adhéré ou qu’au contraire, ils l’aient soumise à leur critique – ont fait l’objet d’un premier colloque, organisé en juin 2018 à l’Université du Luxembourg3. Premier volet d’un projet de recherche consacré, plus largement, à la portée idéologique des imaginaires linguistiques et stylistiques dans la littérature française entre 1870 et 19404, cette manifestation scientifique a permis de constater à quel point chez ces écrivains, le discours sur le style participe d’une véritable stratégie idéologique, voire politique, indépendamment du genre pratiqué pour le déployer, de la critique littéraire (Maurras, Barrès, Bourget) au roman (Barrès encore, Bourget, mais aussi Bazin ou Bordeaux) en passant par le pamphlet (Drumont, Darien). Dans leurs textes, l’écart régulièrement observé entre théorie et pratique du style révèle, d’une part, l’hétéronomie5 du style et des considérations stylistiques littéraires, de l’autre, la dimension éminemment ←11 | 12→idéologique de l’esthétique littéraire à cette époque. Dans ce contexte, comme l’ont souligné Stéphanie Bertrand et Sylvie Freyermuth, « bien davantage que le style des idées, ce sont les idées sur le style qui se révèlent profondément nationalistes, dans une certaine littérature du tournant du XIXe et XXe siècle6. »
Au-delà du style littéraire, c’est la conception même de la langue française qui se trouve investie d’une portée idéologique durant cette même période où, au demeurant, la distinction entre langue et style n’est pas encore clairement établie, les deux termes étant alors souvent employés comme des synonymes. Le corpus littéraire publié sous la IIIe République témoigne en effet de la manière dont la langue française cristallise, chez nombre d’écrivains, et pas seulement chez les représentants du « nationalisme fermé », les revendications comme les interrogations et les craintes liées à l’identité nationale, dont la définition paraît problématique.
« C’est la langue qui fait la patrie7 »
Parfois revendiquée par ces écrivains, mais postulée aussi souvent qu’énoncée, l’analogie entre langue et nation, ou entre style et nation, ne date cependant pas de la fin du XIXe siècle. Héritée de la Révolution française, qui voit naître l’idée de nation, elle se développe ensuite à la faveur d’une politique unificatrice, qui cherche à imposer le choix et la pratique d’une langue unique en présentant « l’usage de la langue nationale » comme « un devoir patriotique et un vote quotidien pour la Nation8. » Mais si l’analogie entre langue et nation remonte à l’époque de la Révolution française, l’idée suivant laquelle l’impérialisme français passe par la langue est en fait très ancienne, y compris en littérature : il n’est que de penser à la Défense et illustration de la langue française9 de Du Bellay.
Au XIXe siècle, en France10, l’analogie se développe et s’enrichit sous une double influence : d’une part l’essor de la psychologie des peuples, d’autre part le sentiment ←12 | 13→de malaise résumé à la fin du XIXe siècle par le mot de décadence. La psychologie des peuples (ou Volksgeist) a en effet constitué un champ particulièrement actif de la science, de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930. Fondée sur une approche essentialiste des êtres et du monde, c’est elle qui contribue au premier chef à populariser les notions d’« esprit national » (français) ou de « génie national » (français), qui s’appliquent au collectif autant qu’à l’individu :
L’âme, l’esprit ou le génie du peuple, la personnalité ethnique, le caractère national, constituent autant de notions qui visent à désigner des formes quasi équivalentes de mentalité collective ordinaire, non pathologique comme la foule. La même terminologie psychologique s’applique alors aussi bien au collectif qu’à l’individuel11.
Parallèlement, les crises politiques qui secouent la France, en particulier à la fin du XIXe siècle après la défaite française de 1870 face à la Prusse et l’annexion de l’Alsace-Moselle, placent les considérations nationales, donc linguistiques, au cœur des discours, y compris littéraires. L’analogie entre langue et nation se décline alors en divers motifs qui, loin d’être originaux, constituent au contraire, pour beaucoup, de véritables « idées reçues12 », appelées à perdurer. Le discours officiel diffusé par les autorités politiques et/ou linguistiques recommande de « défendre » la langue comme la nation, de veiller à la « pureté » linguistique ou sociale, de refuser tout à la fois les termes et les individus « étrangers » à l’entité nationale, etc. ; autant d’arguments propres à fonder le « mythe du génie de la langue nationale » et particulièrement récurrents dans les textes politiques et littéraires de l’époque, en France et plus largement dans cette Europe où naissent et s’affirment alors les identités nationales13.
Si cette question des liens entre langue et nation au XIXe siècle a déjà donné lieu à d’assez nombreux travaux14, ils n’ont cependant pas été le fait de chercheurs en littérature, mais se sont inscrits dans le champ de la linguistique (l’on pense notamment aux travaux de Marc Crépon15, d’Henri Meschonnic16, de Jean-Louis Chiss17), de l’histoire (avec Dorothea Hoehtker18), ou encore des sciences ←13 | 14→politiques19. La littérature n’est certes pas absente de ces travaux, mais elle n’y occupe presque jamais une place centrale : les documents journalistiques ou politiques en constituent bien souvent le corpus de référence. La littérature et les écrivains ont pourtant contribué de manière importante à nouer et à illustrer ce lien entre langue et nation. « Pas de génie de la langue française sans la littérature, sans sa littérature20 », rappelle à juste titre Henri Meschonnic dans l’étude diachronique qu’il consacre à ce qui a longtemps été présenté comme la qualité linguistique française par excellence, la clarté. Non seulement la littérature reflète les représentations (idéologiques) de la langue, mais encore elle contribue à leur construction et à leur diffusion ; c’est particulièrement le cas sous la IIIe République, à une époque où littérature et politique sont étroitement mêlées.
Les imaginaires de la langue au prisme de la littérature
La question du lien, réel ou imaginé, entre d’une part, la littérature ou les écrivains, et d’autre part, la langue française, est donc au cœur de ce volume, qui réunit les communications prononcées lors du colloque organisé à l’Université de Lorraine, à Metz, les 27 et 28 juin 2019. Rassemblant les contributions de chercheurs en langue et littérature françaises, il rend compte des différentes formes prises par ces représentations de la langue qui sont le fait des écrivains de l’époque, en même temps que des enjeux idéologiques associés à ces imaginaires linguistiques.
C’est néanmoins à un linguiste, dont les travaux sur la question font autorité, qu’il est revenu d’ouvrir ces réflexions collectives. En interrogeant le lien qui unit la langue d’un pays à la définition d’une « identité nationale » forcément problématique et en insistant sur la nécessité de prendre en compte les « contextes » et les « historicités » pour comprendre la prise de position de Renan dans sa fameuse conférence de 1882, « Qu’est-ce qu’une nation ? », Jean-Louis Chiss met au jour toutes les ambiguïtés de ce débat. Pour en saisir toute la complexité et la spécificité, il en situe les enjeux à l’intersection du linguistique, de l’historique et du politique, ce qui lui permet de montrer comment le couplage entre langue et nation a pu tout à la fois s’affirmer et se déconstruire. Revenir sur le rôle joué par la langue – ou les langues – dans la construction d’un « imaginaire national » (Benedict Anderson), c’est en effet en mesurer l’importance autant que l’insuffisance : dans ce contexte, la réflexion fondatrice de Renan révèle finalement les contradictions qui sous-tendent et informent le lien entre langue et identité nationale ainsi que la construction d’un « roman national ».
←14 | 15→Tel est donc le cadre à l’intérieur duquel, entre la guerre de 1870 et la Deuxième Guerre mondiale, les prises de position des écrivains sur le rapport entre la nation française et sa langue prennent leur sens. Interroger ce lien, le préciser et, souvent, s’efforcer de le justifier, c’est ce que font les écrivains dont le positionnement est analysé dans la première partie, « Les écrivains, la langue française et l’idée de nation ». Centré sur trois romans de Maurice Barrès et de René Bazin qui abordent la question du conflit entre le français et l’allemand dans l’Alsace et la Moselle annexées, l’article de Jean-Michel Wittmann (« La langue française sous l’œil du barbare germain, de Maurice Barrès à René Bazin ») commence par exposer le discours idéologique sur le lien entre la langue et la nation qui se déploie dans les romans de Barrès, avant d’analyser la place occupée par cette question de la langue française dans l’intrigue de ces romans, puis de revenir sur le lien entre l’imaginaire linguistique et l’expression métaphorique, à partir des images mobilisées pour évoquer la situation de la langue française en Alsace-Lorraine. Dans ces trois romans se déploie en effet un même argumentaire idéologique, mais aussi un même imaginaire de la langue, assis sur les moyens propres de l’expression romanesque. Franck Javourez (« Nation, hérédité et langue française selon Léon Daudet ») analyse ensuite L’Hérédo, un essai philosophique du pamphlétaire et mémorialiste Léon Daudet qui, à mi-chemin entre critique littéraire et psychologie, propose une analyse de l’homme fondée, chez les écrivains, sur leur langue et leur style. La structure de la langue française modèle ainsi l’image de la nation, formée elle aussi d’un moi et d’un soi : pour Daudet, l’héroïsme de la nation française s’entend littéralement dans sa langue, et ses écrivains, héros du verbe, en incarnent les archétypes. Benoît Abert (« Langue(s), nation(s) et vertu(s) : contradictions autour du “patriotisme froid” de la prose de Verlaine ») se penche pour sa part sur le Verlaine prosateur, défenseur parfois outrancier de la pureté et de l’unité de la pensée nationale ainsi que promoteur farouche de la langue française. La position de Verlaine est cependant originale en ceci qu’il valorise non pas l’héritage latin, célébré alors par les nationalistes, mais une langue associée au « naturel » des Ardennes et à la notion de « patriotisme froid », même s’il prend un plaisir manifeste, dans ses textes, à aller à l’encontre de ses propres principes. Élodie Dufour (« La langue selon Anatole France, une patrie à quatre dimensions ») présente ensuite la vision de la langue promue par Anatole France, qui peut sembler de prime abord conservatrice, mais se distingue pourtant d’une conception fixiste, normative et nostalgique de la langue, comme l’est à bien des égards celle des nationalistes de son temps. Pour France, les mots sont « l’œuvre de chair, de sang et d’âme de la patrie et de l’humanité », et la langue assure l’union des compatriotes à travers le temps, dessinant les contours d’une autre patrie, qui n’est pas seulement celle des contemporains, mais qui accueille les compatriotes de tous les temps. Ouvrant la réflexion à la période postérieure à la Grande Guerre, Paola Codazzi (« Identité(s) en discours : le cas de Siegfried et le Limousin (1922) de Jean Giraudoux ») revient enfin sur le roman controversé de Giraudoux, qui présente une réflexion sur l’idée de race et de patrie, et sur la coexistence possible, en un seul individu, de deux âmes nationales. Par-delà l’opposition stéréotypée entre le génie français, fondé sur l’équilibre et l’harmonie, et le génie allemand, caractérisé ←15 | 16→par sa démesure et sa lourdeur, c’est notamment le rôle central de la langue dans la définition problématique d’une identité nationale qu’elle met en lumière.
Une deuxième partie, « Formes et valeurs “françaises” », rassemble des articles qui rendent compte de la manière dont plusieurs écrivains soit s’attachent à cultiver ou à revendiquer le caractère national de certains procédés et de certaines stratégies d’écriture, soit placent leur art d’écrire sous le signe de valeurs considérées comme proprement « françaises ».
Stéphanie Smadja (« Le monologue intérieur et la prose française dans les années 1920 ») revient ainsi sur le monologue intérieur, inventé et déployé par Édouard Dujardin dans Les Lauriers sont coupés, en 1887, et sur les débats qui, une trentaine d’années plus tard, visent à le rattacher à une généalogie de la prose française à laquelle il semble pourtant, par nature, échapper. À travers ces débats dont elle révèle les enjeux et les présupposés idéologiques, c’est le fonctionnement institutionnel de la littérature et de la langue françaises qu’elle met en lumière, de même que l’influence de l’imaginaire du style simple chez les écrivains français de cette période. Contrairement au monologue intérieur, la forme aphoristique a pour sa part été souvent associée à « l’esprit français », comme le rappelle Stéphanie Bertrand (« “un des traits les plus significatifs de l’esprit français” : l’aphorisme, forme “française” au tournant du XIXe–XXe siècle »), qui montre comment l’assimilation entre écriture aphoristique et « esprit français », au tournant des XIXe et XXe siècles, permet alors de valoriser une certaine image de la France, et de l’intelligence française. Chez nombre d’écrivains proches du nationalisme, cette valorisation de l’aphorisme, présenté comme la forme paradigmatique de « l’esprit français » et comme l’incarnation de qualités considérées comme propres à la nation autant qu’à la langue françaises (clarté, fermeté, simplicité notamment), engage en effet moins des enjeux esthétiques qu’idéologiques, dans la mesure où l’aphorisme apparaît comme une possible réponse (littéraire) à la menace d’une supposée décadence (de la littérature) nationale.
Au-delà de l’aphorisme, c’est plus largement l’équivalence entre langue française et « esprit français » qui se trouve convoquée et reprécisée au début du XXe siècle, ainsi que le montre Antoine Piantoni (« Langue et esprit français dans les années 1910 ») pour la décennie qui précède la Première Guerre. Dans ce contexte, il révèle l’importance de la place occupée par la langue française dans ces débats autour de la (re)définition d’un « esprit français », dans des textes de critiques littéraires (René Doumic ou Francis de Croisset), ou d’universitaires (Paul Hazard ou Albert Dauzat), en suivant les ajustements successifs mais aussi la pérennité de certains discours jusqu’après la Grande Guerre.
Parmi les valeurs propres à nourrir cette équivalence entre langue française et « esprit français » figurent au premier chef l’ordre et la clarté, du moins pour Barrès, qui les considère, autour de 1910, comme « nos plus belles qualités nationales ». L’étude que leur consacre Vital Rambaud (« L’ordre et la clarté : “nos plus belles qualités nationales” selon Maurice Barrès ») met en évidence toute l’ambivalence de l’approche barrésienne, qui ne se satisfait pas d’une clarté sèche ou d’un ordre ←16 | 17→qui ne serait animé par aucun enthousiasme, même si, par son éloge de l’ordre et de la clarté, il participe à la « Renaissance classique » que prône notamment l’Action française depuis une dizaine d’années. En défendant régulièrement ces « qualités nationales » face à l’Allemagne, incarnation pour lui des ténèbres et du chaos, il n’en pose pas moins les fondements d’un art d’écrire à la française. Parallèlement aux qualités précédentes, la « pureté » a pu constituer, elle aussi, un mot d’ordre récurrent des discours soucieux de définir le « bon français » (ou « Français ») ; ce sont les formes singulières de ces discours puristes durant l’entre-deux-guerres qu’étudie justement Vincent Berthelier (« Derrière la crise du français : nouveaux aspects du purisme dans l’entre-deux-guerres »), et plus particulièrement la manière dont l’imaginaire puriste est à cette époque structuré par la double crainte du peuple (la démocratisation de l’enseignement consacrant le peuple en sujet politique) et de la science. Le purisme, alors essentiellement porté par des hommes de lettres et non par des savants, développe ainsi un imaginaire national réactionnaire, fondé sur une société d’ordre, artisanale et paysanne, à l’opposé de la société industrielle avancée dans laquelle les lettrés sont appelés à avoir une importance sociale restreinte.
La troisième partie du volume, « De l’académisme aux contre-discours », rend compte de certaines modalités de réception, en littérature mais aussi dans la critique littéraire, des discours nationalistes dominants sur la langue. Deux formes opposées semblent se dégager : celles qui témoignent d’un académisme exacerbé et celles qui prennent délibérément, parfois de manière polémique, le parti de la subversion – les deux formes pouvant d’ailleurs cohabiter, ainsi que le suggère l’exemple de l’espace littéraire belge de l’entre-deux-guerres.
Prenant pour objet un concours d’éloquence organisé par l’Académie française entre 1910 et 1912, l’article de Stéphane Zékian (« Les habits neufs de l’universalité. L’Académie et la langue française en 1912. ») s’intéresse à un premier type de zélateurs : celui des « (trop) bons élèves ». En choisissant alors d’inscrire au programme un « Discours sur la langue française », l’Académie entend contribuer dans sa mesure à répondre au sentiment de décadence de la langue française, à la fois nationale (crise pédagogique) et internationale (supposée perte d’influence du français dans le monde), en cherchant à canaliser les débats hexagonaux, dans une direction conforme aux souhaits de l’institution. Les résultats du concours, déceptifs par l’académisme exacerbé des lauréats, manifestent la perte de son influence autant que son impuissance à susciter un renouvellement de la pensée de la langue. Cet académisme excessif peut aussi être le fait d’écrivains soucieux de montrer des signes de « francité ». Cette manière d’écrire non pas seulement en français, mais en écrivain français, est également au cœur de l’écriture d’Irène Némirovsky, comme le souligne l’étude de Christelle Reggiani (« La langue nationale d’Irène Némirovsky »). Née russe et juive, convertie au catholicisme en 1939 mais jamais naturalisée française, la romancière a de fait construit son identité d’écrivain paradoxale, avec la langue qui lui donne consistance, dans l’appropriation du français littéraire forgé par les prosateurs de la seconde moitié du XIXe siècle et ←17 | 18→de ce que Christelle Reggiani, dans le sillage des travaux de Renée Balibar, désigne, au plan stylistique, comme un « français fictif ».
Plus complexe est la situation littéraire belge de l’entre-deux-guerres, qui voit s’affronter deux positions antinomiques, ainsi que le montre l’étude de Paul Dirkx (« Écrivains “francophones”, nationalisme et langue littéraire. Un exemple de l’entre-deux-guerres belge. ») : celle qui oppose – alors que le nationalisme belge est sorti renforcé de la Grande Guerre – un « universalisme » français gage de pureté formelle et un « régionalisme » belge source d’impuretés de toutes sortes. Évoquant l’un des moments paroxystiques de cette lutte pour la définition de l’autonomie littéraire locale – la publication, en 1937, du Manifeste du Groupe du Lundi, dont les vingt et un signataires nient jusqu’à la possibilité même d’une langue littéraire française propre à leur pays –, son article met notamment en évidence les traits rhétoriques et stylistiques qui, au nom de l’autonomie littéraire, servent aussi des principes littéraires hétéronomes, définis dans un ailleurs hexagonal idéalisé. Raphaëlle Hérout (« “La France, notre bopéyi, s’apeulait ja10 l’Agaule” : le style surréaliste contre la nation ») montre pour sa part que la rhétorique et l’imagerie anti-nationalistes développées avec éclat par les surréalistes passent notamment par une lutte contre les canons de la langue classique. Leur travail d’écriture vise en effet à briser l’association de la langue et de la clarté, régulièrement présentée comme la qualité première du français, afin de libérer la langue de la mainmise de la nation et, partant, d’empêcher les discours nationalistes de trouver dans la langue un argument en leur faveur et un moyen d’action.
La quatrième et dernière partie du volume, « Une nation, plusieurs langues », aborde enfin la question des usages et des représentations d’autres langues qui apparaissent propres à concurrencer le français, érigé en garant de la patrie et en incarnation du génie national, de l’argot au patois en passant par les dialectes régionaux, sans oublier la chimère de l’esperanto. À partir d’un corpus historique, philologique et littéraire (P. Larousse, G. Bruno, M. Bréal, G. Paris, E. Renan, A. Daudet, C. Le Goffic), Cécile Gauthier (« Une nation, des régions : la langue française au singulier, ou le “patois” comme impensé ») questionne ainsi le difficile équilibre à ménager entre unité et diversité linguistiques au cours des premières décennies de la IIIe République, qui célèbre la variété des provinces constitutives de la France et le lien qui lie le terroir à sa langue spécifique, tout en cherchant à préserver l’équivalence entre langue et nation, au singulier. Dans ce contexte, le « patois » pourrait être considéré comme l’impensé de l’imaginaire linguistique national, tantôt passé sous silence, ou effacé par la traduction, tantôt célébré, tout en étant l’objet de théories contradictoires. Dans la même perspective, Pamela Puntel (« Les “petites patries” dans la production poétique en langue française et dialectale après la guerre de 1870 ») revient sur l’exaltation des « petites patries » en tant que ciment de l’esprit national. À partir d’un corpus composé de poèmes publiés après la guerre de 1870 et rédigés en breton et en occitan, elle met en lumière le rôle fondamental joué par la poésie patriotique régionaliste à la fois dans la construction de l’identité nationale et dans le développement de la pensée nationaliste.
←18 | 19→Ce sont les enjeux engagés par l’usage de l’argot dans Le Feu (1916) que Denis Pernot (« L’argot du Feu (1916) d’Henri Barbusse ») analyse ensuite, en montrant que ce procédé a permis à Barbusse de construire un contre-discours de guerre face aux discours de propagande belliciste de la presse, en d’autres termes, d’élaborer un discours d’opposition à la guerre, passé inaperçu de la censure. Dans ce contexte, il apparaît que Barbusse a partagé le préjugé de langue des « bourreurs de crâne » et qu’après avoir « assaisonné » son œuvre d’argot, il l’a « corsée » en belle langue, ce dont témoignent les modifications qu’il y a introduites pour sa publication en volume. Enfin Vincent Gogibu (« L’espéranto : entre complot juif et menace sur la langue française. Remy de Gourmont et Ernest Gaubert. ») retrace les débats suscités par l’espéranto, à un moment où la place de la langue française et l’idée de nation suscitent interrogations et questionnements, en revenant sur les articles de Gourmont, très critique envers ce qui représente à ses yeux une ineptie linguistique inesthétique, ainsi que sur le pamphlet d’Ernest Gaubert, La Sottise espérantiste, qui dénonce la « menace » représentée par l’usage de l’espéranto et appelle de ses vœux le développement et la pratique de la langue française au plan international.
Si la littérature a offert une caisse de résonance particulièrement sonore à ces débats autour du lien problématique entre la nation et la langue françaises, entre 1870 et la Deuxième Guerre mondiale, la question reste brûlante aujourd’hui. La montée récente des nationalismes en Europe, en France a fortiori, a pu ramener sur le devant de la scène ce type de polémiques21. C’est ainsi qu’a par exemple été publié, en 2007, le manifeste « Pour une littérature-monde en français », à l’initiative de Michel Le Bris et Jean Rouaud ; tous deux y défendent, avec une quarantaine de leurs pairs, la nécessité pour le champ littéraire de « dénouer le lien entre la langue et la nation ». Dans le cadre d’un entretien mené à l’occasion du colloque avec Sophie Milcent-Lawson, Jean Rouaud, Prix Goncourt 1990 avec son premier roman Les Champs d’honneur, auteur d’une vingtaine de romans, récits et essais, revient sur ce refus d’appréhender la littérature au prisme d’une seule aire nationale et d’instrumentaliser la langue à des fins idéologiques : qu’il soit de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, d’Afrique, etc., le français reste selon lui « globalement [pareil]. Ce sont les mêmes phrases, c’est la même syntaxe. […] Si on arrive à se lire, c’est bien parce qu’on écrit dans la même langue. […] [G]lobalement c’est la même langue. » À l’heure où la mondialisation se révèle souvent synonyme de pluralité et d’accroissement de tous ordres, cette approche « globalisante » du français, au sens littéral de l’adjectif, apparaît peut-être comme une réponse possible aux dissensus et conquêtes de pouvoir.
←19 | 20→1 C. Maurras, Prologue d’un essai sur la critique, Revue Encyclopédique Larousse, 1896.
2 Voir Nationalisme, fascisme et antisémitisme en France, Paris, Seuil, 1982.
3 Dont les actes sont parus sous le titre Le Nationalisme en littérature : des idées au style (1870–1920), S. Bertrand et S. Freyermuth (éds.), Bruxelles, Peter Lang, « Convergences », 2019.
4 Projet scientifique Du style des idées, mené au sein de l’axe 3 COMES (Constructions Mémorielles et Sacralisations) du Centre Écritures (EA 3943) de l’Université de Lorraine.
5 À entendre au sens défini par Pierre Bourdieu dans Les Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.
Details
- Pages
- 322
- Publication Year
- 2020
- ISBN (Hardcover)
- 9782807614970
- ISBN (PDF)
- 9782807614987
- ISBN (ePUB)
- 9782807614994
- ISBN (MOBI)
- 9782807615007
- DOI
- 10.3726/b16950
- Language
- French
- Publication date
- 2020 (November)
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 322 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG