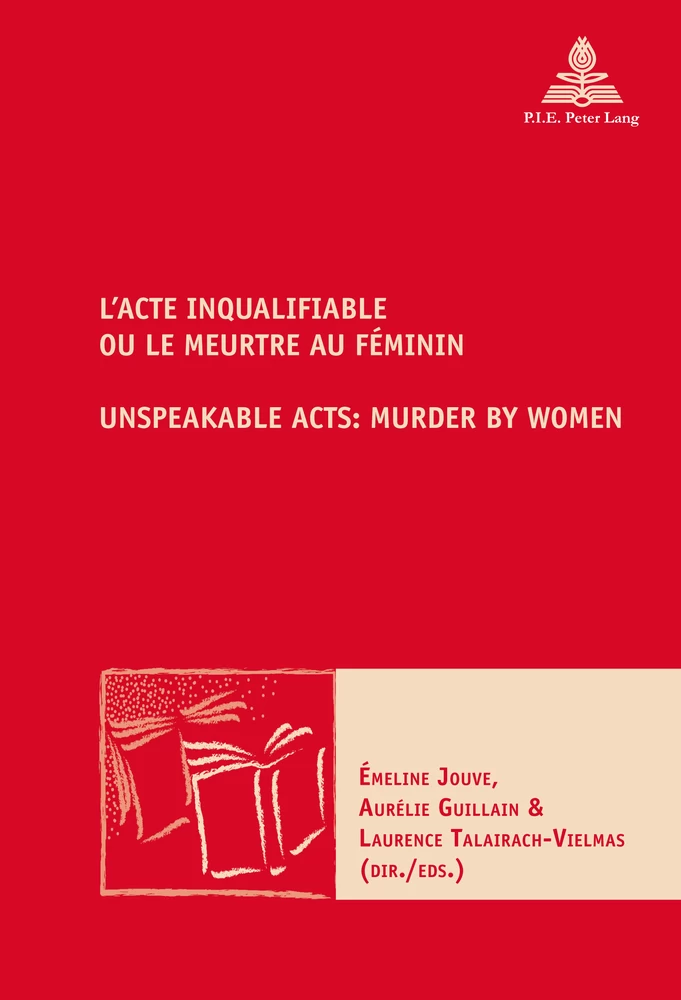L’Acte inqualifiable, ou le meurtre au féminin / Unspeakable Acts: Murder by Women
Résumé
Female murderers often elude firmly established categories as they disrupt the social and symbolic orders of patriarchal societies and call into question the well-oiled mechanisms of their legal systems. This collection of essays (in French and in English) examines the making of narratives that have staged actual or fictional female murderers, influencing the ways in which these women are collectively remembered – narratives that often lay bare the covert foundations of the indictment process.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières / Table of Contents
- Remerciements
- Introduction
- Première partie: reconstitutions / First part: reconstructions
- « [An] undutiful wife is a home-rebel, a house-traitor » : la construction du personnage de l’épouse meurtrière dans Arden of Faversham (1592) et A Warning for Fair Women (1599)
- ‘A traitress, and a dear’ : The Paradoxes of Women and Forensic Rhetoric in Early Modern Drama
- Cage de fer, cage de verre. « La Corriveau » : genèse et transformations d’une légende québécoise
- Charlotte Corday ou « l’ange de l’assassinat »
- Emma de Boucher de Perthes, ou comment peut-on être criminelle ? Représentation et analyse d’une femme criminelle en 1852
- Writing Murderesses: Feminine Crime and Autobiography in Wilkie Collins
- Women’s Justice: Nemesis and Subversion in Susan Glaspell’s Trifles
- Seconde partie: des meurtrières qui entrent en littérature / Second part: caught in the Web of Words
- La petite fille criminelle : archétype et littérature
- Jeux et enjeux des confessions d’une meurtrière : « Child’s Play » d’Alice Munro
- Tensions and Blurring Effects Linked to the Use of the Coordinator OR in ‘Child’s Play’ by Alice Munro
- Le meurtre de Fall River : accusée levez-vous ! Analyse stylistico-linguistique d’une nouvelle d’Angela Carter
- Cru-auté dans « Raw Material » de A.S. Byatt
- The Proof of the Pudding is in the Eating : The Dreadful Dames of William Shakespeare
- Motherhood, Mothering and Violence : Ambivalent Maternity in the Fiction of Yvonne Vera
- Notes bibliographiques / Notes on Contributors
- Titres de la collection
Les contributions réunies dans cet ouvrage collectif ont été présentées pour la première fois lors du colloque international « l’Acte inqualifiable ou le meurtre au féminin » qui a eu lieu à Toulouse les 9 et 10 février 2015, organisé par Emeline Jouve, Aurélie Guillain, Laurence Talairach-Vielmas et Héliane Ventura.
Cette publication a bénéficié du soutien financier de l’Université Toulouse Jean-Jaurès (Équipe d’Accueil CAS (Cultures Anglo-Saxonnes, EA 801), Département des Études du Monde Anglophone et UFR de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères), de l’INU Champollion, de l’Institut des Amériques (IDA), du Conseil Régional Midi-Pyrénées et de la Mairie de Toulouse. Nos remercions également Héliane Ventura pour sa contribution précieuse aux discussions scientifiques et à l’organisation du colloque qui ont mené à la publication de cet ouvrage. ← 9 | 10 →
Émeline JOUVE, Aurélie GUILLAIN & Laurence TALAIRACH-VIELMAS
Non prouvé
Le 30 juin 1860, le corps sans vie du jeune Francis Saville Kent, quatre ans, est découvert, la gorge tranchée. L’enquête de police, qui piétinera longtemps, portera d’abord ses soupçons sur la bonne d’enfants, Élizabeth Gough. Mais celle-ci sera vite innocentée, lorsque l’inspecteur Jonathan Whicher, figure emblématique de Scotland Yard qui inspirera de nombreux détectives du roman victorien,1 soupçonnera la demi-sœur de Saville Kent : Constance Kent. Sous la pression de l’opinion publique, Whicher se voit contraint de relâcher la jeune femme, âgée de seize ans au moment des faits, sans procès. Il devra attendre cinq années avant que Constance Kent avoue à la police le meurtre qu’elle avait confessé quelque temps auparavant à un prêtre.2 L’affaire Constance Kent n’est pas sans rappeler le procès de Madeleine Smith en Écosse en 1857. Smith, accusée d’avoir empoisonné à l’arsenic son amant, Pierre Émile l’Angelier, afin de pouvoir faire un mariage plus avantageux, avait, quant à elle, échappé à la prison, ses bonnes manières troublant les jurés, incapables de se prononcer sur sa responsabilité. Dans un cas comme dans l’autre, deux jeunes filles de bonne famille se retrouvent face à la justice. Dans un cas comme dans l’autre, la puissance des représentations collectives, qui font de la jeune bourgeoise un « ange »3 nécessairement innocent, leur permet d’échapper à l’échafaud ou à la prison. Malgré l’accumulation de preuves accablantes contre Madeleine Smith, le jury conclura en effet au verdict de « Non prouvé ».4 Pour Constance Kent, le manque de preuve et la pression de l’opinion publique auront raison de l’intuition de l’inspecteur ← 11 | 12 → Jonathan Whicher. Si la culpabilité de ces deux jeunes femmes ne fait aucun doute pour les inspecteurs chargés de chacune de ces deux affaires, Constance Kent, comme Madeleine Smith, apparaît aux yeux du public comme un oxymore vivant – composé impossible de la jeune fille de bonne famille et de la meurtrière, ce monstre qui empoisonne d’une main délicate ou celui qui tranche la gorge d’un enfant de quatre ans et lui assène des coups à la poitrine d’une violence inouïe.
Ces deux meurtres prémédités, dont l’un vise à pouvoir faire un meilleur mariage, tandis que l’autre cherche, selon toute vraisemblance, à punir une belle-mère haïe, s’inscrivent dans une longue lignée de meurtres au féminin, où les femmes, qu’elles soient coupables ou innocentes, doivent composer avant tout avec un imaginaire collectif puissant. Paradoxalement, le problème posé par le meurtre n’est pas la présence scandaleuse d’une figure maléfique d’ogresse ou de femme fatale. Le problème survient souvent lorsque l’« ange du foyer » risque d’être couvert de l’opprobre du crime, comme le corroborent les cas de Smith et de Kent. Alors que le XIXe siècle connaît une recrudescence sensible d’empoisonnements à l’arsenic perpétrés par de jeunes femmes ou des épouses insatisfaites de la classe moyenne,5 les chiffres indiquent néanmoins que c’est la gent masculine qui est le plus souvent accusée de meurtre, même si le meurtre arrive en première place parmi les crimes dont sont accusées les femmes. Comme l’ont montré les travaux de Mary Hartman sur les femmes meurtrières en France et en Angleterre au XIXe siècle, ces chiffres étranges dissimulent sans doute une réalité qui se dérobe devant les statistiques : artificiellement bas, ils ne tiennent souvent pas compte des nombreux infanticides, ni des meurtres par empoisonnement qui ont échappé à la justice. En outre, comme les cas de Madeleine Smith et de Constance Kent le montrent, l’attitude du jury et du public vis-à-vis des meurtrières est plus ou moins clémente selon les périodes de l’histoire.6
Comme les articles réunis dans ce volume le souligneront, la littérature mettant en scène des femmes meurtrières fait souvent fi des chiffres et des statistiques, quelle que soit la période historique. Des figures comme ← 12 | 13 → Médée ou Circé, qui traversent les siècles, nous rappellent sans cesse que féminité rime avec fatalité. Des magiciennes issues de la mythologie grecque aux Lucrèce Borgia et Madame de Brinvilliers remises au goût du jour dans la littérature romanesque, nombre de figures de femmes meurtrières se disputent la scène, brouillant fréquemment mythe et histoire dès lors qu’elles passent sous les feux de la rampe. C’est pourquoi il est important de revenir aux représentations de la femme meurtrière, une figure qui se retrouve bien souvent prise dans la gangue du cliché, qu’elle soit ange ou sorcière, coupable avant d’être jugée ou innocente malgré les preuves « circonstantielles ».
La Femme, le meurtre et la critique
Les études portant sur les violences commises par des femmes sont relativement récentes et bien moins nombreuses que celles qui ont été consacrées aux femmes victimes de la violence patriarcale – et notamment de la domination masculine au sens bourdieusien du terme.7 Dans un ouvrage collectif de 1997, Céline Dauphin et Arlette Farge signalent le scrupule éthique et politique qui a longtemps bridé les études sur la violence féminine : « comment même penser la violence des femmes, alors que la violence sur les femmes est de loin la plus manifeste, la plus établie […] Le dimorphisme est si évident qu’il pourrait imposer silence à une quelconque réflexion sur la violence des femmes ».8 Cependant, à partir des années 1990, on note un développement important de l’étude des violences perpétrées par le « sexe faible » en France et dans le monde anglo-saxon. Il est probable que la « deuxième vague » du mouvement féministe a rendu cette évolution possible en élargissant le champ de son enquête à toutes les formes de violence patriarcale, du sexisme ordinaire à l’instrumentalisation du corps féminin comme arme de guerre, des inégalités économiques à la négation des libertés fondamentales. Dans cette perspective, le recours des femmes à la violence peut être conçu comme une forme d’auto-défense, le revers et la conséquence d’une violence systémique exercée contre elles : la violence des femmes criminelles est ainsi entrée dans le champ d’étude et d’action du féminisme.
D’autres facteurs peuvent expliquer la croissance exponentielle des études consacrées à la violence féminine. Selon Coline Cardi et Geneviève Pruvost, l’intérêt pour les matricides, les empoisonneuses, les tueuses en série, les vengeresses et autres criminelles est une conséquence du développement conjoint des recherches sur le genre et des « recherches sur ← 13 | 14 → la police, l’armée, histoire du crime, de la justice et de l’enfermement ».9 Le regain d’intérêt populaire pour les fictions criminelles – notamment pour les séries télévisuelles à suspense qui se sont multipliées dans les années 1990 – a aussi encouragé l’enseignement et la recherche sur le crime et ses représentations.
Dans le paysage intellectuel français, les travaux sur les déviances féminines sont principalement historiques ou historiographiques. La recherche sur l’enfermement pénitentiaire ou asilaire des femmes criminelles a joué un rôle précurseur dans ce champ. La thèse de Claudie Lesselier, Les Femmes et la prison, 1815-1930 (soutenue en 1982), ou l’ouvrage de Yannick Ripa, La Ronde des folles. Femme, folie et enfermement au XIXe siècle (publié en 1986), ont inauguré un cycle d’études sur la prise en charge pénale et médicale des criminelles.10 Parallèlement à ces travaux historiques, la fin du XXe siècle a vu l’expansion des études criminologiques. Loin des analyses morphologiques et biologiques de Cesare Lombroso dans La Femme criminelle et la prostituée, sociologues, juristes et psychologues replacent les violences dans le réseau des contextes sociaux, économiques et institutionnels qui les expliquent et contribuent à en produire des représentations.11
Étonnamment, on trouve relativement peu de publications francophones consacrées à la représentation de la femme criminelle dans la littérature et les arts. Parmi les notables exceptions, l’on compte le livre ← 14 | 15 → de Christophe Régina12 et l’ouvrage collectif Les Vénéneuses : Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours,13 dirigé par Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Myriam Soria, qui comporte quelques articles sur la figure de la meurtrière dans des œuvres romanesques ou dans le domaine des arts. Cependant, lorsque la représentation de la femme meurtrière dans la littérature et les arts est envisagée, c’est souvent à travers l’étude de figures mythiques relevant d’un passé légendaire plutôt que de l’histoire proche. D’une part, comme le remarquent Cardi et Pruvost, « l’étude de la violence, comme ressource réelle ou théorique, au sein des luttes féministes […] est très lacunaire ».14 D’autre part, les approches francophones semblent plus « féminines » que « féministes » : en effet, en replaçant la violence réelle ou fantasmée des femmes dans leur contexte historique et artistique, il est rare qu’elles revendiquent une approche conceptuelle ou politique qui serait ouvertement héritée du féminisme, là où les études anglo-saxonnes tendent au contraire à souligner leur ancrage dans ce mouvement. Ainsi, Feminist Perspectives in Criminology ou Criminology at the Crossroads : Feminist Readings in Crime and Justice,15 ou encore la revue Feminist Criminology, qui l’inscrivent de façon programmatique dans leur titre. Depuis les années 1990, cette vitalité persistante du féminisme et l’investissement d’une partie des études féministes dans le champ en pleine expansion des Law Studies sont des aspects marquants de la recherche en sciences humaines au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Dès la fin des années 1980, les Law Studies ont développé l’analyse conjointe des fonctionnements de la justice institutionnelle et des fictions qui les représentent.16 Notamment après la publication de Women Who Kill (1980) par la journaliste et essayiste Ann Jones,17 les ← 15 | 16 → représentations de la violence des femmes en littérature ont donné lieu à un nombre conséquent d’ouvrages.18 Réciproquement, les historiens de la violence au féminin croisent fréquemment leurs méthodes avec celles des recherches en droit, en sociologie ou même en critique littéraire.19 Enfin, les années 2000 ont vu croître l’intérêt des chercheurs anglo-saxons pour la représentation de la violence à l’écran : plusieurs études spécifiques ont été consacrées à la violence féminine au cinéma et à la télévision.20
L’Acte inqualifiable
À la croisée des cultures scientifiques francophones et anglophones, L’Acte inqualifiable, ou le meurtre au féminin se propose d’articuler l’analyse historique et l’analyse des procédés discursifs mobilisés pour dépeindre celles que les sociétés jugent déviantes. Comme nous l’avons indiqué, cet ouvrage collectif emboîte le pas à des explorations récentes de la violence féminine, tel Les Vénéneuses : Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours. Mais alors que Bodiou, Chauvaud et Soria concentrent leurs recherches sur l’image de l’empoisonneuse, cette perfide dissimulatrice qui n’a nullement besoin d’user de force physique et qui se contente de concocter sa potion fatale depuis sa cuisine comme elle prépare ses soupes et ses purées, les différents chapitres de ce volume embrassent le meurtre féminin dans toute sa variété, tentant de dénouer l’écheveau des relations complexes entre mythe et histoire et ← 16 | 17 → de comprendre comment se façonne l’archétype de la femme meurtrière dans la littérature du XVIe au XXIe siècle, en Europe, Amérique du Nord ou encore en Afrique.
Une organisation chronologique a été adoptée dans cet ouvrage, de façon à situer plus aisément les moments de l’histoire culturelle et politique où vient s’inscrire telle meurtrière célèbre. L’adoption d’une présentation chronologique découle, en outre, de la logique comparatiste présidant à l’ouvrage : il s’agit, par exemple, de comprendre comment l’assassinat d’un mari peut représenter, dans différents contextes, un crime de « petite trahison », un équivalent de lèse-majesté, mais aussi de saisir à quel point la signification d’un tel acte peut varier en fonction des aires culturelles et des moments historiques. À l’organisation chronologique, s’ajoute un partage thématique : la première partie de l’ouvrage porte majoritairement sur des reconstitutions littéraires de cas réels célèbres, tandis que la seconde met davantage en relief des réflexions contemporaines sur les pouvoirs de la littérature dans son rapport avec la violence.
Il apparaît, dans la première partie de cet ouvrage, intitulé « Reconstitutions », que la femme qui tue ne se retrouve pas uniquement prise dans les mailles de la littérature romanesque et des journaux à scandale au XIXe siècle : les mises en récit du meurtre au féminin marquent tout autant la tragédie élisabéthaine dans des pièces au discours trouble qui laissent parfois entendre une voix discordante derrière un message qui se veut avant tout moralisateur. En effet, si les journaux du XIXe siècle se délectent des procès mettant en scène de jeunes bourgeoises soupçonnées ou accusées de meurtre, comme certaines émissions de télé-réalité peuvent aujourd’hui le faire, la littérature populaire de la fin du XVIe siècle s’amuse tout autant à multiplier les histoires de meurtres au féminin à coup de pamphlets et de ballades. Comme l’expliquent Frédérique Fouassier-Tate et Yan Brailowsky dans les deux premiers chapitres, les scènes élisabéthaine et jacobéenne s’emparent des faits réels dès la fin du XVIe siècle, proposant des tragédies domestiques, ou murder plays, qui mettent en lumière les clichés qui emprisonnent la femme meurtrière. Cependant, ces histoires de meurtre au féminin, comme dans Arden of Faversham (1592), qui relate l’histoire du meurtre perpétré par Alice Arden avec l’aide de son amant, de A Warning for Fair Women (1599), ou encore The White Devil (1612), de John Webster, inspiré d’une histoire italienne, ne sont pas simplement transposées sur scène. Le passage de l’histoire à la fiction permet de mettre à nu les fondements d’une idéologie patriarcale qui accuse la femme qui tue son époux de « crime de petite trahison », complexifiant ainsi le portrait de la meurtrière malgré les intentions d’édification des dramaturges. Ainsi, si l’agentivité féminine dérange, comme le suggère Fouassier-Tate, dans des pièces qui vont jusqu’à gommer la femme meurtrière du titre de l’œuvre, elle fait néanmoins ← 17 | 18 → trembler l’ordre patriarcal le temps d’une représentation, dérangeant les présupposés sur le féminin comme elle interroge le public, incapable de prononcer à son tour un verdict, à l’image du procès de Madeleine Smith près de deux siècles plus tard. C’est également la façon dont le statut légal de la femme est représenté sur scène qu’explore Brailowsky dans son étude de la rhétorique qui émaille les textes – une rhétorique « médico-légale » avant la lettre –, des mots qui servent souvent à condamner la meurtrière avant même la fin du procès ou de la pièce.
Ce sont ces mêmes clichés sur la femme meurtrière qui se retrouvent bouleversés dans le cas de Charlotte Corday en France au XVIIIe siècle. Coupable d’avoir assassiné Jean-Paul Marat le 13 juillet 1793 et guillotinée le 17 juillet, Corday n’est pourtant qu’assez peu représentée comme une criminelle. Le portrait de cette femme que les représentations se refusent à inscrire sous le signe de la criminalité, va inspirer les écrivains romantiques, comme l’explique Anne-Sophie Morel, Alphonse de Lamartine lui consacrant le livre 44 de l’Histoire des Girondins. La femme meurtrière, disculpée par une beauté et une grâce qui contrastent avec la laideur repoussante de sa victime, brouille les catégories du bien et du mal, faisant de la meurtrière une image instable.
La labilité de la figure de la femme meurtrière est également au centre de l’étude d’Alex Gagnon qui se penche sur le processus historique de fabrication et de transformation de la légende de « La Corriveau » au Québec au XVIIIe siècle. Coupable d’avoir assassiné son mari à l’aide d’une petite hache en 1763, Marie-Josephte Corriveau est condamnée à être pendue et exposée dans une cage, son corps en décomposition à la vue de tous pendant cinq semaines entières. La mise en scène d’un châtiment qui se veut exemplaire expliquera sans doute l’influence de la Corriveau sur la littérature québécoise dans les siècles qui suivent : dans la seconde moitié du XIXe siècle, la meurtrière se voit diabolisée par un discours normatif et devient tour à tour sorcière ou encore la « Lafarge Canadienne », en référence au cas de Marie Lafarge, en France, accusée en 1840 d’avoir empoisonné son mari à l’arsenic. Plus d’un siècle plus tard, en revanche, l’influence des mouvements féministes des années 1960 permet sa réhabilitation par la littérature, la Corriveau se faisant alors victime emblématique, sa cage métaphorisant la condition sociale des femmes dans une société patriarcale. Dans ce processus de fabrication d’une légende que nous invite à suivre Gagnon, la littérature joue un rôle crucial dans la construction d’une figure malveillante et démoniaque et sa déconstruction, manipulant les faits historiques pour permettre à la figure de la femme meurtrière de porter un discours sur sa société qui évolue au fil des siècles. ← 18 | 19 →
Dans les chapitres suivants, la parole est donnée à la femme meurtrière, qu’il s’agisse du roman épistolaire de Boucher de Perthes, Emma ou Quelques lettres de femme, publié en 1852 ou des héroïnes des romans de Wilkie Collins en Angleterre. Comme le met en lumière Romain Enriquez, le choix d’un mode introspectif chez Boucher de Perthes permet de passer de l’autre côté du miroir et de suivre la meurtrière, atteinte de « monomanie homicide », se construire peu à peu en objet pour analyser sa propre maladie. La jeune Anglaise, nommée Emma, n’est pas sans rappeler la patiente de Breuer, puis de Freud, Anna O., dans les années 1880. Dans son auto-analyse proche de la « talking cure » d’Anna O., Emma, qui tente à plusieurs reprises de tuer son amant dans un état de semi-conscience, nous emmène au plus profond de ses pensées, un voyage que proposent également les personnages féminins de Wilkie Collins quelques années plus tard en Angleterre dans des romans subversifs qui tentent eux aussi de requalifier le meurtre féminin.
Les romans à sensation des années 1860, qui connaissent un succès populaire fulgurant pendant plus d’une décennie, s’inspirent à tout va des affaires criminelles du temps. Les cas de Maria Manning, qui assassine son amant avec l’aide de son mari en 1849 et l’enterre sous le plancher de la cuisine, comme les affaires de Madeleine Smith et Constance Kent, déjà mentionnées, se retrouvent en filigrane des romans de Charles Dickens, Mary Elizabeth Braddon ou Wilkie Collins, entre autres. Mais le traitement de la figure de la femme meurtrière par la littérature populaire de l’époque nous invite à renverser le cliché et lire la meurtrière à travers ses propres écrits. Dans son chapitre, qui porte sur quatre romans de Wilkie Collins – Armadale (1864), The Haunted Hotel (1879), Jezebel’s Daughter (1880) et The Legacy of Cain (1888) – Mariaconcetta Costantini explique comment Collins réécrit des figures légendaires, telle Lucrèce Borgia, ou révise des procès contemporains mettant en scène des femmes meurtrières en nous donnant accès à leurs journaux intimes et leurs écrits. À une époque où les développements de la physiologie mentale condamnent le « sexe faible » à la folie et l’hystérie, le meurtre résultant d’une physiologie souvent déréglée dès les premières années de la puberté, Collins se sert de l’autobiographie comme d’un mode confessionnel pour faire un pied de nez au déterminisme biologique et aux théories proposées par Cesare Lombroso sur le « criminel né » qui s’immiscent outre-Manche dans les dernières décennies du siècle. Comme chez Boucher de Perthes, le meurtre féminin est médicalisé, certains personnages de Collins semblant même avoir hérité leurs pulsions homicides directement de leur mère. Cependant, si la transe laisse sourdre la pathologie dans ces romans de la seconde moitié du XIXe siècle, le récit sensationnaliste réécrit l’histoire en laissant à celle qui tue toute sa raison et en faisant du meurtre, ou de sa tentative, un acte délibéré et consciencieusement réfléchi. Ainsi, si la ← 19 | 20 → jeune Constance Kent est soupçonnée d’avoir été par trop influencée par ses lectures du procès de Madeleine Smith, les écrivains du XIXe siècle s’emparent du meurtre féminin pour réécrire les archétypes du crime féminin et déjouer l’idéologie patriarcale qui construit le féminin comme fragile, influençable et physiologiquement plus faible.
La première partie se clôt sur un chapitre sur Susan Glaspell qui, à l’instar de Wilkie Collins, revisite un procès de son temps pour amener les spectateurs de sa pièce Trifles (1916) à non seulement réviser le jugement de la femme criminelle mais à mettre en question également l’équité de la justice dans une société patriarcale. Adaptée de l’affaire Hossack que Glaspell couvra lorsqu’elle était journaliste pour le Des Moines Daily News, Trifles transpose la scène du procès du public (l’arène du tribunal) au privé (la cuisine de la présumée coupable, Minnie Wright) pour mettre à jour les mécanismes sociaux qui sous-tendent la violence invisible, la violence ordinaire. Pour interroger la justice américaine de son époque, Glaspell, comme le montre Martha C. Carpentier dans son chapitre, interroge le concept de nemesis dans cette tragédie domestique inspirée des plus grandes tragédies grecques.
Dans cette première partie qui nous fait voyager entre plusieurs siècles et plusieurs continents, l’image de la femme meurtrière frappe par ses oscillations multiples, la littérature révélant la force des représentations collectives et permettant de se détacher du mythe et de l’archétype pour reconstruire de l’intérieur la femme qui tue. Alors que la littérature brouille souvent les données de l’histoire, elle permet néanmoins aussi de dégager ce qui relève du mythe et de l’histoire. En abordant des pièces de théâtre et créations romanesques qui confrontent la réalité historique à l’imaginaire de la fiction, les chapitres de cette première partie permettent ainsi de suivre les étapes de la construction d’une légende, comme chez Alex Gagnon, comme de contrer les discours juridiques et médicaux qui condamnent souvent la femme avant même qu’elle ne soit jugée.
Dans sa seconde partie, « Des meurtrières qui entrent en littérature », l’ouvrage se penche sur des textes majoritairement contemporains, et la réflexion des auteurs y porte moins sur des processus de reconstitution littéraire de cas fameux que sur la capacité de la littérature à produire une réflexion critique sur la figure de la meurtrière, ses fonctions et ses valeurs. Dans des nouvelles contemporaines qui font ici l’objet de diverses microlectures, Alice Munro, Angela Carter, A.S. Byatt et Yvonne Vera imaginent des figures féminines qui commettent des actes d’une violence extrême. Cependant, ce qui les rend scandaleuses est moins la violence intrinsèque de leur acte meurtrier que le statut doublement contradictoire de ces figures dans le système social, juridique et politique où elles s’inscrivent. Ici, celles qui tuent ne sont pas seulement des femmes ← 20 | 21 → dévoyées ; le comble, c’est que ce sont des petites filles, ou de très jeunes filles, ou des femmes très âgées – des personnages que Jean-Jacques Lecercle définit comme des criminelles « au carré » : non seulement elles brouillent l’opposition entre un pôle masculin actif, responsable et dominant et un pôle féminin passif, irresponsable et dominé, mais elles inversent aussi symboliquement la norme de l’opposition entre l’autonomie de la force de l’âge et les dépendances multiples de l’enfance ou de la sénilité. Quant aux deux textes shakespeariens étudiés dans cette partie (Titus Andronicus et Macbeth), ils permettent de dégager un système de correspondances métaphoriques entre la sorcière qui cuisine les enfants, la reine prête à réduire la cervelle de son nourrisson en bouillie, et la reine barbare à qui on donne ses propres fils à manger, dans la réécriture par Shakespeare du mythe de Procné. De nouveau, le caractère scandaleux et fascinant de la figure féminine est lié à la révélation oblique d’une structure symbolique fondamentale : la mère s’inverse en ogresse ou en sorcière, celle qui nourrit les enfants devient celle qui les mange, et la prise de pouvoir du féminin fait alors triompher l’indistinction du ragoût sur la forme normée et civilisatrice du sacrifice ritualisé ; ce qui est mis à mal et simultanément révélé, c’est une nouvelle fois un fait de structure. Dans les romans contemporains d’Yvonne Vera qui mettent en scène des mères infanticides, c’est encore une fois une contradiction qui est introduite dans les structures qui circonscrivent culturellement l’identité maternelle. De tels romans, lorsqu’ils produisent des dispositifs d’identification pour saisir la logique interne d’un acte infanticide, créent aussi une tension spécifiquement littéraire entre la saisie d’une rationalité et le saisissement devant un acte scandaleux qui ébranle aussi bien les structures éthiques que les constructions mythiques de la maternité.
Dans son étude de la petite fille criminelle, Jean-Jacques Lecercle se situe dans le prolongement d’études mythographiques qui interrogent les relations possibles entre les rapports de genre historiquement constitués et la représentation mythologique de leur transgression.21 Son article souligne la valeur archétypale de la figure fictionnelle de la meurtrière, notamment lorsque celle-ci se présente sous la forme doublement oxymorique du petit monstre. Le concept d’archétype proposé par Lecercle se distingue radicalement du concept d’archétype jungien. En effet, chez Jung, l’archétype est un schéma matriciel d’images qui relève d’un inconscient collectif universel ; si l’archétype jungien est censé survivre d’une époque historique à l’autre, c’est en vertu d’une constante anthropologique d’autant ← 21 | 22 → plus stable qu’elle correspond selon Jung à un principe métaphysiquement inscrit dans l’ordre des phénomènes. Au contraire, l’archétype selon Lecercle est historiquement constitué : c’est une représentation dont l’apparition, mais aussi la persistance, s’explique par une analyse généalogique. Lecercle explique que la figure de la femme meurtrière est une formation idéologique (au sens marxiste et althussérien) et qu’elle renvoie allusivement à une contradiction historique tout en masquant cette dernière sur le mode de l’illusion. C’est pourquoi l’archétype de la femme meurtrière renvoie par allusion au partage des rôles entre homme dominant et femme dominée, précisément dans la mesure où elle inverse, dans un « syntagme oxymorique », le rapport qui règle normalement l’opposition entre les genres. Ainsi, si l’archétype de la femme meurtrière est primordial et qu’il donne un sentiment de permanence trans-historique, ce n’est donc pas en vertu du caractère anhistorique d’un inconscient collectif, mais parce que la contradiction historique à l’œuvre dans le partage des rôles genrés n’est toujours pas dépassée dans la réalité des rapports sociaux. Outre cette réflexion sur l’archétype qui doit autant à la généalogie de Nietzsche qu’au matérialisme historique de Marx, le chapitre de Lecercle propose aussi un approfondissement de la distinction entre « fiction » et « littérature » que l’auteur a développée antérieurement, par exemple dans L’Emprise des signes (2002). Il prend « Child’s Play », la nouvelle qu’Alice Munro a consacrée à deux enfants infanticides, comme illustration d’une écriture qui ne repose pas sur la reconnaissance de l’oxymore archétypale (ce sont des enfants mais ce sont des tueuses), mais plutôt sur la connaissance d’une situation singulière où l’archétype, universel abstrait, se dissout dans l’universel concret et se dialectise en traversant la complexité et les ambiguïtés insolubles des cas singuliers. En cela, la nouvelle de Munro fournit un exemple de littérature au sens où Lecercle entend le terme : un texte qui propose une sorte de connaissance au lecteur, par opposition aux formules fictionnelles qui se bornent à orchestrer une reconnaissance de la doxa.
Parmi les caractéristiques de l’approche littéraire des meurtres les plus atroces ou les plus scandaleux, on trouve l’introduction toujours possible d’une distance : distance esthétique, distance ludique, ou encore distance sceptique, notamment dans les cas où le narrateur affiche son manque de fiabilité. C’est cet élément de distanciation qui est mis en relief dans l’étude proposée par Corinne Bigot de « Child’s Play » d’Alice Munro. Par exemple, les multiples références à The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner (1824), récit de double de James Hogg qui sert d’hypotexte principal à la nouvelle de Munro, permettent d’interpréter le meurtre de la jeune handicapée comme la destruction d’un double fantasmatique, ce qui introduit simultanément lisibilité et déréalisation dans cette histoire de meurtre enfantin ; cette distance est encore renforcée ← 22 | 23 → par de nombreuses contradictions internes qui mettent en doute la fiabilité de la narratrice, ce qui introduit un élément supplémentaire de jeu, dans le double sens de distance et de participation captivée à une activité gratuite. Les analyses linguistiques et stylistiques de Blandine Pennec, qui portent sur l’omniprésence, dans cette même nouvelle, de la coordination en OR, mettent en relief les stratégies de modalisations des énoncés auto-accusateurs, de sorte que ce récit pseudo-confessionnel met avant tout en relief la fragilité de tous les énoncés assertifs et, partant, la fragilité même de l’imputation d’un crime à un agent.
Dans le chapitre suivant, consacré à la reconstitution du cas Lizzie Borden par Angela Carter, Henri Le Prieult offre également une approche stylistique de ce texte : il montre, en effet, comment la version post-moderne et féministe que Carter propose de l’affaire Borden ne consiste nullement à disculper la jeune Lizzie, mais plutôt à rendre problématiques les principaux processus linguistiques de la mise en accusation. La prolifération des phrases nominales suggérant une impossible prédication, ou encore le brouillage des repères temporels dans le système de temps, permettent certes une compréhension empathique de la situation de Lizzie, mais ils mettent également en question la possibilité même de reconstruire une chaîne causale accusatrice. Dans cette fiction post-moderne, nous revenons à la reconstitution fictionnelle d’une affaire judiciaire réelle : le meurtre supposé d’Andrew Borden par sa fille Lizzie en 1892, qui avait donné lieu à un procès retentissant et s’était soldé par un acquittement. À l’instar du procès de Constance Kent évoqué en préambule, le procès de Lizzie Borden a révélé la difficulté intrinsèque que représentait au tournant du siècle la condamnation pour meurtre d’une jeune fille de bonne famille, c’est-à-dire d’un être essentiellement mineur et passif : d’un être sinon innocent, du moins fondamentalement irresponsable. La fiction contemporaine de Carter, avec l’inflexion méta-littéraire qui lui est propre, attire notre attention sur un trait commun à la plupart des reconstitutions littéraires de cas réels : sous l’effet d’un scrupule qui est indissociablement éthique et esthétique, ces fictions demeurent accusatrices tout en problématisant l’acte d’accusation.
En abordant la nouvelle de A.S. Byatt, « Raw Material », Sylvie Maurel reprend le fil de la discussion théorique ouverte par Jean-Jacques Lecercle sur les pouvoirs et les limites de la fiction littéraire lorsque celle-ci entreprend de représenter la violence. Elle montre comment s’élabore, au sein de la fiction même, une distinction entre l’image littéraire convenue et pour ainsi dire purgative de la violence, et un autre type de représentation de la violence qui serait plus apte à en produire une connaissance. En effet, l’article de Maurel dégage les enjeux méta-fictionnels d’une nouvelle qui est ici considérée comme une leçon d’écriture. Le texte de Byatt oppose une écriture mélodramatique sur le ← 23 | 24 → mal et une évocation plus oblique de la cruauté ; le recours aux catégories de « violence subjective » et de « violence systémique », qui ont été élaborées par Slavoj Žižek dans Violence, permet de caractériser l’écriture oblique comme la seule qui puisse espérer éclairer la violence systémique dans ce qu’elle a d’omniprésent, de quasi invisible et de profondément lié aux mots d’ordre de la norme.22 Ici, Maurel présente les récits enchâssés, ceux que la victime avait écrits avant sa mort, comme les seuls signes qui sachent lever un coin du voile sur la violence systémique, la plus sourde, la plus interminable et la plus tyrannique de toutes : dans le récit des tâches ménagères de la maîtresse de maison à l’époque édouardienne se lit la torture infligée aux corps, en une doublure discrète et normalisée des sévices que les deux vieilles femmes se sont plus tard infligés entre elles. Le meurtre de la vieille dame n’est pas présenté comme une action inqualifiable ou irreprésentable, mais plutôt comme un acte qui nécessite, pour être compris et analysé, cette image oblique qui pointe vers la « violence systémique » de préférence à l’image diabolisante et frontale qui ferait le portrait individualisé de la « violence subjective ».
Enfin, notre parcours se termine sur la figure doublement scandaleuse de la mère infanticide, avec deux études qui envisagent diversement les contradictions auxquelles renvoie ce personnage : l’étude de Anne Sweet-Lecercle adopte une perspective psychanalytique où la mangeuse d’enfants n’est pas envisagée comme un sujet, mais plutôt comme le fantasme du sujet, tandis que l’article de Fiona McCann interroge au contraire les paradoxes de la construction d’un sujet féminin qui se pose simultanément comme mère et comme infanticide. Dans son analyse des mangeuses d’enfants dans deux pièces de Shakespeare, Anne Sweet-Lecercle souligne que les enjeux de la représentation littéraire des meurtrières ne sont jamais exclusivement stylistiques ou esthétiques, mais qu’ils engagent la « radicalité d’une structure ». En l’occurrence, c’est à la structure de l’inconscient que l’article associe l’image du ragoût de nourrisson qui est préparé par les sorcières de Macbeth ou encore celle du pâté d’enfants offert par Titus à leur mère Tamora dans Titus Andronicus. L’interprétation lacanienne qui est proposée de ce « repas dément » insiste sur l’indistinction régnant dans le salmigondis d’enfant et représentant l’image horrifique d’un retour à une totalité unifiée où la marque du Symbolique ne se serait pas encore inscrite. Même si Tamora ne tue pas ses fils, et qu’elle mange involontairement leur chair du fait d’un piège qui lui est tendu (reflet littéraire du piège tendu à Térée par Procné dans le mythe ovidien), elle s’inscrit néanmoins, selon Anne Sweet-Lecercle, dans une composition en diptyque où Lady Macbeth et les sorcières ← 24 | 25 → occupent le deuxième volet, et où se démultiplie la figure fantasmatique de la mangeuse d’enfants qui inverse la figure maternelle nourricière : la femme meurtrière est alors définie comme un fantasme où « l’érosion du pouvoir de la vir-tus masculine » s’accompagne structurellement de l’accès au pouvoir d’une femme phallique ou d’une reine barbare, et où se manifeste la hantise de voir s’effriter et s’effacer le régime du Symbolique. Si l’on suppose que ce jeu de signifiants est révélateur d’une structure inconsciente, on peut également supposer, comme le fait Anne Sweet-Lecercle, que l’image du repas dément (matta cena) de la mangeuse d’enfant peut refaire surface dans des contextes contemporains où l’érosion du pouvoir de la vir-tus fera naître de semblables fantasmes.
Résumé des informations
- Pages
- 276
- ISBN (ePUB)
- 9782807600164
- ISBN (MOBI)
- 9782807600171
- ISBN (Broché)
- 9782875743640
- ISBN (PDF)
- 9783035266405
- DOI
- 10.3726/978-3-0352-6640-5
- Langue
- français
- Date de parution
- 2016 (Septembre)
- Publié
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2016, 271 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG