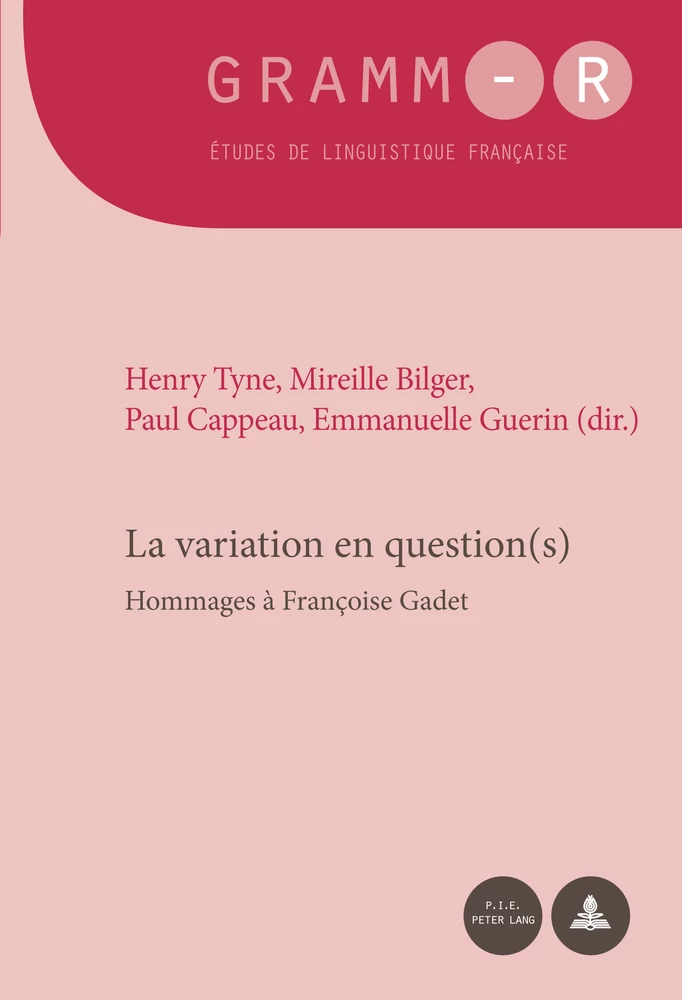La variation en question(s)
Hommages à Françoise Gadet
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur/l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Introduction. Quelques variations sur Françoise Gadet et son œuvre scientifique (Mireille Bilger / Paul Cappeau / Emmanuelle Guerin / Henry Tyne)
- I. Aborder la variation
- 1. When (and Why) Is a Variable Not a Variable? (Nigel Armstrong / Kymmene Dawson)
- 2. De la variation en discours. L’apport de la réflexion sur le diaphasique (Philippe Hambye)
- 3. Éléments pour une approche communicationnelle de la variation (Emmanuelle Guerin)
- II. Sociolinguistique historique
- 4. En passant par la variation, vers la « langue commune » en 1694 (Francine Mazière)
- 5. La sociolinguistique historique devant le lexique (R. Anthony Lodge)
- III. Contact des langues
- 6. Norman Forms, French Norms: Diaphasic Variation and Language Contact (Mari C. Jones)
- IV. Études du français parlé
- 7. L’accord verbal en nombre avec les collectifs dans le français parlé en Ontario (Françoise Mougeon / Raymond Mougeon)
- 8. Reflexivity and Discourse-pragmatic Variation and Change (Kate Beeching)
- 9. Parallel Innovations in Conflictual Rhetorical Questions in the Multicultural Vernaculars of London English and Parisian French (Aidan Coveney / Laurie Dekhissi)
- V. Oral et écrit
- 10. Entre les lignes : écrits de soldats peu-lettrés de la Grande Guerre (France Martineau)
- 11. Écriture numérique spontanée et variabilité : un écrit-oral à exploiter en français langue étrangère (sensibiliser aux styles et à la prononciation) (Sandrine Wachs)
- VI. Acquisition et enseignement
- 12. La variation sociolinguistique en français langue seconde – de bonnes nouvelles ? (Inge Bartning / Fanny Forsberg Lundell)
- 14. Variations phonétiques contemporaines : transparence et opacité dans le marché des langues globalisé. Du côté du FLE (Enrica Galazzi)
- Tabula gratulatoria
- Index
- Titres de la collection
Quelques variations sur Françoise Gadet et son œuvre scientifique
Mireille BILGER, Paul CAPPEAU, Emmanuelle GUERIN et Henry TYNE
Avec la participation d’Annette Boudreau, Bernard Laks et Ralph Ludwig
1. Préambule
Ce livre réunit différents travaux ayant pour objectif commun de rendre hommage à Françoise Gadet. Ensemble, ils concourent à témoigner de sa contribution scientifique majeure, de l’importance et l’étendue de ses travaux. Le profil et le parcours professionnels de Françoise Gadet sont à la fois impressionnants et atypiques. Quand on considère non seulement le nombre mais aussi – et surtout – la diversité de ses publications1, on est frappé par son implication à bien des niveaux, tant pour elle l’étude de la langue ne peut se résumer à une seule approche, à un seul modèle, à une seule discipline : sociolinguiste, certes, mais aussi historienne de la langue, théoricienne, descriptiviste s’intéressant aux données orales, aux corpus, à l’acquisition, etc. Cette approche « ouverte » sera source d’importants éclairages autour de thèmes majeurs concernant la maîtrise de la langue par différents locuteurs, en France comme ailleurs, en synchronie comme en diachronie.
Comme il est difficile de rendre compte de l’ensemble des travaux de Françoise Gadet, nous avons choisi de mettre en exergue quelques termes forts de sa recherche et de les illustrer, entre autres, par le biais de témoignages de ses collègues et ami(e)s. ← 9 | 10 →
2. Sociolinguistique
De son propre aveu, Françoise Gadet n’est « pas née sociolinguiste » et c’est tardivement qu’elle s’est vue « à l’aise dans le champ de la sociolinguistique », ayant d’abord été attirée, l’époque s’y prêtant, par le cadre structuraliste et épistémologique, assumant son faible pour Saussure (à qui elle consacre un livre – Gadet 1987). Mais elle ne regrettera pas le virage amorcé par deux ouvrages, l’un consacré au français « ordinaire » (Gadet 1989) et l’autre au français « populaire » (Gadet 1992a). Justement, elle tirera profit de cette évolution pour faire avancer ces propres interrogations, comme le précisait Bernard Laks au cours de son allocution en hommage à Françoise Gadet :
En 1977, paraît un article de Françoise Gadet « La sociolinguistique n’existe pas : je l’ai rencontrée ». Joli titre sans aucun doute pour quelqu’un qui fera toute sa carrière (et quelle carrière !) apparemment sous ce label. Mais au-delà du titre, si on met de côté tout ce qui dans cet article est forcément daté ou obsolète, une interrogation persiste. Après plus de 35 ans d’une carrière internationale que chacun de l’extérieur qualifiera donc de sociolinguistique, se maintient une même critique, un même regard, une même analyse. Vous savez toutes et tous que Françoise n’aime pas le mot et l’idée même de sociolinguistique. Elle a pour cela des arguments, et elle déploie une persistance de l’interrogation qu’on se doit de souligner. Son objet vrai c’est le français oral, le français populaire, le français qui se cause comme on dit. Elle a sur cet objet fuyant écrit des milliers de pages et publié des dizaines d’ouvrages.
Ce constat est largement partagé par Annette Boudreau :
Ce qui m’a toujours frappée chez Françoise Gadet, c’est la palette très large de ses intérêts de recherche. Si le français parlé et tout ce qui l’entoure a constitué le fil conducteur de ses travaux, la sociolinguistique en général et les questions épistémologiques de sa construction n’ont pas pour autant échappé à ses interrogations. Elle n’a eu de cesse de se questionner sur le rôle du linguiste dans la société, sur les modalités régissant la circulation du savoir linguistique, sur ses enjeux, et sur les conséquences de celui-ci pour les locuteurs.
Ralph Ludwig, quant à lui, parle d’une « sociolinguiste en dialogue ». Cette définition résume joliment la relation toute particulière que Françoise Gadet entretient avec son propre domaine de recherche : dialogue intérieur (interrogations) mais aussi dialogue extérieur (confrontations et échanges). Ralph Ludwig précise par ailleurs que ce dialogue s’est effectué avec la linguistique d’outre-Rhin (ce qui est rare dans la communauté des linguistes hexagonaux) et la linguistique écologique :
En 2008, Françoise Gadet m’invita à une table ronde sur les rapports entre sociolinguistique et écolinguistique. Nous avons, dans ce contexte, ← 10 | 11 → discuté de certains changements auxquels sont confrontées les Sciences du langage : hétérogénéité de diverses disciplines, intérêt croissant pour la mise en rapport de phénomènes universels et de faits linguistiques concrets, importance accrue de la linguistique de terrain découlant d’une multiplicité communicative inédite suite aux mouvements migratoires, et de nouveaux moyens techniques (corpus numériques, etc.). Ce débat a été très stimulant au début d’une réflexion plus globale sur l’écolinguistique, basée sur la théorie de la « fondation », et du tout et des parties de Husserl (voir Ludwig et al. 2017). Suivant cette théorie, le paramètre social – à différencier selon ses divers aspects – constituerait l’un des ancrages fondamentaux du langage, entre autres, et les interrelations changeantes et multiples entre ces paramètres s’avèreraient être une des tâches majeures de la linguistique. Les rapports entre écologie linguistique et sociolinguistique n’ont pas fini d’être explorés ; souhaitons donc que Françoise Gadet poursuive ses initiatives dans l’orchestration du dialogue autour de cette problématique !
Une sociolinguiste en dialogue aussi avec les autres disciplines, prenant ainsi au mot la formation du terme « sociolinguistique » : la linguistique ne serait pas ce champ considérable indépendamment des rapports qu’il entretient inévitablement avec les autres domaines des sciences humaines.
3. Variation(s)
La variation, « plus qu’une écume » (Gadet 1997), est tout naturellement au cœur de l’œuvre scientifique de Françoise Gadet. Mais elle n’hésite pas à pointer les problèmes de sa prise en compte et de son application à la langue (Gadet 1992b), ce qui vaut notamment au variationnisme d’être mis à distance (Gadet 1997, 2003), de même que l’hypothèse diglossique (Gadet & Tyne 2012). De tous les « types » de variation, c’est le diaphasique, la variation inter- et intra-individuelle (appelée aussi « style » – Gadet 2004) qui prend une place importante dans les réflexions de Françoise Gadet car c’est ce qui « rend possible la négociation du sens social » (Gadet 2005 1353). Jamais à l’aise dans la simple application du variationnisme au français telle que pratiquée par d’aucuns – mais tout en entretenant d’excellentes et fructueuses relations avec des collègues variationnistes, comme en témoigne ce volume – et surtout largement insatisfaite de la capacité de la sociolinguistique à expliquer la variation, Françoise Gadet évite soigneusement de traquer des phénomènes à tout prix opposables comme « registres » dans une logique d’équivalence sémantique ou selon un pré-découpage simplifié du social (catégories ou « classes » de locuteurs, etc.) ; elle préfère privilégier l’accès aux individus et à ce qu’ils font avec le langage (d’où notamment l’importance dans ses travaux de la distinction oral-écrit et l’attrait des études sur la variation ← 11 | 12 → en syntaxe), tentant ainsi de mieux comprendre (et décrire) le monde à travers le point de vue de ceux qui le construisent (Gadet 2007).
4. Français ordinaire(s)
Comme le signale Françoise Gadet elle-même, son domaine de recherche est, entre autres, l’étude des français ordinaires parlés dans l’Hexagone mais aussi hors de France. Cette notion de « français ordinaire » (Gadet 1989) a eu un retentissement important, comme le rapporte Annette Boudreau, notamment dans l’espace francophone :
En 1994 à l’Université de Moncton, Françoise Gadet était venue donner plusieurs conférences autour du thème : la norme, le français populaire et les français régionaux. Elle arrivait en Acadie, lieu de la francophonie nord-américaine où les discussions sur le vernaculaire et les rapports à celuici occupent une place centrale. Ses propos sur le français ordinaire ont eu une résonnance immédiate dans l’auditoire composé principalement de professeurs, d’étudiants et de personnes engagés dans la francophonie à des degrés divers et selon des intérêts sociaux et académiques différents. Entendre dire que la langue parlée par les gens dans le quotidien variait partout dans la francophonie et selon les situations, et surtout que la communication orale obéissait à des impératifs sociaux fort complexes n’a laissé personne indifférent, d’autant plus que ces paroles provenaient d’une Française, représentante par excellence de la norme dans l’imaginaire canadien français.
5. Corpus
Profitant des réflexions et des observations en France et ailleurs, issues de la dialectologie, mais aussi de la sociologie, et des travaux sur le français parlé impulsés par Claire Blanche-Benveniste et le GARS (Groupe aixois de recherches en syntaxe, voir Blanche-Benveniste et al. 1990), Françoise Gadet s’est interrogée depuis de nombreuses années sur les aspects empiriques et épistémologiques concernant la constitution des corpus et leur exploitation, questionnant la place (et la nature) des données en sociolinguistique (Cappeau & Gadet 2007). Ces réflexions ont fait d’elle une référence internationale en la matière, d’où le fait qu’elle ait été une des chevilles ouvrières de projets de grands corpus permettant des études variationnelles. Mais là où la linguistique de corpus s’est emparée du terme « corpus », développant ses propres pratiques et préoccupations, parfois éloignées de celles des sociolinguistes (André & Tyne 2014), Françoise Gadet fait valoir ses préoccupations au nom de la démarche dite « écologique », notamment via son implication dans le projet CIEL-F (Gadet et al. 2012), et sa direction du projet MPF (Multicultural ← 12 | 13 → Paris French). La particularité du corpus MPF tient précisément à ses fondements reposant sur les principes et questionnements qui animent la réflexion de Françoise Gadet sur le rapport que le chercheur entretient avec les données, la langue parlée et la variation (Gadet & Guerin 2012). Emmanuelle Guerin précise :
Le projet MPF donne à voir toute l’ouverture d’esprit et la curiosité intellectuelle inépuisable de Françoise Gadet. Le cadre théorique et méthodologique du projet est sans cesse réinterrogé au regard des données recueillies parce que la langue produite par les locuteurs n’est pas catégorisée en amont. Aussi grande et incontestable que soit l’expertise de Françoise Gadet, on est frappé par cette humilité, et pourquoi ne pas parler d’une certaine « naïveté vertueuse », qui la pousse à accepter de ne pas savoir, d’être ébranlée dans ses certitudes, face aux données. De la même façon, alors qu’elle sait défendre avec force ses positions, parce qu’elle en a les arguments, que rien n’est laissé au hasard du fait d’une force de travail constante, elle sait entendre et admettre les points de vue différents, rendant ainsi toute collaboration de travail non seulement fructueuse mais avant tout possible.
6. Enseignement et direction de recherche
Les coordinateurs du présent ouvrage, liés à Françoise Gadet par des rapports de nature sensiblement différente, partagent le fait d’avoir été à des degrés divers « sous sa direction », d’avoir eu ce privilège. Nous pouvons reprendre à notre compte ce qu’en dit Annette Boudreau :
Elle a été ma directrice de thèse, une directrice exemplaire, généreuse de son temps et de son savoir, rigoureuse et attentionnée, tout en me laissant suivre ma voie / voix. Un phare, elle l’a été, autant par ses conseils judicieux que par sa personne, dont la modestie a été inspirante. Alors qu’elle est invitée partout dans le monde pour parler de sociolinguistique, de bilinguisme, de la francophonie, de la variation et qu’elle aurait pu adopter une attitude de surplomb à mon égard, elle est restée totalement disponible et rassurante.
Pour aller dans le sens des propos d’Annette Boudreau, Emmanuelle Guerin se souvient des premiers échanges avec Françoise Gadet lorsqu’elle l’a sollicitée pour diriger sa thèse :
Alors qu’aujourd’hui, nous travaillons ensemble dans un rapport d’égalité, Françoise Gadet reste ce modèle de rigueur et d’honnêteté intellectuelle qui a largement motivé mon engagement dans la voie de l’enseignement et de la recherche en sociolinguistique. De notre premier entretien avant la grande aventure de la thèse sous sa direction, je retiens avant tout ces mots qu’elle a sans doute oubliés : « je ne recherche pas un clone ». Cela résume assez bien le travail de Françoise Gadet auprès de ses thésards. Si elle déploie une énergie, parfois excessive au regard de ce qui se fait traditionnellement, pour soutenir, orienter et éclairer les étudiants, elle accorde une réelle confiance ← 13 | 14 → en leur capacité à produire et à penser. Sans le savoir, avec ces quelques mots, Françoise Gadet rendait possible une collaboration, et plus que ça, une amitié, dont on voit difficilement comment elles pourraient s’épuiser.
De fait, comme le précise Bernard Laks :
Les thésards de Françoise constituent une famille et Françoise les suit tout au long de leur vie bien après la thèse. Aux quatre coins de l’Europe et du monde vous trouvez des enseignants-chercheurs qu’elle a formés et qui lui donnent de leurs nouvelles. Ça lui fait une belle collection de cartes postales !
7. Pour ne pas conclure…
Paul Cappeau fait émerger, avec humour et tendresse, un ensemble de qualités esquissant le personnage de Françoise Gadet :
J’imagine assez des fées se penchant sur le berceau d’une petite fille, il y a déjà (bien) quelques années. Commençons par un « G » pour indiquer qu’elle sera une socioling., et comme il est en majuscule, ce sera une grande socioling. Elle se prénommera Françoise puisque son domaine de prédilection sera le français. Pas de « o » dans son nom, ce serait trop ordinaire. Laissons-lui apprivoiser ce mot, elle pourra toujours s’en servir pour en faire un titre d’ouvrage… Le « a » ce sera pour signaler qu’elle aura une personnalité si attachante (et aussi qu’elle ne pourra se passer des produits Apple). Il lui faudra un « d » pour marquer la diversité de ses activités et de ses centres d’intérêt. Utilisons aussi un « e » comme dans informatique, mais comme il intervient en finale, elle restera une utilisatrice distante. Enfin le « t » final servira à terminer ou à prolonger son nom comme dans « et tout ça » (car on ne pourra la réduire à toutes les qualités que lui donne son patronyme) et à rajouter des adverbes (très, terriblement) devant toutes ses qualités. Pas sûr que ces fées aient existé même si le parcours et la personnalité de Françoise Gadet m’incitent à y croire…
Bien d’autres traits à la fois scientifiques et personnels pourraient être développés concernant Françoise Gadet, mais comment en faire le tour alors que la voilà plus active que jamais ? Pour élaborer ce témoignage d’amitié et d’admiration, nous avons demandé à ses collègues et ami(e)s de participer à cet ouvrage collectif ; d’autres ont accepté d’intégrer le comité scientifique ou ont souhaité simplement figurer dans la tabula gratulatoria. Nous nous excusons auprès de celles et ceux qui n’ont pas été sollicités par manque d’espace, qu’ils n’en prennent pas ombrage !
Le présent ouvrage, organisé en six sections (« Aborder la variation », « Sociolinguistique historique », « Contacts des langues », « Études du français parlé », « Oral et écrit », « Acquisition et enseignement »), a pour objectif de préciser à la fois les procédures et les concepts fondamentaux en sociolinguistique en relation avec les travaux de Françoise Gadet mais également dans une perspective plus large. ← 14 | 15 →
8. Références
André, V. & H. Tyne 2014, « Sociolinguistics and the study of French », dans H. Tyne et al. (dir.), French through corpora : ecological and data-driven perspectives in French language studies, Newcastle : Cambridge Scholars, p. 132-138.
Blanche-Benveniste, C., M. Bilger, C. Rouget & K. Van den Eynde 1990, Le français parlé : études grammaticales, Paris : Éditions du CNRS.
Cappeau, P. & F. Gadet 2007, « L’exploitation sociolinguistique des grands corpus : maître-mot et pierre philosophale », Revue française de linguistique appliquée 12(1), p. 99-110.
Gadet, F. 1977, « La sociolinguistique n’existe pas : je l’ai rencontrée », Dialectiques 20, p. 99-118.
— 1987, Saussure, une science du langage, Paris : PUF.
— 1989, Le français ordinaire, Paris : Armand Colin.
Details
- Pages
- 314
- Publication Year
- 2017
- ISBN (Softcover)
- 9782807602946
- ISBN (PDF)
- 9782807602953
- ISBN (ePUB)
- 9782807602960
- ISBN (MOBI)
- 9782807602977
- DOI
- 10.3726/b10950
- Language
- French
- Publication date
- 2017 (September)
- Keywords
- variation Gadet langues sociolinguistique
- Published
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2017. 314 p., 52 tabl., 7 ill. en n/b.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG