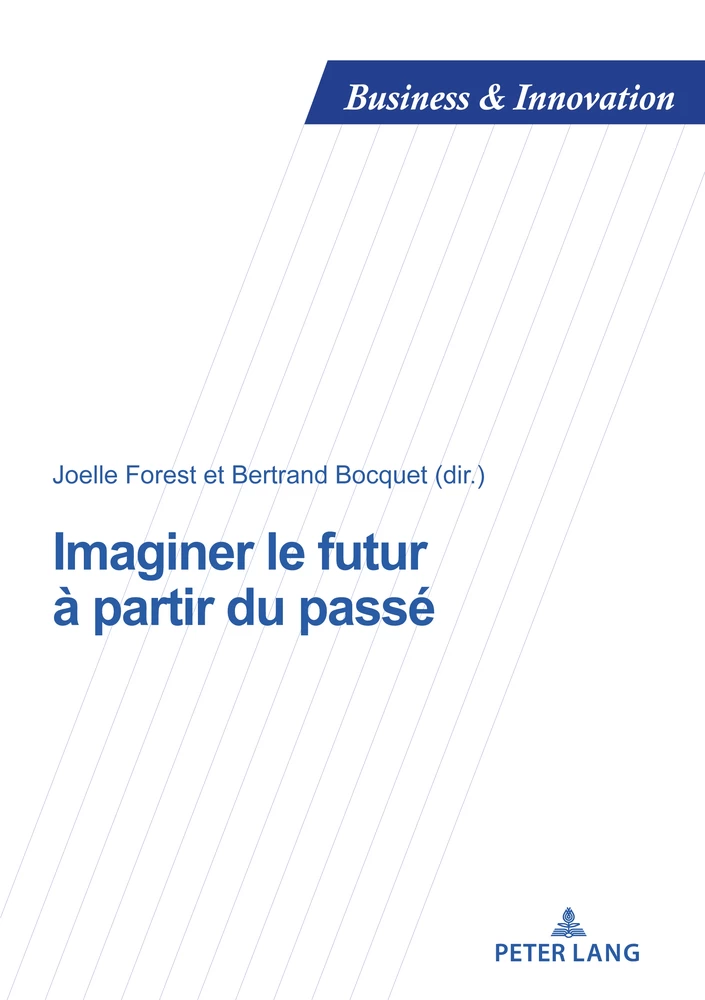Imaginer le futur à partir du passé
Summary
L’enjeu de ce livre n’est pas de retourner vers un passé. Il s’agit d’apprécier la portée heuristique de l’histoire des techniques et des biographies d’innovations pour imaginer des concepts innovants à même d'apporter des réponses inédites aux grands défis du monde contemporain. Les auteurs traitent des exemples issus de secteurs industriels variés. Invité à découvrir les innovations techniques de l'entreprise de Marc Seguin, le lecteur découvrira ainsi l'histoire du four micro-onde en France, en passant par celle du Shock Absorber de SEB ou plus près de nous du vaccin anti-covid de Sanofi.
Ce livre s'adresse aux chercheurs de toutes disciplines, intéressés par la valorization de leurs travaux, aux ingénieurs de R&D qui lancent des projets innovants. Il se destine aussi à un public plus large intéressé par la naissance et la diffusion des innovations.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction (Bertrand Bocquet et Joëlle Forest)
- Éclairer la modernité : retour sur quelques situations historiques d’innovation technique, le cas des entreprises de Marc Seguin (1810–1835) (Michel Cotte)
- La pluralité des usages de l’innovation dans l’industrie gantière (1830–2022) : de la modernisation technique aux rétro-innovations (Audrey Colonel)
- La France et le Micro-ondes : trajectoire d’une innovation culinaire (Aurélie Brayet)
- Anticipation romanesque et innovation culinaire (vers 1840–1930). Explorer les imaginaires de la cuisine du futur. (Noémie Boeglin)
- L’histoire économique et des techniques au service du développement territorial : le cas de Fougerolles-Saint-Valbert en Haute-Saône, le pays du kirsch et de l’absinthe (Abdelhak El Mostain)
- De l’éco-conception à l’innovation environnementale : Chronique d’un échec (Marie-France Vernier)
- Le retard de Sanofi dans la course au vaccin contre la Covid-19. Raisons technologiques, managériales et institutionnelles (Sophie Boutillier, Blandine Laperche et Didier Lebert)
- Postface (Pierre Lamard)
- Titres de la collection
Introduction
Bertrand Bocquet et Joëlle Forest
Université de Lille, HT2S CNAM Paris.
INSA Lyon, S2HEP UR 4148.
Les modèles de développement des différentes parties du monde dépassent aujourd’hui largement les capacités de soutenabilité du système Terre1. La prise de conscience se généralise sous l’effet de connaissances accumulées par exemple sur le climat avec les travaux du GIEC2 (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ou sur la biodiversité avec les travaux de IPBES3 (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Elle se diffuse également sous l’effet du constat bien réel du changement climatique à l’instar de l’accroissement de l’intensité et de la fréquence des catastrophes naturelles4 (canicules, incendies meurtriers et dévastateurs, orages de grêles et inondations) aux conséquences dramatiques, tant ←9 | 10→du point de vue humain qu’économique5. Cette prise de conscience concerne toutes les organisations, quelques soient leurs domaines (industriel, commercial, agricole, scientifique, culturel, touristique etc.), et les politiques publiques à tous les échelons territoriaux, du local au mondial. Si cette prise de conscience semble relativement large, force est cependant de constater que les transitions à opérer vers des modes de vie plus soutenables restent d’une ampleur modérée dans un contexte de forte disparité entre les populations des différents pays, ou au sein même des communautés nationales (Villalba, 2016). Précisons d’ailleurs que la complexité des changements à effectuer crée de fortes incertitudes sur les chemins possibles dans lesquels s’engager (Geels et Schot, 2007 ; Theys, 2017) limitant d’autant nos actions.
Un paradoxe se fait jour au regard du constat qui précède puisque, dans le même temps, la production de connaissances dans tous les domaines scientifiques, aussi bien en sciences formelles, expérimentales, sociales et humaines, n’a jamais été aussi vaste. Or, c’est précisément là que le bat blesse car tout se passe comme s’il suffisait de générer de nouvelles connaissances pour résoudre les grands défis contemporains dans un processus d’innovation linéaire encore très présent aujourd’hui. Si la production de connaissances est un parametre de l’équation, il faut se méfier de tomber dans le mythe de l’application des sciences car ce dont nous avons besoin c’est d’innover or passer de la connaissance à l’innovation est un processus largement plus complexeque ne le laisse envisager ce mythe. Il faut aussi se défaire du solutionnisme ambiant et considérer la question du sens des innovations projetées tant à l’échelle de l’usager qu’à celle de la Société (Chouteau, Forest, Nguyen, 2021).
Par ailleurs, si on ne peut que se réjouire de la reconnaissance institutionnelle, dès 2013, de l’inscription de 10 grands défis sociétaux dans la stratégie nationale de recherche retraduit aujourd’hui dans le plan d’investissement « France 2030 », on peut cependant s’interroger sur la mise en œuvre pratique de ces orientations de la politique publique de recherche lorsque l’on constate la marginalité des structures interdisciplinaires aussi ←10 | 11→bien en termes de laboratoires que de communautés universitaires. Parmi ces dernières, celles qui s’intéressent à l’analyse des intrications entre les sciences, les techniques et la société, et les innovations qui en découlent, pourraient avoir un apport plus conséquent pour éclairer des chemins possibles. Elles réunissent un grand nombre de disciplines des sciences expérimentales mais aussi des épistémologues, des historiens et des sociologues des sciences et des techniques, des éthiciens de la recherche pour n’en citer que quelques-unes. De nombreux travaux, par exemple sur l’évaluation des technologies ou sur les controverses sociotechniques, montrent que le renforcement des interactions entre sciences et société permettrait une meilleure intégration de la question de la transition écologique dans les innovations. Une telle orientation peut même aller jusqu’à la création de liens directs entre les acteurs de la recherche et le monde socio-économique, voire jusqu’aux populations concernées et leurs territoires (Bocquet, 2021). Elle se traduit notamment par des dispositifs d’innovation ouverte (fab-lab, living lab, tiers-lieux, …) (Goyon, 2016 ; Lhoste, 2016). S’il y a bien un impératif à innover, se pose cependant la question de savoir de quelles innovations parle-t-on ? Se pose également celle de leur mode d’existence : sont-elles complètement décorrélées d’une histoire parfois longue, d’un environnement socio-économique particulier, d’une volonté politique ou culturelle ? Nous avons privilégié pour ce livre une présentation d’aspects socio-historiques dont nous pensons qu’ils sont importants pour éclairer d’un jour nouveau les transition à venir et innover en conscience.
L’innovation, clé de voûte pour résoudre les grands défis contemporains
Définit comme « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures » par le Manuel d’Oslo (Oslo, 2005, p. 54), l’innovation se définit d’emblée au regard du critère commun de nouveauté.
Une nouveauté qui est plébiscitée pour résoudre les grands défis contemporains évoqués précédemment. En effet, que l’on évoque ces derniers en termes de transition ou de transformation, un constat ←11 | 12→s’impose : c’est bien une demande de nouveauté dont il est question, les solutions existantes s’avérant dans l’incapacité à résoudre les problèmes identifiés.
Si l’innovation apparaît le vecteur pour aller dans une nouvelle direction, se pose la question de savoir si cette dernière a forcément une vertu méliorative ? Rien n’est moins sûr !
Nombreux sont en effet les exemples qui démontrent que la capacité de l’homme à trouver des solutions inédites ne conduit pas toujours à une amélioration (songeons ici aux fameux effets rebonds), voire peuvent conduire le monde dans la mauvaise direction, à l’opposé d’un avenir durable. On peut citer ici à titre d’illustration le cas du numérique qui, parce qu’il permettait de dématérialiser nombre d’activités humaines, était considéré comme un moyen de réduire l’impact de la croissance sur notre environnement. La réalité est toute autre, si le monde numérique semble virtuel, les nuisances, elles, sont pourtant bien réelles : la croissance de l’impact énergétique du numérique est estimée à 9 % par an et responsable de près de 4 % des émissions mondiales de CO2 en 2018 (cf. aussi le dernier rapport du GIEC).
On peut faire l’hypothèse que le constat qui précède n’est pas étranger au fait que l’innovation n’est plus articulée à un dessein social et moral (Ménissier, 2011) et milite pour que la dimension politique de l’innovation soit réhabilitée (Chouteau, Forest, Nguyen, 2021).
Plaider pour l’innovation ne relève pas de l’irresponsabilité car l’inaction n’est pas une solution. On en veut pour preuve la crise sanitaire du Covid que nous traversons et qui fort heureusement fut un terreau propice à l’innovation.
Details
- Pages
- 230
- Publication Year
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9782875745286
- ISBN (ePUB)
- 9782875745293
- ISBN (Softcover)
- 9782875745279
- DOI
- 10.3726/b20100
- Language
- French
- Publication date
- 2023 (May)
- Keywords
- Apports de l’histoire des techniques à l’innovation Des enseignements du passé Naissance et la diffusion des innovations
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2023. 230 p., 10 ill. n/b, 6 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG