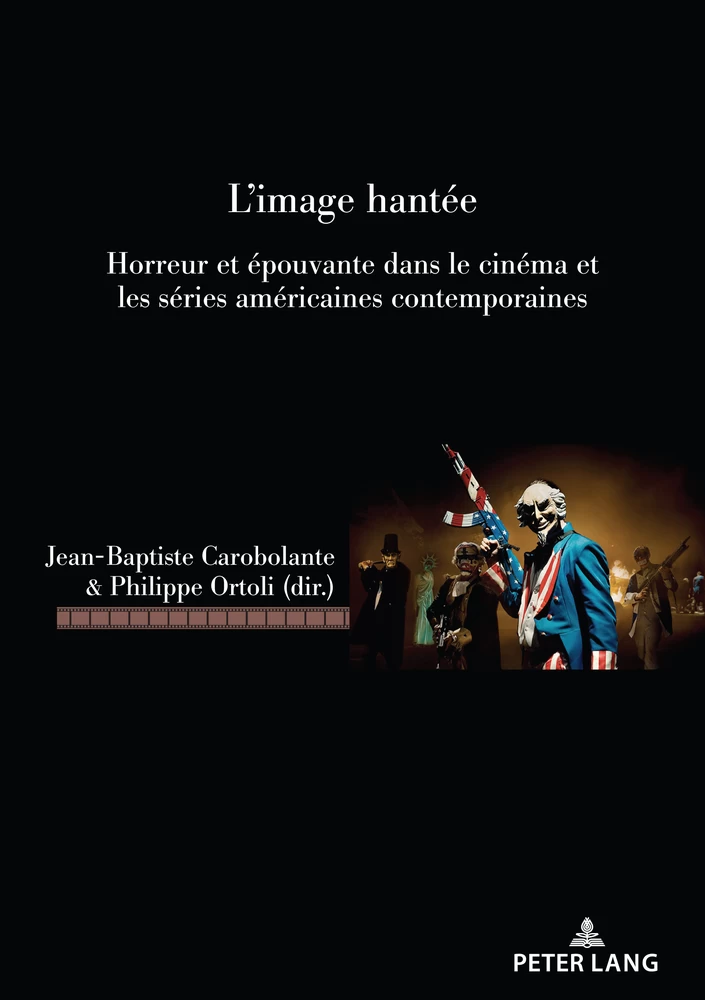L’Image hantée
Horreur et épouvante dans le cinéma et les séries américaines contemporaines
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Présentation
- PARTIE I Cauchemars culturels : des peurs américaines ? Introduction 17
- « Mangez-moi… » le western, l’horreur et le cannibalisme
- Rendre son horreur à l’Amérique : les années Trump
- Clown (Jon Watts, 2014) et les jeux dangereux du néolibéralisme
- La série des Scream de Wes Craven (1996-2011) : le slasher à l’âge « liquide »
- PARTIE II Un territoire réflexif : le film d’horreur américain comme mythologie spécifique Introduction 87
- The Walking Dead (AMC, 2010) : un nouveau mythe ? L’exploitation feuilletonesque du cinéma d’exploitation
- Que le massacre continue : reprises, citations et références foisonnantes de Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre, Tobe Hooper, 1974)
- Ash vs Evil Dead : le triomphe de la matière
- Teen Horror Stories : Horreurs adolescentes à l’ère du vintage audiovisuel
- PARTIE III Peurs originelles : le cinéma américain et les racines de la peur Introduction 175
- L’inquiétant petit monde gigogne de Justin Benson et Aaron Moorhead : le monstre et l’infini dans Resolution (2012), Spring (2014) et The Endless (2017)
- James Wan. Dans les angles morts
- Found footage : l’heure du bilan ? Voyage dans la Blair Witch zone
- Troubles virtuels : cyber horror et reality porn
- Cinéma et jeu vidéo d’horreur : quelle adresse !?
- Toxicité et destin de l’image : sur Hereditary et Midsommar d’Ari Aster
- La peur dans l’air. Twin Peaks : The Return (2017)
- Cinéma de spectre et spiritisme
- Conclusion
- Bibliographie
- Index
- Biographies
Présentation
Avec Le projet Blair Witch, sorti en 1999 (Eduardo Sanchez et Daniel Myrick), il semblerait que les liens entretenus depuis longtemps entre le cinéma et le surnaturel aient franchi un nouveau cap. Le fantastique et l’horreur, alors ancrés dans un déroulement classique qui, globalement, garantissait à la terreur un statut d’objet et à sa captation celui d’un sujet percevant, se trouvèrent incorporés au médium cinématographique lui-même, troublant le spectateur jusque dans sa position contemplative : dès lors, l’horreur provenait de ce qui était chargé de montrer, et plus simplement de ce qui l’était. Révolution copernicienne ? Peut-être bien. Mais, quelque temps après, Saw de James Wan (2004) inaugurait aussi à sa manière une nouvelle façon de concevoir l’horreur, fortement inspirée des tentatives jusqu’au-boutistes italiennes (Joe D’Amato ou Ruggero Deodato), qui allait enfanter un sous-genre, le torture porn (auquel Eli Roth, avec ses Hostel (2005 et 2007), a donné ses lettres de noblesse), sous-genre qui s’est donné pour motif de conter les longs sévices d’une victime (souvent américaine) au sein d’un territoire inconnu (y compris s’il se situe sur le même lieu que les infortunés héros). Là, a contrario, la caméra ne semblait plus destinée qu’à archiver les brutalités les plus sophistiqués infligés aux personnages, retrouvant son rôle «d’ enregistreuse » d’une réalité convoquée pour ses vertus effrayantes. Symptomatiquement, Wan a vite quitté ce terreau pour s’aventurer dans celui du fantastique (là où le principe d’hésitation quant à la vraisemblance interne du surnaturel dans la fiction est central1), à travers, notamment, la série des Insidious (depuis 2010), sortie sous la houlette d’un producteur indépendant visiblement passionné par les questions de lien avec l’au-delà (Jason Blum2), mais également à partir de sa saga des Dossiers Warren (entre autres les séries Conjuring, depuis 2013 ; et Annabelle, depuis 2014). Ce qui change, notamment grâce à l’héritage des Japonais Hideo Nakata (Ringu, 1998) et Takashi Shimizu (The Grudge, 2004), c’est que le fantastique n’est plus lié au gothique de la demeure anglaise (motif qui perdure néanmoins, notamment chez Mike Flanagan (The Haunting, deux saisons, 2018–2020)) mais se mue en une véritable épouvante du quotidien américain. Après les tueurs et boogeymen de la fin du XXe siècle, la demeure de l’American Dream est sujette au doute de l’implosion sous l’effet des spectres. L’Autre invisible n’est alors plus seulement le souvenir d’un passé douloureux, mais la marque d’un présent dont le vernis semble se craqueler.
Ces lignes se doivent d’être complétées par le constat d’un nombre impressionnant de films qui, issus du style found footage dévolu au Projet Blair Witch, ont donné naissance à une quantité prolifique de faux documentaires d’épouvante (pas nécessairement américains), tandis que d’autres productions renouaient, elles, avec le fantastique originel, bâtis sur la distinction entre spectre et fantôme, ou s’axaient sur la représentation de la souffrance du corps humain comme enjeu principal de leurs fictions. Il est d’ailleurs frappant de constater combien le mouvement qui scande cette approche contemporaine est duel, acceptant d’un côté que l’image cinématographique devienne le lieu de passage d’esprits en souffrance et, de l’autre, qu’elle soit le réceptacle des pratiques les plus déstabilisatrices de l’unité du corps. À la fois territoire où l’invisible trouve un support et territoire où il se nie lui-même, le plan confirme son statut de frontière. Les forces le traversent, l’informent, et le déforment : il est le site du visuel et de ses puissances dévastatrices. Mais ce serait restreindre ce paysage, si l’on n’incluait pas dans les peurs ancestrales qu’il revivifie l’exploration des figurations qu’elles ont déjà pu générer. Effectivement, du zombie au teenager capturé par des forces occultes, en passant par le tueur masqué ou les grimoires habités, une large partie de l’iconographie générée par les films d’horreur, principalement des années 1970–1980 (Evil Dead, Zombie, Massacre à la tronçonneuse, La nuit des masques, etc.), s’est vue reprise, reformée, voire distordue par le système des séries télévisées lui permettant d’étendre ses pouvoirs en leur offrant d’autres possibilités de lecture (Stranger Things, Ash vs Evil Dead, The Walking Dead, etc.). Cette prise en compte d’une imagerie pourrait s’apparenter à un nouveau clin d’œil de la postmodernité, cherchant toujours à recycler plutôt qu’à inventer (vieille lune dont on espère qu’elle n’est plus désormais considérée que comme un argument réactionnaire par ses défenseurs), mais elle nous paraît plutôt manifester un étonnant dynamisme dans sa manière de revenir sans cesse sur des motifs pour, littéralement, via le temps permis par le support des épisodes et des saisons qui les (sur)exposent, les analyser.
Il semble donc que le paysage proposé et esquissé soit véritablement foisonnant : en ce début de XXIe siècle, qui voit l’Amérique, engagée dans un difficile processus de reconstruction, interroger l’étendue cinématographique de ses angoisses nous permet, sinon de comprendre, du moins de regarder ses peurs et ses terreurs.
Cet ouvrage est le fruit de 15 collaborations : si la moitié provient d’une journée d’études universitaires qui a eu lieu à la Maison de la Recherche de Caen en 2018, l’autre réside dans des contributions qui nous sont parvenues l’année suivante. Dans un cas comme dans l’autre, si la majorité des textes sont écrits par ce que l’on peut appeler des universitaires, ils ne sont pas, loin s’en faut, les seuls à avoir offert ainsi l’étendue de leurs réflexions (les petites biographies en fin de volume en témoignent), car des écrivains ou des enseignants les accompagnent. Certains peuvent être considérés comme des spécialistes en leur domaine (voire les auteurs des seuls ouvrages français consacrés à leurs sujets), tous partagent le même souci, celui d’aller scruter attentivement un matériau dont la richesse n’empêche pas la rareté des ouvrages francophones qui lui sont consacrés. Pour autant nous n’ignorons pas que, dans le domaine anglo-saxon et celui, plus particulièrement, des études culturelles, les films dont nous parlons sont plus volontiers scrutés. L’ouvrage est divisé en trois parties : nous vous renvoyons pour plus de détails, afin d’éviter les redondances, à leurs introductions respectives. La première partie, « Cauchemars culturels : des peurs américaines ? », entend apporter un éclairage sur la façon dont certains films d’épouvante et d’horreur reflètent une certaine culture américaine, voire un certain état socioculturel ; la seconde, « Un territoire réflexif : le film d’horreur américain comme mythologie spécifique » tente d’aborder les différentes façons dont les sagas d’horreur antérieures sont reprises dans les séries (télévisées et/ ou cinématographiques) contemporaines ; enfin, la troisième, « Peurs originelles : le cinéma américain et les racines de la peur » se veut scruter l’ensemble des nouvelles tendances (auteurs et sous-catégories) d’un genre qui semble vouloir revenir précisément sur les racines de la peur qu’il suscite.
En dernier lieu, et pour éviter de rester dans trop d’imprécision, nous souhaitions clarifier sur les termes originaux d’horreur et d’épouvante : nous ne voulons nullement apporter une touche définitionnelle définitive dans ce qui est justement flottant, puisque ces genres (qui ont à voir avec le fantastique, mais pas uniquement) sont bâtis sur l’émotion qu’ils sont censés produire chez le spectateur et que, comme le rire pour la comédie ou les pleurs pour le mélodrame, il est difficile de tracer un territoire strictement délimité à ce qui se charge de provoquer nos affects. Néanmoins, si les deux appellations « horreur » et « épouvante » sont souvent très proches, puisque leur trait définitoire est lié à la volonté de provoquer la peur du spectateur3, on peut simplement distinguer la volonté de susciter une « peur très profonde violente et soudaine provoquant un désordre de l’esprit s’accompagnant parfois d’un mouvement de fuite », d’un « violent saisissement d’effroi accompagné d’un recul physique ou mental devant une chose hideuse, affreuse4 », car les définitions de ces termes par le dictionnaire trouvent un écho dans la création empirique des genres cinématographiques autour d’eux. Le film d’épouvante tel qu’il a été popularisé par Universal dans les années 1930, est affilié à un surnaturel qui terrifie, là où le film d’horreur dont Philippe Rouyer5 situe la naissance dans les années 1960 (avec Blood Feast de Herschell Gordon Lewis), implique plus globalement la nécessité d’un contenu caractérisé uniquement par sa propension à produire l’aversion, la répulsion, voire le dégoût, sans forcément quitter les lois de la nature. C’est cet appel lancé à un univers supérieur au monde terrestre qui nous semble, faute de mieux établir ce distinguo : l’épouvante est un fantastique dont le principe d’hésitation aurait été aboli et où le surnaturel est posé comme vraisemblable (dans le but de nous terrifier et non de nous enchanter, comme cela pourrait être le cas du « merveilleux »), là où l’horreur peut établir comme critère le souci premier de solliciter notre effroi par l’apparition de tout événement ou chose proprement affreux, mais pas nécessairement hors de notre réalité sensible. On le voit, les frontières sont poreuses et nous n’entendons pas ici les graver dans le marbre (les genres sont comme les êtres vivants, ils évoluent en fonction de ceux qui tentent de les définir et n’ont donc, nominalement, qu’une valeur transitoire), mais nous tenions néanmoins à préciser cela en début d’ouvrage.
Les pages qui vont suivre se proposent donc de vous faire (re)découvrir ce que, jusqu’à aujourd’hui, le cinéma américain a mobilisé comme énergie créative pour susciter en nous ces phénomènes de recul et de tension, d’effroi et de doute, qui nous rendent le monde si étrange dans sa familiarité.
1 Suivant la définition canonique de Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 28
2 Et responsable désormais d’une production considérable y compris télévisuelle (via Blumhouse Productions) (voir Into the Dark, 24 épisodes, 2 saisons, 2018–2019, dont il est un des producteurs exécutifs, Hulu – Amazon prime en France).
3 Eric Dufour tient, à ce sujet, une position alternative. Pour lui, la cause psychologique empêcherait le film d’horreur d’être un genre esthétique. Pourtant, nous pensons que le caractère indubitable de ce dernier point n’empêche pas d’envisager son origine du côté de la mobilisation des affects, sinon, la tragédie, vue par Aristote, serait pareillement frappée d’inanité. DUFOUR Eric, Le cinéma d’horreur et ses figures, Paris, PUF (Lignes d’art), 2006, p. 55.
4 http://atilf.atilf.fr/tlf.htm (trésor de la langue française informatisée).
5 ROUYER Philippe, Le cinéma gore. Une esthétique du sang, Paris/Condé-sur Noireau, Cerf/Corlet, 1997, p. 17.
PARTIE I Cauchemars culturels : des peurs américaines ?
Introduction
Le cinéma américain laisse ses plaies ouvertes : ce sont bien les béances, creusées dans l’édification de son histoire, provoquées par la manière dont elle relit les étapes de l’avènement civilisationnel de son terreau d’émergence, qui provoquent sa terreur. Si la nature de ces peurs témoigne bien d’une volonté introspective, elle reste néanmoins toujours liée à l’acuité d’une réflexion contemporaine. Car, tout en étant consciente de sa propension à avoir constitué sa propre imagerie (cf partie II), le cinéma d’horreur américain revient sur les fondements de cette dernière.
Tout ramène encore et toujours au western, à ce genre qui est aussi et surtout la vision mythologique de la naissance d’un pays exprimé par un art lui aussi en pleine germination. Comment modifie-t-on une terre en arrachant ses mauvaises herbes et en détruisant ses populations indigènes afin de la transformer en territoire d’élection d’une démocratie partagée par tous les exilés des autres sols ? La violence et le déplacement sont sans doute les deux énergies primordiales par lesquelles ce processus se réalise et, de ce point de vue, l’iconographie qu’a enfantée le genre (et dont les motifs du duel et de la chevauchée sont les plus prégnants) décline la nécessité de leur communion et des participations épiques qu’elle hèle. Or, ce que racontent les textes qui vont suivre concerne la résurgence des images ensevelies que cette alliance, galvanisante, a produites : retour du refoulé ? Certes, mais pour quoi revient-il ?
Yann Calvet (« “Mangez-moi…” le western, l’horreur et le cannibalisme »), en relisant l’épisode du convoi Donner (un des exemples avérés de cannibalisme pionnier, cité au tout début de Shining (The Shining, Kubrick, 1980) par Torrance-Nicholson avant même d’arriver à l’hôtel Overlook), inscrit un sous-genre riche en perspectives socioculturelles (le western cannibale) dans un bassin séminal rarement exploité : et si une des peurs américaines consistait justement à envisager la constitution même de l’identité de sa civilisation comme celle de la dévoration permanente d’individus, sur une échelle de plus en plus grande ? La visée politique de ce procès (détruire et assimiler) est d’importance. Elle rejoint la dialectique du seuil, entre le dedans et le dehors, là aussi à la base d’un des plans les plus constitutifs de l’iconographie westernienne (celui, inaugural, de La prisonnière du désert (The Searchers, Ford, 1956) en ce qu’il condense le regard que porte le lieu clos de la civilisation sur l’espace ouvert de la sauvagerie). Cette image-mouvement est citée par Alice Laguarda dans son article sur la série des Scream, du moins ceux réalisés par Craven (« La série des Scream de Wes Craven (1996–2011) : le slasher à l’âge “liquide” »), à travers le lien qu’elle institue entre le slasher postmoderne et le Wilderness originel. Ce qui semble alors faire peur aux Américains, c’est ce qui revient (l’inconnu menaçant) et on comprend que le mal n’est pas situé dans un horizon inconnaissable, mais bien dans l’intériorité que ce dernier déploie. Toute topographie est intérieure. Autrement dit, la résurgence de cette violence est un retour légitime et la regarder dans l’implication qu’elle a pu avoir dans l’histoire américaine (entre autres, par rapport aux minorités) provoque la terreur. Mais, nous le répétons, qu’est-ce qui autorise ce retour ?
Alexandros Tsopotos (« Rendre son horreur à l’Amérique : les années Trump »), en interrogeant le droit à la violence, garanti par le deuxième amendement de la Constitution, montre qu’il est producteur de terreur dans l’Amérique trumpienne. En parlant de la série American Nightmare et de son principe d’anticipation, l’article n’oublie pas de mentionner que les nouveaux gouvernants, autorisant une fois par an chaque citoyen américain à tuer autant de gens qu’il le veut, se nomment « les pères fondateurs »… Et, en évoquant Jordan Peele et son cinéma, l’auteur montre aussi tout ce que l’oppression des Noirs doit à ce schéma fondateur : on ne tire pas sur n’importe qui.
Les accès de cette brutalité débridée semblent participer autant d’un éclair de conscience que d’une tendance néolibérale assumée, dont les Etats-Unis sont l’étendard, consistant à laisser se déchaîner les pulsions les plus primaires et à jouir sans entrave de leurs débordements. La figure du clown qu’évoque Florent Christol (« Clown et les jeux dangereux du néo-libéralisme »), figure qui n’en finit pas de hanter le cinéma d’horreur américain contemporain, apparaît ainsi comme l’incarnation de l’incitation à assouvir ses désirs les plus profonds, prodiguée par la société consumériste. En cela, ces peurs spécifiques montrent bien combien le cinéma américain reste et demeure le cinéma le plus enclin à démonter, avec acuité, les mécanismes de la société contemporaine.
« Mangez-moi… » le western, l'horreur et le cannibalisme
Yann Calvet
Depuis les années quatre-vingt, suivant un mouvement qui a démarré après la Seconde Guerre mondiale, le western américain a connu une amplification des phénomènes d’hybridation générique avec le fantastique, le film de guerre, la science-fiction ou le genre post- apocalyptique…1 Ce mouvement a accompagné la crépuscularisation du genre ainsi que l’augmentation constante, en son sein, de la représentation de la violence2 Cette évolution du genre a abouti ces dernières années à une hybridation plus inattendue entre le western et le film d’horreur et d’épouvante. Ainsi, des films comme Vorace (Ravenous, 1988, Antonia Bird) et Bone Tomahawk, (2015, S. Craig Zahler) sont de véritables westerns horrifiques n’hésitant pas à jouer la carte du gore et à proposer une vision complètement anxiogène de la conquête de l’Ouest ou de ses conséquences à travers la thématique du cannibalisme.
Ce phénomène mérite qu’on s’y intéresse car le western était à l’origine un genre plutôt familial, prompt à véhiculer les valeurs américaines et même une garantie de moralité pour les spectateurs de la période classique. Cependant, comme l’a bien souligné Lauric Guillaud dans La terreur et le sacré : la nuit gothique américaine, « l’histoire de l’Amérique est indissociable de la peur : peur de Dieu et du Diable, de l’apocalypse et du Jugement dernier, des sorcières et des sauvages, de la conspiration et de l’invasion, de la mort et de l’inconnu, des fantômes et des démons, de l’obscurité et de la nuit, de la tempête et des désastres, de l’enfer et de l’abîme. […] Le Nouveau monde suscite des reviviscences d’émotions archétypiques, sédimentées au fond des êtres par-delà les générations.3» Des films comme Vorace et Bone Tomahawk ou Les huit salopards (The Hateful Eight, 2015) de Quentin Tarantino4 font ainsi ressurgir cette vieille alliance entre la terreur et le sacré en investissant les tabous ancestraux. Déjà travaillé par la question du meurtre depuis quasiment son origine, le western aborde aujourd’hui de manière très directe les deux autres tabous religieux que sont l’inceste d’une part (Brimstone, Martin Koolhoven, 2015) et le cannibalisme d’autre part afin de s’interroger encore, mais de manière plus radicale, sur la nature et les fondements de la civilisation américaine.
Details
- Pages
- 326
- Publication Year
- 2023
- ISBN (PDF)
- 9782875744982
- ISBN (ePUB)
- 9782875744999
- ISBN (Softcover)
- 9782875744975
- DOI
- 10.3726/b21273
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (January)
- Keywords
- Cinéma séries télévisées études cinématographiques états-unis horreur épouvante fantôme cannibalisme néo-libéralisme zombie fictions adolescentes cyber horror
- Published
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2023. 326 p., 16 ill. n/b
- Product Safety
- Peter Lang Group AG