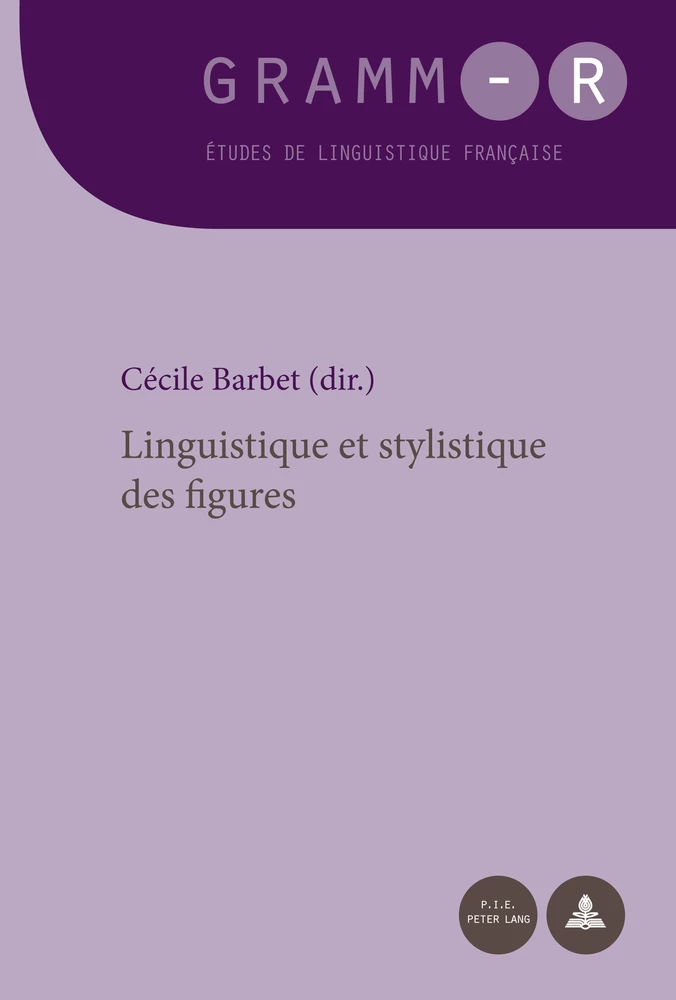Résumé
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’éditeur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Présentation
- La figure et la recatégorisation de l’expérience
- Paraphrase, traduction et métaphore
- Quand la phrase se casse la figure. Modèles psycholinguistiques de l’anacoluthe et de l’hyperbate
- Molécules proverbiales
- Parenthèses ana-cataphoriques et figures du discours
- Figures du discours ou figures de style ? Essai de classification
- Titres de la collection
← 8 | 9 → Présentation
Université de Neuchâtel
La relation entre stylistique et linguistique n’est pas récente. C’est même le linguiste Charles Bally qui est considéré comme le fondateur de la stylistique. Malgré cette quasi « co-naissance », un certain divorce entre linguistique et stylistique fut, et est encore dans une certaine mesure, à déplorer : le linguiste s’attachant surtout à décrire et expliquer les mécanismes de la langue en général ou parlée, et le stylisticien, les ressorts de la langue littéraire en particulier. Cependant, la langue écrite, littéraire, n’use pas de procédés radicalement spécifiques et différents de la langue parlée. De nombreux travaux, d’orientations théoriques différentes (cf. i.a. Le Guern 1973, Berrendonner 1982, Rastier 1987, Ducrot 1984, Klinkenberg 1990, Adam 1997, Sperber & Wilson 1995), ont entretenu avec succès le dialogue entre linguistique et stylistique, et ont montré la fécondité de ce champ d’études. L’essor de la pragmatique notamment, a significativement contribué à renouveler le type de questions linguistiques fondamentales soulevées par le problème du style. Suivant la voie ouverte par Jakobson & Halle (1956) à propos de la différence cognitive entre métaphore et métonymie, les questions posées, et l’intérêt des linguistes, en ce qui concerne les figures de style, a ainsi pu se porter sur les processus d’interprétation des grandes figures et procédés de style tels que la métaphore (cf. Sperber & Wilson 1995, Wilson & Carston 2006), la métonymie (cf. Bonhomme 1987, 2005, 2006), l’ironie (cf. Sperber & Wilson 1978, Ducrot 1984, Perrin 1996, Berrendonner 1982, 2002, Saussure & Schulz 2009) ou le discours indirect libre (Ducrot 1984, Banfield 1973, Reboul 2000). Cependant, de nombreux autres figures ou procédés de style, parfois considérés comme « secondaires », méritent attention et peuvent s’avérer d’un grand intérêt tant pour la théorie stylistique que pour la théorie linguistique (cf. Le Bozec 2004, ou Barbet, Saussure & Le Bozec 2010 sur les points de suspension par exemple).
← 9 | 10 → Dans le cas de la métaphore, s’est posée la question de savoir s’il s’agit d’une implicature issue d’une violation de maxime conversationnelle (cf. Grice 1989) ou d’un procédé usant exactement des mêmes mécanismes que le langage « ordinaire » (cf. Sperber & Wilson 1995). Le fait que certains contenus, et notamment certaines attitudes propositionnelles, soient non littéralisables ou difficilement littéralisables (cf. Saussure 2004), donc difficilement dicibles de manière non figurée, suscite toujours l’intérêt et le questionnement. De la même façon, concernant l’ironie (cf. Reboul 2008), on s’est demandé comment rendre compte de son effet : s’agit-il – d’un point de vue finalement assez traditionnel (cf. Dupriez 1984) – d’une implicature par antiphrase (cf. Grice 1989), d’un effet de polyphonie à la Ducrot, d’un effet d’écho (cf. Sperber & Wilson 1981, 1995), ou encore de « feintise » (cf. Currie 2006) ?
Au-delà même de ces considérations, la métaphore est aussi considérée comme un hyper-trope, ou comme le plus élaboré des tropes (cf. Dupriez 1984, Fontanier 1977, Du Marsais 1808), et comme un des mécanismes les plus importants à l’origine du changement sémantique (cf. entre autres Sapir 1977, Lakoff & Johnson 1980, Claudi & Heine 1986, Sweetser 1988, 1990, Bybee & Pagliuca 1985). Une investigation d’une certaine ampleur s’avère dès lors nécessaire pour expliquer ce phénomène général, si ce n’est universel.
On peut également se demander à partir de quand, et pourquoi, une forme, une construction, fait figure, ou non, que l’on pense aux tropes usés (catachrèses) ou à certaines formes « mixtes », qui servent aussi bien au langage « ordinaire » qu’à la figure.
En définitive, stylisticiens et pragmaticiens se trouvent face au même problème de l’implicite, voire du non-dit (littéralement), de l’indicible (c’est-à-dire du non dicible littéralement). Stylisticiens et syntacticiens, notamment les spécialistes de la langue parlée, sont confrontés à la même problématique de décrire et expliquer des constructions « non standard ». Finalement, les figures, et plus généralement le style, sont loin d’avoir livré tous leurs secrets.
Les auteurs conviés à proposer une contribution à ce volume étaient invités à réfléchir à la problématique ci-dessus et à la question suivante : quels outils, développés par la linguistique contemporaine, pourraient être utiles à la description et l’explication des figures de style ? De façon générale, on peut dire que le point de vue adopté est résolument naturaliste et cognitif. La métaphore, LA figure, ou plutôt certains aspects de la métaphore sont traités notamment dans l’article du Groupe µ (son potentiel recatégorisateur), dans l’article d’Anne Reboul (son impossible paraphrase et sa possible traduction) et dans l’article de Philippe Gréa (quand elle se fait proverbe). Des figures dites de construction occupent la ← 10 | 11 → contribution d’Antoine Gautier qui s’intéresse à l’anacoluthe et l’hyperbate. L’hyperbate revient en filigrane dans la contribution de Laure-Anne Johnsen dédiée aux parenthèses ana-cataphoriques. Le proverbe, qui fait encore plus difficilement figure, mais fonctionne sur des ressorts similaires aux figures, est l’objet de l’article de Philippe Gréa. Finalement, l’article de Marc Bonhomme revient en détail sur la distinction entre figures dites du discours vs de style.
L’article du Groupe µ s’insère dans un projet global de sémiotique matérialiste. L’hypothèse est que le circuit de la signification prend son départ dans le monde naturel : c’est le contact entre l’organisme et les stimuli issus du monde qui aboutit à l’élaboration des structures sémiotiques. La sémiose, loin d’être un phénomène sans lien avec le corps, tire donc son origine de celui-ci. Cet aspect de la corporéité du sens peut être qualifié de cognitif : le signe émerge de l’expérience, et ne saurait être étudié qu’à travers les interactions qu’il a avec son contexte au sens large, incluant l’expérience du monde et d’autrui. La fonction du sens serait de rendre maniable un univers infiniment varié.
Pour obtenir cette stabilisation à forte valeur de survie, on a recours à la modélisation et à la catégorisation. Cependant, pour répondre aux exigences d’un univers variant, un univers dans lequel les intérêts des différents acteurs varient eux aussi, les catégories doivent elles aussi être susceptibles de varier, ce qu’elles font dans l’espace, dans la société, et dans le temps. Les groupes et les individus les plus sophistiqués disposent donc de différents jeux de catégories susceptibles d’intervenir selon les besoins à couvrir.
Les catégories doivent aussi pouvoir évoluer, ce qu’elles font de deux manières. Dans les changements de type 1, les phénomènes nouveaux sont ramenés aux phénomènes connus, dans une manœuvre analogique, et la nouveauté n’est donc jamais qu’un aménagement du système, c’est ici que l’on situera les « métaphores » de Lakoff et Johnson, qui ne sont pas des figures. Les changements de type 2 sont, au contraire, des changements radicaux de systèmes catégoriels. C’est de ce type de nouveauté que se rapproche celle que permet la figure.
Dans l’article est évoqué le rôle recatégorisateur de la figure, en la situant parmi les divers instruments aboutissant au même effet médiateur. Elle est comparée à la recatégorisation du réel que propose la science, en insistant sur le fait que, du point de vue des structures, la rhétorique crée du sens exactement selon le modèle de la démarche scientifique : la différence entre les deux démarches n’est que de nature pragmatique. En conclusion, il est montré que si la métaphore (la vraie) est, de toutes les figures, celle qui présente le plus haut potentiel recatégorisateur, elle le doit à sa structure intersective.
← 11 | 12 → L’article d’Anne Reboul revient en détail sur l’idée de Guttenplan (2005) selon laquelle les métaphores, ou tout au moins les métaphores vives, ne sont pas susceptibles de paraphrase, mais qu’elles ne posent pas, en elles-mêmes, de problème de traduction (au-delà du problème de la traduction de la poésie en général, problème qui n’est certainement pas de nature sémantique).
Comme le note Guttenplan, s’il est difficile de paraphraser, dans l’exemple classique suivant, Juliet is the sun sans perdre une partie de la charge cognitive de la métaphore, on n’a aucune difficulté à la traduire dans une autre langue : Voici l’Est et Juliette est le soleil.
But soft, what light through yonder window breaks ?
It is the east, and Juliet is the sun.
En d’autres termes, les métaphores seraient non-paraphrasables, mais traduisibles. Ceci soulève des questions intéressantes quant à la notion de « dire la même chose » (samesaying) qui semblerait, a priori, sous-tendre tout à la fois la paraphrase et la traduction. Il y a donc quelque chose de paradoxal à l’existence d’énoncés qui seraient traduisibles d’une langue à l’autre, mais qui ne seraient pas paraphrasables. Si Guttenplan a raison, la métaphore est un lieu d’investigation centrale pour l’analyse de l’articulation entre concepts et lexique, parce qu’elle met en jeu des effets proprement conceptuels plutôt que linguistiques. Dans cet article, Anne Reboul essaye donc d’expliquer en quoi la métaphore est un phénomène conceptuel et pourquoi elle n’est pas paraphrasable, lorsqu’il s’agit d’une métaphore vive, alors qu’elle est traduisible.
La délimitation des champs de la linguistique et de la stylistique est un problème récurrent de l’épistémologie des sciences du langage, depuis les travaux de Bally (1983), puis les réflexions de Jakobson (1963), jusqu’aux plus récentes définitions de la poétique cognitive (Stockwell 2002). À travers les notions d’écart, de neutralité, la stylistique met en jeu la spécificité de la langue littéraire et la pertinence d’une analyse linguistique qui lui soit particulière. À ce titre, la nomenclature des figures constitue l’un des traits les plus caractéristiques de sa démarche.
Parmi les configurations linguistiques qui y sont répertoriées, l’article d’Antoine Gautier s’intéresse à certaines de celles que Fontanier a classées dans les figures de construction. Or, quoique cette catégorie soit traditionnellement considérée comme moins typique du discours figuré que celle des tropes, et notamment la métaphore, elle pose le même type de problèmes : sa définition repose en effet sur le postulat d’un seuil de figuralité, seuil en-deçà duquel les séquences ne sont pas considérées comme saillantes sur le plan stylistique. Aussi la stylistique, dès Du Marsais, s’interroge-t-elle sur ce qui détermine ce seuil, autrement dit ce qui fait qu’il y a bel et bien métaphore, syllepse, etc.
← 12 | 13 → Le cas des figures de construction présente à cet égard des caractéristiques intéressantes, en ce sens que le seuil de figuralité y est déterminé par rapport à la phrase canonique, c’est-à-dire par rapport à un prototype censé représenter la neutralité syntaxique, et qui permet d’évaluer la saillance d’une disjonction, d’une rupture, d’un déplacement, etc. Or, la phrase canonique s’acquitte imparfaitement de cette dernière fonction : c’est un objet statique qui ne rend pas compte du processus de lecture dont émerge la figure, autrement dit de la surprise causée lors du déchiffrement par le sentiment que quelque chose n’est pas à sa place.
Car lire, rappelle Quignard (1998), c’était notamment, pour les Grecs, le verbe anagignôskô, ou « reconnaître ce que l’on attend ». La figure de construction pourrait alors se définir comme une dérogation aux attentes que le lecteur construit au fur et à mesure qu’il déchiffre les mots, les syntagmes et les phrases et, du côté du scripteur, comme un jeu plus ou moins conscient avec ces attentes, et avec les principes mêmes du décodage syntaxique de l’énoncé linéarisé ( parsing).
L’article d’Antoine Gautier vise ainsi à décrire, dans la continuité des travaux de Fodor & Frazier (1978), quelques figures engendrées par ce jeu avec la mécanique du parsing. Il s’attache aux effets de déplacement (hyperbate) et de rupture (anacoluthe) en mettant en avant la dynamique de ces figures, qu’une vision statique et spatialisée du texte tend souvent à neutraliser. En esquissant une modélisation psycholinguistique de ces figures de style, l’article a ainsi vocation à illustrer une possibilité d’échange entre une linguistique du neutre ou du langage « ordinaire », et une linguistique de l’écart appliquée au texte littéraire.
L’article de Philippe Gréa traite de la sémantique du proverbe, question très débattue depuis les travaux de Buridant (1976). La raison de ce débat est que toute caractérisation sémantique des proverbes mobilise et interroge une série de concepts tels que la généricité, l’implication, la métaphore et plus généralement, l’opposition littéral vs. figuré. En outre, elle constitue aujourd’hui un enjeu épistémologique entre deux points de vue généraux sur la sémantique, à savoir le point de vue référentialiste (Kleiber 2008) et le point de vue aréférentialiste (Visetti & Cadiot 2008). Le proverbe occupe donc une place stratégique forte dans le champ sémantique contemporain et se trouve au centre de problématiques importantes pour le reste de la discipline.
À partir du cadre théorique de la sémantique interprétative (Rastier 1987) et plus précisément, à partir du concept de perception sémantique (Rastier 1991), Philippe Gréa montre l’existence d’un lien formel entre les proverbes métaphoriques (ex. : petit poisson deviendra grand) et un genre textuel particulier, celui de l’énigme, qu’il a eu l’occasion de caractériser très précisément dans le cadre d’un jeu surréaliste connu sous le nom de ← 13 | 14 → l’un dans l’autre (Gréa 2009, Gréa 2010). Le proverbe comme les énigmes de l’un dans l’autre se caractérisent en effet par un parcours interprétatif spécifique, un système d’isotopies superposées, et ne se distinguent que par le degré d’accessibilité à l’isotopie cible. De ce point de vue, l’article considère le proverbe non pas seulement en soi, comme le propose la plupart des analyses parémiologiques, mais en contexte : un proverbe prend son sens en s’insérant dans un discours ou un texte particulier. Cette façon de procéder a plusieurs conséquences : (i) entre le proverbe et l’énigme il y a un continuum, et non une différence de nature, qui se fonde sur le degré d’accessibilité à l’isotopie cible ; (ii) nous disposons d’un critère de classification qui permet de faire entrer le proverbe dans une classe générale d’énoncés comprenant l’apologue, la parabole, l’énigme.
Dans une seconde étape du raisonnement, l’article s’intéresse cette fois aux proverbes non métaphoriques (ex. : chose promise, chose due). L’une des questions fréquemment posée à leur propos est celle de savoir s’ils doivent être considérés comme des proverbes ou non. Il est montré que la caractérisation des proverbes métaphoriques proposée dans l’article (isotopies superposées) permet de prendre en compte le cas des proverbes littéraux. On aboutit alors à une caractérisation sémantique capable de couvrir les deux cas de figure : un proverbe, qu’il soit métaphorique ou littéral, se fonde sur la transposition d’un complexe sémique spécifique (un groupe organisé de molécules spécifiques). Ce complexe est accessible indirectement dans le cas des proverbes métaphoriques ou bien il est directement explicité dans le cas des proverbes littéraux. Dans les deux cas, c’est la transposabilité du complexe qui détermine le caractère proverbial ou non de l’énoncé.
Certaines parenthèses présentent la particularité de contenir un pointeur ana-cataphorique, c’est-à-dire un pointeur référant à un objet en cours d’élaboration dans la mémoire discursive, nécessitant pour son interprétation le concours des contextes linguistiques gauche et droit de l’insertion. Autrement dit, elles prédiquent sur un objet temporairement sous-specifié. Ces parenthèses ana-cataphoriques sont souvent introduites par le coordonnant et, et peuvent régulièrement être déplacées en fin d’énoncé. Leur position non canonique ne va pas sans rappeler, dans la tradition rhétorique, la figure de l’hyperbate. À la lumière de ces caractéristiques, l’objectif de l’article de Laure-Anne Johnsen est de décrire ces configurations particulières et de mettre en évidence leurs fonctions et rendements pragmatiques en contexte.
Quand on observe les ouvrages consacrés aux figures, on relève souvent un emploi mal défini entre « figures du discours » et « figures de style », ce qui peut entraîner des confusions. L’article de Marc Bonhomme se propose de montrer que, loin d’être interchangeables, ces ← 14 | 15 → deux formulations impliquent une vision différenciée sur la figuralité qui répond à un fonctionnement graduel : si sur le plan linguistique une figure est généralement « du discours », elle devient « de style » seulement sous certaines conditions. Ce fonctionnement graduel de la figuralité est illustré par deux figures représentatives : la métonymie et l’hyperbole, prises dans des productions variées (presse, publicité, littérature, etc.).
Dans un premier temps, Marc Bonhomme réfléchit aux trois paramètres linguistiques qui contribuent conjointement à la définition des figures du discours. Au niveau structural, elles se présentent comme des variations libres dans les ramifications de la langue. Au niveau cognitif, elles constituent des schèmes saillants, à la fois typiques et matriciels. Au niveau pragmatique, elles endossent une forte polarisation fonctionnelle susceptible d’accroître le rendement des énoncés. Si ces trois paramètres sont théoriquement nécessaires pour qu’il y ait une « figure du discours », ils peuvent être plus ou moins neutralisés dans certaines occurrences, suite à des particularismes d’emploi ou à l’ambiguïté de l’entourage figural, sans parler des contraintes exercées par telles ou telles situations de communication. Ainsi, le figement d’une métonymie comme « le gruyère » lui fait perdre son statut variationnel pour la standardiser en langue. De même, la récurrence de nombreuses hyperboles publicitaires (« Sensations maximales. Aquafresh » – « Le plaisir absolu. Miko »…) en estompe inévitablement la saillance en les banalisant. De la sorte, une figure du discours a un statut fragile, en ce qu’elle se dilue fréquemment dans des états intermédiaires ou flous (semi-figuralité, dé-figuration, etc.).
Dans un deuxième temps, Marc Bonhomme tente de dégager les caractéristiques stylistiques de la figuralité, tout en étant conscient que le champ du style forme une nébuleuse diffuse. Les « figures du discours » deviennent des « figures de style » lorsque diverses spécifications s’exercent sur leurs paramètres linguistiques de base. D’un côté, il faut que leurs variations libres manifestent une réelle créativité verbale, source d’opacification du sens, vis-à-vis de l’arrière-plan standardisé de la langue. D’un autre côté, il convient que leurs schèmes saillants s’avèrent quelque part remarquables en donnant lieu à une appréciation positivante. De plus, leur polarisation fonctionnelle doit engager clairement l’expressivité de leurs producteurs, en liaison avec l’activation interprétative de leurs récepteurs. En somme, le passage d’une figure du discours à une figure de style suppose le saut qualitatif du linguistique dans la sphère plus large de l’esthétique. Mais outre que ce saut qualitatif ne remet pas en cause la constante qu’est la langue, il dépend de plusieurs facteurs fortement contextualisés. Ceux-ci tiennent notamment au type de discours en jeu (on verra plus facilement une figure de style dans une métonymie romanesque que dans une métonymie journalistique), ainsi qu’au critère de ← 15 | 16 → stylisticité que l’on choisit. Par exemple, une métonymie de Supervielle peut être jugée « stylistique » soit par rapport à son idiolecte, soit en relation avec la singularité du genre poétique qu’il pratique. À cela s’ajoutent les aléas de l’encyclopédie et de l’horizon d’attente des énonciataires. Dans ce sens, une même hyperbole peut être identifiée comme littérale, comme figure du discours ou comme figure de style selon la diversité de leurs compétences et de leurs mondes de référence.
Au total, le domaine des figures ne met pas en jeu une fracture entre le linguistique et le stylistique, mais des paliers aussi bien complémentaires que progressifs entre ces deux polarités. À travers l’interaction tensionnelle de ces paliers, le stylistique se nourrit dialectiquement du linguistique pour activer l’appropriation de la langue par les sujets communiquants.
Références
Adam, J.-M. (1997). Le style dans la langue. Lausanne, Delachaux & Niestlé.
Aristote, Poétique, introduction, traduction nouvelle et annotations de Magnien M. Paris, Librairie générale française, Le livre de poche 6734. Classique.
Bally, C. (1913). Le Langage et la Vie. Genève, Atar.
Résumé des informations
- Pages
- 174
- Année de publication
- 2014
- ISBN (Broché)
- 9782875742230
- ISBN (PDF)
- 9783035264883
- ISBN (MOBI)
- 9783035299274
- ISBN (ePUB)
- 9783035299281
- DOI
- 10.3726/978-3-0352-6488-3
- Langue
- français
- Date de parution
- 2015 (Janvier)
- Mots Clés (Keywords)
- discours métaphore métonymie hyperbole hyperbate
- Publié
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2014. 174 p., 21 graph., 5 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG