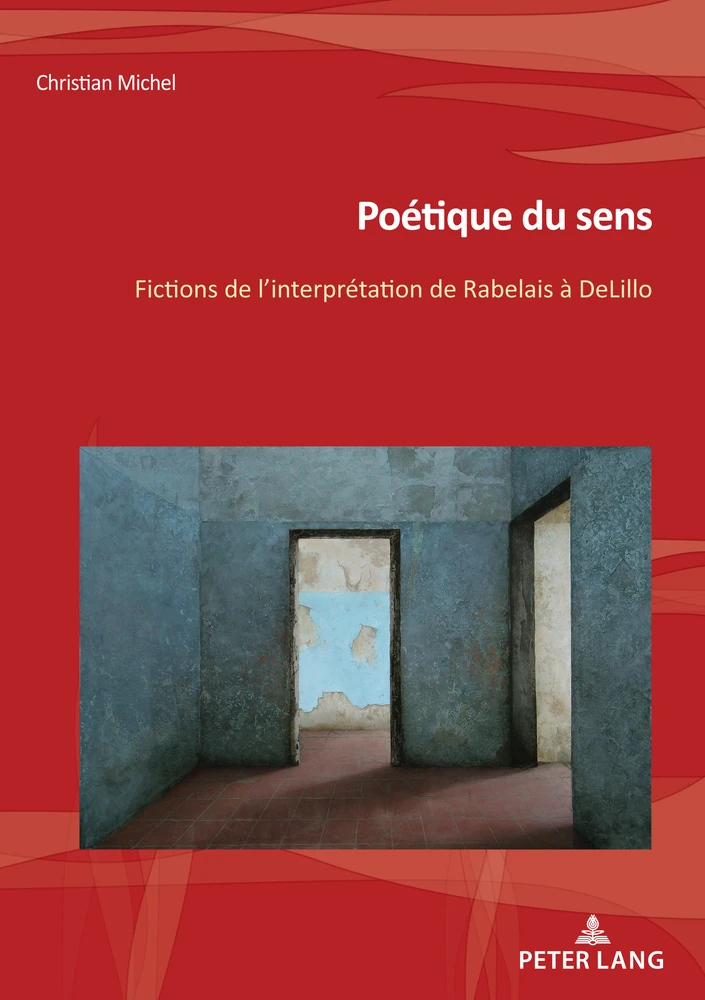Poétique du sens
Fictions de l’interprétation de François Rabelais à DeLillo
Résumé
Associant analyse narratologique, étude poétique et réflexion herméneutique, cet ouvrage s’intéresse au regard réflexif que les fictions de Rabelais, La Fontaine, Walpole, Jean Paul, Mérimée, Poe, Borges et DeLillo portent sur leurs moyens (la lettre, le mot, la langue), sur leur objet (l’interprétation) et sur leur fin (le sens), et il définit trois modes de signification paradigmatiques : selon l’allégorie, selon le figurisme, selon la concordance.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Introduction
- Énigme
- Corpus
- Anachronismes
- La première lettre du Nom a été articulée…
- Ça n’empêche pas d’exister…
- 1. L’imaginaire de la lettre
- I. Dissémination
- II. Figuration
- III. Schématisation
- IV. Lettre, forme, figure
- 2. Les harmonies du mot
- I. Harmoniques
- 1. Éponymie
- 2. Étymologie
- 3. Paronymie
- 4. Polysémie
- II. Cratylismes
- 1. Fiction
- 2. Nostalgie de la conviction
- 3. Langages et signes
- I. Les phases de la langue
- 1. Phases
- 2. Les écrevisses, ou l’oralité
- 3. Le safran d’Hibernie, ou l’analité
- 4. Les caresses nuptiales, ou le sadisme
- 5. Le phallus de Proserpine
- 6. Manger le livre
- II. L’usage des signes
- 1. Littéralisme
- 2. Paroles gelées, paroles dégelées, paroles en l’air
- 3. Indice, signe, symbole
- 4. Invention
- 4. Herméneutique de la fiction
- I. Allégorie
- 1. Petite histoire de l’allégorie
- 2. Vestiges de l’allégorie
- II. Figure
- 1. L’allégorie chrétienne
- 2. Typologie/Figurisme
- 3. Dans les plis du figurisme
- III. Concordance
- 1. Symbolisation
- 2. Superficie
- 3. Indices
- 4. Lecteur détective ?
- IV. Monstres, signes, prodiges
- Conclusion
- Ligne brisée
- Marche arrière
- La lisibilité du monde
- Atahualpa et Élie
- Bibliographie
- Index nominum
- Titres de la collection
Introduction
Ce qui limite le vrai, ce n’est pas le faux, mais l’insignifiant.
René Thom, Prédire n’est pas expliquer (1991)
Je dis souvent qu’un mauvais film est un film qui n’a pas besoin de moi.
André S. Labarthe, « Entretien avec Nicolas Marcadé » (12 novembre 2010)
Ce qui est interdit, c’est d’interpréter, c’est un sentiment presque ancestral, une question d’honneur. Sur ce point, le monde et l’art ont perdu la bataille contre le langage : tout est devenu explication, ou marchandise, la matière ne peut pas exister.
Mario Llinas, à propos du film La Flor (2018), Libération (13 août 2018)
Les fictions de l’interprétation se laissent définir, minimalement, comme des récits qui mettent en scène des personnages confrontés à une réalité mystérieuse ou énigmatique qu’ils tentent de comprendre, d’interpréter ou d’élucider. Elles couvrent donc un large spectre qui va d’Oidípous týrannos au récit policier, en passant par The Figure in the Carpet (Henry James). La réalité énigmatique peut prendre des formes diverses : objet étrange, phénomène inexpliqué, parole mystérieuse, oracle sibyllin, etc., dont la présence est exhibée mais dont la signification est dérobée. Confrontés à ces signes obliques ou opaques qui les déroutent et qui confèrent au récit sa dimension d’énigme, implicite ou explicite, les personnages sont autant de figures d’herméneutes qui s’efforcent d’en percer le sens.
Dans certaines de ces fictions, la question du sens de la réalité énigmatique entre dans une relation d’homologie avec celle de la fiction qui l’inclut : l’interprétation dans la fiction rejoint l’interprétation de la fiction. Ou, pour être plus rigoureux, le thème de l’interprétation dans la fiction entre en résonance avec la question de l’interprétation du récit qui le développe. L’espace de la fiction ne se laisse donc pas distinguer de la représentation, problématisée, du sens en jeu dans l’œuvre même.
Il convient de reconnaître une dernière catégorie, celle des récits dans lesquels l’exégèse est mise en scène dans tous ses états, actuels mais aussi potentiels, et où la réflexion sur l’interprétation est plus vaste que ce que la fiction actualise. Le thème privilégié de ces récits n’est donc plus seulement la réflexion de l’interprétation, mais aussi une réflexion sur l’interprétation.
Énigme
Les fictions de l’interprétation ont souvent la forme du récit à énigme, c’est-à-dire d’un récit qui suppose la tension entre la question et la réponse1, et la dilatation du temps qui les sépare : « Tendu entre une question et sa réponse (qui peut d’ailleurs parfaitement se dérober), le récit à énigme se déploie dans un espace de déchiffrement, de l’explication2 ». L’énigme n’est en effet pas seulement un « secret narratif3 » (Uri Eisenzweig), elle est aussi le moteur d’une activité herméneutique à laquelle elle ouvre un espace dans le récit. Les fictions de l’interprétation sont donc aussi des « récits herméneutiques4 » (Jacques Dubois).
Dans ces récits, le processus de déchiffrement peut être plus ou moins développé. Dans une première catégorie de récits, les événements mystérieux se multiplient, mais l’entreprise de déchiffrement reste marginale ou embryonnaire : une information est occultée avant d’être dévoilée. L’accent est donc davantage mis sur le mystère que sur l’enquête. Ces récits correspondent à une forme affaiblie, ou primitive, du récit herméneutique, dans laquelle la réponse n’emprunte pas la forme du déchiffrement, mais celle d’une révélation. Elle peut être apportée par une découverte fortuite, une révélation miraculeuse ou encore par la confession d’un personnage qui possède une information ignorée de tous, selon le modèle éprouvé de la scène de reconnaissance. Dans ce type de récit, la réponse n’est pas le terme d’un raisonnement, mais le fruit du hasard, ou de la Providence. Ainsi, dans The Castle of Otranto (1764) d’Horace Walpole, l’identité de Theodore est révélée lors d’une scène de reconnaissance par un signe inscrit sur son épaule ; l’origine de la malédiction est révélée par Manfred, qui la tenait secrète jusqu’alors ; et c’est une apparition miraculeuse qui confirme que Theodore est bien l’héritier du roi autrefois assassiné.
Dans une seconde catégorie de récits, l’énigme s’accompagne du progressif déchiffrement des signes qui permettent sa résolution. Dans ce type de récit, les personnages connaissent un changement de nature pour devenir des amateurs éclairés ou des spécialistes de l’investigation, jusqu’à l’invention d’un personnage spécifique : le détective. Ils se définissent par leur appétence ou leur compétence à déchiffrer le monde et les signes, que ce soit par nature ou par profession. Au sein de cette seconde catégorie de récits, deux modalités se distinguent, selon que la réalité énigmatique et son déchiffrement occupent une partie seulement du récit ou son entier. On peut donc proposer une première bipartition entre, d’une part, une forme embryonnaire de fiction de l’interprétation, et d’autre part, une forme pleine, qui se décline en un type mineur où l’énigme n’est qu’une partie du récit et un type majeur où elle est le tout.
Il convient toutefois de préciser que, plus que le déchiffrement des signes, c’est la mise en scène de l’activité herméneutique qui définit en propre les fictions de l’interprétation. Elle prend la forme privilégiée de la concurrence des interprétations, qui s’incarne dans un scénario type. À la découverte du phénomène énigmatique succède tout d’abord l’interrogation des personnages. S’ouvre ensuite le temps des échanges entre personnages qui défendent, face à la réalité énigmatique, des interprétations divergentes ou antagonistes. La forme agonistique connaît des degrés d’intensité divers, de la maïeutique discrète qui règle les échanges entre maître et disciple à l’opposition franche et résolue entre ennemis intimes, en passant par l’affrontement à fleurets mouchetés entre l’amateur et l’initié. En un mot, c’est la confrontation dramatisée des interprétations qui fait la fiction de l’interprétation.
La notion de fiction de l’interprétation s’inscrit dans la continuité de la réflexion sur l’herméneutique fictionnalisée5, mais le cadre de cette dernière est plus large puisqu’elle ne suppose pas nécessairement la présence dans la fiction d’une réalité énigmatique. Ainsi, Pale Fire (1962) de Vladimir Nabokov relève de l’herméneutique fictionnalisée sans que le roman soit une fiction de l’interprétation, elle est plutôt une « fiction d’interprétation (en l’occurrence délirante)6 ». En outre, à la différence des fictions de l’interprétation, les œuvres qui relèvent de l’herméneutique fictionnalisée « ne renvoient pas nécessairement à l’interprétation de l’œuvre, elles ne sont pas immédiatement réflexives et ne relèvent pas d’emblée de la métafictionnalité […]7 ». De même, si notre définition recoupe pour partie celle proposée par Alison Boulanger dans La Posture de l’herméneute8, les fictions de l’interprétation telles que nous les entendons ne mettent pas en scène des « chercheurs de traces9 » (Imre Kertész), pour qui l’activité interprétative serait spontanée, un « ressort fondamental et impossible à réprimer10 » : ils sont confrontés à un événement ou à un objet qui les y invite, ou les y oblige. Symétriquement, la notion de récit à énigme, et plus largement la définition d’une « poétique de l’énigme » (Chantal Massol), suppose une conception plus étroite que la nôtre, puisqu’elle implique la présence effective d’une énigme, et une organisation narrative spécifique (réseau indiciel ; histoire duelle ; tension entre avancée et résistance, complication et explication, obscurcissement et déchiffrement, etc.). La notion de fiction de l’interprétation se fonde, elle, sur la présence d’un objet plus labile, réalité énigmatique ou phénomène inexpliqué, qui n’implique pas nécessairement le mécanisme très formalisé du récit à énigme et qui laisse en outre plus de liberté à l’organisation narrative.
Corpus
Rien à voir avec un corpus : seulement quelques corps.
Roland Barthes, La Chambre claire (1980)
De ces réflexions liminaires, il est possible de dégager trois critères qui, combinés, permettent de proposer une première présentation des huit récits réunis par cette étude : Les Amours de Psiché et de Cupidon (Jean de La Fontaine), The Castle of Otranto (Horace Walpole), Leben Fibels (Jean Paul), La muerte y la brujúla (Jorge Luis Borges), The Murders in the Rue Morgue (Edgar Allan Poe), Le Quart Livre des faicts et dicts Heroiques du bon Pantagruel (François Rabelais), Ratner’s Star (Don DeLillo), La Vénus d’Ille (Prosper Mérimée).
Le premier critère est quantitatif : l’énigme peut être unique ou multiple. Le second est narratologique : il prend en compte la portée de l’énigme, selon qu’elle occupe tout ou partie du récit. Le dernier est logique : il distingue les récits dans lesquels le conflit des interprétations connaît une résolution de ceux où le sens de l’énigme reste suspendu.
Dans la nouvelle d’Edgar Alan Poe, The Murders in the Rue Morgue11 (1841), l’énigme semble unique, mais la construction de la nouvelle est plus complexe qu’il n’y paraît. L’énigme que Dupin doit résoudre est certes celle du meurtre en chambre close des demoiselles L’Espanaye, mais elle n’occupe que la deuxième partie de la nouvelle. Le récit de l’enquête est en effet retardé par une longue séquence introductive consacrée tout d’abord à une réflexion théorique sur la supériorité du jeu de whist sur les échecs et le jeu de dames, puis à une présentation de Dupin par son ami. À la transition entre la première et la deuxième partie, le narrateur raconte comment, un soir, Dupin est intervenu à propos pour ponctuer l’une de ses pensées muettes, ce qui provoque sa stupéfaction. Il est donc deux énigmes dans The Murders in the Rue Morgue, qui sont de nature différente, mais qui sont résolues avec le même brio par le même personnage : celle, psychologique, du train de pensées ; celle, criminelle, de la mort des demoiselles L’Espanaye.
Ce dédoublement de l’énigme se lit aussi dans la nouvelle de Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille12 (1837). Elle associe deux types d’enquête : une enquête épigraphique qui s’intéresse aux inscriptions gravées sur le socle et le bras de la statue de bronze trouvée dans le champ de M. de Peyrehorade ; une enquête criminelle, qui cherche à identifier le responsable de la mort de son fils, Alphonse, le soir de ses noces. Comme dans The Murders in the Rue Morgue, l’interprétation est dramatisée par la mise en scène du conflit des interprétations. Dans la nouvelle de Poe, Dupin met à l’épreuve la sagacité de son ami par des questions auxquelles ce dernier n’apporte que des réponses insuffisantes. Chez Mérimée, deux points de vue antagonistes s’affrontent, tant dans l’enquête épigraphique – M. de Peyrehorade proposant des interprétations qui font sourire le narrateur – que dans l’enquête criminelle – le procureur du roi défendant la thèse de l’assassinat crapuleux à laquelle ne croit pas le narrateur, sans se résoudre pour autant à admettre qu’une statue puisse être meurtrière. À la différence de la nouvelle de Poe, les énigmes de Mérimée ne trouvent pas de solution dans le récit, notamment en raison de la dimension fantastique du récit, qui interdit de conclure. L’hésitation fantastique y est donc solidaire de l’indécision herméneutique.
La nouvelle de Jorge Luis Borges écrite en 1942, « La muerte y la brujúla13 », joue ironiquement avec la nouvelle de Poe. Elle s’ouvre sur un premier assassinat qui a lieu au nord de la ville et qui est bientôt suivi d’un deuxième meurtre, à l’ouest, puis d’un troisième, à l’est. Chaque mort est accompagnée par un message mystérieux qui annonce successivement que la première, la deuxième et enfin la dernière lettre du Nom ont été articulées. L’énigme des crimes se double donc de celle des messages qui les accompagnent. Au terme du troisième meurtre, un ultime message révèle que les lieux des assassinats dessinent une figure géométrique, un « triangle équilatéral et mystique [un triángulo equilátero y místico] » (279/278). L’enquêteur Erik Lönnrot, qui enquête parallèlement à la police officielle, sait que le Nom de Dieu compte, non pas trois, mais quatre lettres. Il fait donc l’hypothèse que la figure géométrique qui régit ces meurtres n’est pas un triangle, mais un losange, et qu’un nouveau meurtre aura lieu. En complétant la figure, il déduit le lieu du quatrième crime. Il se rend alors dans une propriété au sud de la ville, où il trouve la mort : Lönnrot a été attiré dans les filets de son ennemi intime, Red Scharlach, par un piège ourdi more geometrico.
Initiée par le premier meurtre relaté dès les premières pages de la nouvelle, l’énigme se développe tout au long du récit pour trouver sa solution dans les dernières pages. Toutefois, si Lönnrot réussit à déchiffrer l’énigme de la figure géométrique, il ne devine pas qu’elle a pour fin de le prendre au piège. Fasciné par les seuls messages énigmatiques qui mobilisent ses compétences d’exégète – et les flattent –, il méconnaît que deux des crimes sont des mises en scène. Aveuglé par sa passion herméneutique, qui le fait poursuivre une « explication purement rabbinique [una explicación puramente rabínica] » (267/266), alors que le commissaire Treviranus est, lui, convaincu que le meurtre initial du rabbin est la conséquence d’une méprise, il succombe d’avoir déchiffré une énigme qui n’est qu’un faux-semblant : une fiction.
Pastichant le modèle du récit de détection, la nouvelle de Borges renverse la supériorité du détective sur le policier, héritée de Poe, tout en moquant la conviction de toute-puissance des pensées qui sous-tend ce récit, et qui était déjà mise à mal chez Mérimée par l’échec, double, de l’enquête. Elle démontre de plus que résoudre une énigme n’est pas seulement en déchiffrer le code, mais aussi en comprendre les fins, c’est-à-dire le sens.
Dans ces trois récits, le moteur de l’action est le déchiffrement de l’énigme, et le désir de savoir, qui anime le personnage dans son enquête, trouve un écho dans la curiosité du lecteur, qui n’en sait jamais plus que lui. Les Amours de Psiché et de Cupidon14 (1669) de Jean de La Fontaine propose une configuration différente : l’énigme couvre la première partie du conte seulement, puisque la question de l’identité du mari de Psiché est posée dans les premières pages et trouve sa solution à son terme, quand elle l’éclaire de sa torche. L’identité du « Monstre son époux » (I, 73) n’est toutefois une énigme que pour Psiché, puisque le lecteur, comme dans Oidípous týrannos, la connaît d’emblée. Pourtant, comme dans les récits précédemment évoqués, mais de façon plus subreptice, une énigme en cache une autre : l’oracle, qui est une forme privilégiée de l’obliquité depuis l’Antiquité. La Fontaine dit pourtant regretter sa trop grande transparence, il manquerait d’ambiguïté et prédirait en termes trop clairs la véritable identité de Cupidon. Une étude plus attentive, à laquelle invite une remarque de Psiché15, permet pourtant d’en douter : la transparence de l’oracle est un leurre. Symétriquement, la scène de reconnaissance de l’identité de Cupidon est plus complexe qu’il n’y paraît. Dans le conte de La Fontaine, l’ambiguïté de l’oracle vient donc contaminer le récit, et l’énigme se déplace subrepticement de la fiction vers l’interprétation du récit.
Dans The Castle of Otranto16 (1764) d’Horace Walpole, l’énigme a, comme chez La Fontaine, la forme d’une prophétie : le roi actuel, Manfred, perdra son trône le jour où le propriétaire légitime sera devenu trop grand pour l’habiter. Mais cette énigme est d’emblée redoublée par une seconde interrogation, qui s’exprime par le biais de la vox populi : quel lien peut bien s’établir entre cette prophétie et la décision prise par Manfred de marier au plus tôt son fils, Conrad ? Le roman s’ouvre donc à la fois sur une prophétie mystérieuse et sur une énigme adressée au lecteur, l’invitant à découvrir le lien qui unit prophétie et mariage. Si l’urgence du mariage s’explique, au terme du récit, par une seconde prophétie, tenue secrète jusqu’alors par Manfred, la deuxième énigme, celle du lien entre les deux événements initiaux, ne trouve pas de réponse dans la fiction. La faible activité herméneutique des personnages dans la fiction est donc compensée par l’invitation faite au lecteur de déchiffrer une énigme narrative. The Castle of Otranto explicite ainsi la leçon de La Fontaine, et confirme que l’interprétation dans la fiction ouvre sur l’interprétation de la fiction.
Un premier constat s’impose : l’énigme est rarement unique dans les récits, où elle est souvent dédoublée. C’est dire aussi qu’elle occupe une fonction stratégique dans la composition des récits, qu’elle structure, explicitement (Poe), ou implicitement (Mérimée, Walpole, La Fontaine). Le roman de Jean Paul paru en 1811, Leben Fibels17, confirme à la fois la dimension structurante de l’énigme, et sa fonction réflexive et métafictionnelle. Le récit étant moins connu que les récits évoqués ci-dessus, nous en proposons une présentation plus détaillée, que la complexité de son agencement exige par ailleurs.
Parodie de biographies célèbres, des Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque aux biographies de Kant parues en 1804, Leben Fibels, des Verfassers der Bienrodischen Fibel (La Vie de Fibel, auteur de l’abécédaire bienrodien) est l’éloge paradoxal, et héroï-comique, d’un « nain de ménage [Haushaltungs-Zwerg] » élevé à la dignité d’un « héros de roman [Bücher-Held] » (X, 116 ; 74).
L’entreprise de Jean Paul est fondée sur une hypothèse loufoque, en forme d’antonomase renversée : l’auteur de l’abécédaire, ouvrage qui se dit en allemand die Fibel, n’est pas celui que l’on croit, le Konrektor Bienrod de Wernigerode, mais un certain Gotthelf Fibel, sur les traces duquel le narrateur se lance.
Le roman est agencé selon le dispositif d’une biographie au second degré, le narrateur tentant de collecter les fragments dispersés d’une première biographie, rédigée autrefois par un proche de Fibel, Pelz, pour flatter sa vanité et se rendre indispensable auprès de lui. Pelz invente même de rédiger en temps réel la biographie de Fibel en notant au jour le jour, aidé par deux acolytes, Pompier et Fuhrmann, tous ses faits et gestes. La biographie s’enfle ainsi jusqu’à quarante volumes, avant que le projet soit interrompu par la mort de Pelz, et aussi par une énigmatique dissension entre le biographe et l’objet de son étude.
La biographie se perd ensuite : les volumes sont démembrés, les feuillets, dispersés. Mais les reliures, précieuses, sont récupérées : c’est l’une d’elles, encore partiellement garnie et retrouvée chez un marchand juif, qui met le narrateur, qui a pour nom Jean Paul, sur la piste de la biographie de Pelz. Parcourant le pays, il rassemble les feuillets qui ont été détournés de leur fonction première : ils servent à envelopper les denrées alimentaires, à construire des cerfs-volants, à calfeutrer les fenêtres brisées ou encore à dessiner des patrons de tailleur. Certains sont même destinés à un usage encore moins noble, que le narrateur, et le lecteur, découvrent tardivement.
Satirique, le roman moque l’infatuation de Fibel, qui se prend non seulement pour un écrivain, mais encore pour un écrivain digne d’être l’objet d’une biographie d’homme célèbre. Leben Fibels est donc un roman à la fois comique et critique, placé sous l’influence de Cervantes et de Sterne18, mais aussi de Swift et de Grimmelshausen. Il change pourtant de ton sur la fin, quand Jean Paul prend le relais de Pelz, disparu, pour mener l’enquête et connaître les circonstances de la fin de Fibel. Or celui dont la trace s’était perdue, et que tous pensaient mort, est bien vivant, installé dans le village de Bienenroda et âgé à présent de cent-vingt-cinq ans. À l’âge canonique de cent ans, Fibel a connu une révélation en forme de conversion et mène désormais une vie solitaire, entouré de ses animaux. Le roman change de registre, et de comique devient pathétique et apologétique, en apparence du moins.
Leben Fibels est donc le récit d’une enquête qui porte tout d’abord sur le véritable auteur de l’abécédaire saxon, puis sur le destin de la biographie en quarante volumes, enfin sur celui de son auteur. Mais il est aussi une interrogation sur la signification de l’alphabet illustré qui associe lettres, mots, gravures et distiques qui mettent les mots en situation. Comparé à un recueil de « hiéroglyphes [Hieroglyphen]19 », l’abécédaire suscite les interrogations des personnages et du narrateur qui multiplient les hypothèses sur les motifs qui ont présidé au choix des illustrations et sur leur signification. L’enquête a donc un quadruple objet : un nom, un livre, un destin, un sens.
L’abécédaire n’est pas seulement un objet de la fiction commenté par les personnages dans la fiction, il est aussi un élément constitutif de la composition du roman puisqu’il est reproduit in extenso dans le livre. Ce dispositif invite donc le lecteur à interroger les modalités d’articulation de l’abécédaire et du roman, et les échos qui les unissent, parallélisme, contrepoint, déplacement. Si l’abécédaire est la matrice de la fiction qui lui emprunte nombre de ses personnages et objets, la fiction, en retour, donne son sens à l’abécédaire en motivant les différentes associations qu’il propose : entre les lettres et les mots, entre les mots et les images, entre les différents vers qui composent les distiques. Il ouvre aussi sur une nouvelle réflexion, qui porte cette fois sur les différentes logiques d’interprétation du livre, représentées dans la fiction sous la forme de deux objets emblématiques : le livre de massepain rouge et le livre de couture, cadeaux que Fibel enfant a reçus de sa mère pour Noël.
Réflexion sur la composition du roman, le roman est enfin une méditation sur le signe, son usage et son interprétation, qui permet de tracer une ligne de partage entre les différents personnages (Fibel, sa femme Drotta, son beau-père, Pelz, le maître d’école, et Jean Paul, le personnage narrateur).
À l’ouverture du roman d’anticipation dystopique de Don DeLillo, Ratner’s Star20 (1976), Billy Twillig, génie précoce des mathématiques fraîchement couronné du prix Nobel, arrive au centre de recherches Field Experiment Number One, qui réunit dans un désert de Chine les meilleurs scientifiques du monde entier. Il est appelé pour décoder un message en provenance de l’étoile de Ratner, qui se compose d’une suite de 101 impulsions interrompues deux fois, composant la série 14-28-57. Dans ce roman, l’énigme est pour la première fois formulée en langage mathématique, confirmant qu’il n’existe que deux possibilités pour décrire l’énigme du monde, « la langue naturelle, et le formalisme mathématique21 » (René Thom).
Exposé dans les premières pages, le message voit sa signification révélée à la fin du roman, et les étapes de son déchiffrement ponctuent le récit. Ce n’est pourtant pas Billy qui déchiffre le message : il n’en comprend le sens que lorsqu’il visite la chambre qu’occupait autrefois Endor, un mathématicien et astrophysicien appelé avant lui pour résoudre l’énigme et qui a quitté le centre peu avant l’arrivée de Billy pour se réfugier dans un trou creusé dans le sol. La résolution de l’énigme initiale ouvre en outre sur une seconde énigme qui ne trouve pas, elle, de solution dans la fiction : une éclipse apocalyptique qu’aucun scientifique n’a anticipée. L’énigme est donc doublement déceptive. Mais l’intérêt pour l’énigme s’est dissipé bien avant. Avec l’arrivée de Robert Hopper Softly, le mentor de Billy, le roman prend une nouvelle direction. Softly réunit autour de lui un groupe restreint de scientifiques, dont Billy, pour mener à bien le projet Logicon, qui vise à inventer un langage purement logique pour communiquer avec la civilisation extraterrestre à l’origine du message. Softly se désintéresse donc du message codé. Son ambition se révèle toutefois doublement vidée de sa substance : parce que le projet Logicon s’enlise peu à peu, et parce que les recherches sur le message montrent que son origine n’est pas extraterrestre. Alors que le projet Logicon bat de l’aile, les scientifiques réunis dans le centre de recherches, qui tient à la fois de la tour de Babel et de la Nef des fous, ne réussissent à s’entendre sur rien, pas même sur le sens des mots. L’impossible communication, la dimension déceptive de l’énigme et l’échec programmé du projet Logicon assonent donc dans ce roman de la crise du langage, qui fait par ailleurs la part belle à l’histoire des mathématiques.
Le Quart Livre22 (1552) de François Rabelais mérite une place à part dans cette présentation parce qu’il réunit toutes les configurations présentes dans les autres récits tout en étant princeps. Il forme à cet égard un diptyque avec le récit qui le précède et dans la continuité duquel il s’inscrit : ayant échoué à obtenir dans le Tiers Livre un avis qui lui permette de décider s’il doit ou non se marier, Panurge, accompagné de Pantagruel et de ses compagnons, décide d’embarquer pour consulter l’oracle de la Dive Bacbuc. Le Quart Livre occupe le temps, suspendu, entre la question et la réponse qui, si elle reste à l’horizon du voyage, ne s’actualise pas dans la fiction.
Le regretté Michel Jeanneret associait étroitement Tiers et Quart Livre en insistant sur la présence d’un même schème : « Dans chacun des deux cycles – les consultations puis les escales en mer –, des épisodes se succèdent, qui obéissent plus ou moins au même scénario : on écoute un avis ou on assiste à un événement, puis on fait une pause pour tâcher de comprendre ce qui vient de se passer. Et comme rien de sûr n’a été acquis, on recommence. […] La structure à deux temps de la plupart des épisodes – le phénomène puis son commentaire – suggère que l’enjeu véritable, n’en déplaise au spécialiste, n’est ni psychologique, ni moral. C’est d’épistémologie qu’il s’agit. Plus précisément : des signes surgissent, des messages peut-être chargés d’un double sens se donnent à lire. Comment traiter ces données23 ? ».
Toutefois, à la différence du Tiers Livre, la variété des configurations qu’offre le Quart Livre fait que le récit ne se limite pas à une série de consultations. En outre, l’opposition de Pantagruel et Panurge y est moins systématique, et la participation des autres compagnons aux débats, plus fréquente. Cette variété démultiplie les possibilités de controverses tout en favorisant la polyphonie du récit. La diversité des signes est aussi plus grande dans le Quart Livre que dans le Tiers Livre, où ils sont avant tout livresques et érudits. Dans le Quart Livre, les compagnons qui parcourent le grand Livre du monde sont confrontés à des phénomènes aussi divers qu’une tempête inattendue, des insulaires qui adorent un portrait, des bruits de bataille en pleine mer, des chausses souillées d’excrément, un paysan réfugié dans un bénitier, des pratiques masochistes, un souverain contrefait, etc. Proposant une diversité de situations et de configurations remarquable, le Quart Livre associe à une réflexion sur les signes et le langage, comme le font aussi Leben Fibels et Ratner’s Star, une réflexion spéculaire sur l’interprétation.
Anachronismes
Une très ancienne légende talmudique rapporte que Moïse aurait demandé à Dieu de lui faire connaître le destin de la Torah qu’il lui avait révélée. Dieu le transporte alors en songe quelque quinze cents ans plus tard, dans l’académie talmudique où enseigne Rabbi Abika, le plus célèbre des Maîtres de la Mishna. Mais Moïse ne comprend rien à l’enseignement de Rabbi Abika, et demande à Dieu : mais de quoi cet homme peut-il bien parler ? Et Dieu de répondre à Moïse : Sache que c’est ta Torah qu’il est en train d’expliquer !
Stéphane Mosès, « Quelques principes de l’herméneutique rabbinique » (2003)
1841 (The Murders in the Rue Morgue), 1837 (La Vénus d’Ille), 1944 (« La muerte y la brujúla »), 1669 (Psiché et Cupidon), 1764 (The Castle of Otranto), 1811 (Leben Fibels), 1976 (Ratner’s Star), 1552 (Quart Livre). L’ordre de succession des récits dans la présentation qui précède indique à la fois que l’étude porte sur un temps long, et que le parcours qui les relie n’est pas chronologique. Huit récits pour quatre siècles, c’est dire également que la ligne qui les unit non seulement zigzague, mais qu’elle est aussi tracée en pointillés, les vides l’emportant sur les pleins. Les récits retenus l’ont été parce qu’ils présentaient un intérêt pour l’étude, ou pour leur originalité, ou simplement par goût. Les absents sont nombreux, inévitablement : Les États et Empires de la lune (Cyrano de Bergerac), Gulliver’s Travel (Jonathan Swift), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), The Minister’s Black Veil (Nathaniel Hawthorne), The Figure in the Carpet (Henry James), Der Prozess (Franz Kafka), Les Gommes (Alain Robbe-Grillet), The Crying of Lot 49 (Thomas Pynchon), et d’autres encore. Mais le propos ne vise pas à l’exhaustivité – à supposer même qu’elle soit possible sur une période aussi longue –, pas plus qu’il ne cherche véritablement à tracer des lignes, ou à reconstituer des lignées, qu’elles soient généalogiques ou archéologiques. Ces dernières proposent certes « beaucoup de continuité, mais peu d’espoir », soit la « découverte fulgurante de l’inespéré24 ». Nous ne nous interdirons donc pas de lire les récits à la lueur de textes ou de pensées postérieurs pour leur poser des questions qu’ils ne se posent pas, sans plus craindre l’anachronisme que Dieu dans l’apologue talmudique – ou Nicole Loraux dans sa pratique d’historienne25. Si les aïeux se reconnaissent parfois dans les pensées de leurs descendants, les descendants permettent parfois d’entendre ce que leurs aïeux donnaient à lire sans le penser. Ainsi le commentaire ne double pas le texte, comme une cotte au mieux taillée, mais il le constitue en l’inventant. Dans l’analyse des textes comme pour l’exégèse rabbinique, le sens de l’œuvre « ne se dévoile pas en dehors de l’interprétation qui le fait apparaître26 ».
Pour autant, il faut préciser que cet anachronisme de principe est plus une délinéarisation chronologique qu’une ignorance de la chronologie. Elle est en outre régulée, ou mieux : pondérée. On peut distinguer quatre types de perspectives dans l’étude des corpus au long cours. Les deux premières sont en miroir. Le relativisme historique découpe et isole l’avant de l’après, et il avance à pas précautionneux dans l’histoire du temps et des idées, mais il méconnaît la complication des temps chère à Daniel Arasse27 ; la scalarisation généalogique ne découpe pas moins l’histoire, mais pour mieux articuler l’avant et l’après : elle invente des moments de passage, de naissance, de transformation, de révolution, etc. La troisième prend le contrepied de la première : la lecture rétrospective lit le passé à la lumière du présent, et ne craint pas le risque double des « rétroprojections abusives28 » (Jean-Marie Schaeffer) et du finalisme téléologique. Enfin, l’approximation en intention postule des tensions entre ce qui n’est plus tout à fait déjà, mais pour un temps quand même encore, et ce qui n’est pas encore, et pourtant déjà présent en germe. Elle est une pensée, non plus de la révolution, mais de la crise, et elle met en question la « vérité », « dont la mère est l’histoire, émule du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l’avenir29 » (Jorge Luis Borges). Ces quatre perspectives se conjuguent dans ce travail, où les manques de chacune d’entre elles sont susceptibles de trouver dans les autres un correctif.
La réflexion s’efforce de répondre à une question double : comment ces fictions signifient-elles ? et que signifient-elles ? Elle relève dans son principe d’une poétique structurale et narrative, qui « disjoint le contigu et rassemble l’éloigné, qui constitue précisément le texte en espace et non en linéarité30 », mais elle fait l’économie de la conviction immanentiste. Elle considère enfin que le sens relève autant de la disposition que de l’invention, et qu’il est donc plus relationnel qu’essentiel.
Elle met tout d’abord en relation des textes éloignés dans le temps et appartenant à des genres divers par la mise au jour des similitudes, des proximités ou des ressemblances qui les relient. Puis elle élargit la perspective en étudiant les modèles herméneutiques qui sous-tendent l’interprétation dans la fiction et de la fiction, et le sens qu’ils prennent quand la fiction les incorpore. Elle ne considère pas pour autant que les textes soient l’expression de leur temps, ou d’idées extérieures au champ littéraire, qu’elles soient philosophiques, religieuses, morales, sociales, mais que la littérature participe de leur construction selon les modalités qui lui sont propres31.
« Trop peu de textes pour trop de siècles », dira-t-on. L’objection est recevable. Mais la perspective n’est pas encyclopédique, elle est typologique : elle propose une classification des récits définie à partir de caractéristiques formelles communes tout en assortissant aux combinatoires reconnues leurs dynamiques sous-jacentes. Elle s’efforce dans le même temps de dégager des formes paradigmatiques, dont certains récits sont des incarnations exemplaires quand d’autres sont des formes mixtes, qui permettent d’étudier les effets de contamination, de recouvrement ou d’hybridation. La critique doit être en outre pondérée par la forme de l’étude qui accorde une place privilégiée aux textes en s’efforçant de satisfaire à deux exigences : un souci d’exhaustivité qui fait que l’arc narratif des récits est embrassé dans son entier pour proposer une lecture d’ensemble de chaque récit, et un souci de minutie, qui promeut de nombreuses lectures de détail – ce que nous appelons microlectures et les Anglo-Saxons, close reading. Les analyses sont ainsi à la fois filées et sédimentées. Filées, car elles couvrent progressivement l’ensemble des récits pour épouser au plus près leurs singularités. Sédimentées, car les lectures et les interprétations successives d’une même singularité constituent l’analyse en strates. Faire un choix plus large de textes aurait ainsi compromis la possibilité de les étudier chacun en détail.
Des choix, et des contraintes, de natures différentes ont pesé dans la définition du corpus. Nous disions que les fictions de l’interprétation étaient nombreuses. Pour autant, celles qui unissent à la fois mise en scène fictionnelle de l’interprétation, mise en abyme de leurs mécanismes de signification et réflexion sur la notion d’interprétation, le sont moins. Deux d’entre elles se sont donc imposées, qui ont également déterminé les bornes chronologiques du corpus : le Quart Livre et Ratner’s Star. Ils ont aussi été choisis en raison de la complexité qui régit l’enchaînement des épisodes dans ces deux récits, qui est un véritable défi à l’analyse de leur composition tant leur lecture est déroutante – la notion de « fiction en archipel » (Quart Livre), chère à Frank Lestringant, en est un des symptômes. Ils invitaient ainsi à une étude approfondie, dont ce travail a été l’occasion.
On retrouve dans Leben Fibels les trois caractéristiques évoquées ci-dessus, mais le roman présente en outre la caractéristique singulière d’être, y compris dans sa présentation matérielle, un livre du livre – un livre sur un livre. En outre, il relève de la pensée et de l’esthétique du romantisme allemand, même si c’est sous la forme de la prise de congé. Selon Anne-Marie Lang et Jean-Luc Nancy, Jean Paul « figure la queue, dispersée, brisée, pulvérisée, de la comète romantique ». Mais ils ajoutent immédiatement : « Ou son miroir déformant, mais aussi grossissant32 ». Or, on sait combien les réflexions du romantisme ont été décisives à la fois pour l’interprétation des textes, antiques et contemporains, et dans la définition des herméneutiques modernes. Enfin, ce récit est un Witz, qui trouve un écho dans le comique de Rabelais et l’ironie de DeLillo. Le vacillement et l’incertitude que la pensée et l’esthétique du trait d’esprit induisent contribuent à renforcer encore la complexité et l’ambiguïté du roman.
Un second groupe de textes est venu s’ajouter au premier, en raison de la solidarité de la forme de l’énigme et du récit de détection. Le texte qui inaugure le genre a donc été retenu, The Murders in the Rue Morgue, ainsi que son double, « La muerte y la brujúla », qui en précise, ironiquement, l’impensé. À la périphérie du genre, la nouvelle de Mérimée, La Vénus d’Ille, a été choisie à la fois parce qu’elle propose une enquête criminelle embryonnaire et parce que celle-ci trouve un écho dans l’enquête épigraphique, où se lit la présence, dans le texte, d’un texte autre, comme dans Leben Fibels. The Castle of Otranto vient compléter cet ensemble : si le récit policier est une évolution du récit énigmatique, ce dernier trouve sa forme naissante, selon Chantal Massol, dans le roman de Walpole.
Un dernier ensemble, qui est plutôt un sous-ensemble, se compose de The Castle of Otranto et des Amours de Psiché et de Cupidon, car ils proposent à l’interprétation des personnages une forme de parole qui n’est pas indifférente dans l’histoire de l’herméneutique : la parole oraculaire.
L’unification du corpus se fait par la présence, souterraine ou explicite, d’un même objet : le monstre. Or, on connaît la solidarité historique entre le monstre, la mantique et les signes. Cette caractéristique commune est un indice supplémentaire de la solidarité des récits, et plaide a priori en faveur de la cohérence du corpus qui les réunit.
La démarche qui a présidé à l’association de ces récits s’est donc développée selon trois temps : un premier ensemble de récits est tout d’abord réuni à partir de caractéristiques communes, qui sont définitoires de la forme la plus complexe, et aussi la plus achevée, de fiction de l’interprétation ; dans un second temps, le corpus est élargi à partir de la prise en compte d’une contrainte générique, qui découle de la nature de son objet et englobe les récits de détection. C’est enfin la reconnaissance de l’importance, dans l’histoire de l’herméneutique, de la parole oraculaire qui motive l’extension dernière, et permet de refermer la boucle : le récit de Rabelais comme le roman de DeLillo mettent en scène des paroles inspirées, prophétiques ou oraculaires.
La première lettre du Nom a été articulée…
La réflexion procède par élargissements successifs. Le premier temps s’attache à l’étude de la fonction de la lettre dans les récits, où elle est un objet littéraire à part entière (1. L’imaginaire de la lettre). La perspective s’étend ensuite progressivement pour s’intéresser au statut des mots, noms propres et noms communs (2. Les harmonies du mot), puis à la réflexion sur le langage et les signes (3. Langages et signes), et enfin à l’interprétation (4. Herméneutique de la fiction).
Le premier chapitre s’intéresse à la lettre comme forme typographique, qui fait l’objet d’une passion particulière dans les récits. L’étude montre qu’elle est en effet un élément essentiel de la signification des récits qui lui donnent sens en l’insérant dans un réseau à la fois phonétique, figural et sémantique. Les voyelles sont les objets privilégiés des différents dispositifs qui concourent à la rendre signifiante, mais les consonnes peuvent aussi faire l’objet d’une mobilisation singulière, comme le montre l’étude du tétragramme JHVH dans la nouvelle de Borges.
Une première typologie est proposée, qui distingue trois régimes d’utilisation de la lettre (graphématique, iconique, diagrammatique), selon qu’elle est une matière sonore qui est disséminée dans l’espace du texte, une forme qui se donne à reconnaître figurativement, ou la représentation abstraite d’un processus qu’elle schématise. Ces trois formes sont paradigmatiques, mais elles peuvent être associées et se cumuler.
Au terme de ce parcours, la solidarité entre fiction de l’interprétation et signifiance de la lettre est interrogée, et une réponse est proposée tout d’abord par un retour sur l’histoire de la lettre, du livre et de l’imprimé, puis par une réflexion plus intrinsèque sur la nature des fictions de l’interprétation et la relation privilégiée qu’elles entretiennent avec le constituant premier de l’écriture, la lettre.
Dans le deuxième chapitre (« Les harmonies du mot »), l’étude s’attache au cratylisme fictionnel, champ d’étude que Gérard Genette indique dans Mimologiques, sous-titré Voyages en Cratylie33, mais qu’il laisse de côté au profit d’une réflexion sur le cratylisme théorique, de Socrate à Bachelard, et non sur ses formes fictionnelles. L’interrogation sur la signification et la motivation des noms est en effet centrale dans les récits où se lisent les réflexions, alternativement sérieuses, cocasses ou ironiques, que les personnages consacrent aux noms de lieux ou de personnages. L’analyse reconnaît que les différentes formes que prend la motivation des noms ressortissent aux deux catégories distinguées dans le Cratyle (la motivation par étymologie et la motivation par paronomase), auxquelles il convient d’ajouter une troisième forme : la motivation par antiphrase. La motivation étymologique n’est pas seulement convoquée dans la fiction, elle est aussi mobilisée dans la narration, où le principe de décomposition des noms devient une matrice signifiante.
L’étude des formes de paronymie permet de reconnaître leur solidarité avec les phénomènes de polysémie et de leur donner sens. Elle sert aussi la reconnaissance d’une quatrième forme de motivation : la motivation par analogie. Le chapitre se conclut par une réflexion générale sur la pensée cratylique en fiction et propose de distinguer deux formes : un cratylisme ironique et un cratylisme mélancolique.
Les premier et deuxième chapitres sont comme les deux parties d’un diptyque, articulées autour d’une interrogation commune : comment des éléments constitutifs du mot, qui sont a priori asignifiants, sont-ils mobilisés par les récits pour faire sens dans l’économie narrative et symbolique ? Ce changement d’échelle, de la lettre au mot, permet aussi de préciser la logique selon laquelle ces éléments s’inscrivent dans un dispositif plus large, où la signification naît de la dissémination des sèmes.
Le troisième chapitre (« Langages et signes ») propose à la fois un resserrement et un élargissement du point de vue. L’étude se restreint à trois récits seulement, le Quart Livre, Leben Fibels et Ratner’s Star, car leur propos s’élargit à une réflexion sur le langage, qui s’incarne dans des personnages emblématiques. Fondée sur la distinction freudienne des trois phases du développement ontogénétique, elle examine dans un premier temps les configurations narratives privilégiées où se lit la relation des personnages au langage. Dans un second temps, une classification des signes est proposée, qui les définit non plus par leur nature, mais par leur usage, et aussi par la relation qu’ils nouent avec le sens et la vérité. Elle s’appuie sur une quadruple distinction (indice, signe, symbole et invention), et précise la nature des relations au monde et aux autres qui sous-tendent leur usage (conviction, croyance, confiance, réflexion).
Le quatrième, et dernier, chapitre (« Herméneutique de la fiction ») s’intéresse aux schèmes herméneutiques qui régulent la signification dans les récits. Trois formes sont décrites : l’allégorie, le figurisme, la concordance. La première s’inscrit dans une triple tradition, herméneutique, rhétorique et théologique, dont l’histoire est retracée avant que sa mobilisation dans les récits soit étudiée. La seconde forme, le figurisme, s’inscrit dans une tradition spécifique, l’exégèse patristique, qui est à la fois une continuation et une inflexion de la réflexion antique sur l’allégorie. Cette forme est importée dans la fiction, ou acclimatée : elle est donc transformée par les textes qui la mobilisent selon des logiques qui sont précisées. La dernière forme, la concordance, mobilise des modèles herméneutiques variés, qui sont habituellement regroupés sous le nom de paradigme indiciaire (Carlo Ginzburg), dont la notion est discutée. Les modalités spécifiques de production du sens selon la concordance, et symétriquement d’interprétation du monde, sont étudiées à partir de l’analyse du récit de détection et de la forme de l’indice, avant d’être étendues aux autres textes. La réflexion se referme sur l’étude d’un objet privilégié, le monstre, qui est le signe par excellence depuis l’Antiquité, et qui permet de ressaisir l’ensemble des récits dans une perspective synthétique pour préciser la singularité de l’herméneutique indicielle, tout en interrogeant la solidarité, historique et philologique, entre mantique, prophétisme et herméneutique.
Ça n’empêche pas d’exister…
Sans spéculer, ni théoriser – pour un peu j’aurais dit fantasmer – métapsychologiquement, on n’avance pas ici d’un pas.
Résumé des informations
- Pages
- 662
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9782875749925
- ISBN (ePUB)
- 9782875749932
- ISBN (Broché)
- 9782875749918
- DOI
- 10.3726/b21706
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Septembre)
- Mots Clés (Keywords)
- Rabelais La Fontaine Walpole Jean Paul Mérimée Poe Borges DeLillo poétique narratologie Bible herméneutique fiction théorie allégorie figurisme modernisme close reading
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 662 p., 18 ill. n/b, 3 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG